
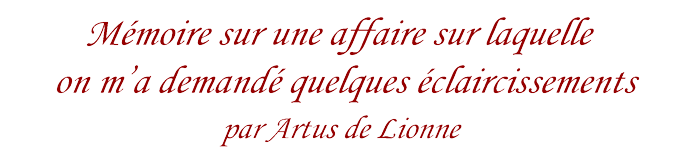
Phaulkon, qui voyait monter le mécontentement des dignitaires et des bonzes entraînés par Phetracha, avait instamment prié de Desfarges de monter à Louvo avec un détachement pour mettre un terme à la rébellion naissante. Le 14 avril 1688, le général partit de Bangkok à la tête d'une petite centaine d'hommes de troupe. Arrivé à Ayutthaya le lendemain, il s'entretint avec les missionnaires Artus de Lionne et Louis Laneau, appuyés par Véret, le directeur du comptoir de la Compagnie des Indes, qui le dissuadèrent d'aller plus loin, assurant que le roi était mort, que le royaume entier était sous les armes, et que le détachement allait tomber dans un piège. Ces avis alarmiste convainquirent Desfarges de s'en retourner à Bangkok, abandonnant ainsi Phaulkon à son sort. Outre qu'elle fut considérée comme une lâcheté, cette décision marqua peut-être le tournant des événements, même si rien ne dit qu'une centaine de soldats, même entraînés, disciplinés et bien armés, auraient pu modifier le cours des choses dans un royaume où la contestation couvait depuis longtemps.
De retour en France, l'abbé de Lionne fut violemment critiqué, notamment par les jésuites, pour ses conseils qui avaient incité Desfarges à abandonner M. Constance et à causer la déroute des Français. Dans une lettre du 11 février 1692, M. de Brisacier, le directeur du séminaire des Missions Étrangères de Paris, écrivait à l'abbé : Il y a toujours une chose qui me fait beaucoup souffrir, et dont je vous supplie de faire le sacrifice avec moi c'est que le père Verjus publie partout à ceux qui veulent l'entendre, même à nos meilleurs amis (témoin M. de Laon qui me le disait chez nous il y a aujourd'hui huit jours), que c'est vous qui par le conseil que vous avez donné à M. Desfarges avez été cause de la mort de M. Constance, du malheur des Français et du renversement des affaires de la religion à Siam. Je ne vous mande pas ceci pour vous aigrir, mais pour vous donner occasion de pratiquer la vertu d'une manière héroïque en aimant sincèrement ceux qui, tout revenus qu'ils paraissent être à notre égard de bien des choses, ne nous ménagent pas assez, à mon sens, en beaucoup d'autres (dans lesquelles il plaît à Dieu d'exercer notre patience), quoique nous tâchions de notre part d'user de tous les ménagements imaginables pour ne pas leur donner lieu de se plaindre.
L'abbé de Lionne rédigea pour se justifier la longue plaidoirie que nous reproduisons ici :
4 janvier 1692
L'affaire est sur le conseil que M. de Métellopolis et moi avons donné à M. Desfarges de ne pas monter à Louvo, ce qu'on prétend être la cause de tous les malheurs de Siam.
Je rapporterai ici avec une très grande exactitude comme la chose se passa au jour du jeudi 15 avril 1688. M. Desfarges montant à Louvo avec 70 soldats passa à la faiturie française, où il trouva M. Véret, chef du comptoir, qui lui témoigna ouvertement qu'il était surpris du voyage qu'il entreprenait dans l'état où étaient les choses, et qu'il craignait extrêmement qu'il ne s'en suivit la perte de tous les Français présents dans le royaume. Ayant assez longtemps discouru sur cette matière, ils montèrent l'un et l'autre à notre séminaire pour nous demander à M. de Métellopolis et à moi notre avis sur le dit voyage. Nous ne crûmes pas dans cette occasion, M. de Métellopolis et moi, devoir refuser de dire ingénument à M. Desfarges ce que nous pensions ; sur quoi il paraît qu'on nos désapprouve de deux choses : 1° d'avoir dit notre avis sur une matière si délicate ; 2° d'avoir été du sentiment dont nous avons été.
Pourquoi les évêques ont dit leur avis à M. Desfarges.
Voici nos raisons sur ce premier point :
C'est un officier de Sa Majesté, un maréchal de camp chargé par le roi du gouvernement de tous les Français, qui nous demande notre avis : qui nous le demande dans l'affaire du monde la plus importante et pour la religion et pour la nation, ne s'agissant pas moins que de la vie de tous les Français, et même de celle de tous les chrétiens ; qui nous le demande à M. de Métellopolis, vicaire apostolique de Siam, et par là père de tous les chrétiens de ce royaume, et à moi qui, quoique très indigne, était élu son coadjuteur ; qui nous le demande conformément aux ordres exprès qu'il avait du roi d'en user ainsi dans les matières de conséquence, ordre que quelque temps auparavant il m'avait montré pour surmonter par-là l'extrême répugnance qu'il avait trouvée en moi de donner avis sur les matières qui ne regardent pas directement ma profession. J'avoue que, si dans cette occasion nous eussions refusé de lui dire ce que nous pensions devant Dieu de ce voyage, nous eussions cru pécher grièvement contre la charité, et contre notre devoir, et contre les ordres mêmes du roi.
Car si nous eussions refusé de lui dire notre avis, je demande ce que nous aurions pu répondre à ceux qui nous en auraient voulu faire un crime devant Dieu et devant les hommes, et en particulier devant le roi. M. Desfarges n'étant que depuis peu de temps à Siam et ne sachant pas un seul mot de la langue ne pouvait connaître par lui-même l'état des choses. Nous, missionnaires, étions les seuls Français qui savions la langue et qui, par les devoirs de notre ministère, étions continuellement mêlés aux Siamois, pratiquant avec eux non par interprète, mais par nous-mêmes. M. de Métellopolis avait une expérience de 25 ans du royaume de Siam ; j'en avais une de plusieurs années ; nos autres missionnaires qui étaient appliqués à la mission de Siam avaient aussi beaucoup de connaissance de l'état des choses et avaient des Siamois fort affidés qui leur rendaient compte d'une partie de ce qui se passait. Et ce qui fait voir, ce me semble, évidemment combien nous étions informés du véritable état du royaume, c'est que l'année précédente, au départ de MM. de La Loubère et Céberet, nous avions écrit en Europe qu'il était probable qu'au retour des vaisseaux français, on trouverait tous les Français massacrés, et Phetracha roi de Siam. Je doute fort que M. Constance et ceux qui ne voyaient que par ses yeux eussent mandé la même chose.
M. Desfarges se trouve dans la conjecture du monde la plus triste, la plus embarrassante, et de la plus grande conséquence qu'on puisse imaginer, puisque, comme je l'ai dit, il ne s'agissait pas moins que de la vie de tous les Français.
En cet état, il vient chez nous et nous demande notre avis, après nous avoir fait connaître qu'il avait ordre du roi d'en user ainsi en de semblables occasions, et par une suite nécessaire et évidente, que c'est l'intention du roi que nous le donnions. Si dans ces circonstances, sous le seul prétexte qu'étant des affaires séculières cela ne nous regardait pas, comme si ce qui regardait la vie des Français et des chrétiens nous devait être indifférent, nous eussions eu la dureté de ne lui vouloir pas seulement dire notre avis, et que, soit de lui-même, et par le conseil de M. Véret qui avait déjà donné le sien, il eût fait ce qu'il a fait, soit qu'il eût pris l'autre parti, qui était de monter à Louvo, il fût tombé, lui et tous les Français dans les pièges des Siamois, et je le tiens indubitable, je demande si ont eût loué notre procédé.
S'il y a eu quelque bonne raison qui dût en ces circonstances nous empêcher de dire notre avis, j'avoue franchement que je n'ai pas eu assez de pénétration d'esprit pour la découvrir ; et peut-être que, si ceux qu'on dit nous accuser d'avoir donné notre avis n'avaient jamais donné le leur sur des choses dont ils n'avaient presque aucune connaissance, les choses n'eussent pas tourné comme elles ont tourné. Quant à moi, je puis dire avec vérité que si, dans tout le temps que je me suis trouvé avec M. Desfarges, il a pu avoir en quelque chose à se plaindre de moi, c'est bien plutôt sur la trop grande répugnance à lui donner conseil qu'il a presque toujours trouvée en moi que sur un trop grand empressement à lui en donner.
Je me suis étendu là-dessus, parce qu'il me semble que ce dont on nous pourrait accuser, M. de Métellopolis et moi, regarde particulièrement ce premier point beaucoup plus que le second.
Pourquoi les évêques ont donné à Desfarges l'avis de ne pas aller à Louvo.
J'en viens présentement au second point, et l'on jugera si devant dire notre avis, nous avons dû le donner tel que nous l'avons donné, M. de Métellopolis et moi, j'y joins aussi M. Véret.
Je vais rapporter comme la chose se passa : M. Desfarges et M. Véret arrivant à notre séminaire trouvèrent M. de Métellopolis occupé à la cérémonie des saintes huiles. J'étais déjà vêtu des habits sacerdotaux pour y assister, lorsque M. Véret me vint faire les dernière instances d'aller parler à M. Desfarges pour une affaire, disait-il, de la dernière conséquence. M'étant mis en état de leur parler, nous eûmes entre nous trois un assez long entretien. M. Véret me racontant la conversation qu'il avait eue chez lui avec M. Desfarges, lui redit en ma présence diverses raisons très fortes et qui me paraissaient de très bon sens, pour le dissuader de faire le voyage de Louvo, auxquelles M. Desfarges ne lui répondit autre chose sinon que s'il ne montait pas, il se brouillerait avec M. Constance, duquel il avait besoin pour achever les fortifications de Bangkok. Quant à moi, je lui rapportai ce que tout ce que nous étions de missionnaires avions appris de divers endroits sur l'état présent des affaires. Je me crus même obligé de lui faire connaître diverses raisons qui pouvaient lui marquer le péril du voyage qu'il entreprenait, étant toujours très bon qu'un homme qui est chargé d'une affaire en ait le plus de connaissance qu'il est possible, cela lui pouvant servir pour prendre diverses précautions. Cependant, je ne voulus pas m'avancer encore pour lors à lui donner aucun avis déterminé, me contentant de lui dire que je ne savais pas les raisons qu'il avait d'entreprendre ce voyage ni les mesures qu'il avait prises avec M. Constance, et qu'il me paraissait seulement qu'il fallait qu'il en eût de bien fortes pour faire prudemment ce voyage dans la conjoncture présente.
M. Desfarges qui, par l'extrême confiance qu'il avait eue en M. Constance, ne savait des choses que ce qu'il lui en avait voulu faire entendre et qui commençait à les voir bien différentes de ce qu'il avait pensé, se trouva dans un extrême embarras, d'autant plus qu'il ne nous avait point encore déclaré le véritable sujet de son voyage sur lequel il avait promis un grand secret à M. Constance. Enfin, étant encore en doute du parti qu'il prendrait, et M. de Métellopolis nous étant venu joindre, il se résolut de nous découvrir, à M. de Métellopolis, à M. Véret et à moi, ce qu'il nous avait caché jusqu'alors, exigeant de nous le secret et que nous lui donnassions après cela notre avis sur ce qu'il y avait à faire. Il nous dit qu'en partant de Louvo, où il était allé faire un tour lui seul quelque temps auparavant, M. Constance lui avait dit que le roi se trouvant fort malade l'avait fait appeler avec Phetracha et Phra Pi, son fils adoptif, et leur avait dit qu'il craignait extrêmement qu'après sa mort ses deux frères qui ne l'aimaient pas ne fissent déshonneur à son corps ; et que Phetracha et Phra Pi lui avaient promis de l'empêcher et de faire rendre à son corps tous les honneurs qu'on avait toujours rendus aux rois ses prédécesseurs ; que pour cela, dès que le roi serait mort, ils devaient s'enfermer dans le palais et y faire faire les funérailles du roi, mais qu'après cela, ils avaient résolu de piller les trésors de Louvo et de monter chacun sur un éléphant de guerre et de s'enfuir hors du royaume, car ils étaient en mauvais terme avec le prince, Phra Pi pour avoir une fois battu le prince par ordre du roi, et Phetracha pour s'être brouillé avec le même prince à l'occasion d'une de ses sœurs, petite femme du roi que le prince avait débauchée. M. Constance ajoutait que l'un et l'autre l'exhortaient à entrer dans le même dessein, lui disant que le prince ne l'aimait pas, à quoi il témoignait acquiescer étant avec eux ; mais que, cependant, le voyage de M. Desfarges avec ses troupes à Louvo était pour les empêcher de réussir dans leur entreprise ; que M. Constance, pour avoir occasion de procurer ce voyage de M. Desfarges avec des troupes à Louvo, avait représenté au roi qu'il n'était pas de la dignité de M. Desfarges d'y être seul, et que le roi avait répondu qu'il pouvait y venir avec le nombre de gens qu'il voudrait. Enfin que M. Desfarges étant à Louvo devait entrer dans le palais, se saisir des trésors du roi, prendre Phetracha et Phra Pi, et après s'en être assurés, inviter le second frère du roi, car le premier étant impotent cédait son droit à venir prendre possession du palais, ce qui était, disait-il, rendre un service important à ce prince et l'affectionnerait extrêmement aux Français étant une fois sur le trône.
C'était là le sujet du voyage de M. Desfarges, et c'est le système sur lequel nous avons donné notre avis, et sur lequel il faut se fonder pour juger si l'avis était bon ou non, ce que je fais spécialement remarquer, parce que depuis j'ai ouï parler certaines personnes qui prétendaient que les choses n'étaient pas ainsi. Mais c'est un procès qui peut être entre ces personnes et M. Desfarges, et qui ne nous regarde point, puisque c'est ici le cas sur lequel M. Desfarges nous consulta, ce que j'attesterai quand on voudra.
Je dirai même ici que, dans la perplexité où était alors M. Desfarges sur le parti qu'il devait prendre, il me paraît qu'il était entièrement hors d'état de nous rien déguiser, et bien moins encore d'inventer ce que je viens de rapporter, outre que c'était lui qui avait le plus d'intérêt de nous exposer fidèlement toutes choses.
M. Desfarges nous ayant déclaré le sujet de son voyage, nous lui dîmes de notre côté ce que nous savions de l'état des choses. Il savait déjà que le roi était malade, et nous lui apprîmes qu'il courait un bruit public de sa mort, qui paraissait d'autant plus vraisemblable que les Siamois, à qui dans un autre temps c'eût été un crime capital d'en parler, le disaient hautement. Mais qu'il fût mort ou non, étant à l'extrémité et n'en pouvant pas sortir, la chose revenait au même, d'autant plus que nous avions une preuve absolument certaine qu'il ne gouvernait plus par lui-même, savoir que les deux princes ses frères, qu'il avait tenus jusqu'alors extrêmement serrés et à qui il n'était pas permis de donner audience, ni aux mandarins de les voir, sous peine de mort pour les uns et pour les autres, étaient à Siam, donnant tous les jours audience aux mandarins : que plusieurs des nations étrangères, Chinois, Cochinchinois et autres qui étaient à Siam, avaient déjà été donner leurs noms aux princes en signe de fidélité. Nous savions certainement que M. Constance n'avait aucune habitude auprès de ces princes. Il y avait déjà du temps que nous savions que son crédit était notablement diminué, quoiqu'il tâchât de le cacher aux Français avec lesquels ils agissait toujours avec les mêmes airs de hauteur qu'auparavant ; que les Siamois ne faisaient plus de compte de ses ordres, ce que quelques-uns de nos missionnaires avaient particulièrement reconnu à Louvo et à Siam, et cela ne pouvait être autrement, car comme il était universellement haï de tout le royaume et que le roi, par la faveur duquel il s'était élevé, était à l'extrémité et ne gouvernait plus, on ne le regardait plus que comme un homme dont la fortune était entièrement ruinée. Il avait déjà même couru beaucoup de bruits qu'on l'allait arrêter et l'on n'attendait que le moment qu'on le ferait. Il est constant qu'en ce temps-là il ne parlait plus que rarement au roi, qu'il n'entrait presque plus au palais que dans les premières salles où s'assemblaient des mandarins de dehors et dans la salle des médecins où l'on envoyait quelquefois quérir, pour servir d'interprète, un de nos missionnaires qui donnait des remèdes au roi. Le roi même lui avait fait dire de se défaire de ses charges, lui conseillant de se retirer, n'y ayant pas de sûreté pour lui, le parti de ses ennemis étant trop fort. Un des plus grands mandarins le lui avait dit même en présence de M. Paumard, un de nos missionnaires.
Il était encore certain que tout le royaume était en armes. Tous les jours on voyait monter à Louvo des gens armés ; tout le chemin de Siam à Louvo en était plein. Il n'y avait pas jusqu'à la plus vile populace et jusqu'aux rameurs de balon, qui ne portassent des armes, chose inouïe dans le royaume, si ce n'est dans un temps de révolte ou de trouble extraordinaire ; enfin, il était constant qu'on répandait dans le royaume des bruits désavantageux contre les Français pour les rendre plus odieux. On les accusait publiquement de vouloir envahir le royaume, ce qui se confirmait, parce que, dès que M. Desfarges avait paru près de Siam, les femmes qui tenaient le marché près de la ville et tout le peuple avaient pris l'alarme et s'étaient enfui comme à la vue d'un ennemi déclaré. Enfin l'on avait redoublé les gardes pour empêcher, disait-on, que les Français ne pillassent le palais de Siam.
Au milieu de cet armement général de tout le royaume, on distinguait deux partis : celui des princes, qui était sans comparaison le plus fort, et celui de Phra Pi. Phetracha s'était déclaré pour le premier, car le moyen dont il s'est servi pour parvenir à la couronne, et qui lui avait attiré généralement tous les mandarins, avait été de se déclarer ouvertement pour les princes à qui il disait qu'on voulait ravir le trône. Les choses étant dans cet état, et M. Desfarges exigeant de nous que nous lui donnassions notre avis, nous examinâmes ce qui paraissait pour lui de plus à propos, ou de se retirer à Bangkok avec le peu de soldats qu'il avait, ou de continuer son voyage à Louvo.
Tout ce qui pouvait porter M. Desfarges à monter à Louvo se réduisait au prétendu service qu'il espérait rendre aux deux princes, frères du roi, en empêchant Phetracha et Phra Pi de piller le trésor de Siam et de s'enfuir, puisque c'était là tout le sujet du dit voyage. De l'autre côté, voici les principales raisons qui étaient contre ce voyage, et paraissaient devoir engager M. Desfarges à s'en retourner à Bangkok :
En retournant à Bangkok, il faisait par cette retraite tout ce qui était en lui pour détruire les bruits désavantageux qui couraient contre les Français ; il se mettait hors de danger d'entrer dans aucun parti qui eût du dessous dans la suite ; il pourvoyait autant qu'il était en lui à la sûreté de Bangkok, qui était le principal intérêt que le roi pût avoir dans le royaume de Siam.
En conservant Bangkok, il se mettait en état d'être considérable au nouveau roi qu'il ne devait pas, ce semble, craindre le devoir venir attaquer, puisqu'il ne donnait aucun sujet de se plaindre de lui. Il ne pouvait continuer son voyage à Louvo sans laisser Bangkok et les Français qui y étaient restés absolument hors de défense, et sans s'exposer lui-même et ses 70 soldats à un danger évident de périr. C'était une chose facile à Phetracha de le faire tuer sur les chemins avant même que d'arriver à Louvo, sans que toute sa vigilance et son courage l'en pussent garantir. Ils étaient séparés dans divers balons qu'ils ne savaient pas conduire eux-mêmes, dans un pays qu'ils ne connaissaient point, où ils étaient obligés de se fier à ceux qui les conduisaient et où ils n'avaient de vivre que ce qu'on leur en donnait à chaque repas. Si, lorsque les Français sont sortis de Siam tous ensemble, avec trois vaisseaux, dans un temps où l'on craignait tout de la perfidie des Siamois et de la noirceur de leurs cœurs dont ils avaient pour lors donné tant de preuves, ces derniers ont pu trouver moyen de retenir une quarantaine de soldats ou officiers, beaucoup de pièces de canons, en séparant les balons des vaisseaux, combien leur eût-il été plus facile de disperser les balons où étaient ces 70 soldats, dans un temps où ils ne se défiaient de rien et ne supposaient avoir aucun ennemi.
Étant même arrivés à Louvo, il était facile à Phetracha de les y faire périr sans même en venir à une force ouverte et à un combat, et cela soit en les faisant brûler la nuit dans les maisons de bambous qu'on leur avait préparées hors de la ville, comme on avait fait environ un an auparavant à Mergui aux Anglais qui étaient à peu près en même nombre et qui avaient déclaré qu'ils venaient pour faire la guerre si on ne les satisfaisait pas, soit en faisant appeler au palais M. Desfarges et les principaux officiers de la part du roi, ce que l'on n'aurait pu refuser, et les y arrêtant comme on a fait depuis à M. Constance et aux officiers français qui l'accompagnaient ; ensuite de quoi, il n'aurait eu aucune difficulté de se rendre maître des soldats. Il y a même bien de l'apparence que Phetracha, qui observait exactement tous les mouvements des Français, avait déjà disposé toute choses pour les prendre dans ses pièges, et qu'il souhaitait fort que les Français montassent ; car quoique le bruit qu'on allait arrêter M. Constance courût depuis longtemps, il ne l'a néanmoins fait arrêter que lorsqu'il a perdu toute espérance d'avoir les Français par son moyen.
Ce qui nous confirme dans cette pensée, c'est que depuis la prise de M. Constance, il n'a jamais cessé un moment de chercher d'autres moyens de les y faire monter, ce qui prouve que, conformément aux dépositions des otages, Phetracha n'était nullement fâché que les Français montassent à Louvo et qu'il était hors d'état d'en rien craindre.
D'ailleurs, on avait tout lieu de soupçonner M. Constance de mauvaise foi dans ce qu'il avait dit à M. Desfarges pour le sujet de son voyage à Louvo ; car quelle apparence que Phetracha, qu'on voyait ne rien omettre pour rendre sont parti le plus fort, comme il y est enfin parvenu, voulût se sauver hors du royaume sur un éléphant ? Comment M. Constance pouvait-il croire une impertinence comme celle-là ? Et ne le croyant pas, pourquoi la vouloir faire croire à M. Desfarges ? Comment se pourrait-on fier d'ailleurs à un homme tel que M. Constance, et qui avait déjà donné tant de marques de sa mauvaise foi, surtout en cette rencontre où il disait des choses qui avaient si fort le caractère de fausseté, et qui étaient en effet fausses comme la suite l'a fait voir. Mais ce qui paraissait le plus convaincant, et même évident contre ce voyage, c'est que, quand bien même M. Constance eût dit vrai en tout, ce voyage à Louvo étant l'entreprise du monde la plus hasardeuse se trouvait en même temps la plus inutile. Je ne demande d'attention que pour ces deux lignes.
M. Constance disait que Phetracha et Phra Pi voulaient piller le palais de Louvo et s'enfuir ensuite hors du royaume sur des éléphants de guerre. Quel préjudice en revenait aux Français pour s'exposer à tant de périls afin de l'empêcher ? Quand même M. Desfarges aurait pu réussir à s'emparer des prétendus trésors de Louvo, ce que je conçois comme l'entreprise du monde la plus chimérique, aurait-il dû le vouloir ? N'aurait-ce pas été la chose du monde la plus infâme devant Dieu et devant les hommes à M. Desfarges de s'en aller, sans aucune autorisation légitime et sans l'aveu du roi et des princes, s'emparer des trésors du palais seulement parce que cela paraissait à propos à M. Constance ? Quand il eût réussi, eût-il été bien sûr d'empêcher le pillage ? Quand il l'eût empêché, aurait-il empêché tout ce qu'on aurait publié contre les Français ? Était-il permis à M. Constance de faire de pareilles entreprises, même sous prétexte du bien de l'État et de la religion ?
La seule utilité qu'on y pouvait voir n'était que pour se gagner par là l'affection des princes, et il y avait un moyen plus honnête, plus efficace, sans aucun danger, qui était que M. Desfarges allât lui-même offrir ses services aux princes qui étaient à Siam. Cela leur eût été bien plus agréable et eût bien mieux fait connaître aux peuples la disposition des Français que d'aller de sa propre autorité et à leur insu s'emparer des trésors de Louvo.
Voilà nos principales raisons contre ce voyage de Louvo, et qui firent que M. Desfarges exigeant de nous que nous lui donnassions notre avis, nous crûmes lui devoir dire qu'il nous paraissait qu'en ces circonstances, il n'était pas à propos qu'il y montât et qu'il valait mieux écrire à M. Constance pour lui demander encore plus en détail le véritable état des choses, des nouvelles de la vie ou de la mort du roi de Siam, lui marquer les raisons qu'il avait eues de suspendre son voyage, et de le prier de venir jusqu'à Siam où il l'attendrait, afin de conférer ensemble.
(Launay, Histoire de la Mission de Siam, 1920, I, pp. 208 et suiv.)


10 mai 2018
