

Ce chapitre n'aurait pas été complet sans les pages des Mémoires pour servir à l'histoire de Louis XIV consacrées à l'ambassade de Siam. L'ouvrage parut en 1727, trois ans après la mort de son auteur. Est-il vrai, comme l'affirme François-Denis Camusat dans sa préface, que l'abbé les avait rédigés pour sa satisfaction particulière et ne croyait pas autrement qu'ils dussent jamais êtres imprimés ? Quoi qu'il en soit, par prudence, il indique clairement qu'il ne désirait pas les voir publier de son vivant. Je déclare d'abord que ce que je vais écrire demeurera pendant ma vie dans l'obscurité de mon cabinet. Une précaution qui n'était pas superflue alors que l'auteur promettait de coucher sur le papier tout ce qu'il savait de plus secret et de plus vrai, et qui se vantait d'en savoir beaucoup.
Le ton est ici bien différent de celui du Journal, les traits sont plus incisifs, les portraits plus rugueux. Le père Tachard ? Brossé sans complaisance en quelques mots : Un esprit doux, souple, rampant, et pourtant hardi, pour ne pas dire téméraire. Phaulkon ? Une face lumineuse : Libéral, magnifique, intrépide, plein de grandes idées, mais aussi une face sombre : Fier, cruel, impitoyable, d’une ambition démesurée. Quant au chevalier de Chaumont, il est bon homme, homme de bien, de qualité, mais il ne sait pas la géométrie. Bref, pour qui sait lire entre les lignes, un brave imbécile. Et l'abbé confirme ce qu'on avait déjà discerné dans le Mémoire du 1er janvier 1686 écrit à bord de l'Oiseau : pénétration, lucidité, esprit critique acéré, il n'avait rien du naïf bon enfant, crédule, éternel optimiste, voire un peu benêt qu'il affectait parfois de paraître dans son Journal.
Le passage consacré à l'ambassade de Siam se trouve dans le second volume des Mémoires, publié à Utrecht par Wan-de-Vater en 1727, pages 33 à 59. Nous n'avons pas reproduis les harangues de congé des ambassadeurs siamois, qu'on trouvera dans le Mercure galant de janvier 1687 à la page 4ème partie du Voyage des ambassadeurs.
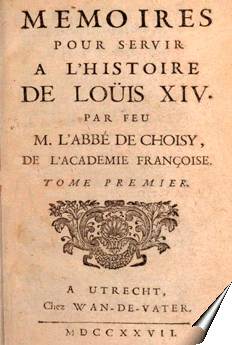
Me voici arrivé à une affaire où l'on me pardonnera bien si je m'étends plus que de coutume, c'est l'affaire de Siam. Elle m'a passé par les mains, je marquerai beaucoup de petites particularités fort ignorées du public, je tâcherai même de ne rien dire de ce qui est dans mon Journal. Je proteste que j'ai toujours dit vrai, mais que je n'ai pas toujours dit tout ce que je savais. Or, dans ces Mémoires-ci, je ne garderai point de mesures, et dirai tout sans déguisement.
J’étais tranquille dans le séminaire des Missions Étrangères, lorsque Bergeret (1), premier commis de M. de Croissy, et mon ancien ami, me vint voir. Il me conta dans la conversation qu’il était venu des mandarins indiens, et qu’on parlait d’envoyer un ambassadeur au roi de Siam pour lui proposer de se faire chrétien, qu’il y avait beaucoup de dispositions, et que c’était là un emploi digne d’un ecclésiastique habile et zélé. Il me dit de plus qu’il me conseillait d’y songer, et que si cela dépendait de M. de Croissy, mon affaire serait bientôt faite, mais qu’à cause de la marine, cela était entièrement au pouvoir de M. de Seignelay (2). Il n’en fallut pas davantage pour me mettre dans le cœur l’ambition apostolique d’aller au bout du monde convertir un grand royaume. J’en parlai au cardinal de Bouillon (3), mon ami dès l’enfance, et, sans perdre de temps, il alla me proposer à M. de Seignelay son ami. Ce ministre lui dit qu’il venait trop tard, que le chevalier de Chaumont, homme de qualité et de vertu, était nommé ambassadeur, qu’on avait été assez embarrassé à trouver un homme propre à cet emploi-là, que le chevalier de Nesmond avait été sur les rangs, et que deux jours plus tôt mon affaire était faite. Le cardinal me rendit cette réponse, mais je ne perdis pas courage, les idées de missions étaient entrées trop avant. Je lui représentai que le chevalier de Chaumont pouvait mourir en chemin, et que l’ambassade tomberait entre les mains de quelque marin peu versé en ces sortes de matière ; que la religion en pouvait souffrir ; que d’ailleurs le roi de Siam voulant se convertir, le chevalier, médiocre théologien (4), lui donnerait des instructions assez superficielles ; enfin, je le priai de demander pour moi la coadjutorerie du chevalier et l’ambassade ordinaire, en cas que le roi se fît instruire dans la religion chrétienne. Il parla au roi, qui m’accorda ma demande, en disant : Je n’avais pas encore ouï parler d’un coadjuteur d’ambassade, mais il y a raison, à cause de la longueur et du péril d’un pareil voyage.
L'affaire étant réglée, j'allai à Versailles chez M. de Seignelay pour y recevoir mes instructions. J'entrai dans son antichambre à trois heures, j'attendis patiemment jusqu'à quatre, et je commençais à m'ennuyer lorsque M. le marquis de Denonville, qui s'en allait vice-roi en Canada, y vint aussi. Il fit dire qu'il était là, on lui répondit comme à moi : Adesso, adesso (5). Nous nous mîmes à causer ensemble, l'un allait vers l'Orient, l'autre vers l'Occident. En causant, sonnent cinq, six et sept heures, sans qu'on songeât à nous donner audience. M. de Seignelay était dans son cabinet avec Cavoye (6) et trois ou quatre autres commensaux riant de temps en temps à gorge déployée. J'admirais la patience héroïque d'un maître de camp des dragons, qui peut-être, dans le fond, n'était pas plus content que moi. Enfin, on l'appela le premier, il demeura un quart d'heure dans le cabinet. On m'appela ensuite. Je ne sais pas si on lui fit excuse de l'avoir fait attendre, mais pour moi on ne m'en dit pas un mot.
Je partis deux jours après, contre l’avis de tous mes parents en colère, peut-être pour ne pas être obligés de m’offrir une pistole. Il n’y eut au monde que le cardinal de Bouillon qui me donna mille écus. Les usuriers me fournirent tout le reste qui m’était nécessaire, et mirent sur ma tête à la grosse aventure. Ils s’en sont bien trouvés par la suite, mais pour moi, si j’en ai rapporté le moule du pourpoint, mes affaires en ont été dérangées dix ans durant. Il faut bien du temps à un ecclésiastique pour prendre sur ses revenus 20 000 livres d’extraordinaire. Mon frère me fit souvenir d’un certain horoscope où l’on m’avait dit beaucoup de choses qui me sont arrivées, et il y avait que je devais courir grande fortune sur l’eau. Je m’en moquai, et partis, mais j’avoue que quoique je méprise ces sortes de pronostics, cela me revint à l’esprit à quatre mille lieues d’ici, dans une tempête qui nous rapprocha fort près du centre du monde.
Notre voyage commença et finit fort heureusement, mais il y avait cinq mois que nous étions sur la mer sans que le chevalier de Chaumont eût eu aucune ouverture pour moi. Cela commençait à me fatiguer. Je prévoyais que si cela durait, je serais un zéro en chiffre à Siam, lorsqu’au travers de la cloison qui séparait ma chambre de la sienne je l’entendis ruminer sa harangue. Je lui dis huit jours après, car il chantait toujours la même note, que j’avais ouï les plus belles choses du monde. Là-dessus, il me mena dans sa chambre, et me la répéta. Je la trouvai sans faute. Il commença à me parler de ce qu’il y avait à faire en ce pays-là et je lui donnai mes petits avis. Il est bon homme, homme de bien, de qualité, mais il ne sait pas la géométrie. Je n’eus pas beaucoup de peine à lui faire sentir que, par aventure, je pourrais lui être bon à quelque chose. Depuis ce jour-là, il ne cracha plus sans m’en avertir, mais il me vint à l'esprit une plaisante pensée : si l'ambassadeur, disais-je, allait mourir en arrivant à Siam, et qu'il fallût que je fisse l'ambassade, il faudrait faire une harangue. Aussitôt dit, aussitôt fait, j'écrivis la harangue suivante que je veux mettre ici pour me réjouir. Je la trouvai en original, toute informe qu'elle est, il y a un an, dans un sac de papiers que j'avais destiné au feu. La voici :
|
Grand roi, Les marques d'estime et d'amitié que Votre Majesté a données au roi mon maître, en lui envoyant des ambassadeurs et des présents, l'ont touché sensiblement, et quoiqu'ils ne soient point arrivés en France, et que selon les apparences ils aient fait naufrage, il ne s'en est pas cru moins obligé à vous en témoigner sa reconnaissance. Votre Majesté connaît sans doute le roi mon maître, les nations européennes qui sont à sa cour lui en auront fait le portrait, et quoique jalouses de sa gloire, elles auront été forcées à rendre justice à son mérite. Toute la terre est remplie du bruit de son nom, et les ambassadeurs de tant de provinces, venus de toutes parts rechercher son alliance, sont retournés dans leurs pays l'esprit occupé et le cœur plein de sa grandeur. Il n'avait que vingt-deux ans quand il commença à gouverner ses royaumes, seul, sans ministre, voyant tout par lui-même, écoutant les plaintes des malheureux, rendant justice à tout le monde. Tous ses jours ont été marqués par des triomphes, et ses soldats l'ont toujours vu à leur tête, soit qu'il fallût prendre des villes, soit qu'il fallût gagner des batailles. Ils n'avaient qu'à le suivre pour marcher à une victoire assurée, mais après avoir vaincu des ennemis, il a bien pu se vaincre lui-même ; il s'est arrêté au milieu de ses conquêtes, prescrivant à chacun des princes qui s'étaient ligués contre lui ce qu'ils avaient à faire pour éviter la fureur de ses armes et rentrer dans son alliance. C'est ce grand prince qui m'envoie des extrémités de l'univers présenter à Votre Majesté des marques de son estime et l'assurer d'une amitié constante, que l'éloignement de cinq mille lieues ne sera jamais capable d'altérer. Le roi, mon maître, ne se contente pas de souhaiter à Votre Majesté toute sorte de bonheur en ce monde, il veut encore vous voir heureux pendant toute l'éternité. Les grands héros meurent comme les autres hommes, il faut songer à cette vie nouvelle, cette vie éternelle qui nous attend après la mort, et pour y arriver, il n'y a qu'un chemin : il faut connaître, il faut aimer le dieu du ciel, le dieu des chrétiens. Votre Majesté l'a déjà reçu dans ses États, vous lui avez bâti des églises, ses ministres, ses évêques ont été dans votre palais. Il ne reste plus, grand roi, qu'à le recevoir dans votre cœur. Il ne demandera à Votre Majesté que des choses aisées. Il faut que les princes soient graves, justes et vertueux. Votre Majesté n'a-t-elle déjà pas toutes ces grandes qualités, et ne donne-t-elle pas à ses sujets l'exemple de toutes les vertus ? C'est ce dieu qui fait régner les rois avec autorité ; c'est son bras tout puissant qui a soutenu le roi mon maître dans ses grandes entreprises, et lorsque toute l'Europe liguée ensemble conspirait la perte de la France, ce dieu que nous adorons nous a fait vaincre, et si notre invincible monarque a donné plus d'une fois la loi à ses ennemis, ç'a été par une protection toute visible du dieu des chrétiens, et nous sommes redevables de nos victoire à la piété de notre roi encore plus qu'à sa valeur. Mais ce grand prince ne croit pas son bonheur parfait, s'il ne le partage avec Votre Majesté. Il sait que Votre Majesté n'a pas besoin de trésors, que ses voisins le craignent, que ses sujets l'aiment. Il ne vous envoie, Sire, ni argent ni troupes, mais il vous envoie la vérité, la connaissance du vrai dieu, le souverain bonheur en ce monde et en l'autre. Voilà le plus beau des présents que le roi mon maître vous envoie. Voilà le but de ses souhaits. Il n'a plus rien à désirer pour sa gloire particulière, son nom victorieux dans tous les temps est assuré de passer à la dernière postérité, il ne lui reste plus qu'à travailler pour ce qu'il aime. Il aime, il estime, il honore Votre Majesté, et ne croit pas pouvoir lui en donner de meilleure marque qu'en lui montrant le chemin du ciel. Ce chemin semble s'ouvrir à Votre Majesté. Elle a depuis vingt ans des missionnaires et des évêques capables de lui faire connaître la vérité, dignes de lui découvrir toutes les beautés de la religion chrétienne, religion aussi ancienne que le monde, et dont la sainteté la rend préférable à toutes les autres religions. J'espère que Votre Majesté fera réflexion sur une affaire qui lui importe si fort. Plaise à ce dieu, qui touche les cœurs quand il lui plaît, toucher celui de Votre Majesté, lui faire connaître, lui faire sentir ses adorables vérités, afin que les deux plus grands rois du monde qui sont amis, malgré tant de mers qui les séparent, qui sur leur seule réputation s'envoient des ambassadeurs et des présents, mais qui selon les apparences n'auront jamais le plaisir de se voir sur la terre, puissent en s'unissant dans le même culte, se voir un jour dans le ciel, dans ces tabernacles éternels, sur ces trônes de gloire que notre dieu prépare à ceux qui le servent. Je n'ai plus rien à souhaiter à Votre Majesté. Il ne me reste qu'à vous présenter tous ces braves Français qui m'accompagnent. Ils commandent les vaisseaux du roi mon maître, et font respecter sa puissance jusqu'aux extrémités de la terre, mais s'ils sont bon sujets, ils sont encore meilleurs chrétiens. Ce sont autant de héros de la religion de Jésus-Christ prêts à répandre pour le service de leur dieu ce même sang qu'ils ont tant de fois exposé pour le service de leurs rois. Pour moi, Sire, je me sens le plus heureux des hommes d'avoir pu m'acquitter d'une commission si importante. |
Dès que nous fûmes arrivés à Siam et que j’eus entretenu l’évêque de Métellopolis et l’abbé de Lionne, je connus clairement qu’on avait un peu grossi les objets, et que le roi de Siam voulait bien protéger les chrétiens, mais non pas embrasser leur religion ; qu’il avait agi en politique qui veut attirer les étrangers et le commerce dans son pays, et s’assurer une protection contre les Hollandais, que tous les rois des Indes craignent beaucoup. M. Constance me découvrit la vérité malgré lui, et donna dans le panneau que je lui tendis. Je crois avoir rapporté ce fait dans mon Journal. Il me proposa de donner au roi la ville de Bangkok, à condition qu’on y enverrait des troupes, des ingénieurs, de l’argent et des vaisseaux. Le chevalier de Chaumont et moi ne crûmes pas la chose faisable, et nous lui dîmes franchement que le roi ne voudrait pas s’engager sur sa parole à une dépense de quatre à cinq millions, qui peut-être seraient perdus. La chose en demeura là, et je crois qu’il n’y eût jamais songé, sans une retraite que je fis au séminaire de Siam pour me préparer à recevoir les ordres sacrés. Il arriva quelque affaire dont M. Constance voulut parler au chevalier de Chaumont. Il fallait un interprète, il se servit du père Tachard. Il lui trouva un esprit doux, souple, rampant, et pourtant hardi, pour ne pas dire téméraire. Il lui parla de la pensée qu’il avait eue, pensée que nous avions traitée de chimère. Le père Tachard offrit de s’en charger, de la faire réussir. Il dit à M. Constance que nous n’avions aucun crédit à la cour, et il n’avait pas grand tort, et que s’il voulait en écrire au père de La Chaize, sa révérence en viendrait bien à bout.
Pendant que cela se négociait, M. Paumard (7), missionnaire, qui était toujours chez M. Constance, en eut quelque vent et vint m’en avertir, mais je ne voulus pas quitter ma retraite, et je laissai faire le père Tachard, qui par là me souffla un beau crucifix d’or que le roi de Siam me devait donner à l’audience de congé, et dont le bon père fut régalé avec justice, puisque le chevalier de Chaumont et moi n’étions plus que des personnages de théâtre et qu’il était le véritable ambassadeur, chargé de la négociation secrète. Je ne sus tout cela bien au juste qu’après être arrivé en France. Mais quand je me vis dans mon pays, je fus si aise que je ne me sentis aucune rancune contre personne.
J'ai dit beaucoup de bien de M. Constance dans mon Journal, je n'ai rien dit que de vrai. C'était un des hommes du monde qui avaient le plus d’esprit. Libéral, magnifique, intrépide, plein de grandes idées, et peut-être qui ne voulait avoir des troupes françaises que pour tâcher de se faire roi lui-même à la mort de son maître, qu’il voyait fort prochaine. Il était fier, cruel, impitoyable, d’une ambition démesurée. Il avait soutenu la religion chrétienne parce qu’elle pouvait le soutenir, et je ne me serais jamais fié à lui dans chose où son élévation n’aurait pas trouvé son compte.
En arrivant à Brest, j’appris deux nouvelles bien différentes : l’une, que M. Boucherat (8) était chancelier, j’en fus fort aise ; l’autre, que M. le cardinal de Bouillon était exilé, j’en fus fort fâché. Nous partîmes aussitôt, le chevalier de Chaumont et moi, et fîmes ensemble la première journée. Il regardait toujours les Bretonnes, et m’avoua, avec toute sa dévotion, qu’il les trouvait aussi belles que la princesse de Conti. Nous venions de voir les Siamoises. Il arriva le premier à la cour, comme de raison, j’y arrivai trois jours après. On nous entourait comme des ours. Le roi me fit beaucoup de questions. Il m’en fit une, entre autre, dont on parla fort : il me demanda comment on disait manger en siamois ; je lui dis qu’on disait kin. Un quart d’heure après, il me demanda comment on disait boire ; je lui répondis : kin. — Je vous y prends, dit-il. Vous m’avez dit tantôt que kin signifie manger. — Il est vrai, Sire, lui repartis-je sans hésiter, mais c’est qu’en siamois kin signifie avaler, et pour dire manger, on dit kin kaou : avaler du riz, et kin nam : avaler de l’eau. — Au moins, dit le roi en riant, il s’en tire avec esprit. Je disais vrai, et l’esprit n’a point aidé en cette occasion.
Le lendemain, en me promenant dans la galerie, j'entendis Cavoye, Livry, d'autres courtisans, qui disaient que le roi de Siam envoyait des présents au cardinal de Bouillon. Cela me fit beaucoup de peine, j'avais eu l'intention de les supprimer, ne croyant pas l'occasion favorable. J'eus peur que le roi ne l'apprît par d'autres que par moi. Je courus chez M. de Seignelay, il était à Sceaux. J'allai demander conseil à M. le chancelier, qui me conseilla de l'aller dire au roi sans perdre un moment. J'allai trouver M. le comte d'Auvergne qui me conseilla la même chose, et je revins aussitôt dans la galerie ; et comme le roi allait à la messe, je m'approchai de l'oreille de Sa Majesté et lui dis : — Sire, je supplie Votre Majesté de m'accorder un moment d'audience dans son cabinet. Il me répondit : — Cela est-il pressé ? Je répliquai : — Oui, Sire. — Eh bien ! me dit-il avec un visage solaire, venez après mon dîner. Je n'y manquai pas, et me trouvai dans l'antichambre à son passage. Il me donna un petit coup sur le bras, et me dit : — Suivez-moi. J'entrai dans son cabinet où il était seul, et lui dis : — Sire, je crois être obligé de dire à Votre Majesté que le roi de Siam a écrit à M. le cardinal de Bouillon, et lui envoie des présents. — Pourquoi cela ? m'interrompit-il, et qui lui a donné le conseil de le faire ? — Sire, lui répliquai-je, j'ai cru bien faire en faisant honorer par un grand roi le premier aumônier de Votre Majesté et le premier homme de l'Église de France. Il se retourna un peu vite, et me dit avec avec une mine à me faire rentrer cent pieds sous terre : — Vous avez fait cela de votre tête ? — Sire, lui répliquai-je, j'en ai parlé à M. le chevalier de Chaumont, et il m'a approuvé, ne pouvant pas deviner que M. le cardinal de Bouillon serait assez malheureux pour vous déplaire. Votre Majesté venait de lui donner l'abbaye de Cluny. — Cela suffit, me dit-il en me tournant le dos, et je sortis du cabinet. Les courtisans me voulaient faire des compliments sur mon audience, mais je payai de modestie, et passai vite. J'allai me renfermer dans une petite chambre de cabaret, où sans reproche, je remerciai Dieu de m'avoir humilié. J'étais trop fier, je croyais avoir trouvé la pie au nid pendant mon voyage, en contentant les jésuites et les missionnaires. La mine que le roi venait de me faire rabattit bien mon caquet, il me semblait pourtant que mon innocence me mettait en repos. À sept heures du soir, je sortis de ma tanière, et retournai au château, pour voir si M. de Seignelay ne serait point revenu. Je trouvai en arrivant vingt personnes qui me dirent que le roi m'avait fait chercher partout pour me parler. J'allai chez M. de Seignelay qui me pensa manger. — Vraiment, Monsieur, me dit-il, le roi est dans une belle colère. Pourquoi ne m'êtes-vous pas venu trouver d'abord ? Je lui dis que j'avais été chez lui, et que ne le trouvant pas, M. le comte d'Auvergne m'avait conseillé d'aller droit au roi. Il me demanda la lettre que le roi de Siam avait écrite à M. le cardinal de Bouillon et le mémoire des présents. Je lui mis le tout entre les mains. J'allai le soir au souper du roi à l'ordinaire, mais il ne me dit mot, plus de questions. Mes amis m'avertirent le lendemain que le roi avait paru fort en colère au petit coucher contre moi, qui m'étais mêlé de ce que je n'avais que faire, et même contre ce pauvre cardinal qu'il accusait de m'avoir fait aller à Siam pour s'attirer des présents, lui qui n'en avait pas eu la moindre idée. Je crus qu'il fallait laisser passer l'orage, et je m'en allais à Paris m'enfermer dans mon séminaire, où une demi-heure d'oraison devant le Saint-Sacrement me fit bientôt oublier tout ce qui venait de m'arriver. Six mois après, je présentai au roi la Vie de David et les Psaumes, qu'il reçut fort agréablement (9). J'en eus obligation au père de La Chaize, qui lui avait parlé en ma faveur, et qui me fit avoir une audience dans le cabinet. Sa Majesté avait bien connu que je n'avais pas grand tort. Cela est si vrai que l'année suivante, il me permit d'aller voir le cardinal, qui était à Tarascon fort malade, et dit au père de La Chaize qu'il était bien aise que certaines gens l'allassent voir en cet état-là. Hélas ! Le pauvre prince avait peut-être bonne opinion de moi, et il avait raison de l'avoir en ce temps-là. J'étais tout frais des missions orientales, où je n'avais pas laissé de prendre de bonnes teintures, seulement en voyant faire, et faisant tant soit peu d'attention.
Un mois après que je fus arrivé à Paris, les ambassadeurs du roi de Siam y arrivèrent. Le roi les fit défrayer partout, et leur donna audience dans la grande galerie de Versailles. On y avait élevé un trône magnifique. Ils firent une fort belle harangue, que l’abbé de Lionne, missionnaire, expliqua en français. Ils marquèrent au roi des respects qui allaient presque jusqu’à l’adoration, et en s’en retournant, ils ne voulurent jamais tourner le dos, et allèrent à reculons. Les présents qu’ils avaient apportés étaient rangés dans le salon au bout de la galerie. M. de Louvois, qui n’estimait pas beaucoup les choses où il n’avait point de part, les méprisait extrêmement. - Monsieur l’abbé, me dit-il en passant, tout ce que vous avez apporté là vaut-il bien quinze cents pistoles ? – Je n’en sais rien, monsieur, lui répondis-je le plus haut que je pus, afin qu’on m’entendît ; mais je sais fort bien qu’il y en a pour plus de vingt mille écus d’or pesant, sans compter les façons ; et je ne dis rien des cabinets du Japon, des paravents, des porcelaines. Il fit, en me regardant, un sourire dédaigneux et il passa quelqu’un qui apparemment conta au roi cette belle conversation, car dès le soir même, M. Bontemps me demanda, de la part de Sa Majesté, si ce que j’avais dit à M. de Louvois était bien vrai. Je lui en donnai la preuve en lui donnant un mémoire exact de poids de chaque vase d’or, et je l’avais fait faire à Siam avant que de partir. Je suis persuadé qu’on le vérifia dans la suite. Cette bagatelle ne laissa pas d’irriter M. de Louvois contre moi. Il ne m’aimait pas déjà, parce que j’étais des amis du cardinal de Bouillon, sa bête.
Quatre jours après, il conta à Meudon, en pleine table, une histoire de moi, fausse depuis le commencement jusqu’à la fin, où M. l’archevêque était fort mêlé. L’archevêque le sut, m’envoya quérir, me conta tout, et me dit : — Mon pauvre abbé, ne relevons point la médisance ; c’est le moyen de la faire crever. Je ne dirai rien davantage des ambassadeurs siamois, il y a des livres imprimés de leurs bons mots, et dans le vrai, le premier ambassadeur avait beaucoup d’esprit. Il avait soin de nous à Siam, il faisait à peu près la fonction de gentilhomme ordinaire. Je dis à M. Constance que cet homme-là me paraissait propre à réussir en France. Il me dit qu’il n’était pas assez grand seigneur pour le charger d’une si belle ambassade, et que d’ailleurs il était malcontent de la Cour, parce qu’à la mort du barcalon, son frère, on lui avait ôté deux millions. Je lui répondis qu’on pouvait lui faire donner un plus grand titre, et que les bienfaits effaçaient les injures. Il y songea, en parla au roi de Siam, le fit Opra (10) et ambassadeur. Il faut pourtant avouer que M. Constance avait raison. Ce bon ambassadeur se mit à son retour dans le parti de Phetracha, et par ses conseils contribua beaucoup à le faire roi, et à faire scier en deux le pauvre M. Constance. Il est à présent barcalon, c’est-à-dire premier ministre. La harangue qu’il fit au roi à son audience de congé fut admirée. On me fit l’honneur de me soupçonner d’y avoir mis la main. Le roi m’envoya chercher pour me la demander, il la voulait faire voir à Mme de Maintenon. Je lui en portai un brouillon qui se trouva dans ma poche. Il m’ordonna de lui en apporter au retour de la chasse une copie bien écrite, ce que je fis. La vérité est que les ambassadeurs avaient mis dans leur patois une partie des pensées qui y sont. L’abbé de Lionne les avait traduites en français. M. Tiberge (11) y avait donné ce tour simple, naturel et noble qu’il sait donner à tout ce qu’il fait, et j’y avais marqué quelques points et quelques virgules.

NOTES
1 - Jean-Louis Bergeret (1641-1694), avocat général au parlement de Metz en 1672, il devient ensuite premier commis de Charles Colbert de Croissy, puis secrétaire de la chambre et du cabinet du roi. En 1684, il est élu membre de l’Académie française, contre Ménage, et il y est reçu par Racine. (Wikipédia). ⇑
2 - Jean-Baptiste Antoine Colbert, marquis de Seignelay (1651-1690), fils du Grand Colbert, fut secrétaire d'État à la marine entre 1683 et 1690. ⇑
3 - Emmanuel-Théodose de la Tour d'Auvergne, cardinal de Bouillon (1643-1715) eut par deux fois l'occasion d'être disgracié par Louis XIV. Ses neveux, les princes de Conti et le prince de Turenne étaient partis sans l'aveu du roi pour participer à la guerre de Hongrie contre les Turcs. Ils envoyaient des courriers qui ne témoignaient pas seulement de leur « vice abominable » et de leur impiété, mais qui diffamaient le roi. Soupçonné d'avoir favorisé leur départ, voire de partager leurs mœurs, le cardinal de Bouillon fut exilé dans son abbaye de Cluny, à Paray-le-Monial en août 1685. (Robert Challe, Mémoires - Correspondance complète, Rapports sur l'Acadie et autres pièces, publié par Frédéric Deloffre et Jacques Popin, Genève, Droz, 1996, note 200, page 339). Toutefois, les démêlés du cardinal avec Louis XIV ne s'arrêtèrent pas là. En 1700, il eut le malheur de déplaire à nouveau au monarque et subit les rigueurs de l'arbitraire royal, ainsi que le relate Victor_Louis Bourilly dans la Revue d'Histoire moderne et contemporaines (1889, 1-1, pp. 58-59) : Chargé des affaires de France à Rome au moment où éclate en Fénélon et Bossuet la querelle des Maximes des Saints, le cardinal est frappé de disgrâce, privé de ses charges pour ne s'être pas prononcé contre Fénelon, et envoyé en exil dans ses abbayes de Bourgogne. Là, pour occuper ses loisirs et consacrer à la gloire de sa maison un monument digne d'elle, il s'occupe de faire élever à Cluny un mausolée et fait composer par Baluze une histoire généalogique de la Maison d'Auvergne. Louis XIV sévit de nouveau : par arrêt du Conseil d'État du 10 juillet 1710, tous les exemplaires de l'histoire généalogiques seront recherchés, déchirés et mis au pilon. Par arrêt du Parlement du 2 janvier 1711, est interdite l'érection du mausolée. ⇑
4 - Né dans une famille calviniste, Chaumont s'était converti très jeune au catholicisme. Les témoignages dépeignent une piété qui tournait à la bigoterie, mais le chevalier était certainement davantage dévot que théologien. ⇑
5 - Italien : Tout de suite, dans un instant… ⇑
6 - Louis d'Oger, ou d'Augier, marquis de Cavoye (1640-1716). ⇑
7 - Étienne Paumard (1640-1690). Missionnaire et médecin, il bénéficie de la confiance de Phaulkon qu'il a guéri en 1682 d'une grave maladie. Il joue un rôle de médiateur fort important dans les rivalités entre missionnaires et jésuites. ⇑
8 - Louis Boucherat, comte de Compans, (1616-1699), chancelier de France en 1685. ⇑
9 - L'Interprétation des Psaumes, avec la vie de David de l'abbé de Choisy fut publié par Mabre-Cramoisy en 1687. ⇑
10 - Ok-phra (ออกพระ) était un titre nobiliaire siamois, un peu l'équivalent du marquis ou du comte. ⇑
11 - Louis Tiberge, ou Thiberge (1651-1730) était le directeur du séminaire des Missions Étrangères. ⇑

24 janvier 2019
