

Deuxième partie.
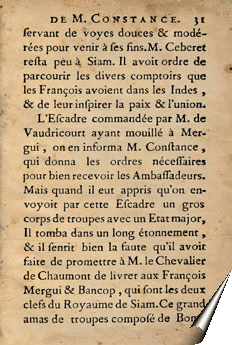
L'escadre commandée par M. de Vaudricourt ayant mouillé à Mergui (1), on en informa M. Constance, qui donna les ordres nécessaires pour bien recevoir les ambassadeurs. Mais quand il eut appris qu'on envoyait par cette escadre un gros corps de troupe avec un état-major (2), il tomba dans un long étonnement et il sentit bien la faute qu'il avait faite de promettre à M. le chevalier de Chaumont de livrer aux Français Mergui et Bangkok, qui sont les deux clés du royaume de Siam. Ce grand amas de troupes composé de bombardiers, de soldats de marine et de volontaires, causa une grande rumeur dans le pays. On y voyait avec peine que les étrangers étaient presque maîtres du royaume, et qu'un étranger gouvernait les affaires impérieusement. Plus la France le soutenait, et plus il sa faisait haïr. Les Hollandais surtout travaillaient sourdement à le décrier, eux qui n'ont d'autre attention dans les Indes qu'à augmenter leur commerce et à ruiner celui des autres nations.
Les troupes débarquées à Siam avaient pour commandant M. Desfarges, ancien lieutenant colonel du régiment d'Orléans, et que le roi fit maréchal de camp pour cette expédition à laquelle il était peu propre. Homme d'un génie étroit et serré, incapable de prendre son parti, n'ayant point d'amis et ne méritant point d'en avoir, ne se fiant qu'à des gens de la plus basse condition, du reste fort intéressé et aimant l'argent à l'excés. Son excuse était, comme c'est encore celle de beaucoup d'officiers de la marine, qu'il n'avait point quitté la France seulement pour changer d'air.
En cas que M. Desfarge vînt à mourir pendant la traversée ou qu'il ne pût point s'accommoder des manières de vivre de Siam, M. de Bruant, brigadier des armées du roi, devait lui succéder, et en attendant, il avait ordre de rester à Mergui comme gouverneur et de donner avis à M. Desfarges de tous les vaisseaux qui arrivaient. Mais ces deux officiers ne vécurent pas longtemps en bonne intelligence. Ils se brouillèrent ensemble, ce qui n'arrive que trop souvent dans ces pays éloignés où chacun veut dominer et où les caractères mal choisis s'accordent rarement entre eux. L'intérêt en est la principale cause.
Quand les Français se furent établis, moitié gré, moitié force dans le royaume de Siam, tout fut calme et tranquille. Mais ce n'était qu'un calme apparent et une fausse tranquillité. M. de la Loubère revint sur la même escadre que commandait M. de Vaudricourt, mais sans prendre congé de M. Constance avec lequel il était brouillé. Pour M. Céberet, il avait déjà quitté Siam où il ne prévoyait que des troubles et des revers, tant par rapport au commerce que par rapport à la conduite des Français qui se livrent aux femmes d'une manière inconsidérée, et sans sauver les bienséances dues au pays. On sait que c'est là l'écueil où les Français emportés par le plaisir et ne ménageant rien pour y satisfaire, viennent échouer. Il faut cependant dire à l'honneur des évêques et des autres missionnaires employés à Siam, qu'ils y furent toujours très considérés. Il sauvèrent aux Français et des injures et des affronts, que les Français méritaient par leur conduite.
Après le départ de MM. de la Loubère et Céberet, qui firent plus de tort aux affaires qu'ils n'y firent de bien, l'un par des hauteurs affectées et l'autre par des demandes captieuses, après, dis-je, leur départ, M. Constance n'eut plus pour les Français les mêmes égards ni les mêmes attentions qu'il avait eus jusqu'alors. Il chercha toutes les occasions de les mortifier, et même une des raison qui piqua M. de la Loubère avant que de partir, c'est qu'on remit au père Tachard les nouveaux présents destinés à Louis XIV au lieu de les lui remettre. Par cette conduite, M. Constance marqua le peu de satisfaction qu'il avait des ambassadeurs, qui à leur tour lui témoignèrent une grande défiance de toutes ses promesses. Le père Tachard s'embarqua avec M. de Vaudricourt, et presque malgré lui, mais il avait eu la précaution de se faire donner le titre d'Envoyé du roi de Siam. Il était de plus accompagné d'un grand nombre de Siamois et de Tonkinois qu'on disait être des députés des Églises de Siam et de Tonkin, qui venaient rendre hommage au Pape (3).
Cependant, M. Constance était de plus en plus inquiet de la situation où se trouvait le royaume. Il aurait voulu que tous les Français en fussent sortis. Et d'abord il leur fit retrancher les vivres qu'ils recevaient du roi, par forme de gratification, et les réduisit à leur prêt seulement, ce qui causa une grande mortalité parmi les soldats peu accoutumés à ne manger que du riz et à ne boire que de l'eau. Les officiers ne furent pas mieux traités. Tout leur manquait au besoin.
Comme ils s'en plaignirent, leurs plaintes ne furent pas écoutées des Siamois devenus insolents parce qu'ils voyaient qu'on les ménageait, ce qui est assez le caractère des hommes lâches et sans cœur. On en fit une première épreuve à Mergui, où commandait M. de Bruant, qui avait trois compagnies de cent hommes chacune sous ses ordres. Il était convenu avec M. Constance qu'on fortifierait cette place et qu'on y bâtirait une citadelle ; les Siamois devaient y travailler conjointement avec les Français, mais bientôt on remarqua du relâchement dans les premiers, qui quittèrent enfin l'ouvrage et ne parurent plus. M. de Bruant eut beau les rappeler à leur devoir, ils faisaient peu de cas de ses menaces, et même ils maltraitaient ceux qui allaient les en avertir. Il ner douta point que ce ne fût par des ordres secrets de M. Constance qui employa toutes sortes d'artifices pour chasser les Français de Mergui ; mais ne pouvant en venir à bout, il eut recours à la force ouverte.
M. de Bruant, ne sachant quel parti prendre, et ne recevant point de nouvelles de M. Desfarges qui était à Siam, assembla le Conseil de guerre, et tous les officiers de concert résolurent de s'emparer d'une frégate qui était dans le port de Mergui et d'aller courir les hasards de la mer. Ils partirent donc si précipitamment qu'ils laissèrent une partie des soldats à terre, et qu'une compagnie presque entière se noya en s'embarquant avec le sieur Hiton qui commandait cette compagnie. Jamais fuite ne fut plus rapide ni plus honteuse. M. de Bruant y souffrit beaucoup d'incommodités et de misères, car s'étant embarqué sans vivres et sans pilote, il pensa périr sur les côtes de Martaban et de Pégou, où quelques Français descendus à terre furent faits esclaves. On ignore quel a été leur sort. Enfin la frégate où M. de Bruant était embarqué avec les Français échappés de Mergui, fut rencontrée par une escadre anglaise de huit vaisseaux qui s'en empara sans aucune déclaration de guerre. J'ajouterai ici que les Anglais, quand ils se trouvent les plus forts, sont très sujets à faire de ces sortes de violences sur mer, et il est assez rare d'en obtenir justice en Angleterre.
Pour M. Desfarges, il avait demeuré à Siam auprès de M. Constance, depuis le départ des ambassadeurs, et il tâchait d'y ménager les intérêts des Français, de quoi certes il n'était point capable, ne songeant qu'à ménager les siens propres. Cependant il courait de ces bruits sourds qui sont les premières annonces des grandes révolutions, et tous les esprits étonnés s'attendaient à quelque catastrophe prochaine. On ne parlait que de soldats armés qui se rassemblaient autour de Siam, sans qu'on pût deviner par quel ordre ils marchaient, et sous quels chefs. Tout cela se passait dans un grand secret. Les talapoins d'ailleurs, ennemis déclarés de la religion chrétienne et que l'austérité de leur vie faisait infiniment respecter des peuples, criaient à haute voix qu'on avait tout à craindre de cette nouvelle religion, et qu'elle allait causer des calamités sans nombre. Les jésuites surtout leurs étaient odieux par le crédit qu'ils avaient acquis, et par les mœurs régulières. Les talapoins s'imaginaient qu'en les attaquant, ils attaquaient tous les chrétiens ensemble.
M. Constance, informé de ces mouvements, et voyant que tout se disposait à une révolte générale, se hâta d'aller à Louvo où était le roi déjà vieux et infirme et qui ne sortait point de son sérail. De son côté, M. Desfarges descendit à Bangkok où tous les Français étaient réunis. Mais avant que de partir, il se réconcilia avec M. Constance qui lui fit promettre d'honneur qu'il partirait à la première nouvelle qu'il recevrait de la cour, avec cent hommes des meilleurs de sa garnison, et qu'il se rendrait à Louvo, ce qui était plus que suffisant pour dissiper la conspiration et défendre le roi et M. Constance. Il comptait si fort sur ce secours qui lui paraissait décisif qu'il ne prit pas toutes les mesures qu'il pouvait prendre.
L'auteur de cette conspiration était O-Pra-Pitracha (4), un des premiers mandarins, homme d'esprit, entreprenant et courageux. Il voyait le roi presque mourant, et qui n'avait que deux frères, l'un imbécile, l'autre paralytique et toujours couché (5). Pitracha par conséquent n'avait rien à craindre de leur part, et ce qui augmentait sa confiance, c'est qu'il avait mis dans ses intérêts plusieurs mandarins, et surtout le premier des trois ambassadeurs qui avaient été en France, lequel ne conservait aucune mémoire de son voyage.
Sur cela, M. Constance dépêcha courriers sur courriers à M. Desfarges pour l'obliger de venir à Louvo suivant sa promesse. L'affaire était de la dernière importance et le temps pressait. M. Desfarges se mit aussitôt en chemin avec quatre-vingts hommes, tous officiers et soldats de résolution. Mais à peine fut-il en campagne, que sur de faux avis qu'une armée de Siamois l'attendait, il retourna sur ses pas et s'alla renfermer dans la citadelle de Bangkok. On eut beau, pour le rassurer, lui dire que tous les chemins étaient libres et qu'il ne paraissait personne qui pût lui faire obsacle, M. Desfarges ne revint point de sa terreur, et laissa M. Constance au milieu de ses plus grands ennemis. Quelle lâcheté !
Pitracha, instruit de la retraite inopinée de Français et de la crainte qui les avait saisis, jugea qu'il était temps d'agir, et dès le soir même, il entra dans le palais et s'empara de la personne du roi et de celles de ses frères. M. Constance accourut à leur secours et fut arrêté par ordre de Pitracha. Il agissait en maître, rien ne lui résistait, tous les Siamois étaient même charmés de la révolution qui venait d'arriver. On ignore quel fut le genre de mort du roi (6). Ses frères furent renfermés dans des sacs d'écarlate et assommés à coups de bûches de santal, ce qui est le supplice des personnes de la plus haute considération. À l'égard de M. Constance, après qu'on lui eut fait souffrir des tourments inouïs, on le conduisit dans un bois voisin de Louvo, et là, les bourreaux armés de sabres le massacrèrent inhumainement.
Mme Constance, pendant ces mouvements, avait été retenue à Siam où l'on lui fit souffrir mille indignités. La plus sensible à une personne d'honneur fut d'être exposée aux violences du fils de Pitracha, vrai monstre livré à toutes sortes de débauches (7), qui n'ayant pu la faire consentir à ses ardents désirs, épuisa sur elle toute sa fureur. Vers ce même temps, un officier nommé Saint-Marie, qui devait descendre secrètement à Bangkok, proposa à Mme Constance, qu'on avait dépouillée de tous ses biens, de l'y conduire en sûreté. Elle accepta l'offre d'autant plus volontiers qu'elle avait entre les mains une lettre de Louis XIV qui l'assurait de toute sa protection. Elle était même écrite de ce style qui ne sied qu'à un grand roi. Mais à l'arrivée de Mme Constance, les craintes de M. Desfarges redoublèrent et il ordonna les arrêts à Sainte-Marie pour l'avoir amenée à Bangkok. Tous les officiers, au contraire, le louèrent beaucoup et dirent à haute voix que cette dame infortunée s'étant réfugiée sous le pavillon de France, il était de l'honneur de la nation, et de sa générosité connue dans toute l'Asie, de la protéger, et qu'il fallait périr plutôt que de l'abandonner.
M. Desfarges se trouva presque seul d'un avis opposé à celui des officiers de sa garnison, et sur la demande insolente de Pitracha, il lui renvoya sans aucun délai Mme Constance qui sortit de Bangkk avec un visage fier, et sur lequel il paraissait moins de crainte de la mort que de mépris pour les Français. Arrivée à Siam, elle fut réduite aux services les plus bas et les plus humiliants de la maison de Pitracha (8). Telle fut la destinée de M. et de Mme Constance, destinée qu'on ne peut envisager sans horreur, par les supplices affreux qu'on leur fit souffrir. La mort certainement est un moindre mal que de pareils supplices.
Il ne restait plus à Pitracha, pour se mettre sur le trône, que de retirer Bangkok des mains des Français et de les chasser tous hors du royaume. La chose n'était point facile à exécuter et les Siamois mal aguerris ignoraient l'art de faire un siège. Cela engagea Pitracha à tenter la voie de la négociation, dont fut chargé le premier des trois ambassadeurs qui avaient été en France. Il alla donc à Bangkok avec une nombreuse suite, et ayant vu M. Desfarges, ils convinrent ensemble et sans y appeler autre officier, des conditions suivantes : Que les Siamois fourniraient deux frégates pour conduire à Pondichéry les Français avec leurs armes et bagages, qu'ils pourraient d'ailleurs embarquer autant de vivres et de rafraîchissements qu'ils auraient besoin ; que pour sûreté des deux frégates, on laisserait en qualité d'otages à Siam M. l'évêque de Métellopolis et M. Véret, directeur des affaires du commerce de France, lesquels seraient remis en liberté au retour de ces deux frégates (9). Il restait d'ailleurs plusieurs autrse Français à Siam, la plupart ouvriers, qui abandonnés parmi des barbares sans mœurs et sans discipline, ne recevant aucun salaire de leur travail, périrent presque tous de misères.
Ce fut le 2 novembre 1688 que les Français sortirent de Bangkok, un an jour pour jour de leur entrée dans cette forteresse. Ainsi leur triomphe ne dura point longtemps, et de tous les Européens, les perfides Hollandais furent les seuls qui s'en réjouirent. M. Desfarges eut beau redemander deux mortiers de fonte que M. de Vaudricourt avait laissés du temps de M. Constance, on ne voulut jamais les lui rendre. On retint de plus les bombardiers qui étaient destinés au service et à la manœuvre de ces mortiers. Toutes ces injustices mirent au désespoir les Français, qui s'embarquèrent avec tant de confusion que leur départ de Siam ressembla à une fuite honteuse. M. Desfarges et MM. de Bruant et de Vertesalle retournèrent en France déshonorés. On leur avait confié une affaire qui demandait du courage, de la fermeté, une conduite réfléchie, et tout leur manqua. Quel mauvais choix on avait fait !
Fin de l'Histoire de Monsieur Constance.

NOTES
1 - La flotille de l'ambassade Céberet-La Loubère ne mouilla pas à Mergui, mais à Bangkok, comme l'ambassade précédente du chevalier de Chaumont. ⇑
2 - Plus de mille trois cents personnes s’étaient entassées à bord des cinq navires de la flotte, l’Oiseau, le Gaillard, la Loire, la Normande et le Dromadaire. À voir le détail de ces passagers (six cents hommes de troupe et leurs officiers, des charpentiers, des menuisiers, des musiciens, des peintres, un jardinier, un cordonnier, etc.) il était évident qu’on n'allait plus seulement saluer un monarque ami. On allait coloniser un pays. ⇑
3 - Outre ces ecclésiastiques, le père Tachard nous apprend qu'il y avait cinq enfants de mandarins siamois qu'on envoyait en France pour leur éducation (il était prévu à l'origine d'en envoyer une douzaine, mais on ne put en prendre que cinq), trois éléphants et deux rhinocéros. (Second voyage du père Tachard, 1689, p.273-274). ⇑
4 - Phra Phetracha พระเพทราชา était frère de lait du roi Naraï et général des éléphants. Il usurpa le pouvoir après la mort du roi et régna de 1688 à sa mort en 1703, menant une politique d'indépendance fortement nationaliste. ⇑
5 - L'abbé de Choisy notait dans son journal du 12 novembre : Le roi n’a qu’une fille unique qui a vingt-sept ans. Elle a le rang et les revenus de la reine depuis que sa mère est morte et les aura jusqu’à ce que son père se remarie. Il y a deux frères du roi : l’un qui a trente-sept ans et est impotent, fier et capable de remuer, si son corps lui permettait d’agir ; l’autre qui n’a que vingt-sept ans est bien fait et muet. Il est vrai que l’on dit qu’il fait le muet par politique. Ils ont chacun un palais, des jardins, des concubines, des esclaves, et ne sortent presque jamais. La sœur du roi et ses tantes sont fort vieilles. Ces deux frères n'étaient en fait que des demi-frères du roi Naraï. L'aîné, Chao Fa Apai thot (เจ้าฟ้าอภัยทศ), boiteux, ivrogne et colérique, fut assigné à résidence pour avoir comploté. Le cadet, Chao Fa Noi (เจ้าฟ้าน้อย), fut condamné à mort pour avoir eu une liaison avec une concubine de son frère le roi. Gracié, il subit néanmoins une formidable correction qui le laissa à moitié paralysé. Tous deux furent exécutés lors de la révolution de 1688. Voir dans la relation du chevalier de Chaumont la note consacrée aux frères du roi Naraï. ⇑
6 - L'empoisonnement du roi Naraï est une hypothèse qu'on ne peut écarter. Dans ses Mémoires, François Martin écrivait : On a des informations sûres que les Hollandais étaient fort intrigués dans ces révolutions, particulièrement un certain Daniel, de leur loge, natif de Sedan, chirurgien de profession, hérétique opiniâtre et ennemi déclaré de la religion catholique et des Français. On assure encore que l'on a des témoignages par les mêmes informations qu'on mêla du poison dans un breuvage qu'on donna au roi, qui avança beaucoup sa mort. (Mémoires de François Martin, III, 1934, p.15). Par ailleurs, les Archives Nationales conservent une déclaration du français Jean Rival, ancien gouverneur de Phuket, (AN Cl 25, fs.58-59) et datée du 25 novembre 1691 qui révèle qu'une conjuration s'était nouée entre Phetracha, le capitaine de la loge hollandaise, le médecin de la VOC Daniel Brouchebourde et quelques mandarins pour faire mourir le roi : Ok Pra Phetracha demanda au capitaine hollandais : comment pouvons-nous entreprendre cette affaire ? Le capitaine hollandais fit répondre à Daniel qui lui servait d'interprète : il faut que vous fassiez donner du poison lent au roi, et Daniel le préparera, et Ok Meun Sri Meun Chaya, qui est auprès du roi, le donnera au roi, et quand le roi se trouvera un peu atteint, il faut que Ok Meun Sri Meun Chaya vous donne le cachet du roi, et surtout, si Ok Pra Vitticamheng apportait des médecines pour les donner au roi, il faut que Ok Meun Sri Meun Chaya ne les donne pas au roi, sinon celles que Daniel lui donnera, et tant qu'il pourra empêcher Ok Pra Vitticamheng d'approcher du roi. Même si ces rumeurs et ces affirmations restent sujettes à caution, la brusque dégradation de l'état de santé du roi Naraï et les précautions prises par Phetracha pour empêcher quiconque d'approcher le monarque dans ses derniers jours pourraient accréditer cette thèse. ⇑
7 - Le fils de Phetracha, Naï Dua, devenu Luang Sorasak, (หลวงสรศักดิ์) est décrit par Wood comme un jeune homme violent et agressif. Sous l'empire de la colère, il aurait même cassé deux dents à Phaulkon d'un coup de poing. Élevé au rang de Maha Upparat (มหาอุปราช), il succède à son père en 1703. Wood indique que cette succession eut toutes les apparences d'une usurpation, car Petratcha avait deux autres fils, nés de la princesse Yothatep - fille du roi Naraï - qu'il avait épousée après son accession au trône. L'aîné, Chao Kwan, avait 14 ans à la mort de Petratcha, et le cadet, Tras Noï en avait 10. En tant que descendant du roi Prasat Thong, c'est Chao Kwan qui avait le plus de légitimité et la faveur de la plupart des mandarins pour monter sur le trône. Sarasak écarta définitivement ce prétendant en le faisant assassiner.
A la mort de son père, en 1703, Sarasak devint le 33ème roi d’Ayutthaya, connu sous le surnom de Roi-tigre (Phra Chao Süa : พระเจ้าเสือ). W.A.R. Wood brosse ainsi son portrait : Ce fut un homme cruel, intempérant et dépravé. Turpin dit qu’il a épousé la princesse Yotathep, une des veuves de son père [par ailleurs fille de Phra Naraï]. Une des portes de son palais était connue sous le nom de « Porte des Cadavres » en raison du grand nombre de petits cercueils qui en sortaient, contenant des enfants assassinés victimes de sa luxure et de sa cruauté. (…) Le roi Tigre, usé par l’alcool et la débauche, mourut en 1709, terminant ainsi un règne court et peu glorieux. (A History of Siam, p.225). ⇑
8 - Le sort de Mme Constance sera moins dur qu'on ne pouvait le craindre. Le père de Bèze qui la voit juste après la révolution de Siam la décrit jetée dans une écurie parmi la puanteur et l'ordure, dénuée de toutes choses, et n'ayant qu'une claie pour se coucher. (Drans et Bernard, 1947, p. 125). Le père Tachard aura l'occasion de la visiter en 1699, lors de son avant-dernier voyage en Asie, et son sort semble s'être sensiblement adouci. D'abord confinée dans un emploi de domestique, on retrouve la veuve de Phaulkon surintendante des cuisines du roi Thai Sa (ท้ายสระ) Sanphet 9. On ignore la date de sa mort, mais le missionnaire Paul Aumont la vit du temps qu'il résidait à Ayutthaya entre 1719 et 1724. Il l'évoque dans ses mémoires, citées par Launay, Histoire de la mission de Siam, 1920, I, p.216, note 1 : Mme Constance, veuve du fameux M. Constance qui a fait tant de bruit du temps de l'ambassade de M. de Chaumont, vint aussi me voir. Cette dame pouvait avoir 65 ou 66 ans ; elle était dans le palais du roi de Siam depuis la mort de M. Constance ; l'usurpateur du royaume l'avait mise au rang de ses esclaves, ce qui, bien loin d'être déshonorant dans le pays, est pour les Siamois un rang d'honneur et leur donne le privilège de faire mille injustices ; mais pour une bonne chrétienne comme était Mme Constance, c'était un véritable esclavage. Elle avait la liberté de venir à l'église lorsqu'elle le souhaitait, et d'aller quelquefois coucher à sa maison, la plus belle du camp des Portugais, où étaient ses petits-fils. Elle avait la direction de plus de deux mille femmes siamoises faisant le service du palais ; elle était surintendante du magasin de la vaisselle d'or et d'argent du roi, de son vestiaire et de tous les fruits qui se servaient à sa table ; dans ces emplois elle aurait pu tirer des sommes considérables ; mais sa conscience ne lui permettant pas de tourner à son profit bien des choses pour lesquelles celles qui l'avaient précédée dans ces emplois n'avaient pas fait de difficulté, elle rendait tous les ans au trésor du roi une somme assez considérable, ce qui faisait dire au roi de Siam qu'il n'y avait que des chrétiens pour être capables d'une si grande droiture, ce qui faisait beaucoup d'honneur à la religion.
Je reconnus tant de religion et de bon esprit dans cette dame, qui connaissait parfaitement le génie de la nation saimoise, ses coutumes et ses chicanes dans les procédures, que je me servis souvent d'elle pour me tirer d'affaires très difficiles, et je me suis toujours très bien trouvé de ses conseils. Elle avait encore sa mère qui demeurait près de notre église, et était âgée de plus de 80 ans ; elle ne pouvait plus marcher, et mourut environ un an après mon arrivée. ⇑
9 - Les deux frégates étaient le Siam et le Louvo, et il y avait trois otages : L'évêque de Métellopolis, Louis Laneau, Véret, et le chevalier Desfarges, fils cadet du général. Dans la confusion du départ, Véret et le fils Desfarges s'embarquèrent subrepticement à bord de l'Oriflamme, ce qui provoqua la fureur des Siamois, qui passèrent leur colère sur le malheureux Louis Laneau. ⇑

12 mars 2019
