
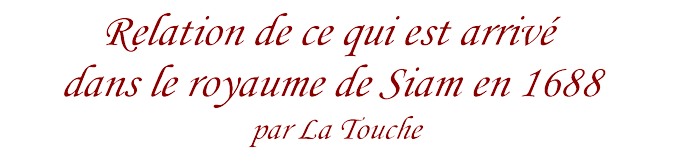
2ème partie.
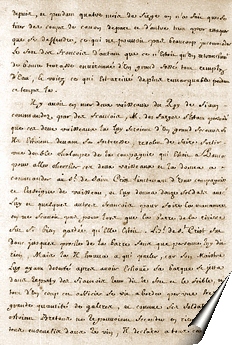
Et voici ce qui est arrivé de plus remarquable pendant ce temps-là. Il y avait en mer deux vaisseaux du roi de Siam commandés par des Français (1). M. Desfarges, s'étant persuadé que ces deux vaisseaux-là lui seraient d'un grand secours s'ils étaient devant sa forteresse, résolut de faire sortir une double-chaloupe (2) de la Compagnie qui était à Bangkok (3) pour aller chercher ces deux vaisseaux, et la donna à commander au sieur de Saint-Cricq (4), lieutenant d'une compagnie et enseigne de vaisseau, et lui donna douze soldats avec lui et quelques autres Français pour faire la manœuvre. On ne savait pas pour lors que la barre de la rivière fût si bien gardée qu'elle était. Le sieur de Saint-Cricq fut donc jusque proche de la barre sans que personne lui dît rien. Mais là il trouva à qui parler, car son maître, lui ayant déserté après avoir échoué sa barque, se jeta dans le parti des Siamois, leur dit le fort et le faible, et tout d'un coup, cet officier se vit aborder par une très grande quantité de galères, et comme ses soldats qui étaient Bretons (5) ne le pouvaient seconder en rien, étant tous ensevelis dans le vin, il déclara à tous ceux de [10r°] sa barque qu'il n'empêchait point qu'ils ne tâchassent de se sauver s'ils le pouvaient, et ensuite se retira où étaient les poudres, et lorsqu'il vit sa barque toute entourée de galères et comblée de Siamois haut et bas, il mit le feu aux poudres et la fit sauter, de sorte que les Siamois ont eux-mêmes estimé la perte qu'ils firent d'hommes dans ce moment-là, tant de tués, de noyés que d'estropiés, à plus de 400 (6). Ce pauvre officier périt avec eux par la trahison de son maître et la brutalité de ses soldats ; il ne s'en sauva que deux personnes seulement, que les Siamois firent prisonniers et qu'ils ont ensuite rendus à M. Desfarges (7).
Je vous dirai aussi que dès le commencement du siège, tous les Français qui étaient à Siam et à Louvo furent tous faits prisonniers et traités de la dernière rigueur. M. l'évêque de Métellopolis fut conduit à Bangkok, dans l'armée ennemie. Il y fut dépouillé nu, fort mal traité, attaché à un poteau et exposé pendant 24 heures à l'endroit où nos batteries faisaient le plus de feu, les Siamois s'imaginant que cela nous obligerait de cesser. Tous les prêtres missionnaires français qui étaient à Louvo ont tous été faits prisonniers, après qu'on leur a eu tout pris, et pillé leur séminaire.
Les révérends pères jésuites ont eu dans cette occasion un bonheur tout particulier : ils ont joui d'une entière liberté, leur maison a été un lieu d'asile inviolable pour [10v°] tous ceux qui s'y sont retirés, tout ce qu'ils ont demandé leur a été accordé (8). Ils ont demandé le fils de défunt M. de Constance : on le leur a donné (9), et dans un temps où tous les Français étaient pillés, maltraités et tués, Phetracha leur a fait présent de cinquante écus à chacun d'eux. Ils ne veulent pas cependant avouer que ce présent vienne de Phetracha, mais que ce soit un ressouvenir du roi (10). À la vérité, ce prince était encore vivant, mais il était sans pouvoir, car il y avait déjà du temps que Phetracha s'en était rendu le maître et à plus forte raison de son trésor, et que ce scélérat faisait tout sous le nom du roi. Mais il lui faisait signer de force les ordres qui autorisaient ses violences afin d'attirer d'autant plus la haine de tout le monde sur ce malheureux prince. Les Français reconnaissent si bien cette vérité que quelques maux qu'ils aient soufferts par des ordres émanés et signés de sa main, ils ne l'en accusent point et rejettent tout sur Phetracha.
Je reviens présentement au siège de Bangkok, que j'avais discontinué pour vous raconter toutes ces petites particularités, et vous dirai que la plus grande partie des troupes de Phetracha, ennuyée et fatiguée tant par la longueur du siège que le mauvais temps, commencèrent à déserter et que le reste menaçait d'en faire bientôt autant. Cela vous surprendra peut-être, mais non quand vous saurez que ce n'est pas comme en Europe, et que ces [11r°] soldats ne sont que peuples ramassés que les mandarins prennent dans leurs seigneuries, tant par amitié que par crainte, et que le roi ne leur donne rien, de sorte que c'est chaque famille qui entretient son parent ; et quand la guerre dure longtemps, on n'envoie plus rien à ces soldats, et c'est ce qui les oblige à déserter.
Phetracha, voyant le désordre de son armée, se résolut de faire la paix avec M. Desfarges. Il lui députa M. de Métellopolis pour en faire les premières ouvertures et lui renvoya ses deux fils en même temps. Le compliment qu'il lui faisait dans sa lettre était assez fier, car il lui marquait qu'il ne tenait qu'à lui de le perdre, quoiqu'il sût bien que lui et toutes ses troupes étaient de braves gens et bien résolus à se défendre, mais que cela ne faisait rien et qu'il n'avait, sans risquer ses soldats, qu'à lui laisser consommer ses vivres et qu'ensuite il fallait périr (11) ; mais non, qu'il voulait la paix avec lui et qu'ils fussent amis.
Quand M. Desfarges eut connu l'intention de Phetracha, il tint conseil avec ses officiers, et lui manda, par le même évêque, qu'il n'était venu à Siam que pour le service du roi, et que présentement si on ne voulait plus de son service, qu'il n'était pas nécessaire de lui déclarer la guerre, qu'on n'avait qu'à le lui faire connaître et lui donner des vaisseaux ; qu'il était prêt de se retirer. Sa lettre fut signée de tous les officiers de la garnison. Je n'en rapporte pas le contenu mais seulement l'essentiel. [11v°] Cette réponse donna lieu à une trêve de plus d'un mois. Les Siamois nous vendaient des vivres comme auparavant, mais plus cher ; on se parlait les uns les autres, et enfin la paix se conclut. Le roi rendit à M. Desfarges tous les Français qu'il tenait prisonniers, et lui fournit trois vaisseaux pour le porter à la côte de Coromandel, lui, tout son monde, et tout ce qui appartenait au roi de France, et lui fit fournir des vivres suffisamment pour la traversée. M. Desfarges de son côté fut obligé de donner pour caution M. l'évêque de Métellopolis et le chef du comptoir de la Compagnie française, tant pour les vaisseaux que pour les vivres qu'on lui fournit, n'ayant point alors d'argent pour les payer (12).
Pendant tout le temps qu'on se préparait à sortir, il nous arriva un sujet qui pensa rompre tout, mais nous étions pour lors bien en état de faire enrager les Siamois, parce que nous avions beaucoup de vivres et leurs vaisseaux. Mais M. Desfarges y remédia contre le sentiment de tout son monde.
Un officier, nommé Sainte-Marie, étant allé à Siam pour demander quelque manœuvre pour les vaisseaux que le roi nous avait donnés, lorsqu'il était prêt de s'embarquer pour revenir à Bangkok, la femme de défunt M. de Constance se présenta à lui, habillée en cavalier, et le pria de la tirer de la captivité où elle était réduite et des poursuites infâmes et brutales que lui faisait journellement le fils de Phetracha. Cet officier, croyant bien [12r°] faire, comme tout autre en sa place l'aurait cru, embarqua cette dame et son fils dans son balon et les amena tous deux à Bangkok. M. Desfarges ne fut pas content de cela. Il en présageait les suites apparemment, et mit même cet officier aux arrêts.
Quand le roi, qui était alors Phetracha, sut la fuite de Mme de Constance, il envoya la demander à M. Desfarges, qui d'abord la refusa. Cela donna lieu à un petit commencement de guerre, et les Siamois de leur côté ne nous voulurent plus rien vendre, et, de grands amis que nous étions le jour d'auparavant, nous voilà ennemis. Le roi Phetracha persista toujours à demander Mme Constance ; M. Desfarges demanda du temps pour y répondre. Il assembla le conseil de guerre deux et trois fois pour délibérer sur cette affaire, et toutes les trois fois les officiers conclurent tous unanimement à périr plutôt que de la rendre (13). Cependant, contre une résolution unanime et un conseil si juste, si bon et si généreux, M. Desfarges, de son autorité particulière, remit cette malheureuse dame et son fils entre les mains de ses tyrans. Je vous proteste que ce fut au grand déplaisir de tous les officiers et soldats de la garnison, qui tous avaient les larmes aux yeux de voir cette malheureuse dame si cruellement abandonnée. À la vérité, auparavant que de la rendre, le Roi donna une promesse à M. Desfarges qu'elle ne serait point insultée, qu'elle demeurerait en toute liberté dans le royaume, tant pour la religion que pour [12v°] toutes autres choses (14), et après cela, nous voilà devenus bons amis.
Il ne faut pas oublier de vous dire que cette malheureuse dame, avant que de repasser dans les mains des Siamois, fit une harangue aux officiers et aux soldats de notre fort. Elle a infiniment d'esprit. Elle nous remercia des bontés qu'on avait pour elle et rejeta la cause de son malheur et de sa reddition sur celui seul qui en était l'auteur (15). Elle tenait son fils entre ses bras, âgé de trois ans ou environ, et elle, de 22 ou 23, bien faite et fort agréable, et c'était assurément un spectacle fort touchant que cette dame désolée, qui faisait paraître à travers son désespoir toute la constance dont une femme est capable. Cela tira des larmes des yeux de tout le monde, et vraisemblablement, elle est réduite à présent à la dernière extrémité et à la dernière infamie, car outre que Phetracha est un scélérat sans parole et sans foi, il se croira autorisé d'en manquer à la promesse qu'il a faite à M. Desfarges de la laisser en tranquillité, puisque M. Desfarges, contre sa promesse, a emmené avec lui le sieur Véret, chef du comptoir de la Compagnie, qu'il avait promis pour otage des vaisseaux comme je vous ai dit ci-dessus.
Après cette belle action, on nous donna ce qui nous manquait afin de nous obliger à nous en aller au plus tôt. M. Desfarges s'embarqua donc avec tous les Français, le 2 novembre dans les vaisseaux qu'on lui avait prêtés. [13r°] Il alla en rade pour joindre un vaisseau du roi nommé l'Oriflamme, qui était venu de France dès le commencement de septembre (16), et lorsqu'il fut sorti hors de la barre de la rivière, les Siamois, voyant qu'il emmenait Véret, un des otages qu'il leur avait promis, arrêtèrent trois mirons (17), qui sont de grands bateaux, façon du pays, dans lesquels étaient les hardes des soldats, trente pièces de gros canon, quelques munitions de guerre, deux officiers et 17 ou 18 soldats ; et tout cela leur est resté entre les mains.
Laissons présentement M. Desfarges faire voile vers Pondichéry, côte de Coromandel, et voyons ce qui s'est fait à Mergui. Pendant que les Français à Bangkok ont couru grand risque et qu'on n'a rien épargné pour les perdre, ceux de Mergui, commandés par M. Du Bruant, n'ont pas eu meilleur marché, et même ont couru beaucoup plus de risque, étant peu de monde et dans un lieu qui n'était point fortifié. Nous étions arrivés à Mergui le 27 mars 1688, trois compagnies qui faisaient 90 hommes, sous le commandement de M. Du Bruant. Nous y avons trouvé, sur le haut d'une montagne, un petit fort de bambou en façon de deux bonnets carrés, dans lequel il y avait 8 à 10 méchantes pièces de canon pour battre dans le port, et lequel était si petit que le magasin des munitions de guerre en contenait la moitié. Au bas de cette même montagne, il y avait un méchant ouvrage [13v°] à corne, dans lequel il y avait 18 pièces de canon battant à fleur d'eau pour défendre l'entrée du port.
D'abord que nous y fûmes arrivés, M. Du Bruant donna ses ordres et ses soins pour faire faire un retranchement d'un rempart de quatorze pieds de large où nous étions campés, qui était autour de cet ancien petit fort. Mais avec toute la diligence qu'il a pu y apporter, il n'a pu le rendre parfait à cause du peu de temps que nous avons été en paix.
Dès le mois de mai ensuivant, M. Du Bruant fut averti de se défier des Siamois et qu'ils avaient dessein de nous en faire autant qu'ils en avaient fait aux Anglais l'année précédente, c'est-à-dire de nous égorger tous (18). Quelques jours après cet avis, tous ceux qui travaillaient avec nos soldats à notre retranchement quittèrent tous ensemble, et il n'en revint pas un. Cela confirma l'avis qu'on avait donné à M. Du Bruant. C'est pourquoi, se voyant si mal fortifié, il s'assura d'une petite frégate de 24 pièces de canon, laquelle était toute armée dans le port, et qui appartenait au roi de Siam (19), précaution qui lui a été dans la suite d'un grand secours. Il fit faire dans le milieu de la place un retranchement de palissades pour s'y retirer en cas que les ennemis forçassent son retranchement de terre. Le vice-roi de la province de Ténassérim et Mergui ayant reçu les ordres du roi, ou plutôt de l'okphra Phetracha, de passer tous les Français au fil de l'épée, commença à la fin de mai de faire investir M. Du Bruant avec 12 000 hommes, et voyant qu'il ne [14r°] pouvait pas le surprendre, à cause que nuit et jour il faisait faire bonne garde, il se résolut de le forcer. Mais avant cela, il voulut tenter le hasard par une autre voie.
Ce vice-roi avait la lettre que Phetracha avait obligé M. Desfarges d'écrire à M. Du Bruant, par laquelle il lui ordonnait de quitter Mergui et de le venir joindre dans un lieu qu'il lui indiquait (20). Il la lui envoya par un mandarin, lequel, en la lui donnant, lui demanda de sa part pourquoi il se tenait ainsi sur ses gardes depuis quelque temps et ce qu'il craignait ? Qu'il ne fallait pas croire tous les bruits qui couraient et qu'il apprendrait, et que s'il avait besoin de quelque chose on le lui donnerait. M. Du Bruant, qui connaissait le génie de ces gens-là, ne donna pas là-dedans, et ayant consulté cette lettre de M. Desfarges et les termes extraordinaires dans lesquels elle était conçue, il se douta qu'il y avait de la surprise, ainsi le lendemain, quand on vint lui en demander la réponse et qu'on lui dit que s'il voulait partir, tout était prêt, il dit que non et qu'il ne connaissait point ces ordres-là, et ayant dessein de tirer les choses en longueur, il dit qu'on lui en fît venir d'autres et qu'il allait écrire à M. Desfarges si on voulait lui faire tenir ses lettres. Ils refusèrent cette proposition et après tout ce vice-roi manda à M. Du Bruant par le révérend père d'Espagnac, jésuite (21), qu'il lui ferait exécuter de force les ordres de son général.
Dès le lendemain, 26 juin, il se mit en devoir d'exécuter sa menace. Il avait assemblé toutes ses forces, qui consistaient [14v°] en plus de 12 000 hommes. Il les divisa en trois corps pour monter à l'assaut par trois endroits différents, connaissant bien qu'il y avait trop peu de Français pour bien défendre leur retranchement qui était grand et imparfait. Le signal fait sur les huit à neuf heures du matin, on vit venir ces gens en confusion, hurlant comme s'ils avaient donné chasse à des loups ; on ne s'en étonna pas beaucoup aussi.
M. Du Bruant qui les attendait de pied ferme avec peu d'hommes effectivement, mais bien résolus, mit si bon ordre à tout et fut si bien obéi que tout réussit à notre avantage. On les laissa approcher jusque sur le bord du fossé sans tirer un seul coup ; alors la mousqueterie et les grenades donnèrent dessus d'une telle force qu'ils prirent l'épouvante et la fuite en même temps, et laissèrent plus de 100 hommes sur le carreau et plusieurs blessés. Ils employèrent le reste du jour à nous canonner d'une pagode qui était à la portée du fusil de notre retranchement, où ils avaient dressé une batterie de quatre pièces de canon qui nous incommoda beaucoup et tua même quelques soldats.
Le lendemain 27, ils tentèrent encore fortune, et après avoir redoublé leur prise d'affion (22), ils revinrent à 8 heures du matin dans la même confusion que la veille. On les reçut avec pareils honneurs, et il y en eut environ 200 qui en furent si satisfaits qu'ils y sont restés depuis.
Pendant qu'ils voulaient nous forcer dans notre retranchement, ils firent d'un autre côté leur possible pour prendre [15r°] et enlever avec des galères la frégate dont M. Du Bruant s'était assuré dès le commencement de la guerre et dans laquelle il avait envoyé 17 soldats avec un officier nommé Du Chemin-Franqueville pour renfort, lesquels firent si bien leur devoir qu'ils coulèrent à fond une galère et obligèrent les autres de se retirer fort incommodés, et bien des morts.
La vigueur dont nous défendions étonnait les Siamois, et il est certain que si le vice-roi en avait été le maître, il nous aurait laissés en repos, mais ayant des ordres de se défaire de nous à quelque prix que ce fût, il fallait les exécuter ou perdre la tête ; c'est pourquoi il résolut de commencer par brûler la frégate, ce qui lui était fort facile, et ensuite d'escalader notre retranchement de tous côtés, ce qui aurait infailliblement réussi par la quantité de monde contre si peu que nous étions, étant résolu de venir lui-même à la tête de ses gens pour les animer par sa présence.
M. Du Bruant fut averti que cette résolution avait été prise, et j'ai vu moi-même peu de temps après les machines qu'on avait commencé de faire et les échelles qu'on préparait. Il assembla sur cet avis ses officiers pour consulter sur le parti qu'on devait prendre, et voyant la nécessité où il était réduit, n'ayant pour tous vivres que pour 5 ou 10 jours de riz et rien autre chose, et qu'il n'avait point d'eau dans le retranchement, qu'il avait peu de monde, n'étant pas en tout, tant officiers que soldats, 70 ou 72 hommes, et que puisqu'on avait juré leur perte, il serait facile d'en venir [15v°] à bout lorsqu'on aurait brûlé leur frégate. Toutes ces raisons mûrement pesées, M. Du Bruant trouva à propos d'abandonner son retranchement et de faire une honorable retraite pendant qu'il en avait encore le pouvoir, ainsi il s'embarqua le 28 juin (23), mais non pas avec tout son monde car il y en eut de tués et de noyés pendant l'embarquement et même il y en eut encore de tués et d'estropiés après s'être embarqués (24), et peu s'en fallut qu'ils ne périssent tous et que leur frégate ne fût coulée à fond par la quantité de coups de canon que les Siamois tirèrent dessus pendant plus d'une heure, et cela par l'imprudence ou la trahison de notre maître canonnier, à qui on avait ordonné de mettre une mèche dans le magasin aux poudres, de longueur mesurée, afin qu'on n'eût simplement que le temps de gagner le pied de la montagne avant que le feu y prît, ce qui ne fut point exécuté, et on n'a point encore pu savoir ce qu'était devenu ce canonnier. Enfin, le vent qui vint favorable tira M. Du Bruant hors du port de Mergui, et il va être obligé pendant quatre mois de gagner quelque île déserte pour y attendre la mousson, ou saison des vents, qui le conduiront à Bengale ou à Pondichéry.
Vous voudrez bien, après vous avoir fait connaître toutes les particularités considérables qui sont arrivées à Siam, que je vous raconte ce qui m'est arrivé en mon particulier et combien de sortes de personnages j'ai faits. Il faut premièrement remarquer que le 27 juin (25), ayant [16r°] été commandé par M. Du Bruant pour aller garder l'ouvrage à corne dont je vous ai parlé ci-devant, qui défend l'entrée du port de Mergui, avec 50 soldats siamois, l'officier que je fus relever ne fut pas plutôt sorti qu'à soixante pas de là il fut assassiné par 700 ou 800 personnes qu'il rencontra dans son chemin, lesquels vinrent se rendre maîtres de l'ouvrage à corne où j'étais ; et aussitôt qu'ils parurent, ma garde prit les armes, mais ce fut pour me trahir et me livrer entre les mains des ennemis. Ensuite on me conduisit prisonnier, et je fus pendant quatre jours attaché à un poteau avec des chaînes de fer par le col, les pieds et les mains (26). Ne soyez pas surpris quand je vous ai dit que j'avais été commandé avec 50 soldats siamois : c'est que M. Du Bruant ne savait pas comme les choses se passaient dans le royaume, et il croyait, suivant les avis qu'on lui donnait, que ce n'était qu'une révolte de la seule province de Ténassérim et Mergui. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour-là, il avait toujours conservé les soldats que le roi de Siam, notre allié, lui avait donnés en arrivant à Mergui, qui étaient au nombre de 300 hommes.
Le 29 ensuivant, qui fut le lendemain de la retraite de M. Du Bruant, on me détacha du poteau où j'étais et on me conduisit chez le vice-roi de la province, qui ordonna en même temps qu'on me menât visiter tous les Français qui avaient été tués la veille, lors [16v°] de cette retraite. Ils étaient au nombre de 13 en tout. Jamais homme ne put voir de spectacle plus horrible que celui que je vis dans ce moment, car les uns étaient ouverts par le ventre, les autres par le dos, d'autres par le côté, et tous généralement avaient les intestins hors du corps et même il y en avait déjà trois ou quatre que les chiens avaient commencé de dévorer ; et après que ces misérables tyrans m'eurent fait voir jusqu'où était allé l'excès de leur rage, ils me reconduisirent chez le vice-roi, mais en passant à travers de la ville, je ne manquai point de saluts, qui consistaient en soufflets et coups de pied, et ceux qui m'avaient été donnés pour escorte eurent bien de la peine dans ce temps-là de me sauver la vie, et on entendait de toutes parts crier : — Quoi ! voilà encore un Français ! Tollé, tollé, crucifigé eum ! (27)
Étant de retour chez le vice-roi, il me mena avec lui au divan, où il y avait quelque 50 des plus grands mandarins de la province. Là, on commença de me vouloir donner de grandes espérances et de me vouloir persuader qu'il ne tenait qu'à moi de devenir grand seigneur chez eux, et qu'en leur avouant ce qu'ils m'allaient demander, je pouvais aussi de ma part leur demander tel emploi que je voudrais.
D'abord ils commencèrent à m'interroger sur des bagatelles et sur des choses de nulle conséquence, et [17r°] puis ensuite, me croyant disposé à leur accorder tout, ils commencèrent à me demander s'il n'était pas vrai que tous les Français fussent venus à Siam à l'insu du roi ; que ç'avait été M. Constance seul qui les avait appelés ; si ce n'avait pas encore été lui qui nous avait donné les places de Bangkok et de Mergui sans la participation du roi, et s'il n'était pas vrai que tout cela ne s'était fait qu'à condition de le rendre maître du royaume, et que nous attendions pour cet effet des navires de France qui devaient venir tant à Siam qu'à Mergui dans tout le mois de septembre prochain, chargés de soldats, et que nous attendions leur arrivée pour nous déclarer en faveur de M. Constance contre le roi.
Je leur fis réponse qu'ils devaient s'adresser à leurs ambassadeurs qui avaient été en France pour savoir ces choses-là, et non pas à moi qui n'était qu'un simple officier à qui on ne confiait pas des choses d'une pareille conséquence. Et en m'adressant au vice-roi même, je lui dis qu'il n'avait lui-même qu'à consulter les ordres que nous lui avions apportés lorsque nous étions arrivés à Mergui, et en vertu desquels il nous avait fait si bonne réception, cédé la possession de cette place, et même donné plus de 2 000 hommes pour nous y fortifier, et que tout ce monde y était resté par son ordre pendant plus d'un mois de temps ; qu'il pouvait voir si ces ordres étaient du roi ou non ; qu'il fallait qu'ils [17v°] fussent du roi, puisqu'il y avait obéi, et qu'après tout, je n'avais aucune connaissance de tout ce qu'ils me demandaient.
Ils me dirent derechef que je prisse garde à moi, et que je voulais me rendre malheureux ; qu'ils étaient assurés que je savais tout ce qu'ils me demandaient, d'autant que M. Du Bruant ayant assemblé tous les officiers il y avait plus d'un mois, leur en avait fait confidence, et qu'en étant du nombre, je devais le savoir ; c'est pourquoi, si je ne voulais pas le leur avouer d'amitié, ils me le feraient dire de force.
Je leur répartis que ni leur amitié ni leur force ne me ferait jamais dire ce que je ne savais point, ni avouer ce qui était faux pour une vérité. Dans ce même temps-là, je vis tous ces mandarins courroucés de ma résolution, et vis aussitôt quatre bras-peints (28) qui sont leurs exécuteurs de justice, se venir saisir de moi. Je crus d'abord, connaissant ces sortes de gens, qu'on m'allait faire mourir, ce qui ne me surprit pas beaucoup parce que, dès le moment que j'étais tombé entre leurs mains, je m'y étais résolu et préparé. Mais je fus trompé, car ces quatre estafiers me menèrent seulement au bout du divan. Ce qu'on appelle divan est un lieu destiné pour rendre la justice et pour délibérer des affaires de conséquence qui concernent l'État. Je vis en même temps les quatre premiers mandarins se détacher des autres pour venir me tenir compagnie, et ils ne furent pas plutôt assis qu'en même temps [18r°] on commença à me lier les deux bras au-dessus du coude par le derrière, et à force de me les serrer contre le dos, on me les fit joindre l'un contre l'autre à corde tendue, de sorte que je crus avoir les deux bras rompus. Après m'avoir laissé quelque temps dans cet état, ils me délièrent, mais ce fut pour me faire pis, car voyant ma persévérance, ils me serrèrent entre des morceaux de bois tous les doigts des deux mains, de sorte qu'ils les rendirent tous plats. Ensuite, ils m'attachèrent une corde aux deux gros doigts et puis me soulevèrent en l'air, puis après, deux de ces bras-peints, un à droite et l'autre à gauche, après m'avoir ôté la chemise qui était la seule chose qui me restait sur le corps, commencèrent à faire jouer le rotin à qui mieux mieux sur mon pauvre dos.
Comme ces gens-là me tenaient depuis plus de quatre heures dans les tourments, et que la nature n'en pouvait plus et que mes forces étaient épuisées, je tombai en défaillance, ce qui les obligea de me laisser, croyant que j'allais expirer. Cependant, ils eurent encore la charité de faire venir un père missionnaire pour me donner quelque soulagement, lequel me voyant les bras et les mains noirs comme de l'encre et le dos tout déchiré de coups de rotin, dit pour me consoler qu'il aurait voulu être en ma place et avoir souffert pour moi. Et en même temps, il bassina mes plaies et me frotta tout le corps avec beaucoup d'eau-de-vie. Voilà [18v°] le seul remède humain que j'ai eu pendant que j'ai été entre les mains de ces scélérats ; mais j'en ai reçu de bien plus grands de la providence.
Le 5 juillet ensuivant, on me fit sortir de Mergui pour me conduire à Siam avec un nommé Picard, caporal, qui fut fait prisonnier le jour de la retraite de M. Du Bruant et qu'ils croyaient officier ; et quoique nous fussions tous deux enchaînés par les pieds et les mains, et chacun une cangue au col, ils ne laissèrent pas de nous donner plus de 60 hommes armés pour nous conduire. Nous souffrions beaucoup par les chemins car on ne nous donnait qu'un peu de riz et de l'eau, et il fallut toujours rester assis, ne pouvant nous coucher ni sur le dos ni sur le côté à cause de la cangue que nous avions au col.
Le 17 juillet, j'arrivai à Siam, et le 19 à Louvo, et le premier endroit où l'on me mena, ce fut au divan où présidait le barcalon avec plusieurs grands mandarins qui m'interrogèrent encore de nouveau. Le barcalon est le chef de la justice, et devant qui passent toutes les affaires du royaume.
Le lendemain 20, j'appris par un prêtre missionnaire, nommé M. Pommare (29), qui découvrit par hasard l'endroit où j'étais prisonnier, que l'on attendait de jour à autre M. l'évêque de Métellopolis, qui était allé à Bangkok pour moyenner la paix avec M. Desfarges, et [19r°] le 25, ce même prélat revint à Louvo avec un consentement de M. Desfarges pour la traiter.
Le roi de Siam étant enfin mort dans le mois de juillet, on ignore encore le jour et la manière (30), Phetracha, qui avait si bien disposé toutes choses à son avantage, partit de Louvo le 31 juillet pour aller à Siam se faire couronner roi, ce qui lui a réussi sans aucun contredit.
Tous les Français et Anglais qui étaient détenus prisonniers à Louvo furent le lendemain conduits à Siam. J'en fus du nombre et y arrivai le 3 août, avec quatre autres officiers, qui sont MM. de Fretteville, Saint-Vandrille, Des Targes et De Lasse ; et le 9 du même mois, Phetracha, à présent roi, nous envoya tous cinq à Bangkok, non pas à notre général, mais à son général des Malais qui nous garda encore prisonniers près d'un mois, et ensuite nous fûmes rendus à M. Desfarges, la paix étant conclue le ... septembre (31), et peu après notre reddition, arriva l'affaire de la pauvre Mme de Constance dont je vous ai parlé.
Le 26 septembre, M. Desfarges me fit partir de Bangkok pour retourner à Mergui m'y embarquer pour aller chercher M. Du Bruant, afin de lui porter le traité de paix qui avait été fait, et le roi de Siam me donna un mandarin pour me faire fournir tout ce qui me serait nécessaire.
[19v°] Le 1er novembre, je m'embarquai à Mergui, où j'étais arrivé le 12 octobre, dans une petite frégate du roi de Siam, et j'allai dans les rivières de Tanaïs, de Martaban et Sevian (32), côte du Pégou, croyant y trouver M. Du Bruant, mais non ; cela m'obligea de passer par les îles de Rey, et ayant mouillé à une et étant allé à terre, je connus que M. Du Bruant y avait été par plusieurs marques et signes que j'y trouvai, principalement par quelques morceaux de justaucorps de soldats français et même de vieux câbles et une machine dont on s'était servi pour en faire de neufs. J'y ai aussi vu deux baraques.
Je suis ensuite retourné à Mergui le 12 de novembre, et ayant trouvé un navire de la Compagnie française nommé le Coche, commandé par M. d'Armagnac ; je m'y suis embarqué le 13 du même mois pour aller à Pondichéry y attendre M. Desfarges et y rejoindre M. Du Bruant, que j'y crois présentement.
Paul Lucas (33)
Fin de la relation de La Touche

NOTES :
1 - Ces deux navires, partis le 1er mars 1688 et qu'on crut quelque temps perdus, étaient le Siam et le Louvo, commandés par M. de Sainte-Marie, nom de guerre du lieutenant de Larre ou Delars, et Suhart. Selon le père Le Blanc, ils avaient pour missions d'aller croiser sur un corsaire dans le golfe de Siam, avec un ordre secret qu'ils avaient de M. Constance d'interrompre leur course aux premiers bruits de guerre et de troubles qui pourraient arriver dans le royaume, et d'aller se mettre sous le canon de Bangkok, où il recevraient les ordres de M. Desfarges pour le service des deux rois. (Histoire de la révolution du royaume de Siam, 1692, I, p. 32). Beauchamp donne une autre version de la mission qui leur était confiée, tout aussi vraisemblable que celle du père Le Blanc : M. Desfarges vit l'ordre que ces deux officiers lui montrèrent qui était d'aller après ces forbans, et un autre ordre que mon dit sieur Constance avait donné pour aller brûler les vaisseaux anglais qui seraient en rade de la ville de Madras, côte de Coromandel. Les sieurs de Sainte-Marie et Suhart écrivirent à M. de Constance que cela ne se pouvait, la saison étant contraire. M. Constance leur écrivit de sortir et qu'ils tinssent la mer et d'aller où ils voudraient et de ne revenir que dans quatre mois (A.N. Col. C1/25 f° 73v°). Desfarges, pour se justifier, accusa plus tard Sainte-Marie de lui avoir dissimulé ce second ordre mais il est vraisemblable, comme le laisse entendre François Martin, que le général et tous les Français étaient parfaitement informés de la mission des deux officiers et que d’ailleurs les personnes qui n’entraient point dans les sentiments de M. Constance étaient surpris de la facilité de M. Desfarges à permettre l’embarquement des troupes du roi pour faire la guerre aux Anglais. (Mémoires de François Martin, 1934, III, p. 17). L'expédition de Sainte-Marie et Suhart dura plus longtemps que prévue, puisque selon un abrégé de ce qui s’est passé à Bangkok pendant le siège en 1688 (Archives Nationales, Col. C1/24 f° 140r°-171v°), les deux navires ne furent de retour que le 5 septembre. ⇑
2 - Petit bâtiment qui n'est point ponté, et qui est plus long et plus bas de bord que les barques ordinaires, aigu par son avant, et qui va à voiles et à rames. Il a le gabarit d'une chaloupe, et en beaucoup d'endroits ou l'appelle double-chaloupe. (Nicolas Aubin, Dictionnaire de marine, 1736, pp. 84-85). ⇑
3 - Selon l'Abrégé de ce qui s'est passé à Bangkok […] (AN Col. C1/24, f° 155r°), cette barque s'appelait le Rosaire. Beauchamp indique qu'elle appartenait à Véret (Lettre de Middelbourg du 17 novembre 1689, AN, Col. C1/25 f° 77v°). C'est peut-être celle que François Martin appelle la Vérette dans ses Mémoires (1934, III, pp. 27, 78 et 79). ⇑
4 - La Touche orthographie Saint-Christ On trouve dans d'autres relations Saint-Cry, Saint-Criq, Saint-Cri, etc. Nous avons conservé l'épellation des documents officiels. Dans la Liste des Officiers choisis par le roi pour commander les compagnies d'infanterie que Sa Majesté envoie a siam datée du 14 février 1687 à Versailles et conservée aux Archives Nationales de Paris sous la référence Col. C1/27 ff° 46r° et suiv., Saint-Cricq apparaît comme enseigne de la 7ème compagnie. ⇑
5 - Le père Leblanc confirme qu'il n'y avait dans la barque que huit soldats Français presque tous ivres et couchés sur le pont. La chose était ainsi : un accident léger y avait donné occasion. La frégate en se retirant avait reçu de la batterie des ennemis un coup de canon qui avait cassé une cave remplie d'eau-de-vie. Les soldats avaient recueilli cette liqueur avec trop de soin, et pour n'en laisser rien perdre ils s'étaient enivrés. (op. cit., I, p.267). Beauchamp note pour sa part que la plupart des soldats étaient en désordre pour avoir bu un peu trop d'eau-de-vie (BN Ms. Fr. 8210, f° 537r°), La Touche est le seul à indiquer qu'ils étaient Bretons, sans préciser s'il entendait dénoncer chez eux un goût prononcé pour l'alcool, ou honorer un sens aigu de l'économie. ⇑
6 - Le chiffre paraît très exagéré, et il peu probable que 400 hommes aient pu monter à bord de cette petite barque. L'Abrégé de ce qui s'est passé à Bangkok […] (op. cit. f° 155v°) parle plus raisonnablement de plus de 200. ⇑
7 - Les deux rescapés français étaient un soldat nommé La Pierre, et un petit mousse dont aucune relation ne révèle le nom. Le soldat n'alla pas loin. Le père Le Blanc relate qu'il gagna le bord du fleuve à la nage, portant son sabre à la bouche. Quand il fut à terre, il se vit aussitôt environné d'une troupe de Siamois contre lesquels il se défendit longtemps, en tua cinq et tomba enfin sur eux percé de coups. (Op. cit., I, p. 271). Les témoignages sont plus contradictoires quand au sort du mousse. L'Abrégé de ce qui s'est passé à Bangkok […] (op. cit. f° 155v°) indique : Le petit mousse se sauva à la nage. Les galères, enragées de ce qui venait d'arriver, lui tirèrent plusieurs coups de canon dans l'eau en le suivant, ce qu'ils firent longtemps, mais comme la rivière est d'ordinaire trouble, cela le favorisait, et d'ailleurs y ayant des petits îlots flottants sur lesquels il se reposait et cachait, cela le sauva ; [il] revint à Bangkok et est mort quatre mois après. Selon Beauchamp, malgré un coup de mousquet dans le bras, il aurait réussi à se sauver et à regagner la forteresse où il aurait raconté toute l'histoire (B.N. Ms. Fr. 8210 f° 538r°). Le père Le Blanc, qui sous-entend l'avoir vu, affirme qu’il aurait été blessé au bras et au talon, fait prisonnier par les Siamois, puis emmené et durement persécuté dans les geôles de Louvo : Un jeune Français qui se sauva, comme j'ai dit, de la barque de Saint-Cricq quand il y mit le feu, ayant été pris des Siamois, souffrit les derniers excès de leur cruauté en haine de la religion. Ils faisaient des croix de bambou, et lui mettant une moitié de coco sur la tête, ils la lui enfonçaient avec des coups qu'ils lui donnaient de ces croix, en dérision de notre sauveur ; et comme ce jeune homme avait le bras cassé d'une balle de mousquet, ils prenaient plaisir à sonder la profondeur de la plaie avec des morceaux de bois et à la remplir de terre. Ils l'amenèrent ainsi dans les prisons de Louvo, où les pères jésuites le guérirent plus par l'assistance de Dieu que par leur habileté en ces sortes de cures. (Op. cit. I, pp. 302-303). ⇑
8 - De fait, aucun jésuite ne figurait dans le Catalogue des prisonniers ecclésiastiques et laïques dressé par le missionnaire Martineau en 1690 (Launay, Histoire de la Mission de Siam, 1920, I, pp. 247 et suiv.). L'auteur de l'Abrégé de ce qui s'est passé à Bangkok […] écrivait : Il n'y eut que les pères jésuites à qui l'on n'a jamais fait de tort. Ils étaient logés dans une maison du [roi]54 qu'on laissa en paix, et cette maison fut un asile inviolable pour tous ceux qui s'y retirèrent, au nombre de vingt, tant Castillans, Portugais, Anglais que Français. (Op. cit., f° 149v°). Le père Le Blanc confirmait naïvement cette clémence des Siamois : Les pères jésuites que tout le monde avait cru devoir être pillés et massacrés, furent les seuls qui sortirent de Louvo sans rien perdre. Leur maison toute environnée qu'elle était de gardes, fut pendant toute la persécution un asile inviolable pour tous les chrétiens qui purent s'y retirer. Leurs propres gardes adoucis devinrent dans la suite leurs domestiques, rendant à ces pères toutes sortes de services. (Op. cit., I, p. 352). L'affirmation de La Touche inspira sans doute à Challe ce paragraphe dans lequel il donne libre court à sa détestation des jésuites : Les seuls jésuites ont été à couvert de la persécution, et leur fine politique y a si bien réussi que bien loin d'avoir été vexés en quoi que ce soit, on leur a donné de l'argent pour s'en aller. On s'attend ici que suivant leur coutume de donner des soufflets à la vérité, il donneront en Europe une Histoire de la Révolution de Siam où il chanteront les Lamentations de Jérémie, et canoniseront de leur autorité les pères de leur Société qui y étaient, et les inscriront dans leur martyrologue. Croyez-moi, ne leur offrez point de bougies : la cire et le coton en seraient perdus. (Journal d'un voyage fait aux Indes orientales, 1721, II, pp. 169-170). ⇑
9 - La Touche laisse entendre que Georges, le fils de Phaulkon, âgé d'environ 4 ans lors du coup d'État, fut accueilli dans la maison des jésuites à Ayutthaya, sur leur demande. Rien n'est moins sûr, et cette affirmation ne se trouve dans aucune autre relation. Au sujet de Mme Constance, le père Le Blanc écrivait : elle fut faite esclave avec son fils d'un mandarin nommé Simounkiai (op. cit., II, p. 23), et plus loin (pp. 51-52) : Ce petit innocent, accoutumé aux délicatesses des enfants de sa condition n'avait pour tout habit qu'une chemise de toile rayée et couchait comme les autres prisonniers sur la terre parmi les vers et les insectes dont leur prison était pleine. Son âge de quatre ans ne lui avait pas encore donné assez d'ouverture d'esprit pour ressentir le désastre de sa Maison, mais il en avait assez pour faire à sa mère mille questions affligeantes, qui perçaient le cœur de cette bonne dame. Plus tard, Georges Phaulkon ne fut pas confié aux jésuites, mais aux prêtres des Missions Étrangères. En 1694, Alexandre Pocquet, qui assurait l'enseignement au séminaire, écrivait : Je vous assure qu'il [Georges Phaulkon] est mon écolier depuis sept ou huit mois, que je viens de lui faire la leçon et à ses autres petits camarades, et que voilà actuellement un clerc tonkinois qui la leur fait répéter à côté de moi, et m'interrompt bien fort. Ce petit Georges a huit ou neuf ans, parait faible de corps et de santé, mais il a un bon esprit et de très bonnes inclinations pour son âge. Depuis le peu de temps qu'il est ici, il ne me parle déjà qu'en latin, et m'entend dans la même langue, quoi que je lui dise. Il ne sait pourtant encore rien de la grammaire, si ce n'est un peu décliner. Sa mère l'aurait mis bien plus tôt ici, si on ne l'en avait détournée. Quoique nous nourrissions et enseignions ce pauvre enfant par charité comme les autres, il n'y a rien qu'on n'ait fait auprès de la mère et de l'enfant pour nous le retirer, mais la mère s'en est rapportée à ses yeux, et l'enfant à son inclination. Croiriez-vous qu'après tout cela, on a trouvé des personnes qui ont accusé cette pauvre veuve désolée de je ne sais quelle nouvelle conspiration avec les Français, sur ce qu'elle avait mis son enfant avec nous. Elle fut arrêtée quelque temps. Les Siamois qui permettent qu'un chacun vive suivant sa religion, et qui ont coutume de mettre leurs enfants chez les talapoins, ne lui firent pas grande peine sur ce qu'elle avait mis le sien ici. Elle s'est tirée d'affaire, et l'enfant, qui avait été cependant obligé de s'absenter, revint vers le vingtième d'août avec autant de joie qu'il avait versé de larmes lorsqu'il fut obligé de s'en aller. Je fis réciter, le jour de saint Louis, quelques centaines de vers latins devant Monseigneur ; cet enfant en eut une bonne partie, dont il s'acquitta parfaitement bien. (Launay, Histoire de la Mission de Siam I, p. 299). ⇑
10 - La Touche était-il particulièrement bien informé, relayait-il des rumeurs ou échafaudait-il des hypothèses ? Quoi qu'il en soit, son affirmation est plausible. On peut penser que même si cette initiative ne venait pas directement de Phetracha, il l'avait forcément autorisée, le roi malade n'étant plus en état d'imposer sa volonté. Le père Le Blanc donnait ainsi la version officielle des jésuites : Ce bon roi, pour faire plus d'honneur aux pères, leur envoya cet argent par le second mandarin du royaume avec une grande suite qui nous donna l'alarme dont j'ai parlé. Lorsque ce mandarin fut à leur maison et qu'il les eut tous assemblés, comme j'ai dit, il leur parla ainsi : — Le roi mon maître conserve un souvenir particulier des grandes recommandations avec lesquelles le roi de France vous a envoyés en ce royaume. Sa Majesté vous a fait entretenir par M. Constance tandis qu'il a vécu. À présent que vous n'avez plus personne, elle appréhende que vous ne manquiez d'argent, et m'a chargé de vous en apporter de sa part. En même temps un esclave s'avança pour présenter sur un bandège de la Chine un cati, c'est-à-dire cinquante écus à chacun des sept pères, qui en sa présence mirent tout l'argent entre les mains du supérieur. Le mandarin reçut ensuite par écrit le remerciement des pères au roi, et n'y répondit que par une inclination de tête, disant seulement : — Nous sommes dans un temps où il faut avoir la langue courte. (Op. cit., I, pp. 347-348). Le père d'Orléans, s'appuyant sur les récits des jésuites, résumait ainsi cet épisode : Trois ou quatre jours avant qu'il mourût, ayant ouï dire que ces pères étaient en danger de tomber dans la nécessité à cause des aumônes qu'ils avaient faites aux chrétiens durant la persécution, il fit demander à Pitracha quelque argent pour en disposer; et l'ayant reçu, il l'envoya aux pères, disant qu'il n'était pas juste que des gens qui lui avaient été recommandés si particulièrement par le grand roi manquassent des choses nécessaires. (Histoire de M. Constance […], 1690, pp. 122-123). ⇑
11 - Selon l'abrégé de ce qui s’est passé à Bangkok pendant le siège en 1688 (op. cit., f° 156v°), les fils Desfarges et Louis Laneau revinrent à Bangkok le 24 juin 1688. Le 24, nous vîmes arriver M. l'évêque de Métellopolis de l'autre bande avec MM. Desfarges que Phetracha renvoyait très généreusement avec une lettre à M. Desfarges où il se plaignait qu'il ne lui avait pas tenu sa parole. Ces messieurs passèrent le même jour de notre côté et M. l'évêque resta détenu de l'autre. ⇑
12 - L'affaire des otages justifia amplement la défiance que les Siamois manifestèrent par la suite envers la parole des Français. Il était conclu que, pour garantir la sécurité des Français lors de leur sortie du royaume, deux otages seraient donnés de part et d'autre, qui seraient échangés dès que les navires seraient en sûreté en mer. Le chevalier Desfarges, fils cadet du général, et le major Beauchamp, les deux otages désignés du côté français, parvinrent à fausser compagnie à leurs gardiens et à s'embarquer avec les troupes, emmenant avec eux les deux otages siamois qui ne purent regagner leur pays qu'en 1691, avec l'escadre Duquesne-Guitton. Par ailleurs, le traité de capitulation prévoyait que Mgr Laneau et Véret (qui s’étaient d’ailleurs portés volontaires) devaient rester au Siam pour répondre de la bonne exécution du traité de capitulation et de la restitution des navires et des sommes avancées par les Siamois. Ils accompagnèrent les Français sur un mirou jusqu'à leur embarquement sur l'Oriflamme, et Véret, profitant de la confusion du départ, trompa la vigilance de ses gardes et monta prestement à bord du vaisseau. Mgr Laneau, formellement accusé par le père de Bèze d'avoir prémédité une fuite semblable, n'eut pas la présence d'esprit de Véret et demeura sur le mirou. Il fut rudement malmené en représailles de cette traîtrise. ⇑
13 - Les autres relations n'indiquent que deux réunions du Conseil. Selon l'abrégé de ce qui s’est passé à Bangkok […] (op. cit., f° 162v°) la première se serait tenue le 7 octobre. Saint-Vandrille et le père Le Blanc confirment les deux réunions, mais Le Blanc en fixe les dates aux 9 et 14 octobre (op. cit., II, pp. 67 et 70). Quant aux résultats de ces concertations, ils ne semblent pas avoir été aussi unanimes que ce qu'en rapporte La Touche, et là encore, les avis divergent. Le Blanc (II, p. 69), Saint-Vandrille (A.N. C1/25 f° 115r°) et Vollant (Histoire de la révolution de Siam, 1691, p. 131) s’accordent pour évoquer deux avis contraires, sans les nommer. L'abrégé de ce qui s’est passé à Bangkok […] relève aussi deux avis contraires, et nomme Desfarges et de la Roche du Vigier. Le père d’Orléans (op. cit. p. 178), s’appuyant sur des documents jésuites, rapporte lui aussi deux avis contraires et cite les deux fils de Desfarges. Beauchamp (B.N. Ms. Fr. 8210 f° 553r°) relève quatre avis contraires : les deux fils de Desfarges, Vollant et de la Roche du Vigier ; quant à François Martin, qui n’en rapporte que ce qu’il a entendu, il parle comme Beauchamp de quatre avis contraires, les deux fils Desfarges, un officier qui touchait le général d'une alliance de loin (sans doute La Roche du Vigier), et un quatrième qu'il avait encore attaché à son parti (Mémoires, 1934, III, p. 22). Selon Le Blanc (II, p. 70), la seconde réunion du Conseil, le 14 octobre, aurait donné les mêmes résultats que la première. ⇑
14 - Le missionnaire Pierre Ferreux écrit dans une lettre à Gabriel de la Vigne datée du 18 novembre 1692 : Il [Desfarges] fit un traité pour elle avantageux autant qu'on l'eût osé espérer, savoir : qu'elle pourrait demeurer où elle voudrait, sans que personne la molestât en rien, ni pour la religion, ni pour quoi que ce fût ; qu'elle pourrait se marier si elle le souhaitait, et à qui elle voudrait ; qu'enfin toute sa famille serait libre. Ces belles promesses ne furent pas tenue. Le père Tachard, qui eut l'occasion de lui parler en janvier 1699, lors de son 4ème voyage dans le royaume, écrivait : elle me représenta sa grande pauvreté, n'ayant pour subsister avec son fils que l'aumône que nous lui envoyons tous les ans et ce qu'elle pouvait gagner à la sueur de son front ; que le prince dont elle était esclave l'avait logée dans une cabane vis-à-vis du petit palais où il demeurait, que son occupation était de recevoir les présents qu'on lui apportait quand on lui présentait des requêtes et des mémoires ; qu'elle n'en pouvait sortir non pas même pour aller à l'église qu'en donnant de l'argent ou des présents, à moins que de s'exposer à être cruellement fustigée, ce qui lui était arrivé plusieurs fois jusqu'à perdre la parole. (Relation d'un voyage dans l'Inde (1690-1699) BN Ms. Fr. 19030, f° 38-191v°). ⇑
15 - La Touche ne nomme pas le principal intéressé, mais on peut partager les responsabilités entre Desfarges et l'abbé de Lionne, dont l'avis pesa certainement très lourd dans la décision du général de livrer la veuve de Phaulkon aux Siamois. Le père de Bèze accusait clairement les missionnaires d'avoir incité Mme Constance à se livrer d'elle-même : Personne n'eut plus permission de la voir que MM. du séminaire. Ils l'obsédaient sans cesse, lui disant que c'était les jésuites qui lui mettaient en tête de vouloir sortir du royaume pour aller en France. Qu'elle ne devait pas suivre leurs conseils, qu'elle y serait mal reçue, qu'elle ferait bien mieux de s'en retourner à Siam où ils feraient en sorte qu'elle fût désormais mieux traitée ; qu'elle était même obligée en conscience de prendre ce parti pour ne pas attirer une persécution aux chrétiens ; qu'elle ne devait pas aussi s'attendre que la garnison de Bangkok voulût s'exposer à de nouveaux dangers pour la sauver et, qu'ainsi, il fallait qu'elle fît d'elle-même ce qu'on l'obligerait bientôt de faire de force. (Drans et Bernard, Mémoires du père de Bèze sur la vie de Constance Phaulkon, 1947, p. 160). L'abbé de Lionne fut violemment attaqué à son retour en France et tenta de se justifier quelques années plus tard dans un mémoire qu'on pourra lire sur ce site : Mémoire sur l'affaire de Mme Constance. ⇑
16 - Le vaisseau du roi l'Oriflamme, commandé par M. de l'Estrille, était parti de France le 19 janvier 1688 et amenait au Siam un renfort de 200 hommes, dont beaucoup avaient péri pendant la traversée. Évoquant l'état piteux où se trouvaient ces nouvelles troupes, Beauchamp écrivit : Ce M. de l'Estrille est arrivé le 20 de septembre en la rade de Siam avec le navire l'Oriflamme et quatre-vingts méchants soldats. Je suis sûr qu'ils ne valaient pas dix bons hommes (A.N. Col. C1/25 f° 79v°). François Martin, confirmant la manière habituelle par laquelle on recrutait alors les troupes et les équipages - quelques chopines d’eau-de-vie, de vagues promesses de gloire et de fortune et une croix tracée au bas d’un engagement que nul ne savait lire - évoque également cette « canaille » : c’était des misérables qu’on avait pris gueusant aux ports de France et qui avaient été embarqués de force sur le navire l’Oriflamme et à qui l’on n’avait pu faire perdre dans les exercices où l’on avait tâché de les dresser la contenance de ce qu’ils avaient été. (Op. cit., III, p. 343). ⇑
17 - Les mirous, ou dans certaines relations mirons, étaient de petits bateaux à rames réservés aux trajets côtiers. Robert Lingat (Une note de Véret sur la révolution siamoise, T'oung Pao vol. XXXI, 1934, p. 360), qui note que les Anglais écrivaient meruah ou merua, suggère que ce mot pourrait avoir une étymologie siamoise, de mi rua (มีเรือ) : Il y a un bateau (ou des bateaux). ⇑
18 - Le massacre des Anglais de Mergui eut lieu le 14 juillet 1687. Wood le relate ainsi (A History of Siam, 1924, pp. 208-209) : Le 28 avril 1687, la compagnie anglaise envoya au roi Naraï une facture détaillée de 65 000 livres, en paiement des dommages subis par les sujets britanniques du fait de la guerre entre le Siam et Golconde, ainsi que pour les avances consenties à l'ambassadeur de Perse. Cette réclamation était accompagnée d'une lettre très amicale, assortie toutefois de menaces de représailles sur les sujets et les navires siamois, voire du blocus du port de Mergui, tant que la demande ne serait pas satisfaite.
La lettre ne fut délivrée qu'après l'arrivée à Mergui de deux frégates anglaises, le Curtana et le James. Le capitaine Anthony Weltden, du Curtana, débarqua, et une proclamation du roi Jacques II fut lue, ordonnant à tous les Anglais au service du roi de Siam de partir immédiatement. Les Anglais de Mergui, qui étaient au moins une cinquantaine, se préparèrent à obéir et une trêve de 60 jours fut proclamée pour permettre l'envoi de la lettre au roi Naraï à Ayutthaya. Après la proclamation de cette trêve, des préparatifs furent entrepris pour défendre le port. Weltden s'y opposa et le 9 juillet, il fit retirer quelques pieux qui avaient été plantés dans le lit de la rivière et captura un navire siamois, le Resolution.
Dans la nuit du 14 juillet, le gouverneur siamois de Mergui, exaspéré par les procédés de Weltden et craignant que tous les Anglais de Mergui ne fassent cause commune avec leurs compatriotes, canonna soudainement le James et réussit à le couler. Au cours de la même nuit, une cinquantaine d'Anglais furent massacrés. ⇑
19 - Du Bruant s'était emparé de deux navires au mouillage dans la rade de Ténassérim, l'Aigle noir, rebaptisé le Mergui par les Français, une frégate de 24 pièces de canon qui appartenait au roi de Siam, et un petit navire anglais d'un particulier de Madras (Le Blanc, op. cit., II, p. 282). ⇑
20 - Voir page précédente, note 29 ⇑
21 - Pierre d'Espagnac (1650-1689) était l'un des 14 jésuites-mathématiciens arrivés au Siam avec l'ambassade Céberet-La Loubère. Présent à Mergui lors de l'assaut des Siamois, il s'embarqua avec la garnison française en déroute. Les troupes françaises quittent Mergui le 24 juin 1688, à bord d’un médiocre navire du roi de Siam, laissant sur la plage une vingtaine de soldats tués à coups de sabre par des Siamois. Le navire pris dans une tempête ne réussit pas à rejoindre Pondichéry. Manquant de vivre il fait relâche au large de Martaban, capitale du royaume de Pégou. Le père d’Espagnac, le sieur de Beauregard et quatre soldats français descendent à terre pour chercher des provisions. On ne les revit jamais... La tradition veut que le père d’Espagnac ait été réduit en esclavage avant de trouver une mort tragique dans ce royaume inhospitalier. (Raphaël Vongsuratavana, Un jésuite à la cour de Siam, 1992, p. 277).
 Les Péguans assaillent le navire le Mergui.
Les Péguans assaillent le navire le Mergui.
Rivière de Tavoy entre Mergui et Pégou. Cette rivière dépend du roi de Pégou ou d'Ava où sont les mines de rubis. Tous les vaisseaux qui vont dans ces rivières avec les personnes qui sont dessus sont pris par les gens du pays s'ils sont les plus forts. On voit ici un vaisseau nommé le Mergui qui s'était sauvé de la déroute de Siam ou du siège de Mergui ; il y avait environ 80 Français avec M. Du Bruant, commandant des troupes, M. de Beauregard, gouverneur de Mergui, et le père d'Espagnac, jésuite, aumônier des troupes.
Les père d'Espagnac et M. de Beauregard avec quelques soldats allèrent dans la chaloupe du navire pour demander des vivres à acheter. On les fit prisonniers, et les peuples allèrent pour s'emparer du vaisseau qui était échoué alors que la marée baissait. On se défendit bien, et lorsque la marée remonta, le vaisseau se remit à flot et sortit de la rivière ; il trouva à l'entrée que ces peuples avaient déjà bouché l'entrée avec des pieux, mais ils se firent aisément passage. Leur chaloupe et le père, avec M. de Beauregard et les soldats, restèrent prisonniers. Le père d'Espagnac y est mort à 200 lieues de là des misères qu'il a souffertes ; on ne sait rien des autres. (Bibliothèque Nationale, Paris, Cabinet des Estampes). ⇑
22 - L'opium. Selon Yule et Burnell (Hobson-Jobson, 1903, p. 640), le mot viendrait de l'arabe afyūn. Yule et Burnell citent de nombreuses déclinaisons portugaises, anglaises, françaises et même chinoises : arfiun, anfion, oafyam, amfiao, anfiam, A-fu-yung, amfion, aphion, ophyan etc. ⇑
23 - Le père Le Blanc, qui ne s'y trouvait pas, indique le 24 juin, fête de saint Jean-Baptiste, après qu'on eut encloué le canon qu'on y laissait, appartenant aux Siamois. (Op. cit., II, p. 295). ⇑
24 - L'embarquement des troupes se fit dans la confusion la plus totale. Le père Le Blanc relate : il arriva qu'en descendant la hauteur dont la pente est rapide, et la terre étant alors humide et glissante, quelques soldats rompirent leur rang et tombèrent les uns sur les autres. Ceux-ci étant la plupart chargés d'armes, d'argent et de munitions ne purent soutenir contre ces premiers désordres et se laissèrent entraîner. Ainsi, une partie des troupes se débanda malgré les efforts que firent le commandant et les officiers pour arrêter la fuite et rétablir les rangs. Les ennemis aperçurent le désordre des nôtres et en conjecturèrent qu'ils avaient peur. J'ai déjà remarqué ailleurs que cette nation fuit toujours devant ceux qui la poursuivent et poursuit ceux qui fuient. La frayeur de nos soldats leur donna de la hardiesse. Ils vinrent fondre sur eux avec des sagaies et des sabres. Les capitaines Du Halgouët et De Launay soutinrent leurs efforts pour donner aux nôtres le temps de s'embarquer, par les ordres de M. Du Bruant qui fit partout le devoir de commandant et de soldat. Nous perdîmes là le commissaire Chambiche et quelques soldats qui demeurèrent dans la vase, parce qu'ils étaient trop chargés d'argent. Le sieur Hiton, brave officier, fut noyé, et avec lui une partie de sa compagnie dans une chaloupe qui coula bas ; le reste s'embarqua heureusement. Comme on n'avait pas pu enclouer le canon du fort de l'Étoile, les ennemis s'en servirent pour tirer sur les deux vaisseaux, où ils tuèrent encore dix ou douze hommes. (Op. cit., II, pp. 296 et suiv.). ⇑
25 - Voir note 22 ci-dessus. D'après le père Le Blanc, la garnison française avait déjà quitté Mergui le 27 juin. ⇑
26 - Le père Le Blanc, qui vit La Touche à son arrivée à Louvo et recueillit sans doute ses confidences, relate ainsi cette arrestation : Un enseigne nommé La Touche étant allé relever l'officier qui avait été de garde dans ce poste, les Siamois les arrêtèrent l'un et l'autre. La Touche vit tuer son compagnon, et fut lui-même environné, pris et lié par les mains et les pieds sur une claie. Il ne douta point qu'on l'allât faire mourir aussi, mais un More le rassura et lui dit qu'on ne lui ferait point de mal s'il ne faisait point de résistance. On lui attacha quatre cordes au col. Quatre Siamois prirent chacun une corde, et marchant l'un devant, l'autre derrière, et les autres à côté, ils le conduisirent au milieu d'une troupe de gens armés, avec de grands cris de joie, dans la bourgade où tout le peuple s'assembla autour de lui. Il fut mis aux fers, suspendu par les mains et menacé de la mort pour l'obliger à déclarer les desseins des Français, et enfin conduit, la cangue au col, avec un sergent aussi prisonnier, jusqu'à Louvo où nous les vîmes venir dans un état pitoyable et leur donnâmes le soulagement que nous pûmes. Ainsi la guerre fut déclarée à Mergui contre les Français, avant qu'ils sussent le sujet de la rupture. (Op. cit., II, pp. 285 et suiv.). ⇑
27 - À mort, à mort, crucifie-le !, cri des juifs demandant à Pilate de crucifier Jésus (Évangile de saint Jean, 19, 15). ⇑
28 - Les bras-peints (ken laï : แขนลาย), ainsi appelés parce leurs bras scarifiés avaient été recouverts de poudre à canon, ce qui, en cicatrisant, leur donnait une couleur bleue mate, sont ainsi décrit par La Loubère : Ils sont les exécuteurs de la justice du prince, comme les officiers et les soldats des cohortes prétoriennes étaient les exécuteurs de la justice des empereurs romains. Mais en même temps, ils ne laissent pas de veiller à la sûreté de la personne du prince, car il y a dans le palais de quoi les armer aux besoin. Ils rament le balon du corps, et le roi de Siam n'a point d'autre garde à pied. Leur emploi est héréditaire comme tous les autres du royaume, et l'ancienne loi porte qu'ils ne doivent être que six cents, mais cela se doit sans doute entendre qu'il n'y en doit avoir que six cents pour le palais, car il en faut bien davantage dans toute l'étendue de l'État parce que le roi en donne, comme j'ai dit ailleurs, à un fort grand nombre d'officiers. Ces bras-peints donneront toute la mesure de leur cruauté lors de la révolution de 1688. ⇑
29 - Sans doute le prêtre des Missions Étrangères Étienne Paumard (ca 1640-1690). Les connaissances médicales de ce missionnaire lui permirent de rester en liberté après le coup d'État. Le missionnaire laïque Martineau écrivait dans le Journal de la Mission (cité par Launay, op. cit., I, p. 222) : Il n'y eut que M. Paumard qui fut privilégié, et qui l'a toujours été à cause de la médecine. Dès le commencement, il eut le privilège de faire faire une maisonnette dans l'enclos où sont les magasins du roi, assez proche de la prison. Il s'y retira avec six des plus petits écoliers et la plupart de nos domestiques (s'entend des noirs étrangers, car pour les Siamois et Pégous, il ne nous en est pas resté un seul). Il commença dès les premiers jours à faire apprêter à manger, et à envoyer la nourriture une fois chaque jour. Il continua toujours du même train, traitant également et sans distinction tous nos prisonniers, tant missionnaires qu'écoliers et séculiers, gens du roi et de la Compagnie, et autres particuliers, parce que nous voyant tous dans une extrême nécessité, nous avons cru que tout devait être commun, et que si Dieu permettait que nous mourussions de misère, notre sacrifice étant de plusieurs victimes unies ensemble lui en serait plus agréable. Cependant je n'oserais répondre qu'il pourra encore continuer aussi longtemps que nous prévoyons qu'il nous faudra ainsi demeurer dans la misère, car les bourses de nos amis sont bien épuisées, et les dépenses sont grandes. ⇑
30 - Le 10 ou le 11 juillet 1688. ⇑
31 - La Touche n'indique pas la date. Le Papier de répondance (traité de capitulation) signé par Desfarges et reproduit par Launay (op. cit., I, pp. 217 et suiv.) est daté du mardi du dixième mois et de la lune, de l'année 2282. 2282 est évidemment une coquille, il faut lire 2232. Dans le calendrier siamois, le dixième mois était septembre, et la nouvelle lune ayant eu lieu le vendredi 24, la date désigne sans doute le mardi suivant, c'est-à-dire le 28 septembre. Toutefois, il y a quelques doutes dans la chronologie. La Touche mentionne plus loin l'arrivée de Mme Constance qui eut lieu, selon l'Abrégé de ce qui s’est passé à Bangkok […] le 4 octobre (f° 162r°). Par ailleurs, il indique également qu'il fut chargé par Desfarges le 26 septembre d'aller à Mergui porter à Du Bruant le traité de paix qui avait été fait. ⇑
32 - Tanaïs : sans doute Tavoy. Sevian : Syriam ? ⇑
33 - Ce pseudonyme fut-il choisi en référence à Paul Lucas (1664-1737), voyageur, marchand, naturaliste, collectionneur, antiquaire et écrivain, qui fit de nombreux voyages, notamment en Grèce, en Turquie, en Égypte et en Perse ? Si c'est le cas, ce Paul Lucas était à peu près complètement inconnu en 1691, la première relation de voyage que nous connaissons de lui ne fut publiée qu'en 1704. ⇑

12 mars 2019
