

4ème partie.
Le chevalier de Forbin écrase la révolte des Macassars.
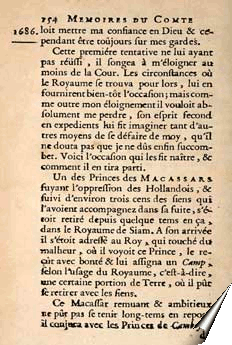
Cette première tentative ne lui ayant pas réussi, il songea à m'éloigner au moins de la Cour. Les circonstances où le royaume se trouva pour lors lui en fournirent bientôt l'occasion, mais comme, outre mon éloignement, il voulait absolument me perdre, son esprit fécond en expédients lui fit imaginer tant d'autres moyens de se défaire de moi qu'il ne douta pas que je ne dusse enfin succomber. Voici l'occasion qui les fit naître, et comme il en tira parti.
Un des princes des Macassars, fuyant l'oppression des Hollandais et suivi d'environ 300 des siens qui l'avaient accompagné dans sa fuite, s'était retiré depuis quelque temps en çà dans le royaume de Siam (1). À son arrivée il s'était adressé au roi, qui, touché du malheur où il voyait ce prince, le reçut avec bonté et lui assigna un camp selon l'usage du royaume, c'est-à-dire une certaine portion de terre, où il put se retirer avec les siens (2).
Ce Macassar, remuant et ambitieux, ne put pas se tenir longtemps en repos. Il conjura avec les princes de Cambodge, de Malacca et le prince de Chiampia (3). Leur projet était de faire mourir le roi et de s'emparer du royaume qu'ils avaient déjà partagé entre eux, et comme ils étaient tous mahométans, ils étaient convenus de faire périr tous les chrétiens portugais et japonais sans qu'il en échappât un seul. M. Constance, informé de cette conjuration et du jour qu'elle devait éclater, après en avoir conféré avec le roi, fit donner tous les ordres nécessaires pour la sûreté du royaume (4)
Il ne pouvait guère se présenter d'occasion plus favorable pour m'éloigner de la Cour. Bangkok, dont j'étais gouverneur, était une place trop importante pour la laisser abandonnée dans des conjonctures si périlleuses. J'eus donc ordre de m'y rendre incessamment, d'y faire finir au plus tôt les fortifications, et travailler à de nouvelles levées de soldats siamois jusqu'à la concurrence de 2 000 hommes, et de les dresser à la manière de France.
Pour subvenir aux frais que je devais faire en qualité de général, Constance eut ordre de me compter 100 catis (5), qui reviennent à la somme de 15 000 livres de notre monnaie, mais je ne touchai que 1 000 écus, le ministre s'excusant pour le reste sur ce qu'il n'y avait pas pour lors d'argent dans l'épargne. Il se contenta de me faire son billet, et de m'assurer que lorsque certains bâtiments, qu'il attendait tous les jours de la Chine, seraient arrivés, je serais payé de 12 000 livres qui restaient.
Le roi, voulant que je fusse obéi et respecté dans mon gouvernement, me donna quatre de ses bourreaux pour faire justice, ce qui n'avait lieu pourtant que jusqu'à la bastonnade, n'y ayant ordinairement dans le royaume que le roi seul, ou en certaines occasions son premier ministre, qui puissent condamner à mort.
Je partis sans avoir eu le moindre avis de la conjuration et sans savoir à quelle occasion on me renvoyait dans mon gouvernement. Constance, qui savait à point nommé le jour auquel les rebelles devaient faire leur dernière assemblée, prit si bien ses mesures et me fit partir si à propos pour me faire tomber entre leurs mains que je me trouvai sans le savoir au milieu des conjurés dont l'entrevue se faisait sur ma route et qui me laissèrent passer, je ne sais pourquoi, leur projet devant éclater le lendemain ou le jour d'après pour le plus tard.
En arrivant à Bangkok, autre danger où je ne courus pas un moindre risque. Aux premières nouvelles de la conjuration, Constance avait envoyé à mon insu faire mettre en liberté les Portugais que le conseil de guerre avait condamnés aux galères. Il avait ordonné qu'on en formât des compagnies comme auparavant, et que les officiers exilés fussent rappelés.
M'envoyer ainsi, sans m'avoir donné le moindre avis de ce changement, c'était me livrer pieds et poings liés à mes ennemis. Je le compris parfaitement lorsqu'à mon arrivée, je trouvai sous les armes des gens que j'avais fait enchaîner peu auparavant. Mais la malice de Constance ne me porta aucun préjudice. Je me tins dans le commencement sur mes gardes, et je maniai ensuite si adroitement l'esprit des soldats et des officiers, en donnant souvent à manger à ces derniers et en ne parlant aux premiers qu'obligeamment, que je me rendis maître des uns et des autres, et que d'ennemis que je les avais laissés en partant, j'en fis des amis qui m'aimèrent dans la suite sincèrement et de bonne foi.
M. Constance, peu satisfait de m'avoir éloigné de la Cour, et désespéré de n'avoir encore pu venir à bout de ses desseins, me tendit un nouveau piège qu'il crut infaillible, et qui lui aurait immanquablement réussi si le Seigneur ne m'avait visiblement protégé. Mais enfin je m'en tirai encore assez heureusement, au moins par rapport à moi, qui n'en reçus aucun dommage dans ma personne, quoiqu'il me causât d'ailleurs beaucoup de fatigues et qu'il donnât lieu à répandre bien du sang, comme on verra par ce que je vais dire.
Le capitaine d'une galère de l'île des Macassars qui était venu à Siam pour commercer, avait eu part, et était même entré assez avant dans la conjuration. La voyant manquée, il s'était retiré dans son bord, résolu de retourner chez lui s'il en avait l'occasion, ou de vendre chèrement sa vie si l'on entreprenait de le forcer. M. Constance, qui pour avoir moins d'ennemis sur les bras, souhaitait de séparer celui-ci du reste des conjurés, lui fit offrir un passeport, au moyen duquel lui et sa troupe qui allait à 53 hommes d'équipage, pourraient sortir paisiblement du royaume et se retirer où il trouverait bon.
Le capitaine, ravi de cette offre, ne balança pas à l'accepter. Alors M. Constance voyant qu'il pouvait en même temps, et diviser les ennemis, et me perdre sans ressource, me dépêcha un courrier avec ordre de la part du roi de tendre la chaîne et d'empêcher la sortie de ce bâtiment. Il me déclarait que le capitaine et tout l'équipage étaient complices de la conjuration et m'ordonnait de n'avoir aucun égard à leur passeport, qui ne leur avait été donné que pour les tromper et les affaiblir.
L'ordre portait encore que la galère étant arrivée à la chaîne, j'eusse à me transporter dans ce bâtiment, que j'y fisse un inventaire exact de tout ce que contenait sa cargaison, après quoi il m'était ordonné de me saisir, et du capitaine, et de tout l'équipage, et de le retenir prisonnier jusqu'à nouvel ordre ; et, par un article à part, il m'était surtout défendu très expressément de communiquer à personne les ordres que je recevais, des raisons d'État demandant un secret inviolable sur ce point. C'est ainsi qu'il m'envoyait à la boucherie, me prescrivant pas à pas tout ce que j'avais à faire pour périr infailliblement.
J'attendis fort longtemps l'arrivée de cette galère qui ne paraissait point. Je m'amusais, en attendant, à dresser les troupes que j'avais eu l'ordre de lever. Cette commission ne m'avait pas donné beaucoup de peines, ces sortes de levées se font à Siam en très peu de temps et avec beaucoup de facilité. Le roi étant maître absolu de tous ses sujets, les gouverneurs prennent au nom du prince qui bon leur semble, et le peuple, qui est fort docile, marche et obéit sans murmure.
Je divisai mes nouveaux soldats en compagnies de 50 hommes. Je mis à la tête de chaque compagnie un capitaine, un lieutenant, un enseigne, deux sergents, quatre caporaux et quatre anspessades (6). Je m'appliquai avec tant de soin à les dresser, qu'à l'aide de quelques soldats portugais qui entendaient le siamois et d'un Français que je fis sergent, ils furent en moins de six jours en état de monter et de descendre des gardes, de poser des sentinelles et de les relever, comme on fait en France.
Je l'ai déjà dit, la docilité de ce peuple est admirable, on leur fait faire tout ce qu'on veut. Ces 2 000 hommes firent dans la suite l'exercice, et furent aussi bien disciplinés que les soldats aux gardes (7) pourraient l'être.
J'attendais toujours les Macassars. Comme je n'avais point de prison où je pusse les retenir, j'en fis construire une joignant la courtine sur le devant du nouveau fort. Elle était formée avec de gros pieux. Je l'avais fortifiée de telle sorte, qu'avec une garde assez peu nombreuse, il aurait été aisé d'y retenir sûrement une cinquantaine de prisonniers.
La galère parut enfin vingt jours après que j'eus reçu l'ordre de l'arrêter, sans que pendant tout ce temps la chaîne eût cessé d'être tendue jour et nuit, crainte de surprise. Dans le plan que je m'étais formé, pour m'acquitter sûrement de ma commission, je m'étais écarté quelque peu des instructions de M. Constance, car, comme il ne me paraissait ni sûr ni convenable à ma dignité d'aller à bord tandis que les Macassars en seraient les maîtres, je résolus de les engager à prendre terre et de commencer par les arrêter, après quoi j'irais à bord travailler selon mes ordres à l'inventaire que le ministre voulait qu'on dressât. Dans cette vue, du plus loin que je les vis paraître, je postai en différents endroits quelques soldats prêts à les investir quand je leur en ferais donner l'ordre.
La galère étant arrivée à la chaîne et ayant trouvé le passage fermé, le capitaine vint à terre avec sept hommes de sa suite et demanda à me parler. Il fut conduit dans le vieux fort, où je l'attendais. Je le reçus dans un grand pavillon carré que j'avais fait construire avec des cannes, dans un des bastions du fort et dont le côté qui faisait face à la gorge du bastion n'était fermé que par un grand rideau.
À mesure qu'ils entrèrent, je leur fis civilité, et les ayant fait asseoir autour d'une table où je mangeais ordinairement avec les officiers, je demandai au capitaine d'où il venait et où il allait. Il me répondit qu'il venait de Siam et qu'il retournait à l'île des Macassars, en même temps il me présenta son passeport. Après avoir fait semblant de l'examiner, je lui dis qu'il était fort bon, mais j'ajoutai qu'étant étranger et nouvellement au service du roi, je devais être plus attentif qu'un autre à ne manquer en rien de ce qui m'était ordonné ; qu'en conséquence, depuis la révolte dont il avait sans doute entendu parler, j'avais reçu des ordres très rigoureux pour empêcher qu'aucun Siamois ne sortît du royaume. Le capitaine me répondit qu'il n'avait avec lui que des Macassars. Je lui répliquai que je ne doutais nullement de ce qu'il me disait, mais qu'étant environné de Siamois qui observaient toutes mes actions, je le priais, afin que la Cour n'eût rien à me reprocher, de mettre tout son monde à terre, et qu'après qu'ils auraient été reconnus pour Macassars, ils n'auraient qu'à se rembarquer, qu'on détendrait la chaîne et qu'il leur serait libre de passer et de se retirer où ils jugeraient à propos.
Ce capitaine, sans hésiter, répondit : — Je le veux bien, mais ils descendront armés. Alors, le regardant en riant : — Est-ce que nous sommes en guerre ? lui dis-je. — Non, me répondit-il, mais le kriss que j'ai à mon côté, et qui est l'arme que nous portons, est tellement une marque d'honneur parmi nous que nous ne saurions le quitter sans infamie. Cette raison me paraissant sans réplique, je m'y rendis, ne comptant pas qu'une arme qui me paraissait si méprisable fût aussi dangereuse que je l'éprouvai bientôt après.
Ce kriss est une espèce de poignard, d'environ un pied de long et large d'un pouce et demi par le bas. Il est fait en onde, la pointe en langue de serpent, d'un bon acier trempé. Il coupe comme un rasoir, et des deux côtés. Ils le ferment dans une gaine de bois et ne le quittent jamais (8).
Le capitaine détacha deux de ses hommes pour aller chercher ce qui restait de ses gens. Je lui fis servir du thé pour l'amuser, en attendant qu'on vînt m'avertir quand tout le monde serait à terre, auquel temps je comptais envoyer mes ordres pour les arrêter. Comme ils tardaient trop à mon gré, je me levai, et ayant prétexté quelque ordre que j'avais à donner, je priai un mandarin qui était présent de tenir ma place, ajoutant que j'allais revenir à l'instant.
Mes Siamois, attentifs à tout ce qui se passait, étaient fort en peine de savoir à quoi je destinais les troupes que j'avais postées de côté et d'autre. En sortant du pavillon, je trouvai un vieil officier portugais, brave homme que j'avais fait major, et qui était là en attendant mes ordres. — Monsieur, lui dis-je, allez avertir tels et tels et se tenir prêts, et dès que les Macassars auront passé un tel endroit, que je lui désignai, vous commencerez par les investir, vous les désarmerez, et ensuite vous les arrêterez jusqu'à ce que je vous envoie dire ce qu'il y aura à faire.
Le Portugais, effrayé de ce qu'il venait d'entendre : — Monsieur, me dit-il, je vous demande pardon, mais ce que vous proposez n'est pas faisable. Vous ne connaissez pas cette nation comme moi. Je suis enfants des Indes. Croyez-moi, ces sortes d'hommes sont imprenables, et il faut les tuer pour s'en rendre maître. Je vous dis bien plus, c'est que si vous faites mine de vouloir arrêter ce capitaine qui est dans le pavillon, lui et ce peu d'hommes qui sont avec lui nous tueront tous, sans qu'il en échappe un seul.
Je ne fis pas tout le cas que je devais de l'avis que ce Portugais me donnait, et persistant dans mon projet, dont l'exécution me paraissait assez facile : — Allez, lui repris-je. Portez mes ordres tels que vous les avez reçus. Je suis persuadé qu'avant de se faire tuer, ils y penseront plus d'une fois. Le major s'en alla fort triste, et, me continuant ses bons avis, me dit en partant : — Mon Dieu, prenez bien garde à ce que vous faites. Ils vous tueront infailliblement. Croyez ce que j'ai l'honneur de vous dire, c'est pour votre bien.
Le zèle de cet officier me fit entrer en considération. Pour ne rien hasarder, je fis monter vingt soldats siamois dans la gorge du bastion, dix desquels étaient armés de lances, et dix autres de fusils. Je fis tirer le rideau du pavillon, et m'étant avancé vers l'entrée, j'ordonnai à un mandarin d'aller de ma part dire au capitaine que j'étais bien mortifié de l'ordre que j'avais de l'arrêter, mais qu'il recevrait de moi toute sorte de bons traitements.
Ce pauvre mandarin qui me servait d'interprète obéit. Au premier mot qu'il prononça, ces six Macassars, ayant jeté leurs bonnets à terre, mirent le kriss à la main, et s'élançant comme des démons, tuèrent dans un instant, et l'interprète, et six autres mandarins qui étaient dans le pavillon. Voyant ce carnage, je me retirai vers mes soldats qui étaient armés. Je sautai sur la lance d'un d'entre eux et je criai aux autres de tirer.
Un de ces six enragés vint sur moi le kriss à la main. Je lui plongeai ma lance dans l'estomac. Le Macassar, comme s'il eût été insensible, venait toujours en avant, à travers le fer que je lui tenais enfoncé dans le corps, et faisait des efforts incroyables afin de parvenir jusqu'à moi pour me percer. Il l'aurait fait immanquablement, si la garde qui était vers le défaut de la lame, ne lui en eût ôté le moyen. Tout ce que j'eus de mieux à faire fut de reculer en lui tenant toujours la lance dans l'estomac, sans oser jamais redoubler le coup. Enfin je fus secouru par d'autres lanciers qui achevèrent de le tuer.
Des six Macassars, il y en eut quatre de tués dans le pavillon. Les deux autres, quoique blessés grièvement, se sauvèrent en sautant du bastion en bas. La hardiesse, ou plutôt la rage de ces six hommes m'ayant fait connaître que le Portugais avait dit vrai et qu'ils étaient en effet imprenables, je commençai à craindre les 47 autres qui étaient en marche. Dans cette fâcheuse situation, je changeai l'ordre que j'avais donné de les arrêter, et reconnaissant qu'il n'y avait pas d'autre parti à prendre, je résolus de les faire tous tuer s'il était possible. Dans cette pensée, j'envoyai et j'allai moi-même de tous côtés pour faire assembler les troupes.
Cependant les Macassars, descendus à terre, marchaient vers le fort. J'envoyai ordre à un capitaine anglais que M. Constance avait mis à la tête de 40 Portugais (9) d'aller leur couper chemin, de les empêcher d'avancer, et en cas de refus de leur part de tirer dessus, ajoutant que j'allais être à lui dans un moment pour le soutenir avec tout ce que je pourrais ramasser de troupes. Sur la défense que l'Anglais leur fit de passer outre, ils s'arrêtèrent tout court. Pendant ce temps-là, je faisais avancer mes soldats dans le meilleur ordre que je pouvais. Ils étaient armés de fusils, mais il y avait peu à compter sur eux. C'étaient tout de nouvelles troupes et nullement aguerries.
Nous nous arrêtâmes à cinquante pas des Macassars. Il y eut des pourparlers de part et d'autre. Je leur fis dire que, s'ils voulaient, il leur était libre de retourner dans leur galère. Je compris que s'ils prenaient le parti de se rembarquer, il me serait aisé de les faire tous tuer à coups de fusil, car ils n'en avaient point pour se défendre et ne portent jamais d'armes à feu. Ils me firent répondre qu'ils voulaient bien retourner à bord, mais qu'il fallait auparavant qu'on leur rendît leur capitaine sans lequel ils ne se rembarqueraient jamais.
Le capitaine anglais, ennuyé de toutes ces longueurs, m'envoya dire que, puisqu'ils ne voulaient pas entendre raison, il allait dans le moment faire attacher tous ces gueux-là, qui faisaient si fort les entendus, et sans attendre ma réponse, marcha à eux avec beaucoup d'imprudence.
Il n'eut pas plutôt remué, que les 47 Macassars qui jusqu'alors s'étaient tenus accroupis à leur manière, se levèrent tout à coup, et ayant entouré leur bras gauche d'une espèce d'écharpe dont ils ont accoutumé de se ceindre, ils en formèrent comme une targue (10). Ensuite, se couvrant le corps de leur bras ainsi entortillé, ils fondirent sur les Portugais, le kriss à la main, et donnèrent tête baissée, avec tant de vigueur qu'ils les enfoncèrent et les mirent en pièces presque avant que nous nous fussions aperçus qu'ils les avaient attaqués. De là, sans perdre haleine, ils poussèrent vers les troupes que je commandais. Quoique j'eusse plus de 1 000 soldats armés de lances et de fusils, l'épouvante les prit à tel point que tout se culbuta. Les Macassars leur passèrent sur le ventre, et tuant à droite et à gauche tout ce qu'ils pouvaient joindre, ce ne fut plus qu'un horrible carnage.
Dans une déroute si générale, ils nous eurent bientôt poussés jusqu'au pied de la muraille du nouveau fort. Six d'entre eux, plus acharnés que les autres, poursuivirent les fuyards et entrèrent dans la fausse baie qui donne sur la rivière auprès du mur du petit fort carré. Ils passèrent de l'autre côté du fort et ils firent dans tous ces endroits un carnage épouvantable, tuant sans distinction d'âge et de sexe, femmes, enfants, et tout ce qui se présentait à eux.
Dans cet embarras, ne pouvant plus retenir le gros des troupes, je les laissai fuir, et comme je n'avais qu'une lance pour toute arme, je gagnai le bord du fossé, résolu de sauter dedans si j'étais poursuivi. Ma pensée était que ce fossé étant plein de vase, ils ne pourraient pas venir à moi avec leur vitesse ordinaire et que j'en aurais meilleur parti.
Ils passèrent à dix pas sans m'apercevoir. Ils étaient trop occupés à tuer. Pas un de ces malheureux Siamois qui songeât à faire face pour se défendre, tant ils étaient effrayés. Enfin, ne voyant aucun moyen de les rallier, je gagnai la porte du nouveau fort qui n'était fermée que d'une barrière et je montai sur un bastion d'où je fis tirer quelques coups de fusil sur les ennemis, qui, se trouvant maîtres du champ de bataille et n'ayant plus personne à tuer, se retirèrent sur le bord de la rivière. Après avoir conféré quelque temps entre eux, n'écoutant plus que leur désespoir et résolus de se mettre dans la nécessité de combattre, ils regagnèrent leur galère, y mirent le feu, et après s'être armés de targues et de lances, ils descendirent de nouveau à terre dans le dessein de faire main basse sur tout ce qui se présenterait.
Ils commencèrent par brûler toutes les maisons des soldats, qui, selon l'usage du pays, n'étaient que de cannes, et remontant sur le bord de la rivière, ils attaquèrent et tuèrent indistinctement tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage. Tant de meurtres répandirent tellement l'alarme dans les environs que la rivière fut bientôt couverte de gens à la nage, hommes et femmes, qui portaient leurs enfants sur le dos.
Touché de ce spectacle, et indigné de ne voir plus que des morts dans l'endroit où l'on avait combattu, je ramassai une vingtaine de soldats armés de fusils et je m'embarquai avec eux sur un balon pour suivre ces désespérés. Je les joignis à une lieue du fort. Je leur fis tirer dessus et je les obligeai à s'éloigner du rivage. Ils s'avancèrent dans les terres, d'où ils entrèrent dans des bois qui étaient à côté. N'ayant pas assez de monde pour les poursuivre, et la partie n'étant pas égale, je n'osai pas entreprendre de les forcer. Ainsi je pris le parti de m'en retourner au fort.
À peine fus-je arrivé qu'on vint m'avertir que les six Macassars qui avaient passé de l'autre côté de la fausse baie s'étaient saisis d'un couvent de talapoins, qu'ils en avaient tué tous les moines, et avec eux un mandarin d'importance dans le corps duquel l'un deux avait laissé son kriss, qu'on me présenta. J'y courus avec 80 de mes soldats armés de lances, car ils ne savaient pas encore manier l'arme à feu. Je trouvai en arrivant que les Siamois, ne pouvant plus se défendre, avaient été obligés de mettre le feu au couvent.
On me dit que les Macassars s'étaient jetés à deux pas de là, dans un champ plein de grandes herbes fort épaisses et presque de la hauteur de trois pieds, dans lesquelles ils se tenaient accroupis. J'y conduisis ma troupe, j'en formai deux rangs bien serrés, menaçant de tuer le premier qui ferait mine de fuir. Mes lanciers ne marchaient d'abord que pas à pas et à tâtons, mais peu à peu ma présence les rassura.
Le premier Macassar que nous trouvâmes se dressa sur ses pieds comme un furieux, et élevant son kriss, allait se jeter sur mes gens. Je le prévins et je lui cassai la tête d'un coup de fusil. Quatre autres furent tués successivement par nos Siamois qui ne s'ébranlèrent point dans cette occasion, se soutenant les uns les autres et donnant à grands coups de lance sur ces malheureux, qui, combattant toujours à leur ordinaire, aimaient mieux trouver la mort en avançant que de reculer un seul pas.
Comme je songeais à m'en retourner, je fus averti qu'il restait encore un sixième Macassar. C'était un jeune garçon, celui-là même qui, ayant tué le mandarin, lui avait laissé son kriss dans le corps. Nous retournâmes dans les herbes pour chercher ce dernier. J'ordonnai à mes soldats de ne le point tuer, j'étais bien aise de le prendre vif, puisqu'il était désarmé. Mais ils étaient si animés et ils firent si peu d'attention à ce que je leur dis qu'ils le percèrent de mille coups.
Étant de retour au fort, j'assemblai tous les mandarins pour conférer avec eux sur le parti qu'il y avait à prendre. Il fut résolu qu'on ramasserait tout ce qui nous restait de troupes et que nous poursuivrions les ennemis dès que nous aurions des nouvelles de l'endroit où ils s'étaient retirés. Je voulus ensuite savoir le nombre des morts. Je trouvai que j'avais perdu dans cette malheureuse journée 366 hommes. Les Macassars n'en perdirent que 17, savoir, six dans le petit fort, six au couvent des talapoins, et cinq sur le champ de bataille.
Comme je voulus entrer dans le pavillon pour me reposer un moment, car j'en avais grand besoin après les fatigues que j'avais eu à essuyer, je fus frappé d'un spectacle d'autant plus triste que je m'y attendais moins. Outre les cadavres des Macassars et des Siamois, qu'on n'avait pas eu le temps d'enlever, je trouvai étendu sur le bord de mon lit un jeune officier nommé Beauregard (11), fils d'un commissaire du roi à Brest. Il était demeuré à Siam et je l'avais fait major de toutes les troupes siamoises. En le voyant dans cette situation, je le crus mort et j'en eus le cœur serré de douleur.
On ne croira peut-être pas ce que je vais dire, car en effet, il a bien plus l'air d'une fable que de toute autre chose. Je puis pourtant assurer que je n'y ajouterai rien du mien, et que je ne rapporterai que la pure vérité. M'étant approché du lit et ayant examiné ce jeune homme de plus près, je vis qu'il respirait encore, mais il ne parlait plus, et il avait la bouche toute couverte d'écume. Je lui trouvais le ventre ouvert, toutes les entrailles et l'estomac même qui étaient sortis pendaient en s'abattant sur les cuisses. Ne sachant comme faire pour lui donner quelque secours, car je n'avais ni remède ni chirurgien, je me hasardai de le traiter comme je pourrais.
Pour cet effet, ayant accommodé deux aiguilles avec de la soie, je remis les entrailles à leur place et je cousis la plaie, comme j'avais vu faire dans de semblables occasions. Je fis ensuite deux ligatures que je joignis, et après avoir battu du blanc d'œuf que je mêlai avec de l'arack qui est une espèce d'eau-de-vie, je m'en servis pour panser le malade, ce que je continuai pendant dix jours. Mon opération réussit parfaitement bien, et Beauregard fut guéri. À la vérité, il n'eut jamais la fièvre ni aucun autre symptôme fâcheux. Je remarquai en lui remettant les entrailles dans le ventre qu'elles étaient déjà sèches comme du parchemin et mêlées avec du sang caillé. Mais tout cela n'empêcha pas la parfaite guérison qui suivit peu de jours après.
Le lendemain matin, je reçus avis qu'un des six Macassars qui avaient combattu dans le pavillon, n'était pas mort. Quelques soldats siamois l'avaient saisi, et de peur qu'il ne leur échappât, ils en avaient fait comme un peloton à force de le lier. Je fus le voir pour le questionner et pour en tirer, s'il était possible, quelque éclaircissement, soit par rapport à ses camarades, soit par rapport aux mouvements qui s'étaient faits à Louvo et à Joudia. Ce démon, car la force et la patience humaine ne vont pas si loin, avait passé avec un sang-froid étonnant tout la nuit dans les boues, ayant dix-sept coups de lance dans le corps. Je lui fis quelques questions, mais il me répondit qu'il ne pouvait me satisfaire qu'auparavant je ne l'eusse fait détacher. Il n'y avait pas à craindre qu'il échappât. J'ordonnai au sergent français que j'avais mené avec moi de le délier. Celui-ci posa sa hallebarde contre un petit arbre, assez près du blessé, et le jugeant hors d'état de rien entreprendre, il la laissa, après l'avoir détaché, dans l'endroit où il l'avait mise d'abord.
À peine le Macassar fut en liberté qu'il commença à allonger les jambes et à remuer les bras, comme pour les dégourdir. Je m'aperçus qu'en répondant aux questions que je lui faisais, il se tournait, et tâchant de gagner terrain, s'approchait insensiblement de la hallebarde pour s'en saisir. Je connus son dessein, et m'adressant au sergent : – Tiens-toi près de ta hallebarde, lui dis-je. Voyons jusqu'où cet enragé poussera l'audace. Dès qu'il en fut à portée, il ne manqua pas de se jeter dessus pour la saisir en effet, mais ayant plus de courage que de force, il se laissa tomber presque mort sur le visage. Alors voyant qu'il n'y avait rien à espérer de lui, je le fis achever sur-le-champ.

J'étais si frappé de tout ce que j'avais vu faire à ces hommes qui me paraissaient si différents de tous les autres, que je souhaitai d'apprendre d'où pouvait venir à ces peuples tant de courage, ou pour mieux dire tant de férocité. Des Portugais qui demeuraient dans les Indes depuis l'enfance et que je questionnai sur ce point me dirent ces peuples étaient habitants de l'île de Calebos, ou Macassar, qu'ils étaient mahométans schismatiques et très superstitieux ; que leurs prêtres leur donnaient des lettres écrites en caractères magiques qu'ils leur attachaient eux-mêmes au bras, en les assurant que tant qu'ils les porteraient sur eux, ils seraient invulnérables ; qu'un point particulier de leur créance ne contribuait pas peu à les rendre cruels et intrépides. Ce point consiste à être fortement persuadés que tous ceux qu'ils pourront tuer sur la terre, hors les mahométans, seront tout autant d'esclaves qui les serviront dans l'autre monde. Enfin, ils ajoutèrent qu'on leur imprimait si fortement dès l'enfance ce qu'on appelle le point d'honneur, qui se réduit parmi eux à ne se rendre jamais, qu'il était encore hors d'exemple qu'un seul y eût contrevenu.
Pleins de ces idées, ils ne demandent ni ne donnent jamais de quartier. Dix Macassars, le kriss à la main, attaqueraient cent mille hommes. Il n'y a pas lieu d'en être surpris, des gens imbus de tels principes ne doivent rien craindre, et ce sont des hommes bien dangereux. Ces insulaires sont d'une taille médiocre, basanés, agiles et très vigoureux. Leur habillement consiste en une culotte fort étroite et comme à l'anglaise, une chemisette de coton blanche ou grise, un bonnet d'étoffe bordé d'une bande de toile large d'environ trois doigts. Ils vont les jambes nues, les pieds dans des babouches, et se ceignent les reins d'une écharpe dans laquelle ils passent leur arme diabolique. Tels étaient ceux à qui j'avais affaire et qui me tuèrent misérablement tant de monde.
Beauregard, à qui j'avais remis les entrailles et que je continuais de panser, se trouvant un peu mieux et commençant à parler, je voulus savoir de lui comment il avait reçu sa blessure, puisque tandis que nous étions dans le fort à batailler avec les six premiers Macassars, il était dehors.
Il me dit qu'ayant vu tomber du bastion des hommes, la tête la première et ayant pris l'un d'eux pour le capitaine, il y était accouru pour empêcher les Siamois de le tuer ; que le Macassar s'en étant aperçu, et contrefaisant le mort, l'avait laissé approcher jusqu'à ce qu'étant à portée, il lui avait allongé un coup de kriss qui lui avait fait la blessure que j'avais vue ; que dans cette situation, ne sachant où aller et portant ses entrailles dans les mains, il avait gagné le pavillon où ne trouvant personne pour le secourir, il était tombé de faiblesse sur mon lit à peu près dans la situation où je le trouvai.
Je rendis compte à M. Constance de cette malheureuse aventure. Quoique sa manœuvre ne m'eût que trop manifesté sa mauvaise volonté à mon égard, je crus qu'il ne convenait pas de lui en témoigner du ressentiment. Je lui écrivis donc comme si je ne m'étais douté de rien , et en lui faisant un détail bien circonstancié de tout ce qui m'était arrivé, je lui donnai avis de prendre garde au reste des Macassars qui étaient retranchés dans leur camp et de profiter de mon malheur. Ayant reçu ma relation, il fit entendre au roi tout ce qu'il voulut, et comme je m'étais sans doute trop bien conduit à son gré, il me répondit par une lettre pleine de reproches, m'accusant d'imprudence et d'avoir été, par mon peu de conduite, la cause de tout ce massacre. Il finissait en me donnant ordre, non plus d'arrêter les Macassars comme la première fois, mais d'en faire mourir tout autant que je pourrais.
Je n'avais pas attendu ses instructions sur ce point. Dès le lendemain de notre déroute, ayant encore assemblé tous les mandarins, je leur avais distribué des troupes avec ordre de se tenir sur les avenues pour empêcher que les ennemis qui avaient gagné les bois ne revinssent sur le bord de la rivière y jeter de nouveau l'épouvante, car c'est ce qu'il y a de plus habité dans le pays et l'endroit où ils pouvaient faire le plus de ravage.
Quinze jours après, j'appris qu'ils avaient paru à deux lieues de Bangkok. J'y courus avec 80 soldats que j'embarquai dans mon balon, le pays étant encore inondé. J'arrivai fort à propos pour rassurer les peuples. J'y trouvai plus de 1 500 personnes qui fuyaient comme des moutons devant 24 ou 25 Macassars qui étaient encore attroupés.
À mon arrivée, ces furieux abandonnèrent quelques balons dont ils s'étaient saisis et se jetèrent à la nage. Je leur fis tirer dessus, mais ils furent bientôt hors de la portée du fusil et se retirèrent dans les bois. Je rassemblai tout ce peuple effrayé, je lui reprochai sa lâcheté et la honte qu'il y avait à fuir devant un si petit nombre d'ennemis. Animés par mes discours, ils se rallièrent et les poursuivirent jusqu'à l'entrée du bois où, voyant qu'il était impossible de les forcer, je retournai à Bangkok.
Je trouvai en arrivant deux de ces malheureux qui, ayant été blessés, n'avaient pu suivre les autres et avaient été pris par nos Siamois. Un missionnaire que j'avais auprès de moi, appelé M. Manuel (12), les ayant regardés comme un objet digne de son zèle, fit tant et leur parla avec tant de force, qu'ils se convertirent et moururent peu de temps après avoir reçu le baptême.
Quelques jours après, on m'en amena un troisième. Le missionnaire le prêcha beaucoup, mais inutilement. Ce misérable demanda si, se faisant chrétien, on lui sauverait la vie. On lui dit que non. — Puisque je dois mourir, dit-il, qu'importe de demeurer avec Dieu ou avec le diable ? Là-dessus il eut le cou coupé. Un Siamois qui vit que je faisais emporter la tête pour l'exposer au bout d'une lance me pria de n'en rien faire, en m'assurant que quelqu'un ne manquerait pas de l'enlever dans la nuit pour s'en servir à des sortilèges auxquels la nation est fort portée. Je me pris à rire de ce qu'il disait, et me moquant de la superstition siamoise, j'ordonnai que la tête serait mise en un lieu où elle pût être vue et donner de la terreur aux autres.
Au bout de huit jours, quelques paysans effrayés vinrent m'avertir que les ennemis avaient paru sur le rivage, qu'ils y avaient pillé un jardin d'où ils avaient enlevé quelques herbes et une quantité assez considérable de fruits. J'y allai avec environ cent soldats armés de lances et de fusils. J'y trouvai plus de 2 000 Siamois qui s'étaient rendus sur le lieu. On me fit remarquer l'endroit où les Macassars avaient mangé et couché.
Lassé de me voir mener pendant si longtemps par une poignée d'ennemis, je résolus d'en voir le bout. Je partageai les deux mille hommes que j'avais en deux corps que je postai à droite et à gauche, et je me mis avec mes cent hommes aux trousses de ces bêtes féroces. Je suivis dans l'eau la route qu'ils s'étaient ouverte à travers les herbes. Comme ils mouraient presque de faim, ne se nourrissant depuis un mois que d'herbes sauvages, je vis bien qu'il était temps de ne les plus marchander, surtout n'ayant avec moi que des hommes frais et dont je pouvais tirer quelque parti. Dans cette pensée, je leur fis doubler le pas. Après avoir marché environ une demi-lieue, nous aperçûmes les ennemis et nous nous mîmes en devoir de les joindre.
Je les serrais de fort près. Pour m'éviter, ils se jetèrent dans un bois qui était sur la gauche, d'où ils tombèrent sur une troupe des miens qui, du plus loin qu'ils les aperçurent, firent une décharge de mousqueterie hors de la portée et se sauvèrent à toutes jambes. Cette fuite ne me fit pas prendre le change. Je joignis encore les ennemis et je mis mes soldats en bataille. Comme nous avions de l'eau jusqu'à mi-jambe, les Macassars ne pouvant venir à nous avec leur activité ordinaire, gagnèrent une petite hauteur entourée d'un fossé où il y avait de l'eau jusqu'au cou.
Je les investis, et m'approchant jusqu'à la distance de dix à douze pas, je leur fis crier par un interprète de se rendre, les assurant que s'ils se fiaient à moi je m'engageais à leur ménager leur grâce auprès du roi de Siam. Ils se tinrent si offensés de cette proposition qu'ils nous jetèrent leur lance contre, en témoignage de leur indignation, et se jetant un moment après eux-mêmes dans l'eau, le kriss aux dents, ils se mirent à la nage pour venir nous attaquer.
Les Siamois encouragés et par mes discours et par mon exemple, firent si à propos leur décharge sur ces désespérés qu'il n'en échappa pas un seul. Ils n'étaient plus que dix-sept, tout le reste était mort dans les bois, ou de misère, ou des blessures qu'ils avaient reçues. J'en fis dépouiller quelques-uns, je les trouvai tous secs comme des momies, n'ayant que la peau collée sur les os. Ils avaient tous sur le bras gauche de ces caractères dont nous avons parlé et avec lesquels ils se regardent comme invincibles sur la parole de leurs prêtres qui, pour quelque intérêt de peu de valeur, les séduisent misérablement tous les jours.
Telle fut la fin de cette malheureuse aventure qui, pendant un mois, me causa des fatigues incroyables, qui faillit me coûter la vie, qui me fit périr tant de monde et qui n'aurait jamais eu lieu sans la jalousie d'un ministre aussi méfiant que cruel.
Mais pour faire voir encore mieux combien injustes étaient les reproches qu'il me fit, lorsqu'en répondant à ma lettre il m'avait taxé d'imprudence, je rapporterai en peu de mots ce qui se passa à Siam au sujet du prince des Macassars qui, après la conspiration découverte, s'était retranché dans son camp. M. Constance, résolu de l'attaquer, avait ramassé plus de 20 000 hommes à la tête desquels il avait mis quarante Européens, Français, Anglais et Hollandais. Avec ces troupes, il entreprit de forcer les retranchements des ennemis. Ceux-ci firent d'abord semblant de fuir. Constance y fut trompé, et les croyant en déroute, il commanda aux Siamois de les poursuivre. Ses gens les chargèrent d'abord et les suivirent en assez bon ordre, mais peu à peu, s'étant débandés, les Macassars firent tout à coup volte-face et les chargèrent à leur tour si vigoureusement qu'ils tuèrent d'abord dix-sept des Européens et plus de mille Siamois. M. Constance faillit à y périr et ne se sauva qu'en se jetant dans la rivière où il se serait noyé sans le secours d'un de ses esclaves.
La quantité de corps morts que la rivière emportait et qui passèrent devant Bangkok furent les premiers courriers qui nous annoncèrent cette défaite, après laquelle le ministre ne se trouva pas peu embarrassé. Il fit faire plusieurs propositions au prince des Macassars qui ne voulut jamais rien entendre. Enfin, n'y ayant plus d'autre parti à prendre, il se résolut à une seconde attaque, à laquelle il se prépara pendant deux mois et dont il se tira avec plus d'honneur, ayant pris des mesures plus justes que la première fois. L'expérience qu'il avait faite lui ayant appris qu'il avait affaire à des gens dont il ne lui serait pas aisé de tirer parti s'il les attaquait à force ouverte, il s'avisa d'un stratagème qui lui réussit et auquel il fut redevable de la victoire.
Comme le pays était inondé, en sorte qu'on était obligé de marcher dans l'eau jusqu'à mi-jambe, il fit faire des claies de cannes où l'on avait posé fort près l'un de l'autre de gros clous à trois pointes, qui traversaient la claie et s'élevaient par-dessus à la hauteur d'un demi-pied. Ces machines qui marchaient devant les troupes furent plongées dans l'eau, en sorte que ne paraissant plus, et les Macassars à leur ordinaire venant tous à la fois à la charge, tête baissée, et sans voir où ils mettaient les pieds, se trouvaient pris pour la plupart, tellement que ne pouvant plus ni avancer ni reculer, on en tua debout à coups de fusil un nombre très considérable.
Ceux qui échappèrent s'étant retranchés dans des maisons de cannes ou de bois auxquelles on mit le feu, n'en sortirent qu'à demi brûlés et se laissèrent assommer sans qu'aucun demandât quartier ; aussi ne sauva-t-on la vie qu'à deux jeunes fils du prince qui furent amenés à Louvo. On les a vus depuis en France servir dans la marine, ayant été amenés dans le royaume par le père Tachard (13).

1 - Les Macassars étaient des habitants des îles Célèbes, conquises par les Hollandais à la fin des années 1650. Le prince cité par le chevalier de Forbin était le Prince Daéng Mangallé, qui, pour fuir l'oppression hollandaise, vint s'installer à Ayutthaya vers 1664 avec une soixantaine de familles. ⇑
2 - Le camp des Macassars était situé en contrebas de ceux des Malais et des Portugais.
 Emplacement du camp des Macassars à Ayutthaya. ⇑
Emplacement du camp des Macassars à Ayutthaya. ⇑
3 - Aucune source n'affirme que Daéng Mangallé fut à l'origine de la révolte, même s'il est probable qu'il y fut impliqué. Selon les témoignages, on évoque un personnage influent, un capitaine malais natif de Champa (Tachard), un Malais, homme audacieux n'ayant rien à perdre (...) [et] un prêtre mahométan (Turpin), etc. Voir Christian Pelras : La conspiration des Makassar à Ayuthia en 1686, Archipel 1998, et Michael Smithies, Accounts of the Makassar Revolt, 1686, JSS n° 90.1&2, 2003). ⇑
4 - Le Mercure galant d'Octobre 1687 publiait un long extrait de lettre venue de Siam même qui relatait les détails de la révolte des Macassars :
Il y a environ vingt-sept ans que les Hollandais s'étant rendus maîtres du pays de Macassar, qui est à la pointe de l'île Célèbes, le roi de Macassar fut obligé de se retirer chez le roi de Jambi [Java], où il fut fort bien reçu, mais étant naturellement fort remuant, il ne put s'empêcher de cabaler contre ce roi qui était son bienfaiteur. La chose ayant été découverte, on le fit mourir. Son fils alla se jeter aux pieds du roi de Jambi, auquel il représenta que n'ayant point eu de part à la mauvaise conduite de son père, il espérait de sa clémence qu'il n'en aurait point à son supplice. En effet, le roi de Jambi donna à ce jeune prince macassar non seulement la permission de se retirer où il voudrait avec environ deux cent cinquante Macassars qu'il avait avec lui, mais encore il leur fournit un bâtiment pour aller dans les États du roi de Siam, qui leur donna un camp auprès de la ville pour y faire commodément leur résidence, de même que plusieurs autres nations qui ont des camps autour de Siam. Ce prince macassar, fort zélé mahométan, ayant cru découvrir depuis environ trois ans que le roi de Siam songeait à quitter le paganisme, en donna aussitôt avis au roi de Perse, qui envoya un ambassadeur à Sa Majesté siamoise pour l'exhorter à embrasser l'Alcoran. Cet ambassadeur arriva à Tenasserim lorsque M. le chevalier de Chaumont partait de Siam pour retourner en France, et y ayant appris la bonne réception que le roi de Siam lui avait faite, il crut que ce prince avait embrassé l'Évangile, parce que dans l'Orient, lorsque les rois ont changé de religion, ils ont toujours pris la chrétienne ou celle de Mahomet, selon que ceux qui se sont présentés les premiers pour les prier d'embrasser leur religion étaient chrétiens ou mahométans. Ainsi cet ambassadeur persan, ne doutant pas qu'à son retour en Perse on ne lui fît couper le cou, parce qu'en effet contre les ordres du roi son maître il avait beaucoup plus tardé qu'il ne devait, il s'égorgea lui-même à Tenasserim. Cette nouvelle qui affligea le prince macassar ne lui ôta pas l'envie de conspirer contre la vie du roi de Siam et de prendre des mesures pour venir à bout de son dessein qui devait s'exécuter le 15 août de l'année dernière. Il voulut en donner avis à un grand seigneur qui était à Louvo avec le roi, qu'il ne quittait point à cause de ses charges, et lui écrivit un billet par un Macassar affidé, qui étant entré dans le palais, y fut rencontré par M. Constance devenu alors barcalon par la mort de celui qui possédait cette charge. M. Constance ayant demandé à ce Macassar qu'il reconnut ce qu'il venait faire à Louvo, et s'il ne savait pas qu'aucun étranger ne devait entrer dans la maison du roi sans en avoir demandé la permission, il le trouva chancelant, ce qui lui fit soupçonner quelque chose et l'obligea d'ordonner qu'on le fouettât pour avoir osé entré chez le roi sans le consentement du grand barcalon. Lorsqu'on voulut lui ôter son pagne, le billet du prince macassar, qui était en chiffre, tomba de la poche que les Siamois portent au-devant de cet habillement. On essaya en vain de le déchiffrer, ce qui fit résoudre sur le champ d'en mettre le porteur à la question pour lui faire avouer la vérité, ce qu'il fit après qu'on lui eut promis de lui pardonner. Lorsqu'on eut appris que les mesures avaient été prises pour le 15 août et que le grand seigneur qui était alors en cour s'était mis de la partie, le roi de Siam s'abandonna entièrement à M. Constance pour faire ce qu'il jugerait à propos. Comme M. Constance est humain, il envoya quérir ce seigneur, et lui ayant fait connaître que tout était découvert, il lui conseilla d'avoir recours à la clémence du roi, auprès duquel il promit de le servir, à condition qu'il avouerait toutes choses, ce qu'il fit avec franchise, après quoi M. Constance partit toute la nuit de Louvo pour se rendre à Siam, d'où il alla au camp des Macassars, où ayant fait entendre à leur prince que sa conspiration était découverte et qu'il n'y avait point d'autre parti à prendre pour lui que d'avoir recours à la clémence du roi, ce prince loin de l'écouter, éclata en injures contre la conduite du roi de Siam qu'il traita de chien pour avoir préféré l'Évangile à l'Alcoran. Cela fit résoudre M. Constance de retourner dans la ville où il assembla ce qu'il put d'amis pour venir assiéger le camp des Macassars et pour y prendre leur prince. Mais ayant débarqué avec une vingtaine de ses amis dont il connaissait le courage et le zèle pour lui, les Siamois qui étaient dans les balons pour le soutenir se retirèrent et emmenaient les balons, lorsque M. Constance s'étant jeté à l'eau pour les faire revenir, en vint à bout fort heureusement. Le prince macassar les voyant venir, se présenta avec deux cents des siens, la lance à la main pour les repousser. M. Constance était alors avec ses troupes sur une pointe de terre dont le camp des Macassars était commandé. Leur prince était prêt de le percer, lorsque M. Véret, chef du comptoir de la Compagnie française, s'avança, et retirant M. Constance d'un si grand péril, tira un coup de fusil dans l'épaule droite du prince macassar, qui en mourut peu après, ce qui obligea ses gens de se rendre. On en fit mourir les plus coupables, et les autres furent condamnés à porter de la terre le reste de leur vie. Les deux fils de ce prince malheureux sont partis pour la France dans le navire nommé le Coche, commandé par M. de Hautmesnil. ⇑
5 - Le cati, ou catti, mot probablement d'origine malayo-javanaise était le terme employé dans les relations occidentales pour évoquer l'unité de poids siamoise chang (ชั่ง). Aujourd'hui, en Thaïlande, le chang est fixé officiellement à 600 g. On peut penser qu'il était légèrement supérieur au XVIIe siècle. ⇑
6 - Dans l'ancienne armée française, bas-officier d'infanterie, subordonné au caporal. (Littré). ⇑
7 - Un soldat aux gardes était un soldat du régiment des gardes françaises, régiment formé par Charles IX et destiné à garder les avenues des lieux où le roi était logé. ⇑
8 - On trouve également les formes crid, ou criss, ou encore kriss. Dans son Second voyage, le père Tachard fournit de curieuses indications sur cette arme : Le kriss est un petit poignard d'un pied à un pied et demi de long, dont la lame est plate et faite le plus souvent en ondes par les cotés. Elle peut avoir deux doigts de large au-dessous de la garde ; de là, elle va en diminuant peu à peu se terminer dans une pointe assez aiguë. Il y a de ces criss dont la lame est empoisonnée, ce qui se fait en deux manière : ou bien en y appliquant le poison à chaque fois qu'on s'en veut servir, ou bien en mêlant le poison dans la trempe où l'on met le fer, afin que la substance en soit pénétrée, et de ces derniers on en trouve, à ce qu'on dit, dont la lame coûte jusqu'à mille écus. Il est vrai qu'ils sont un temps considérable à faire ces sortes d'ouvrages. Ils observent certains moments superstitieux pour la trempe ; ils frappent un nombre déterminé de coups à certains jours du mois pour le forger ; ils interrompent leur travail des semaines entières, et ils passent quelquefois ainsi à diverses reprises toute un année à faire ce chef-d'œuvre de leur art diabolique. Les faiseurs de talismans gardent moins de cérémonie dans la fabrique de leurs figures. Ce poison est si subtil en été qu'il suffit que le kriss fasse une légère égratignure et tire une goutte de sang, pour être en peu de temps porté jusqu'au cœur. Le seul remède, à ce que tout le monde dit, est de manger au plus vite ses propres excréments. Au reste un brave malais et son kriss sont inséparables. Le rendre est parmi eux un insigne affront : le tirer et ne tuer personne est une marque de lâcheté. Ces deux maximes ont encore plus de cours chez les Macassars que chez les autres. (Tachard, Second voyage, p. 90-91).
 Kriss d'un dignitaire. Rijksmuseum. ⇑
Kriss d'un dignitaire. Rijksmuseum. ⇑
9 - Il s'agissait du capitaine Hue. ⇑
10 - Targe, ou Targue : Bouclier dont usaient les Romains, les Espagnols & les Africains. Il était fait en façon de croissant courbe et carré long, qu'on appelait en latin pelta. (Furetière). ⇑
11 - Ce même Beauregard deviendra gouverneur de Bangkok après le départ du chevalier de Forbin, puis gouverneur de Mergui avec le titre d'Okphra. Voir sur ce site la page qui lui est consacrée : Beauregard. ⇑
12 - Étienne Manuel (1662-1693) était l'un des trois missionnaires des Missions Étrangères qui arrivèrent au Siam avec l'ambassade du chevalier de Chaumont. Il fut emprisonné après la révolution de Siam, puis se rendit en Cochinchine. Voir sa biographie sur le site des Missions Étrangères : Étienne Manuel. ⇑
13 - André François Boureau-Deslandes, le fils du fondateur du comptoir de Siam, évoque ces deux rescapés : Le sort de l'aîné fut bien triste : il se tua lui-même à coups de couteau. Pour le second, je l'ai connu à Brest, il avait la couleur, l'air et les manières d'un nègre grossier. Jamais les jésuites n'ont fait une plus mauvaise emplette que d'avoir amené en France ces princes macassars. Ils déshonoreraient l'humanité. Je dirai en passant qu'on a souvent été trompé à Paris et à la cour par ces prétendus princes d'Asie et d'Afrique. On aurait dû rougir seulement de les présenter, à moins que ce ne fût comme des animaux extraordinaires. (Histoire de M. Constance, 1756, p. 29-30). ⇑

2 janvier 2019
