

LETTRE DU 15 FÉVRIER 1690
Monsieur,
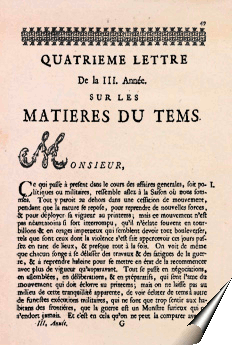
Ce qui se passe à présent dans le cours des affaires générales, soit politiques ou militaires, ressemble assez à la saison où nous sommes. Tout y paraît au-dehors dans une cessation de mouvement, pendant que la nature se repose pour reprendre de nouvelles forces et pour déployer sa vigueur au printemps ; mais ce mouvement n'est pas néanmoins si interrompu qu'il n'éclate souvent en tourbillons et en orages impétueux qui semblent devoir tout bouleverser, tels que font ceux dont la violence s'est fait apercevoir ces jours passés en tant de lieux, et presque tout à la fois. On voit de même que chacun songe à se délasser des travaux et des fatigues de la guerre, et à reprendre haleine pour se mettre en état de la recommencer avec plus de vigueur qu'auparavant. Tout se passe en négociations, en assemblées, en délibérations, et en préparatifs qui sont l'âme du mouvement qui doit éclore au printemps, mais on ne laisse pas, au milieu de cette tranquillité apparente, de voir éclater de temps à autre de funestes exécutions militaires qui ne font que trop sentir aux habitants des frontières que la guerre est un monstre furieux qui ne s'endort jamais. Et c'est en cela qu'on ne peut la comparer avec la nature, dont le cours ordinaire est de faire du bien aux hommes et de les enrichir de ses présents, tandis qu'ils ne s'occupent qu'à le détruire en se détruisant eux-mêmes. Cependant, parmi tant de tristes effets de la guerre, on voit encore reluire quelques beaux jours, et tels sont ceux qui se passent à Augsbourg, où leurs majestés impériales, après avoir vu il n'y a pas bien longtemps toutes leurs espérances sur le point d'être fauchées, se voient enfin aujourd'hui couronnées de bonheur, autant par la main d'un ennemi que par celle de leurs amis. C'est de quoi j'aurai occasion de vous entretenir dans ma première lettre. Je vais fini le récit de l'affaire de Siam, ainsi que je vous l'ai promis, afin de passer à d'autres matières.
Nous en sommes demeurés à la fin tragique du malheureux Constantin Phaulkon. On prit soin de la cacher au commandant Desfarges qui était à Louvo, et qui eut ce même soir son congé pour aller à Bangkok avec deux mandarins auxquels il devait remettre cette forteresse. En descendant la rivière, il fut agité de diverses pensée, incertain du parti qu'il devait prendre, d'obéir ou de ne pas obéir, mais enfin, il prit le pire en manquant à sa parole, et en s'exposant à se voir contrainte de la tenir de mauvaise grâce. Les mémoires remarquent que dès qu'il fut arrivé, il fit arrêter les gens qui l'avaient conduit, et qu'il voulut aussi se saisir des deux mandarins, mais son coup lui manqua. Il fit même tirer sur deux jonques du roi (qui sont des bâtiments de la Chine), lesquels descendaient la rivière pour aller au Japon, et parce que deux hommes de la forteresse, dont l'un était Européen, et tous deux au service du roi de Siam, refusèrent de tirer sur ces bâtiments, ils furent mis en prison et ensuite cruellement empalés (1). Les mémoires ajoutent que M. Desfarges, ayant eu après cela le temps de réfléchir sur cette action et sur les suites qu'il en devait craindre, écrivit une lettre en Cour par laquelle il tâchait de s'excuser, en rejetant la faute sur ses gens qui, à ce qu'il disait, ne lui avaient pas voulu obéir, et pour marquer qu'il n'y avait point contribué, il demandait un vaisseau pour le transporter avec ses gens hors du royaume, ainsi qu'il avait été convenu. Mais le général Phetracha, avant que de lui faire réponse, jugea à propos de prendre les précautions nécessaires pour prévenir la suite de ces hostilités. Il envoya beaucoup de monde pour garder le bas de la rivière, lesquels depuis là jusque auprès de Bangkok, firent élever 12 batteries, enfoncèrent des bâtiments à l'embouchure, et bordèrent de palissades toutes les avenues, où ils mirent une forte garde pour empêcher qu'on ne pût entrer ni sortir sans leur permission.
Le bruit de tout ce qui s'était passé ayant été répandu dans Louvo donna lieu à un autre incident qui augmenta encore l'irritation contre les Français. Les deux fils de M. Desfarges y étaient demeurés en otage, comme il a été ci-devant remarqué, et c'était une chose assez extraordinaire que leur père eût osé prendre le parti de contrevenir à son accord, pendant qu'il laissait ses deux fils pour sûreté de son engagement. Comme ils n'étaient pas fort étroitement gardés, dès qu'ils apprirent cette fâcheuse nouvelle, ils songèrent à se tirer du péril qui les menaçait, et à pourvoir à leur sûreté par la fuite. Ils trouvèrent le moyen de se sauver avec 10 ou 12 autres Français, mais ils eurent le malheur d'être pris en chemin, et ramenés dans la ville, ce qui coûta la vie à l'un d'entre eux qui avait été donné pour ingénieur au roi de Siam, et qui tomba mort à terre, soit que la frayeur l'eût saisi, ou quelque autre accident (2). Il n'arriva néanmoins autre chose de ce contretemps qui semblait leur devoir attirer des suites fâcheuses, sinon qu'ils furent plus étroitement resserrés et gardés, et qu'il en coûta la prison à plusieurs autres Européens.
On peut juger que les choses étant aigries au point où elles l'étaient par le procédé des Français, les autres nations chrétiennes en furent extrêmement alarmées, craignant non sans beaucoup de sujet de se trouver enveloppées dans le ressentiment des Siamois ; ce que le général ou régent ayant appris, il envoya quelques mandarins au chef des Hollandais, pour les rassurer, en lui faisant dire qu'on ne devait point se mettre en peine sur tout ce qui passait, et l'assurant en particulier de l'estime qu'il avait pour la Compagnie, à laquelle il empêcherait qu'on ne fît aucun tort, mais faisant en même temps de grandes plaintes contre les Français, sur la manière dont ils agissaient envers les Siamois pour récompense de tant de bienfaits dont ils avaient été comblés et de tous les bons traitements qu'ils avaient reçus, tant du roi que de ses sujets. En quoi le régent prit le contre-pied du défunt favori, lequel n'était pas ami des Hollandais et le leur avait témoigné en plusieurs occasions, qui peut-être auraient pu avoir quelques suites s'il eût continué dans la faveur (3). Il est vrai que le régent n'eut pas la même confiance pour les Anglais et les Portugais, et qu'il craignit que les Français ne les sollicitassent de se joindre à eux et de les secourir, surtout au cas que le parti abattu reprît quelque vigueur en se joignant à l'autre qui se soutenait encore, comme on le verra ci-après. C'est pour cela qu'il fit arrêter leurs vaisseaux qui étaient au bas de la rivière, et en fit ôter tous les agrès. Cette précaution lui parut d'autant plus nécessaire qu'il y avait encore deux vaisseaux du roi en mer, lesquels avaient eu ordre d'aller croiser sur les corsaires, et dont on attendait le retour (4), et comme ils étaient commandés par des Français et que la plupart de l'équipage était de la même nation, le régent voulait s'en assurer avant que les capitaines fussent avertis de ce qui se passait ; en quoi la diligence fut nécessaire, car le commandant Desfarges avait fait armer une chaloupe pour l'envoyer au-devant de ces vaisseaux, laquelle en descendant la rivière, voulut forcer le passage malgré l'opposition des Siamois, mais après une vigoureuse résistance, elle fut prise et brûlée, et les deux vaisseaux tombèrent au pouvoir du régent (5).
Le commandant français sentit bien que ce dernier coup manqué n'adoucirait pas les esprits en sa faveur, et voulant marquer aux Siamois qu'il se désistait de toute hostilité, il fit ôter le pavillon français et arborer celui de Siam sur le château de Bangkok, mais cela ne servit qu'à exciter le mépris et les railleries des Siamois. Le régent était dans une telle indignation, qu'il fut sur le point d'envoyer au vieux château l'évêque de Métellopolis et les deux fils du commandant, pour les faire attacher à la bouche d'un canon et les envoyer au lieu de boulet à ce commandant. Mais le chef des Hollandais en ayant été averti, et se prévalant de l'accès favorable qu'il avait trouvé auprès du régent, le supplia avec tant d'instance et par des raisons si touchantes de ne pas étendre sa colère sur des innocents, que le régent, plein d'ailleurs d'humanité, non seulement se laissa fléchir, mais fit une action assez surprenante quelques jours après, car il renvoya de son propre mouvement ces deux enfants à leur père, avec une lettre par laquelle il se contenta de lui reprocher son manquement de parole, sa perfidie, et son inhumanité pour ses propres enfants ; que nonobstant cela, il avait trouvé grâce auprès de lui, parce qu'il n'aimait pas à répandre le sang, et qu'il ne voulait pas se venger sur deux innocents ; mais qu'il ferait connaître à tout le monde que les Siamois avaient toute la justice de leur côté, et que les Français avaient tout le tort (6). Paroles qui font autant d'honneur à ce prince païen et à sa nation qu'elles en font peu à des gens qui se disaient envoyés pour la convertir.
Le commandant Desfarges voyant revenir ses deux enfants par un bonheur si imprévu, et connaissant par là que l'esprit du Régent était adouci, il écrivit une lettre pour l'en remercier et pour le supplier en même temps qu'on lui envoyât un vaisseau pour se retirer. La réponse fut qu'on lui accordait une suspension d'armes, mais que la Cour n'avait encore pu se résoudre sur le reste, après tant d'infractions précédentes, et qu'il fallait qu'il attendît les ordres qui lui seraient envoyés. Cependant, il fut ordonné à celui qui commandait les troupes de Siam d'y veiller de près, et en cas de quelque nouvelle hostilité de la part des Français, de faire main basse sur eux.
Les choses étaient en cet état lorsque le régent trouva d'autres affaires à démêler. La maladie du roi augmentait à vue d'œil, et le prince son plus jeune frère, lequel plusieurs mandarins voulaient élever sur le trône, n'oubliait rien pour grossir son parti et pour profiter des débris de celui qui venait d'être abattu. Il faisait faire sous main de grandes levées, et il tâchait par tous moyens de se mettre en état de s'emparer de la Couronne dès que le roi son frère serait mort. Le régent ne témoigna pas au commencement de s'en mettre beaucoup en peine, parce qu'il dissimulait son dessein, et l'on dit même qu'un jour, le roi lui ayant fait demander si après sa mort il voudrait accepter la Couronne, il fit réponse qu'il n'y pensait en aucune manière, ce qui donna d'autant plus de droit au prince d'y prétendre ouvertement. Il avait ses raisons pour dissimuler, et il jugeait qu'alors il n'y avait pas assez de sûreté pour lui en déclarant son dessein. Mais après qu'il eut affermi son pouvoir et qu'il connut qu'il était temps d'arrêter les progrès de son concurrent, il ne craignit plus de manifester son dessein. Il fit prendre les deux frères du roi, le soir du 9 juillet, et il les fit assommer (à ce qu'on dit) dans une pagode hors de la ville de Louvo (7) ; ce qui étant venu à la connaissance du roi, augmenta encore son chagrin et son mal, en sorte qu'il mourut de son hydropisie le 11 juillet, après avoir gouverné glorieusement son royaume pendant 31 ans, 8 mois et 14 jours, ne laissant d'autres enfants que la princesse sa fille, dont il a été fait mention ci-devant, à laquelle il remit l'épée royale quelques heures avant sa mort.
Le régent se vit par là au-dessus de tous ses desseins, cependant sans y trouver le moindre obstacle, tout demeurant tranquille comme auparavant et soumis à son pouvoir. Enfin, le premier jour du mois d'août, il sortit de Louvo avec le corps du roi, et se rendit à Siam dans un pompeux équipage, où il se fit proclamer roi et ensuite couronner, ayant épousé la princesse afin de rendre son règne pour assuré et d'ôter tout prétexte de l'y troubler. Avant son départ de Louvo, il avait donné le vieux palais aux talapoins, les maisons aux habitants, tous les beaux bâtiments, églises, chapelles, collèges et autres que le défunt ministre avait fait construire à plusieurs grands et mandarins, et les moindres furent assignés pour la demeure des marchands chinois. Mais ce qu'il y eut de plus remarquable dans le commencement de son règne, c'est qu'il posséda tout d'un coup la même autorité absolue qu'avait son prédécesseur, sans se voir traversé ni contredit en aucune manière, mais au contraire applaudi et estimé de tout le monde, en sorte qu'on ne s'aperçut pas d'avoir changé de gouvernement, et il semblait qu'il eût été assis sur le trône pendant une longue suite d'années, tant il en était paisible possesseur.
Quoique cette soumission des grands et des peuples soit l'effet ordinaire d'un pouvoir qui se fait craindre et respecter, cependant on rend cette justice au nouveau roi que sa bonne conduite et ses qualités personnelles ont autant ou plus contribué que son pouvoir à l'affermir tout d'un coup dans son élévation. On l'avait vu auparavant vivre d'une manière réglée, modeste et tranquille, content de sa dignité et de son emploi, n'étant à charge à personne, souhaitant le soulagement des peuples, s'étant opposé aux droits excessifs que le feu roi avait imposés dans les dernières années de son règne par le conseil de son ministre, et les ayant même ôtés pendant sa régence. D'ailleurs, il avait toujours marqué de l'affection et de la bienveillance pour les talapoins, ce qui lui attirait tout le crédit qu'ils avaient sur les peuples. Avec toutes ces qualités et les autres que j'ai déjà remarquées, il ne faut pas s'étonner s'il s'est attiré l'estime générale. Aussi a-t-il pris soin de la cultiver depuis sa royauté, car se voyant tranquille, sans guerre et sans obstacles à surmonter, il a fait jouir les peuples de l'exemption des impôts qu'il avait ôtés pendant sa régence, et même des gros droits sur le bétail, fruits et autres denrées, voulant que pendant trois ans ils en demeurent déchargés dans toute l'étendue du royaume, afin qu'ils puissent reprendre haleine, et se mettre en état de supporter les charges à l'avenir avec moins d'incommodité. Un roi est bien puissant et bien riche quand il peut ainsi posséder le cœur de ses sujets.
Les choses s'étant passées de cette manière, il arriva de nouveaux incidents de la part des Français, qui excitèrent d'autres plaintes contre eux, aussi bien des Portugais et des Anglais que de ceux du pays, et qui contribuèrent à faire hâter leur départ, dont ils se tirèrent d'aussi mauvaise grâce que de tout le reste.
Le premier incident fut que le commandant Desfarges, n'étant instruit que confusément de ce qui venait d'arriver, résolut d'envoyer à la Cour deux Portugais nés de Siamoises pour épier ce qui s'y passait ; mais quoiqu'il les eût fait habiller à la mode du pays, à peine furent-ils arrivés à la Cour qu'on les reconnut. Ils furent aussitôt arrêtés comme espions, et le nouveau roi prit si mal cette action, après toutes les autres, qu'il défendit le port d'armes à tous les Portugais sans exception et fit prendre tous leurs enfants qui étaient nés tant de femmes de Pégou que de celles de Siam, qui s'étaient faites chrétiennes, ce qui causa beaucoup de pleurs et de lamentations parmi tous ceux de cette nation, et de plaintes contre les Français qui leur avaient attiré cette affaire, pour laquelle le chef des Hollandais s'employa à leur instante prière, mais sans beaucoup de succès, n'ayant pu obtenir qu'une partie de sa demande, laquelle ne leur fut pas d'un grand soulagement (8).
Le second incident fut que les Français se saisirent d'un vaisseau anglais qui était devant Ténassérim, chargé de riz et prêt à partir pour la côte de Coromandel, dont les Siamois furent tellement irrités qu'ils tuèrent une partie des Français qui étaient restés à terre, et firent le reste prisonniers (9). Le roi ne voulut plus écouter de justification de leur part, et pour s'en délivrer, il envoya enfin au commandant la permission de se retirer, en achetant les vaisseaux et les provisions qui leur étaient nécessaires, et laissant pour otages jusqu'à leur départ l'évêque de Métellopolis et le chef de la Compagnie française. Ce qui fut exécuté. Ils achetèrent des Portugais deux vaisseaux et une chaloupe, et ils prirent leurs provisions des Siamois en payant.
Le troisième fut que dans le temps que tout se préparait pour leur départ, ils apprirent que le vaisseau l'Orphelin (10) était arrivé de France à la rade de Siam le 9 septembre, ce qui d'abord leur donna beaucoup de joie et les flatta de l'espérance d'un plus grand secours, en sorte que non seulement ils ne se pressèrent plus de partir, mais ils entreprirent auparavant de s'assurer de la femme et du fils du défunt ministre (qui avaient été mis en liberté) en les faisant conduire secrètement à Bangkok (11), ce qui fut ménagé par le moyen de quelques pères qui étaient restés à Siam et qui pouvaient aller et venir où bon leur semblait ; et fut exécuté le 4 octobre. Mais cela ne put être si bien caché que le roi n'en eût connaissance au bout de quelques jours, sur quoi il fit savoir au commandant que s'il ne renvoyait cette femme et son fils qui étaient sujets de la Couronne, et s'il ne les faisait promptement remettre au même lieu d'où ils avaient été enlevés, ni lui ni aucun Français ne sortiraient plus du royaume (12). À cette menace, il fallut obéir. Les deux personnes furent remises le 19 du même mois entre les mains des gens du roi, avec offre de la part du commandant de donner de nouveaux otages pour sûreté de son départ, et priant qu'on lui en donnât de réciproques pour l'assurer qu'après sa sortie de Bangkok, il ne lui serait fait aucune insulte, lesquels otages seraient échangés et restitués de part et d'autre lorsque les Français seraient hors de la rivière et du pouvoir des Siamois. Le roi, voyant qu'ils avaient obéi, consentit à leur demande. Les otages furent donnés de part et d'autre, et les Français partirent enfin le 9 septembre (13) et se rendirent bientôt à la rade de Siam avec quatre bâtiments (14). Il fut question de faire l'échange des otages : le barcalon renvoya de bonne foi à leur bord les otages français, dont l'un était fils de M. Desfarges, et l'autre un officier (15), et il y ajouta même un régal de plusieurs rafraîchissements. Mais les Français finirent aussi mal qu'ils avaient commencé, car ils retinrent les otages siamois, avec environ 10 autres personnes, et se contentèrent de renvoyer le bateau (16) ; encore dit-on qu'ils dépouillèrent et maltraitèrent les gens qui étaient dessus, ce qui paraît presque incroyable, si les mémoires ne l'affirmaient positivement. Quoi qu'il en soit, ils s'éloignèrent ainsi de la vue de la rade de Siam, faisant voile, à ce qu'on dit, du côté de Coromandel. Quelques-uns disent que le commandant français a agi de cette manière pour se contre-gager de plusieurs effets que la Compagnie avait encore dans le pays, et d'une vingtaine de Français qu'ils avaient laissés à terre, dont plusieurs étaient malades, outre l'évêque de Métellopolis et une dizaine de pères ou religieux qui étaient demeurés à Siam (17). Mais ce fut plutôt un mal qu'une précaution, puisque c'était le vrai moyen d'exposer toutes ces personnes au ressentiment des Siamois, outrés au dernier point de cette dernière action, qui avait comblé la mesure de toutes les précédentes infractions. Tous furent privés de la liberté qu'on leur avait laissée, et plusieurs maltraités et mis aux fers, et particulièrement l'évêque, qui s'était rendu caution du bon comportement des Français, avec le chef de leur Compagnie (lequel s'était retiré secrètement) de même que les pères et religieux qui sont demeurés les victimes des fautes d'autrui, parce que les Siamois les regardent, et principalement l'évêque, comme les conseillers du défunt ministre et les principaux auteurs de tout le mal qui est arrivé.
C'est par là que finissent les mémoires qui sont venus de Siam et de Batavia, et ceux en particulier qui m'ont été mis entre les mains, lesquels j'ai suivis exactement, quoique j'aie passé par-dessus plusieurs circonstances qui ne m'ont pas paru absolument essentielles, afin d'abréger ce récit et de le finir par quelques réflexions.
Je commencerai par celles qui ont été faites sur les lieux, lesquelles j'étendrai un peu plus qu'elles ne le sont dans les mémoires. On dit donc premièrement que le défunt roi, tout habile et éclairé qu'il était, a marqué plus de bonté et de facilité que de prudence en s'abandonnant avec tant de confiance aux démonstrations d'amitié qu'il recevait de la part des Français, dont la suite a fait voir que leurs desseins, quoique couverts du spécieux prétexte de la conversion, n'étaient pas aussi désintéressés qu'il se l'était imaginé. À la vérité, il n'y avait pas donné tout d'un coup. C'était une affaire ménagée de longue main, et dont l'évêque de Métellopolis avait jeté les premiers fondements.
Sur quoi l'on raconte une histoire qui mérite d'être ici insérée. On dit qu'en l'année 1660, ce prélat ayant été envoyé de France aux Indes avec deux autres évêques titulaires de Berythe et d'Héliopolis (18), et tous trois par différentes route, afin de prendre une exacte connaissance de ces pays, et d'y travailler à la propagation de la religion chrétienne, et en même temps y répandre la renommée du nom français, cela donna occasion à l'évêque de Métellopolis (19) de s'arrêter à la Cour de Siam, où il s'appliqua à jeter de meilleurs fondements d'instruction et de connaissance que les ecclésiastiques portugais n'avaient fait jusque alors, ce qui lui réussit assez heureusement, par le soin qu'il prit de se rendre recommandable, non seulement par son savoir dans les Lettres et dans la langue du pays, mais aussi par sa piété. On ajoute qu'il se présenta ensuite une occasion assez extraordinaire qui le fit encore mieux connaître et lui attira l'estime et la bienveillance de la Cour, car on dit que le roi de Golconde, mahométan, qui avait beaucoup d'envie de faire embrasser sa croyance à celui de Siam, lui envoya une célèbre ambassade, dont le chef était un homme habile et adroit, lequel fit en sorte d'obtenir une conférence avec quelques talapoins en présence du roi ; mais comme ces religieux ne sont pas des plus éclairés, ils s'en tirèrent si mal que le roi, qui n'avait pas consenti fort volontiers à cette conférence, se repentit de l'avoir accordée. Cependant, l'évêque en ayant eu plusieurs avec les Mores en différentes occasions où il les avait toujours confondus, on proposa au roi de le mettre aux mains avec le docteur mahométan, ce qui ayant été fait en présence de la Cour, ce prélat se joua tellement de son adversaire qu'il le rendit tout confus et interdit, dont la Cour témoigna une grande joie, et le roi particulièrement, jusque-là qu'on remarque qu'il dit : Je ne vois jusqu'à présent aucunes raisons qui m'obligent de quitter la religion de mes pères, cependant si je venais à changer d'avis, je ne deviendrais jamais mahométan, mais chrétien. Voilà de quelle manière on raconte cette histoire. Quoi qu'il en soit, il est constant que cet évêque avait acquis beaucoup de crédit auprès du roi et des grands de sa Cour, qu'il obtint plusieurs grâces en faveur de la religion et qu'il se prévalut de cet accès pour donner des idées avantageuses de la grandeur de la France et de l'utilité qui reviendrait au royaume de Siam de lier une étroite amitié et correspondance entre les deux Cours. Son crédit augmenta encore par la faveur où parvint le ministre Constantin Phaulkon, avec lequel il se lia très particulièrement, et c'est sur ces heureux commencements que l'on forma dans la suite le plan de l'entreprise et de son exécution, par tous les autres ressorts qui ont paru. Il ne faut pas s'étonner si les choses ayant été ainsi amenées de loin et par des circonstances si favorables, elles ont prévenu et disposé l'esprit du roi de Siam à faire des démarches qu'il n'aurait pas faites sans cela. Il était assez difficile à ce monarque de résister aux douces et avantageuses impressions qui lui étaient insinuées de temps en temps en faveur des Français par des personnes qui possédaient son estime et sa confiance. Il se voyait recherché, caressé et applaudi. Il se flattait d'y trouver une puissante amitié. Le cœur des rois n'est pas inaccessible à ces douceurs, non plus qu'aux persuasions de ceux qui les obsèdent. Mais leurs fautes sont moins excusées que celles des autres hommes, et surtout lorsqu'elle procèdent d'un défaut de prévoyance et de précaution, comme est celle dont il s'agit, parce qu'on juge de leurs lumières par l'étendue de leur puissance, et qu'étant regardés comme l'œil et l'intelligence du grand corps qu'ils gouvernent, on suppose que non seulement ils aperçoivent tout ce qui paraît aux autres, mais qu'ils voient encore tout ce que les autres ne voient pas.
On remarque en second lieu, sur le mauvais succès de l'entreprise des Français en ce pays-là, que si quelque chose a manqué à ce grand projet, c'est qu'on a trop fait paraître que l'on ne voulait pas qu'il y manquât rien du tout. Si on se fût simplement attaché à l'établissement du commerce et à jouir des grâces qu'on avait obtenues pour la religion, ou même si dans une autre vue qu'on avait, on s'y fût pris par degrés et pied à pied, il semble qu'on n'aurait pas risqué de tout perdre par un changement, et qu'on s'y serait maintenu tout au moins comme les autres nations. Mais on a fait marcher tant de choses à la fois qu'on a excité la défiance de ceux du pays, aussi bien que la jalousie des étrangers. On ne s'est pas contenté d'y établir avantageusement le commerce, et de s'y distinguer de tous les autres par des faveurs particulières, on s'est voulu rendre maître des principales forteresses du royaume ; on a fait voir qu'on disposait de l'esprit du premier ministre et qu'on faisait faire au roi tout ce qu'on voulait. On a souhaité tout d'un coup de grands établissements pour la religion. On a obtenu des églises, des collèges et des maisons magnifiques. On a introduit dans la faveur des religieux étrangers, au préjudice de ceux du pays, dont on parlait d'abolir la religion. En un mot, on a poussé tous ces progrès aussi loin et aussi vite qu'on pouvait, pour un ouvrage qui demandait des années pour s'affermir avec quelque solidité. C'est par là qu'on a excité l'ombrage de la nation, la jalousie des grands et surtout le ressentiment des talapoins contre des gens qu'ils voyaient caressés et favorisés, plus habiles qu'eux dans les sciences aussi bien que dans l'art de s'insinuer dans les Cours, et d'autant plus à craindre qu'ils ne pouvaient s'établir entièrement que sur leur ruine. C'est un crime qui ne se pardonne point entre de semblables rivaux. Tout cela a produit son effet au premier changement, et a donné au parti contraire l'avantage de paraître le défenseur des droits, des intérêts et de la religion du pays, contre des étrangers qui voulaient tout envahir. Ainsi l'élévation du nouveau parti a dû être nécessairement suivie de la ruine de l'autre, n'y ayant point de milieu en matière de jalousie de gouvernement, et le ministre favori qui avait donné prise sur lui par tous ces endroits ne pouvait manquer d'en être la première victime. On s'est même étonné qu'il ait osé entreprendre de pousser les choses si loin tout d'un coup, et de faire voir aux yeux de tout le monde qu'il cherchait appui de sa faveur dans un secours étranger plutôt que dans celui de la nation. Mais il est bien difficile qu'une grande prospérité laisse tout voir et tout prévoir dans un poste si élevé, et comme il a été dit il y a longtemps : Les fautes sont pour les heureux, et les réflexions pour les malheureux.
Vous pouvez croire, Monsieur, que dans les mémoires qui nous sont venus de ce pays-là, dont quelques-uns ont été dressés par des protestants, on n'a pas oublié d'y faire des remarques sur ce zèle infatigable qui embrasse en même temps les conversions de l'Orient et de l'Occident, et qui ne se donne point de relâche dans l'exécution de ses grands et vastes projets. Les nouvelles du triste état des protestants de France, des contraintes exercées contre eux et de leur dispersion ont été bientôt répandues dans les Indes. J'en ai dit quelque chose ci-devant et de l'entretien que le père Tachard eut avec le général de Batavia sur ce sujet. Il est certain que ces nouvelles avaient non seulement excité la compassion des protestants de ce pays-là, mais qu'elles y avaient donné beaucoup d'alarme et de crainte, et que la seule vue d'un convertisseur était quelque chose de terrible pour eux. Cependant, quand ils venaient à comparer combien ce zèle qu'on voyait agir en Orient était opposé, à l'égard des manières, à celui qui avait causé tant de trouble en Occident, on avait peine à se persuader qu'ils pussent partir d'un même principe. Il est vrai qu'on les voyait marcher également partout avec le même train de grandeur, mais avec des airs et des allures fort différentes. En Occident, où il était le maître, il s'est montré farouche, cruel, impitoyable, voulant tout subjuguer par la force, entraîner les volontés sans les captiver, convertir sans persuader, faisant passer pour justice tout le mal qu'il en a fait et pour grâce celui qu'il n'a pas fait, au lieu qu'en Orient, où il s'agissait de devenir le maître, il s'est montré souple, insinuant, ne cherchant qu'à plaire et qu'à persuader, ne trouvant rien de difficile pour parvenir à son but, prêt à passer des honneurs de la Cour dans l'austérité des cellules des talapoins. Il n'était pas possible à ceux qui étaient attentifs sur toutes ces choses de trouver dans les maximes de la religion un principe commun à des effets si opposés, mais on le trouvait parfaitement dans l'esprit de politique et de domination ; cependant on a remarqué qu'avec les avantages de cette supériorité qu'il prenait partout, il a eu un mauvais succès des deux côtés, parce que dans l'un, il s'est trop fait craindre pour soumettre, et que dans l'autre, il s'est rendu trop suspect pour dominer.
Je finirai ce discours par deux ou trois autres réflexions devant les yeux, entre plusieurs autres qu'elle peut fournir, car c'est un tableau raccourci de l'inconstance, du bizarre mélange et du néant de toutes les choses humaines.
On y voit premièrement à quoi tient la grandeur des monarques, c'est-à-dire quels sont les liens qui attachent les peuples et les sujets à leur devoir absolu. Il n'y a peut-être point de rois qui aient une autorité plus étendue ni plus respectée que ceux de Siam. Personne n'oserait prononcer le nom du roi vivant. On l'adore comme s'il était le dieu des Siamois, sur quoi l'auteur du Journal dit fort agréablement à son ordinaire, dans un endroit de sa relation : Hé, mon dieu, qu'il m'a fait pitié ce pauvre roi, quand je l'ai vu dans cette pompe, passant entre 200 000 personnes qui bordaient la rivière, et qui les mains jointes et le visage contre terre, lui rendaient les honneurs divins ! Hé, le moyen qu'un pauvre homme accoutumé à ces adorations ne s'imagine pas être quelque chose au-dessus de l'homme ! Et qu'il sera difficile de lui persuader de se soumettre à toutes les humiliations de la religion chrétienne ! (20) Il avait bien raison, et il serait à souhaiter que l'Occident ne fournît point d'exemples pour autoriser ce qui se pratique en Orient ; mais par malheur, il n'y en a que trop. On trouve le secret pour tout accommoder. Cependant ce roi adoré voit éclipser sa grandeur dès qu'il tombe malade. Il voit immoler devant ses yeux les deux idoles de sa faveur, son fils et son favori. On y ajoute même ses deux propres frères, et la douleur qui achève de le mettre au tombeau fait monter sur le trône celui qu'il n'y avait point destiné. Cela fait bien voir que tous ces honneurs, ces hommages et cette pompe qui environne les princes, en un mot, tout cet attirail de la grandeur, n'est autre chose qu'un habillement de prospérité qui craint les injures du temps et dont le moindre accident est capable des les dépouiller avant leur mort.
Il en est de même de tous les projets qui sont appuyés sur ce fragile fondement. Celui dont il s'agit était revêtu de tous les plus beaux dehors dont on peut parer un magnifique dessein. On s'y proposait la conversion d'un grand monarque, un établissement considérable en faveur de la religion chrétienne, une correspondance avantageuse pour la Chine et pour les autres régions de l'Orient, une retraite et un port assuré pour entreprendre de nouveaux progrès dans les pays voisins. Tout cela était soutenu par une grande puissance, manié par d'habiles mains, favorisé d'une rapidité surprenante et cimenté par tous les ressorts de la politique. Cependant, tout ce grand édifice reposait sur la fortune d'un favori, et celle-ci sur la santé de son maître. Une maladie survient, un nouveau ministre partage la faveur, la décoration change, l'édifice s'évanouit, et tout disparaît comme par enchantement, ne restant de ce grand appareil qu'une mauvaise odeur de la conduite de ceux à qui on s'était confié ; de même que dans les spectacles publics, après la fin des jeux, on ne trouve plus derrière le théâtre que des chandelles éteintes, des machines suspendues, et des acteurs qui se retirent, démasqués et dans leur état naturel.
Enfin, on y voit une image de ce qui se passe dans les Cours lorsque l'autorité est disputée entre des concurrents. Il est bien rare qu'alors la scène ne soit ensanglantée par le vainqueur, et qu'il n'arrose du sang de quelque victime les degrés par où il doit monter sur le trône. On ne voit presque jamais le miracle qui est arrivé de nos jours, aussi trouve-t-on peu d'exemples d'une semblable conjoncture et d'un dessein aussi héroïque. Le malheureux Constance voulait continuer de régner en s'appuyant sur le parti du fils adoptif du roi. Si son dessein eût réussi, si Mom Pi fût parvenu à la Couronne, il eût bientôt mis le droit de son côté. Mais il a été malheureux et immolé, parce, dit-on, qu'il a voulu se défaire des princes et des grands qui lui étaient en obstacle ; et néanmoins son concurrent, qui s'est vu réduit à cette nécessité malgré la douceur de son naturel, et qui en est venu à bout, s'est mis la Couronne sur la tête. Le dessein de l'autre est appelé une conjuration ; celui-ci est devenu le parti de la justice par la loi de l'événement. Pendant que les choses sont en doute, on dispute, on agit, on cabale ; chacun allègue les droits et appuie sa cause par raison. L'événement a-t-il décidé, la cause du plus fort devient la règle souveraine de la raison, c'est-à-dire, au moins, de cette raison d'État qui admet de certaines prescriptions en faveur de l'Ordre et du Bien public, non seulement contre des prétentions injustes, mais aussi contre des droits légitimes dont on est déchu, ou par sa faute, ou par son malheur ; parce qu'il s'agit de finir une fois les querelles, et qu'il n'est pas juste que le public en soit toujours la victime par des guerres sans fin, de la même manière que les tribunaux souverains, pour finir les querelles des particuliers, admettent de semblables prescriptions contre ceux qu'ils ont condamnés en dernier ressort, et sont censés rendre justice lors même qu'ils jugent injustement et que le nombre des juges ignorants, prévenus ou corrompus l'emporte sur celui des sages.
C'est ainsi que parmi les hommes, le bien et le mal sont souvent confondus sous les mêmes apparences, comme je crois de l'avoir dit ailleurs ; parce qu'ils sont tous composés de passions et d'opinions, aussi bien que de raison, et malheureusement plus enclins à se laisser conduire par celles-là que par celles-ci. C'est ce qui produit ce mélange bizarre de jugements, d'actions et d'intérêts si opposés, et ce théâtre perpétuel de vicissitudes et de changements, où l'ordre et le désordre se tiennent toujours par la main, où l'on juge des choses non par ce qui en est, mais par ce qui en paraît, où la grandeur des uns s'élève sur l'abaissement des autres, où le plus faible est la proie du plus fort, où l'on mène les hommes par leurs défauts plutôt qu'on ne les redresse par raison, mais où ceux qui mènent les autres partagent ordinairement plus d'épines que ceux qui sont menés ; et où enfin, sous les noms respectés de Vérité, de Justice et de Religion, les passions humaines ne tiennent que trop souvent le haut bout. Mais quoi ! Ce monde n'a été et ne sera jamais autre chose. C'est une leçon de tous les siècles.
Et parmi les dégoûts de l'humaine faiblesse
Heureux qui cueille en paix quelques fruits de sagesse.
Je suis, Monsieur, votre, etc.
Ce 15 février 1690.

NOTES
1 - Tronchin du Breuil reprend les accusations de la Relation succincte […] hollandaise : Il fit tirer du canon sur deux petites jonques du roi qui allaient au Japon et qui étaient alors sur la rivière fort près de là, et comme deux canonniers qui étaient dans ces jonques refusèrent de tirer au même temps sur les Français, on les crut d'intelligence et ils furent à l'instant empalés. (A.N. C1/24, f° 133r°). Les relations françaises, dont celle de Desfarges, ne disent pas un mot de ces exactions. ⇑
2 - Seul le fils cadet de Desfarges, le chevalier, participa à cette tentative d'évasion. Quant aux autres fugitifs, les relations diffèrent quant à leur nombre. Outre le chevalier Desfarges, on peut citer le chevalier de Fretteville, Saint-Vandrille, peut-être Delas, un officier nommé Des Targes, dont le nom apparaît dans la relation de La Touche, et qui est confondu avec Des Farges dans la relation du père Louis Le Blanc, et l'ingénieur Bressy (ou Brecy) qui mourut après avoir été repris par les Siamois, soit de peur, soit de coups, soit encore d'avoir été obligé de courir attaché à la queue d'un cheval. ⇑
3 - Phetracha s'était effectivement rapproché des Hollandais dont Phaulkon avait essayé de contrebalancer la puissance en faisant appel aux Français. Peu après le départ des troupes françaises, la VOC obtenait un très avantageux traité commercial lui confirmant le monopole du commerce des peaux, et y ajoutant un monopole pour le commerce de l'étain. ⇑
4 - Ces deux navires, partis le 1er mars 1688 et qu'on crut quelque temps perdus, étaient le Siam et le Louvo, commandés par M. de Sainte-Marie, nom de guerre du lieutenant de Larre ou Delars, et Suhart. Selon Beauchamp, ils avaient été envoyés par Phaulkon pour faire la chasse aux pirates et aller brûler les vaisseaux anglais qui seraient en rade de la ville de Madras, côte de Coromandel. Les sieurs de Sainte-Marie et Suhart écrivirent à M. de Constance que cela ne se pouvait, la saison étant contraire. M. Constance leur écrivit de sortir et qu'ils tinssent la mer et d'aller où ils voudraient et de ne revenir que dans quatre mois (A.N. Col. C1/25 f° 73v°). Le père Le Blanc donne une autre version, tout aussi plausible (Histoire de la révolution du royaume de Siam, 1692, I, pp. 31-32) : aller croiser sur un corsaire dans le golfe de Siam, avec un ordre secret qu'ils avaient de M. Constance d'interrompre leur course aux premiers bruits de guerre et de troubles qui pourraient arriver dans le royaume, et d'aller se mettre sous le canon de Bangkok, où il recevraient les ordres de M. Desfarges pour le service des deux rois. ⇑
5 - Ce navire appartenait à Véret, le chef du comptoir de Siam. Selon l'Abrégé de ce qui s'est passé à Bangkok pendant le siège de 1688 (op. cit. (f° 155r°), elle se nommait le Rosaire. C'était peut-être celle que François Martin appelait la Vérette dans ses Mémoires (III, p. 27). La relation hollandaise passe évidemment sous silence l'héroïque action de l'officier Saint-Cry qui, se voyant perdu, fit sauter le navire avec tous les Siamois qui l'avaient pris d'assaut. ⇑
6 - Le texte de Jean Tronchin du Breuil suit fidèlement la Relation succincte […] hollandaise et semble en être une traduction très proche de la traduction française : Ils partirent deux ou trois jours après avec une lettre par laquelle Phetracha reprochait aux Français leur perfidie, leur manque de parole, leur déloyauté, et à M. Desfarges en particulier qu'il n'était pas digne d'être père, puisqu'il avait si peu de tendresse pour ses enfants qu'il avait laissés en otages dans Louvo, qu'ils avaient trouvé plus de compassion et de miséricordes en lui qu'il n'en méritait, que n'aimant pas le sang, il n'aurait eu garde de se venger sur des innocents, mais qu'il voulait faire voir à tout le monde que les Siamois étaient gens de bonne foi et avaient la raison de leur côté, ayant été offensés et maltraités dans leur propre pays par des ingrats. (f° 135v°). ⇑
7 - C'était le mode d'exécution traditionnel des personnes de sang royal, dont on ne pouvait faire couler le sang. Enfermé dans un sac de velours rouge, le supplicié était assommé et tué à coup de bûches de bois de santal. ⇑
8 - Cet enlèvement des enfants métis portugais, qui est relaté dans la Relation succincte […] hollandaise, n'est mentionné dans aucune relation française. ⇑
9 - Du Bruant, en garnison à Mergui, s'était emparé de deux navires au mouillage dans la rade de Ténassérim, l'Aigle noir, rebaptisé le Mergui par les Français, une frégate de 24 pièces de canon qui appartenait au roi de Siam, et un petit navire anglais d'un particulier de Madras (Le Blanc, op. cit., II, p. 282). ⇑
10 - L'Oriflamme. Commandé par M. de l'Estrille, il était parti de Brest au début du mois de février 1688 et amenait 200 hommes de troupe pour renforcer les garnisons françaises. ⇑
11 - L'enlèvement de Mme Constance et de son fils par l'officier Sainte-Marie (nom de guerre de Delars, ou De Larre), qui avait agi de sa propre initiative et sans en référer à personne, constituait pour Desfarges un problème très embarrassant dont il se serait bien passé. ⇑
12 - Il est vraisemblable que Phetracha se souciait peu de la personne de Mme Constance, mais qu'il tenait avant tout à récupérer ses bijoux, qui furent l'objet de toutes les convoitises et tombèrent mystérieusement entre les mains d'officiers français peu scrupuleux, dont Desfarges faisait certainement partie. Voir sur ce sujet la note 3 de la 6ème partie de la relation de Vollant des Verquains. ⇑
13 - Il s'agit manifestement d'une coquille, et il faut lire le 9 novembre. Les Français mirent à la voile pour Pondichéry le 13 novembre 1688. ⇑
14 - Selon l'Abrégé de ce qui s’est passé à Bangkok pendant le siège en 1688 (Archives Nationales, Col. C1/24 f° 166r°) ces quatre navires étaient l'Oriflamme, le Siam, le Louvo, et une chaloupe nommée le Rosaire. ⇑
15 - Les trois otages français devaient être Véret, le chevalier Desfarges, fils cadet du général, et Louis Laneau, évêque de Métellopolis. Toutefois, dans sa relation écrite à Middelburg, Beauchamp indique qu'il fut également désigné : Je vous dirai que je fus nommé pour otage avec le chevalier Desfarges et Mgr l'évêque et Véret qui devaient nous accompagner jusqu'en la rade. (A.N. C1/25, f° 79v°). ⇑
16 - Le départ des Français et les échanges d’otages se firent dans la plus grande confusion. Le traité de capitulation ne prévoyait que deux otages siamois qui devaient être relâchés avant le départ des Français. Le premier était l’Ok-ya gouverneur de Siam et le second l’Ok-phra gouverneur de Paknam (ปากน้ำ). Ce dernier mandarin est cité dans le Journal de la Mission (Launay, 1920, I, p. 224) sous le nom d’Ok-phra Pichaï Songkhram (ออกพระพิชัยสงคราม). Le gouverneur de Siam fut renvoyé à terre en échange des mirous (petits bateaux siamois), mais trois autres personnes furent encore emmenés par les Français : Ok-luang Kanlaya Ratchamaitri ((ออกหลวงกัลยาราชไมตรี), le vieil ambassadeur qui avait été en France, attiré par ruse sur l’Oriflamme, le valet du gouverneur de Paknam et l’interprète portugais Vincent Pinheiro, qui avait été élevé par les Siamois à la dignité de mandarin avec le titre d'Ok-luang Worowat (ออกขุนวรวาที). ⇑
17 - Sur les Français restés au Siam, voir le Catalogue des prisonniers ecclésiastiques et laïques. ⇑
18 - Pierre Lambert de la Motte (1624-1679), évêque de Bérythe, François Pallu (1626-1684), évêque d'Héliopolis. ⇑
19 - L'évêque de Métellopolis était alors Ignace Cotolendi (1630-1662). L'évêché fut attribué à Louis Laneau en 1674. ⇑
20 - Journal de l'abbé de Choisy du 4 novembre 1685. ⇑

14 mai 2019
