

6ème partie.
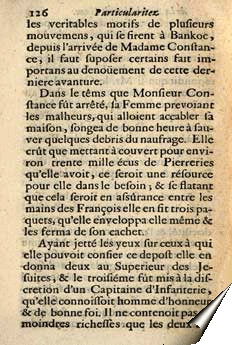
Dans le temps que M. Constance fut arrêté, sa femme, prévoyant les malheurs qui allaient accabler sa maison, songea de bonne heure à sauver quelques débris du naufrage. Elle crut que mettant à couvert pour environ trente mille écus de pierreries qu'elle avait, ce serait une ressource pour elle dans le besoin ; et se flattant que cela serait en assurance entre les mains des Français, elle en fit trois paquets, qu'elle enveloppa elle-même, et les ferma de son cachet.
Ayant jeté les yeux sur ceux à qui elle pouvait confier ce dépôt, elle en donna deux au supérieur des jésuites (1), et le troisième fut mis à la discrétion d'un capitaine d'infanterie qu'elle connaissait homme d'honneur et de bonne foi (2). Il ne contenait pas de moindres richesses que les deux autres, et l'opinion était qu'il y avait dedans des perles d'un prix considérable, et quinze bagues, dont la moindre était estimée vingt catis, le catis valant cinquante écus de notre monnaie.
Le père, qui n'était pas en sûreté pour lui-même à Louvo, crut qu'il n'y en aurait point pour le dépôt de Mme Constance que dans Bangkok, et le sieur Beauchamp major de la place y allant, il le pria de le donner aux pères de sa compagnie qui servaient d'aumôniers aux troupes de cette place ; quant à l'officier, il porta lui-même le sien, et ne s'en cachant pas, il déclara qu'il en serait le gardien fidèle jusqu'à ce qu'il plût d'en disposer à celle qui le lui avait commis. Mais le major, à qui des choses de cette conséquence donnaient une violente tentation, ne fit mine de rien, jugeant que cela valait bien la peine d'être demandé par ceux qui le voudraient avoir.
La commission qu'il avait reçue du père supérieur ne vint pas à la connaissance des jésuites que M. Desfarges n'en fût aussi averti. Il demanda que l'on remît à sa garde tout ce qui venait de Mme Constance, ce qui lui tiendrait lieu de gages pour une somme de mille écus que feu son mari avait à lui et qui avait subi le sort des autres biens de ce ministre dans la désolation de sa Maison.
Le sieur Beauchamp néanmoins, qui croyait résister à son général, ne fut pas fâché de voir naître ce conflit qui lui offrait un beau prétexte de ne se pas dégarnir de ce dépôt en faveur des révérends pères jésuites, considérant que le temps amène bien des choses, que peut-être une jeune femme nourrie délicatement mourrait à la gêne ou serait faite esclave pour le reste de ses jours, et qu'étant muni du butin, il serait bien malheureux s'il ne lui en tombait le meilleur lot en partage ; mais M. Desfarges ne désista point qu'il ne fût en possession de ce qui le pouvait dédommager de son argent perdu, et vint pour cela à un point d'emportement contre le major si grand qu'il n'y eut rien d'outrageant qu'il ne lui dît sur sa naissance, trouvant étrange qu'un homme à qui sa faveur avait toujours tenu lieu de tout, osât lui tenir tête.
Le sieur Véret était revenu du fort des Siamois, chargé d'un mémoire que le barcalon lui avait mis entre les mains, qui contenait un détail de tous les bijoux que Mme Constance avait avoué d'avoir fait transporter dans Bangkok et dont il demandait la restitution. On se mit à l'examiner avec soin, et voyant qu'il n'était point fait mention des bagues, on dissimula la chose, et s'étant fait pour le reste plusieurs allées et venues, la conclusion fut que, laissant à part les intérêts de Mme Constance, le général commencerait par rendre ce qui était contenu dans le mémoire et que d'un autre côté le barcalon lui ferait payer ses mille écus, ce qui fut exécuté, ensuite de quoi le ministre partit pour se rendre à la ville capitale où le sieur Véret, qui avait été le médiateur de cette affaire, le suivit pour en négocier d'autres.
On a su depuis que le barcalon, ayant porté ses paquets fermés jusqu'à Louvo, où les révérends pères jésuites, avec la plus grande partie du christianisme, étaient depuis le commencement des troubles, il envoya quérir le père supérieur en la présence duquel et de quelque mandarin il fit l'ouverture des deux paquets, mais n'y ayant que le tiers au plus de ce que portait la déposition de Mme Constance, le père fut interrogé d'où pouvait venir une diminution si considérable, et lui qui la reconnaissait visiblement répondit qu'il en ignorait la cause (3).
Cependant le ressentiment de M. Desfarges contre le libérateur de Mme Constance augmentait à mesure qu'il faisait réflexion sur l'embarras où il se trouvait de ne la pouvoir renvoyer sans franchir les lois de la guerre les plus sacrées. Dans ces inquiétudes, il reçut des nouvelles du sieur Véret qui l'obligèrent de faire assembler le Conseil, où il exposa que le barcalon ayant été à Louvo pour demander au roi de Siam d'agréer la sortie de Mme Constance hors de ses États, Sa Majesté siamoise n'y avait point voulu consentir et menaçait de pousser à bout la nation et d'abolir jusqu'aux vestiges de la religion plutôt que de le souffrir. Après une ample explication de ces choses, il demanda les avis sur ce qu'il y avait à faire.
Toutes ces menaces n'effrayèrent personne. De neuf capitaines qui composaient le Conseil avec l'état-major, il n'y en eut que deux sur qui cette prétendue raison d'État fit impression (4). Tout le reste opina avec un courage déterminé de ne point épargner son sang pour conserver à Mme Constance un asile qui lui était acquis par tant de titres et qu'on ne pouvait lui refuser sans injustice, opposant au rapport que faisait M. le général, d'un côté la honte qui rejaillirait sur toute la nation, si sous le pavillon de France il n'y avait point de sûreté pour la veuve d'un homme qui s'était sacrifié pour ses intérêts, et de l'autre l'obligation où l'on était de défendre la liberté des sujets de Sa Majesté, au nombre desquels cette dame devait être comptée depuis qu'elle et toute sa famille avaient reçu tant de marques honorables de la protection du roi notre maître.
M. Desfarges, voyant une si générale opposition à ses sentiments, rompit le conseil avec des manières peu séantes à la gravité d'un chef qui doit gouverner avec discrétion, et les officiers étant entrés ensemble en discussion des raisonnements dont il avait appuyé son opinion et que personne n'avait osé combattre en sa présence par respect, ils trouvèrent qu'il n'y avait nulle apparence que l'évasion d'une femme malheureuse fût de telle importance au roi de Siam pour l'obliger à recommencer la guerre qu'il avait tant souhaité de finir pour son repos et le soulagement de ses peuples.
Cela était encore plus incroyable à ceux qui faisaient réflexion sur l'état présent des Français, remis pour la plupart des fatigues du siège, ayant bonne provision de vivres et de munitions qu'ils avaient amassés pour leur voyage, et accrus considérablement par le nombre de Français et Anglais que l'on avait laissé venir à Bangkok depuis l'accommodement. Le roi aurait plutôt cédé Mme Constance avec tous les trésors qu'elle avait eus que de venir alors l'enlever par force aux Français, dont on avait lieu de craindre une plus longue et plus vigoureuse résistance qu'auparavant.
D'ailleurs on était informé que Sa Majesté siamoise n'approuvait pas les violences de son fils envers cette dame ; au contraire, il n'était pas fâché que son éloignement fît mourir une passion, qui, pour avoir tant éclaté, lui déplaisait infiniment. Enfin la religion ne pouvait pas avoir pis, et si elle en souffrit alors, ce ne fut qu'autant que les pratiques détestables des ennemis de Mme Constance la firent persécuter.
Les choses demeurèrent indécises près de huit jours, pendant quoi M. Desfarges fit éclater son ressentiment contre tous ceux qu'il croyait avoir eu part à ce qui faisait sa peine. Il traita Sainte-Marie avec la dernière rigueur, il le cassa premièrement du commandement qu'il lui avait donné du plus grand des deux bâtiments que l'on préparait pour la retraite, et le fit mettre ensuite en prison, gardé à vue par deux sentinelles l'épée à la main, avec ordre de ne le laisser parler à personne.
Sa mauvaise humeur s'étendit aussi sur les révérends pères jésuites, qu'il savait ne pas ignorer le fondement qui le faisait agir avec tant de passion. Il leur défendit d'approcher Mme Constance, leur attribuant de lui avoir suggéré sa fuite, et pour s'en assurer davantage, il ordonna un officier de garde à la porte de la chambre de cette dame.
Pendant ce temps, les flatteurs de Soyatan représentèrent au barcalon qu'il rendrait un service considérable à ce prince s'il lui faisait rendre cette femme qui s'obstinait à demeurer avec les Français. Ce ministre, joyeux de pouvoir obliger en quelque chose le fils de son maître, fit prendre plusieurs chrétiens avec la mère et tous les plus proches parents de Mme Constance, les fit mettre à la cangueInstrument de torture portatif, d'origine chinoise, ayant la forme d'une planche ou d'une table percée de trois trous dans lesquels on introduisait la tête et les mains du supplicié. (ce sont deux pièces de bois qu'on attache au col des prisonniers, de manières qu'il ne peuvent s'en dépêtrer et sont obligés de demeurer au lieu où on les attache) et les menaça du dernier des supplices s'ils ne rachetaient bientôt leur liberté en lui livrant la dame réfugiée.
(ce sont deux pièces de bois qu'on attache au col des prisonniers, de manières qu'il ne peuvent s'en dépêtrer et sont obligés de demeurer au lieu où on les attache) et les menaça du dernier des supplices s'ils ne rachetaient bientôt leur liberté en lui livrant la dame réfugiée.
Cette nouvelle ne tarda guère à être divulguée dans Bangkok, où le pieux évêque de Métellopolis, vivement alarmé de la persécution qui allait détruire le reste du christianisme de Siam, jugea que c'était là une occasion de se signaler pour une personne de son caractère. Ce saint prélat, digne de l'estime et de la vénération de l'univers autant pour sa profonde science que pour ses autres vertus apostoliques qui lui ont attiré l'admiration et le respect des barbares, estimait sans doute les intentions des autres semblables aux sentiments que son zèle et sa charité faisaient naître en son cœur, et peu accoutumé à démêler la fuséeLa fusée est la masse de fil enroulé sur le fuseau et qui provient de la filasse de la quenouille. Démêler une fusée, c'est pénétrer un mystère, une intrigue, toute espèce d'affaire embrouillée. (Littré). d'une intrigue délicate, n'envisageait que la délivrance de ce grand nombre de captifs, aux intérêts de qui il ne pouvait préférer la satisfaction d'une seule personne.
Il conseilla à M. Desfarges d'assembler de nouveau le Conseil, où il avait lieu d'espérer qu'il trouverait du changement depuis que l'expérience des maux présents faisait pressentir ceux que l'on devait craindre pour l'avenir, et offrit de lui donner par écrit les raisons qu'il jugeait plus capables de ramener les esprits (5), avouant néanmoins qu'il ne prétendait pas décider du point d'honneur, à cause du peu de connaissance qu'il avait des maximes du monde, mais seulement proposer les intérêts du christianisme auxquels il fallait déférer quelque chose.
Ainsi deux sortes de prudences bien opposées l'une à l'autre conspirèrent ensemble pour une même fin. On tint conseil pour la seconde fois, où l'on ne fit que produire les mémoires du prélat, et ensuite on exhorta puissamment de remédier aux désordres que causait l'entêtement de vouloir garder Mme Constance.
L'assemblée répondit que M. de Métellopolis était louable du soin qu'il avait de son Église, mais on se défendit toujours d'une action si injuste que de faire un sacrifice au bien public contre le droit des gens, et chacun demeura ferme dans son premier sentiment. Le général, fort en colère, menaçant tout le monde et moins maître de lui-même en ce moment qu'il ne l'avait été à la première délibération, protesta qu'il ferait bien voir, qu'usant de toute son autorité, il aurait l'avantage d'être estimé le plus sage de ceux que le roi avait envoyés pour soutenir la cause de la religion aussi bien que la gloire de ses armes.
Sur une décision si authentique, il ordonna que Mme Constance changerait de logement et serait transportée dans l'endroit du fort le plus inaccessible aux révérends pères jésuites, attendant, ou qu'elle-même consentît de s'en retourner, ou qu'il survînt quelque autre motif plus pressant de la renvoyer.
Quant à la proposition qu'on lui fit de sortir de son gré, il fut impossible d'en rien obtenir. Elle répondit avec une discrétion merveilleuse à toutes les sollicitations qu'on lui en fit faire par des personnes de qui les bonnes intentions furent tout le mérite de cet emploi. Mais les efforts du sieur Véret décidèrent bientôt toutes choses, car s'étant fait arrêter par les Siamois, on le mit avec les autres prisonniers, où trouvant la mère de Mme Constance, il n'eut pas de peine à lui persuader d'écrire à M. Desfarges que s'il avait compassion de sa vieille accablée sous le poids de tant de souffrance, il lui renvoyât sa fille.
Un si étrange stratagème ne se put tramer avec tant de circonspection que le père de la Breuille, jésuite, ne s'en aperçût (6). Il était dans la prison comme les autres, qu'il encourageait à la patience en la pratiquant le premier, et il ne fut jamais plus surpris que lorsqu'il découvrit ce lâche dessein. Il en donna avis à son supérieur qui séjournait depuis quelque temps à Bangkok, et l'assura qu'un si grand nombre de personnes mises aux fers, tant de la famille de Mme Constance que d'autres des plus illustres de la chrétienté du pays, et l'emprisonnement du sieur Véret, n'étaient qu'une feinte pour obliger de renvoyer Mme Constance, et que c'était là la seule cause de la persécution.
Il est à croire que M. Desfarges n'eut aucune part à un aussi lâche procédé et que le sieur Véret, qui avait ses raisons pour vouloir sortir du royaume avec les autres, quoiqu'il fût porté par la capitulation qu'il y demeurerait pour sûreté du retour des vaisseaux que le nouveau roi de Siam donnait aux Français pour leur sortie, jugea que le plus sûr moyen d'abréger tout sujet de contestation était de faire tomber entre les mains de ce général quelques lettres qui lui parussent assez fortes pour ne pouvoir plus douter qu'il était obligé, pour remédier à un plus grand mal, de se servir de toute son autorité pour rendre Mme Constance.
En effet le stratagème eut tout le succès qu'il en attendait. M. Desfarges n'eut pas plutôt reçu les lettres de la mère et de toute la parenté de Mme Constance, que se sentant muni de ce qu'il croyait nécessaire pour justifier en France la conduite qu'il avait tenue en cette affaire, il ne songea plus qu'aux conditions avec lesquelles il la remettrait au pouvoir des Siamois, et pour cet effet il dressa quelques articles d'un traité particulier, qui fut ensuite ratifié par le barcalon, voulant non seulement paraître ne pas être contraire aux intérêts de cette dame, mais aussi que ses malheurs le touchaient assez pour aviser aux moyens de la soulager.
Ces articles contenaient en substance des assurances que le roi de Siam lui donnait pour la liberté de sa religion et celle de son fils ; qu'elle demeurerait dans le camp des Portugais à Siam sous la protection de M. l'évêque de Métellopolis, et qu'il lui serait permis de se remarier à qui elle le souhaiterait sans que Soyatan y mît par son autorité aucun obstacle ; enfin qu'elle ne serait plus inquiétée dorénavant au sujet des affaires du feu ministre son époux. Ce qui étant achevé et signé de part et d'autre le même jour 19 octobre, le général appela son major et l'envoya vers Mme Constance pour lui faire entendre que, n'ayant pu obtenir du roi de Siam la permission de l'emmener avec lui, la conjoncture présente de ses affaires ne lui permettait pas de la garder davantage dans sa forteresse et qu'il fallait qu'elle se résolût d'en sortir incessamment si elle ne voulait s'y voir contrainte par force, qu'au surplus il avait pris tous les soins qu'il croyait nécessaires pour la mettre à couvert des persécutions qui l'avaient obligée de chercher un asile sous le pavillon du roi.
Le major trouva cette pauvre dame dans une extrême désolation attendant la décision de son sort, et lui ayant déclaré sa commission, s'il remarqua en elle des signes d'une douleur bien amère, il ne lui vit rien faire indigne de son courage ; mais considérant de quelle manière elle avait été traitée pendant son séjour dans la forteresse, elle témoigna que ces indignités lui étaient très sensibles au milieu d'un asile qu'elle avait cru inviolable, et regardant avec indignation les ministres des violences qu'on était près de lui faire, elle ne put s'empêcher de dire qu'elle n'en avait pas moins attendu de celui qui avait tant fait que d'abandonner son époux.
Incontinent, elle marcha vers la porte du petit fort où elle avait été enfermée, et s'y étant arrêtée, elle appela le commissaire en présence duquel, et de plusieurs officiers de la garnison qui s'y rencontrèrent, elle fit sa protestation contre le commandant qui de son autorité privée lui refusait non seulement la protection du roi, dont elle avait des assurances dans deux lettres de Sa Majesté qu'elle produisait publiquement, mais de plus l'arrachait par force de dessous le pavillon de France où elle était venue implorer un asile, remerciant tous les officiers de la bonne volonté qu'ils avaient témoignée pour elle et les priant pour dernière grâce d'informer Sa Majesté des violences qu'on lui faisait, si contraires à ses généreuses et royales intentions.
Elle acheva ainsi ses tristes adieux, qui tirèrent des larmes de toute l'assemblée, et continua sa marche jusqu'au bord de l'eau, où le vieux Siamois venu en France dans la seconde ambassade (7) la fit entrer dans un balon qu'il tenait tout prêt, accompagné de plusieurs autres pour lui servir d'escorte.
Ce fut une espèce de triomphe que les Siamois remportèrent sur les Français, et il emmenèrent leur conquête avec d'autant plus de gloire qu'ils la leur avaient enlevée dans un temps où ils étaient plus que jamais en état de la maintenir ou de la transporter hors du royaume, obtenant en ce temps-là très facilement des tarrasTra (ตรา) : document officiel, permis, autorisation. ou passeports pour sortir de la rivière et aller à bord de l'Oriflamme, vaisseau du roi qui était mouillé à la barre.
Les Siamois gardèrent leur conquête avec beaucoup de soin pendant quelques jours sur la rivière en présence de la ville capitale avec une bonne garde, et il ne lui fut pas permis de mettre sitôt pied à terre. Mais enfin les causes qui arrêtaient son débarquement ayant cessé, elle fut tirée de son balon, et ensuite condamnée à un esclavage perpétuel (8).
Justement après le départ de Mme Constance, tout se trouva prêt pour celui des troupes, et il ne fut plus parlé que d'avoir les otages pour se mettre en chemin. M. Desfarges les ayant demandés et reçus sans délai donna les siens, et on sortit de la place en bon ordre pour s'aller embarquer sur les vaisseaux. Le général voulait que le sien fît l'avant-garde et que celui du sieur de Vertesalle, second commandant, fît l'arrière-garde, mais on se hâta si fort de sortir qu'on négligea plusieurs mirous chargés de vivres et de canons que l'on destinait pour l'Oriflamme, et qui furent ensuite enlevés par les Siamois au sujet de la rupture du traité.

NOTES :
1 - Le père Abraham Le Royer (1646-1715). (Leblanc, Histoire de la révolution [...], 1692, I, p.212). ⇑
2 - D'après Beauchamp, il s'agissait de M. de Fretteville. (Relation des révolutions de la Cour de Siam, Bibliothèque Nationale, manuscrit Fr 8210, f° 550v). ⇑
3 - L'histoire des biens de Phaulkon et des bijoux de Mme Constance constitue un invraisemblable imbroglio. Il n'est pas un officier qui n'espère retourner en France avec une part du butin et il est bien difficile de démêler le vrai du faux, les uns et les autres déguisant la vérité et s'accusant mutuellement. Il semble qu'avant son arrestation, Mme Constance avait fait trois paquets de ses bijoux. Elle en remit deux au supérieur des jésuites, le père Le Royer, et le troisième à l'officier Fretteville. Le père Le Royer ne tenant pas à conserver ce précieux et dangereux dépôt le remit à Beauchamp afin de les faire rendre à Mme Constance par l'intermédiaire du père Comilh. Selon Beauchamp, le général Desfarges, informé de cette commission, aurait demandé que ces deux paquets ne soient pas restitués tant que les Siamois ne lui auraient pas remboursé une somme de 400 pistoles que Phaulkon lui devait. Les Siamois ayant promis d'honorer cette dette, Desfarges aurait fait remettre les deux paquets au barcalon par l'intermédiaire de Véret. Connaissant la réputation plus que douteuse du chef du comptoir, on peut légitimement se demander si les bijoux ont jamais été rendus à leur propriétaire. Le contenu de ces deux paquets, révélé par Beauchamp, avait effectivement de quoi faire tourner les têtes : quatre colliers, un chapelet, deux paires de bracelets et des pendants d'oreille de perles, quatre douzaines d'anneaux d'or de plusieurs façons, une très grosse et parfaitement belle émeraude, des agrafes, de petits rubis, quatre bagues de petits diamants, neuf ou dix chaînes d'or, onze lingots d'or pesant plus de trois marcs chacun, huit coupans d'or de dix écus pièce, une douzaine de boutons, demi-douzaine d'aiguilles de tête, et douze ducats d'or. (Bibliothèque Nationale, manuscrit Fr 8210, f° 550r-550v). L'accusation à peine voilée de Vollant des Verquains qui indique que les paquets restitués ne renfermaient plus qu'à peine le tiers de leur contenu initial laisse à penser que certains se sont servis au passage.
Le sort du troisième paquet n'est pas plus clair. M. de Fretteville à qui il fut remis fut arrêté à Louvo lors de l'arrestation de Phaulkon, fouillé et sans doute dépouillé d'une partie des trésors. Beauchamp ici encore nous donne sa version : Quelques jours après Saint-Vandrille et M. Desfarges me vinrent trouver et me dirent qu'ils avaient sauvé des diamants que Mme Constance avait mis entre les mains de Fretteville, lorsqu'ils furent pris et fouillés quand on les ramena à Louvo, et que le chevalier Desfarges les avait, qu'ils me priaient de leur en faire donner leur part, puisqu'ayant tout perdu et ayant aidé à les sauver, il était bien juste qu'ils en profitassent. Je leur dis que je n'entrais point là-dedans, que c'était une chose qu'il fallait rendre à Mme Constance, et qu'il était indigne à des gens comme eux de vouloir profiter de son malheur. Comme Saint-Vandrille vit que je ne donnais point dans sa proposition, il en parla à M. Desfarges, qui lui dit que c'était infâme à lui de vouloir partager le bien d'une femme qui avait tout perdu, et que s'il faisait son devoir, il le ferait mettre dans un cul de basse-fosse. Aussitôt il fit appeler le chevalier son fils, qu'il gronda très fort de ce qu'il ne lui avait rien dit de ces diamants, lui ordonna de les remettre entre les mains de Fretteville, puisque c'était à lui que Mme Constance les avait confiés, et à Fretteville de les rendre à Mme Constance aussitôt qu'il pourrait, et que si les uns et les autres manquaient à la moindre de ces choses, il les mettrait tous en prison et commencerait par son fils. (Bibliothèque Nationale, manuscrit Fr 8210, f° 550v-551r). Les protestations vertueuses de Beauchamp ne suffisent pas pour nous convaincre. Quant à Saint-Vandrille, auteur d'une relation conservée aux Archives Nationales de Paris, il ne souffle pas un mot de ce trésor. Desfarges garde le même silence. Beauchamp note sobrement qu'après la signature du traité de capitulation, le chevalier de Fretteville, qui avait été chargé des diamants dont j'ai parlé, alla voir Mme Constance, à qui il rendit ce qu'il lui avait pu sauver. (manuscrit Fr 8210, f° 556r). Ce chevalier de Fretteville était peut-être le seul officier honnête au milieu de cette brochette de canailles. Cela ne lui porta pas chance, puisqu'il se noya au mois d'octobre 1688. Il était d'une grande piété et voulait rentrer dans les ordres à son retour en France. Quant à la famille Desfarges, à Beauchamp, à Saint-Vandrille, à Véret, il est plus que probable qu'ils ont tous plus ou moins participé au pillage des biens de Mme Phaulkon. ⇑
4 - Les témoignages divergent quant à la date exacte de cette consultation et quant à ses résultats. Le père Le Blanc et Saint-Vandrille confirment le chiffre de deux voix en faveur du renvoi de Mme Constance, sans donner de nom. Une relation anonyme conservée aux Archives Nationales de Paris, intitulée Relation de ce qui s'est passé à Louvo [...], indique la date du 7 octobre et donne un résultat de deux voix, celle de Desfarges et celle de la Roche du Vigeay. Le père d'Orléans, s'appuyant sur des témoignages de jésuites, indique également deux voix et nomme les deux fils Desfarges. Beauchamp qui, comme le père Le Blanc, place la réunion du Conseil le 9 octobre et qui affirme vertueusement qu'il aurait préféré périr que de rendre Mme Constance, indique cinq votes en faveur du renvoi, et cite les noms des deux fils Desfarges, de M. de la Roche Vigeay et de Vollant des Verquains. Ce nouveau petit coup bas n'est pas forcément crédible, l'inimitié étant grande entre l'ingénieur et le major de Bangkok. Quant à François Martin, qui n'était pas présent et s'appuyait sur on ne sait quels témoignages, il parle comme Beauchamp de quatre avis contraires, et cite les deux fils Desfarges, un officier qui touchait le général d'une alliance de loin, (sans doute la Roche du Vigeay) et un autre qu'il avait attaché à son parti (et qui pourrait bien être Beauchamp). ⇑
5 - Selon Le Blanc (Histoire de la révolution [...], 1692, II, p. 70), il y aurait effectivement eu une deuxième réunion du Conseil le 14 octobre, avec les mêmes résultats que la première. ⇑
6 - Charles de La Breuille (1653-1720) arriva au Siam avec en 1687 avec l’ambassade Céberet – La loubère. Lors de la révolution de 1688, seul de tous les jésuites, il décida de demeurer dans le royaume et il connut les mêmes infortunes que Mgr Laneau. Après sa libération, il rejoignit à Pondichéry le père Tachard, dont il devient l’homme de confiance. Tous deux retournèrent au Siam en 1699, et eurent notamment une audience avec Phetratcha. ⇑
7 - Il s'agissait d'Okluang Kanlaya Ratchamaïtri (ออกหลวงกัลยาราชไมตรี), connu en France sous le nom de Uppathut (second ambassadeur).
 Ooc Louang Calayanaraa Tchaimaitrioupathoud.
Ooc Louang Calayanaraa Tchaimaitrioupathoud.
OOC LOÜANG CALAYANARAA TCHAIMAÏTRIOUPATHOUD. Premier ajoint de l'ambassadeur de Siam envoyé au Roy, homme âgé et qui a beaucoup d'Esprit. Il a été Ambassadeur du Roy de siam vers l'Empereur de la Chine, et s'acquita fort bien de cette Ambassade. Ces Ambassadeurs partirent de Siam le 22 Decembre 1685. sur les trois heures du matin dans le Vaisseau du Roy nommé l'Oiseau, commandé par Mr de Vaudricourt. Dessiné sur le naturel. A Paris chez Nolin, rue St Iacques, a l'Enseigne de la Place des Victoires. Avec P. du Roy. ⇑
8 - Le sort de Mme Constance sera moins dur qu'on ne pouvait le craindre. Le père de Bèze qui la voit juste après la révolution de Siam la décrit jetée dans une écurie parmi la puanteur et l'ordure, dénuée de toutes choses, et n'ayant qu'une claie pour se coucher. (Drans et Bernard, 1947, p. 125). Le père Tachard aura l'occasion de la visiter en 1699, lors de son avant-dernier voyage en Asie, et son sort semble s'être sensiblement adouci. D'abord confinée dans un emploi de domestique, on retrouve la veuve de Phaulkon surintendante des cuisines du roi Thai Sa (ท้ายสระ) Sanphet 9. On ignore la date de sa mort, mais le missionnaire Paul Aumont la vit du temps qu'il résidait à Ayutthaya entre 1719 et 1724. Il l'évoque dans ses mémoires, citées par Launay, Histoire de la mission de Siam, 1920, I, p. 216, note 1 : Mme Constance, veuve du fameux M. Constance qui a fait tant de bruit du temps de l'ambassade de M. de Chaumont, vint aussi me voir. Cette dame pouvait avoir 65 ou 66 ans ; elle était dans le palais du roi de Siam depuis la mort de M. Constance ; l'usurpateur du royaume l'avait mise au rang de ses esclaves, ce qui, bien loin d'être déshonorant dans le pays, est pour les Siamois un rang d'honneur et leur donne le privilège de faire mille injustices ; mais pour une bonne chrétienne comme était Mme Constance, c'était un véritable esclavage. Elle avait la liberté de venir à l'église lorsqu'elle le souhaitait, et d'aller quelquefois coucher à sa maison, la plus belle du camp des Portugais, où étaient ses petits-fils. Elle avait la direction de plus de deux mille femmes siamoises faisant le service du palais ; elle était surintendante du magasin de la vaisselle d'or et d'argent du roi, de son vestiaire et de tous les fruits qui se servaient à sa table ; dans ces emplois elle aurait pu tirer des sommes considérables ; mais sa conscience ne lui permettant pas de tourner à son profit bien des choses pour lesquelles celles qui l'avaient précédée dans ces emplois n'avaient pas fait de difficulté, elle rendait tous les ans au trésor du roi une somme assez considérable, ce qui faisait dire au roi de Siam qu'il n'y avait que des chrétiens pour être capables d'une si grande droiture, ce qui faisait beaucoup d'honneur à la religion.
Je reconnus tant de religion et de bon esprit dans cette dame, qui connaissait parfaitement le génie de la nation saimoise, ses coutumes et ses chicanes dans les procédures, que je me servis souvent d'elle pour me tirer d'affaires très difficiles, et je me suis toujours très bien trouvé de ses conseils. Elle avait encore sa mère qui demeurait près de notre église, et était âgée de plus de 80 ans ; elle ne pouvait plus marcher, et mourut environ un an après mon arrivée.⇑

18 février 2019
