

LETTRE DU 1er FÉVRIER 1690
Monsieur,
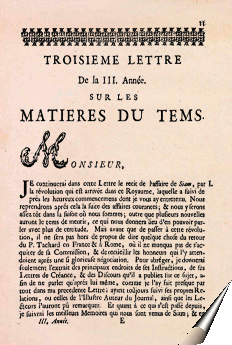
Je continuerai dans cette lettre le récit de l'affaire de Siam, par la révolution qui est arrivée dans ce royaume, laquelle a suivi de près les heureux commencements dont je vous ai entretenu. Nous reprendrons après cela la suite des affaires courantes, et nous y serons assez tôt dans la saison où nous sommes, outre que plusieurs nouvelles auront le temps de mûrir, ce qui nous donnera lieu d'en pouvoir parler avec plus de certitude. Mais avant que de passer à cette révolution, il ne sera pas hors de propos de dire quelque chose du retour du père Tachard en France et à Rome, où il ne manqua pas de s'acquitter de sa commission et de recueillir les honneurs qui l'y attendaient après une si glorieuse négociation. Pour abréger, je donnerai seulement l'extrait des principaux endroits de ses instructions, de ses lettres de créance et des discours qu'il a publiés sur ce sujet, afin de ne parler qu'après lui-même, comme je l'ai fait presque partout dans ma précédente lettre, ayant toujours suivi ses propres relations ou celles de l'illustre auteur du Journal, ainsi que les lecteurs l'auront pu remarquer. Et quant à ce qui s'est passé depuis, je suivrai les meilleurs mémoires qui nous sont venus de Siam (1), et en cas que dans la suite, par les nouveaux avis qu'on pourra recevoir, il y eût quelque fait ou circonstance à rectifier, je prendrai soin de l'insérer ci-après.
Le père Tachard était revenu avec les envoyés du roi de Siam et avec quelques enfants de mandarins qui lui avaient été confiés pour les faire élever en France, ainsi qu'il a été remarqué ci-devant (2). Ses instructions portaient à l'égard des derniers que le roi souhaitait qu'on les élevât dans le collège de Louis-le-Grand, à tous les exercices des gentilshommes français ; qu'il avait résolu d'y en entretenir toujours un pareil nombre, pour unir par cette voie le cœur des deux nations, et faire prendre à ses sujets les manières françaises (3). Outre l'utilité de ce dessin, laquelle aurait été considérable dans la suite du temps, on avait toujours par ce moyen des otages réciproques de part et d'autre, qui faisaient qu'il y avait moins de hasard et de péril à pousser les entreprises du côté de Siam. À l'égard des envoyés, il paraît qu'ils ne servaient proprement qu'à donner plus de poids et de crédit au caractère du père Tachard, qui avait entre ses mains tout le pouvoir et le secret de la députation. Ces termes de son instruction le font assez connaître : Au reste, Sa Majesté se remet à votre prudence, sur la manière dont vous devez vous comporter, persuadée que vous ressentez comme il faut les marque de sa royale confiance, qui l'a portée à vous confier, quoique étranger, ses pouvoirs, ses interprètes, et même son honneur, dans la Cour de votre véritable souverain. Procédé qui vous doit être d'autant plus agréable qu'il est extraordinaire et presque sans exemple (4).
La lettre du roi de Siam au roi très chrétien n'est pas moins formelle sur ce sujet (5), car après avoir marqué qu'il avait confié aux troupes françaises les places les plus importantes, et en même temps la force de son royaume, et qu'il avait reçu les pères jésuites avec la même estime qui l'avait porté à les demander, il ajoute : Nous les considérons tous comme les plus utiles instruments et le véritable canal de nos royales correspondances, et par conséquent ils seront toujours intimes à notre cœur. Mais comme les circonstances qui doivent établir ces royales correspondances entre Votre Majesté et vous n'ont pu être conclues ni déterminées, nous sommes obligés d'envoyer vers Votre Majesté le père Tachard pour traiter avec elle de toutes choses. Nous n'avons oint donné de qualité à ce père, à cause de son caractère de prêtre et de jésuites, d'où les malintentionnés pourraient prendre quelque avantage pour lui faire quelque peine, ce qui retomberait sur nous. Ainsi, nous remettons à la royale prudence de Votre Majesté pour faire sur ce point tout ce qui conviendra à notre gloire réciproque et au crédit de sa fonction, et nous la conjurons de lui donner une entière croyance.
Mais dans la lettre que le roi de Siam écrivit au pape, il n'a pas jugé à propos de garder les mêmes ménagements, puisqu'il y donne à ce père la qualité d'Envoyé extraordinaire, sans doute pour lui procurer plus de crédit en Cour de Rome, où son ordre en avait moins qu'en France. Voici les propres termes de la lettre (6) : Nous nous trouvons obligés de renvoyer le père Tachard de la Compagnie de Jésus, en qualité d'Envoyé extraordinaire auprès de Votre Sainteté, pour établir entre elle et nous cette bonne correspondance que nos premiers ambassadeurs étaient chargés de ménager. Ce père prendra la liberté d'assurer de notre part Votre Sainteté que nous donnerons une entière protection à tous ces pères, et à tous les chrétiens, etc. Ce même père aura l'honneur d'informer Votre Sainteté des autres moyens qui conviennent à cette fin, selon les ordres que nous lui en avons donnés. Nous la prions de donner à ce religieux une entière créance, sur ce qu'il lui représentera, etc.
Il faut avouer, Monsieur, que quand ce père aurait pris soin de composer lui-même toutes ces dépêches, il n'aurait pu y donner un autre tour plus avantageux ni plus convenable à ses fins. Mais s'il avait en main une belle et ample matière pour se faire valoir en Cour de Rome, il faut aussi convenir qu'il a encore mieux su la mettre en œuvre et en rehausser le prix par la forme qu'il y a donnée, car dans la harangue qu'il fit au pape le 23 décembre 1688 en lui présentant les mandarins et les présents du roi de Siam, il exagéra avec beaucoup d'éloquence (7) : Que les bénédictions que le ciel avait répandues sur l'Église ne permettaient pas de douter que Dieu n'eût choisi Sa Sainteté dans ces derniers siècles pour réunir tout l'univers dans son bercail, puisqu'on voyait sous ce saint pontificat les hérétiques les plus opiniâtres chassés ou convertis, les royaumes qui s'étaient séparés, avec tant de scandale, réunis à l'Église et soumis à son autorité, les ennemis les plus redoutables du nom chrétien presque tous exterminés, ou si affaiblis qu'ils n'attendaient que le dernier coup pour achever leur ruine ; mais que ce qui était de plus extraordinaire et sans exemple, c'était de voir qu'un des plus grands rois de l'Orient, encore païen, l'eût chargé de venir de sa part demander à Sa Sainteté son amitié, et l'assurer de ses respects. Que non seulement ce prince commençait déjà à se faire instruire, dressait des autels au vrai dieu, demandait des missionnaires savants et zélés, et leur faisait bâtir des maisons et des collèges magnifiques. Mais, ajoute-t-il : Il nous donne très souvent des audiences secrètes et très longues, il nous fait même rendre des honneurs qui font de la jalousie aux principaux ministres de sa secte. Après quoi il finit en disant : Si Dieu écoute nos vœux, ou plutôt s'il exauce les larmes et les prières de Votre Sainteté par la conversion de ce monarque, que de rois, de princes et de peuples n'imiteront pas son exemple ? Pour moi, je regarde déjà cette lettre royale, ces présents et ces mandarins auxquels il a ordonné de se prosterner à ses pieds, non seulement comme des témoignages de profond respect de ce prince, mais encore comme des engagements de sa soumission, et si je l'ose dire, comme des prémices de ses hommages et de son obéissance.
J'ai remarqué ci-dessus la date du 23 décembre, parce qu'alors les affaires avaient bien changé de face de tous côtés, et ce qui en paraissait déjà en Europe, préparait de plus grands changements à l'avenir. La guerre était commencée en Allemagne, et déclarée contre les Provinces-Unies. L'expédition d'Angleterre avait été suivie d'un heureux trajet, et tout s'y disposait aux grandes choses que nous avons vues depuis. Il est vrai qu'on ne savait pas si tôt à Rome tout ce qui se passait en nos quartiers, mais ces commencements n'empêchèrent pas que le père Tachard ne parlât encore sur le même ton à son retour en France, lorsqu'il présenta la relation de son voyage à Sa Majesté très chrétienne. Il en prit même occasion de renchérir sur tous les éloges de ce grand monarque, car non seulement il lui fait espérer que la postérité comptera parmi les conquêtes de Louis le Grand les rois de Siam, de la Chine soumis à la croix de Jésus-Christ, mais il ajoute : « Ces conquêtes, Sire, que Votre Majesté fait pour accroître le royaume de Dieu, intéressent le Ciel à conserver les vôtres contre tant d'ennemis ligués. Vous avez la consolation de n'en avoir point qui n'aient pris de ceux de l'Église les armes dont ils vous attaquent tant que vos intérêts et ceux de la religions sont inséparables. Ils n'oublient par même d'y mêler un éloge dont il fait une prérogative en faveur de sa Société. C'est, dit-il, l'avantage des personnes de notre profession que de servir Dieu en servant leur roi, et d'être sûres de ne pouvoir rendre de plus agréables services à leur roi que par ceux même qu'elles rendent à Dieu. Avec vous, on n'est point embarrassé de rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu, puisque par un exemple de piété chrétienne aussi singulier qu'il vous est glorieux, aujourd'hui, en France, Dieu et César n'ont plus que le même intérêt.
Mais tandis que ce père entretenait les deux Cours de ces belles espérances, et qu'il faisait honneur à son ordre de députation d'un grand roi des Indes, il ne songeait pas que ce prince n'était plus, que son favori avait perdu tout d'un coup sa fortune et sa vie, par le revers d'une triste destinée, et que pendant que les grands desseins de la France commençaient à s'ébranler en Occident, ils venaient d'être renversés en Orient. Tant il est vrai
Que des plus grands projets la trompeuse apparence
S'appuie et se soutient sur un sable mouvant.
Pour entrer dans le récit du changement qui est arrivé au royaume de Siam, il est nécessaire de donner quelque idée de la personne du roi et de l'état auquel sa Cour sa trouvait alors.
Ce prince était âgé d'environ 50 à 55 ans, petit et maigre, mais d'une taille droite et bien prise, d'une physionomie agréable, ayant de grands yeux noirs, vifs, pleins d'esprit (8). Il parlait vite et bredouillait ; il était affable envers tout le monde, et surtout envers les étrangers, d'un bon jugement, habile, curieux, agissant, ennemi de l'oisiveté, des excès, et surtout de certains vices ordinaires aux princes d'Orient. Il s'appliquait tout entier aux affaires de son royaume, donnant tous les jours plus de huit heures à différents Conseils ; son grand divertissement était la chasse des éléphants. Il n'aimait pas la guerre, parce qu'il aimait le soulagement et le repos de ses sujets, mais il savait l'entreprendre et la soutenir vigoureusement quand il s'agissait, ou de dompter des sujets rebelles, ou de se faire respecter par ses voisins. Il avait au reste plus de connaissance de la divinité, et il en jugeait plus sainement que tous les docteurs siamois, prenant plaisir à s'informer de la religion, des mœurs et des coutumes des autres nations, et donnant un libre accès à tous les étrangers. Voilà en abrégé le portrait qu'en font toutes les relations, qui conviennent qu'il passait, à cause de toutes ces qualités, pour le plus grand et le meilleur prince qui eût jamais régné sur les Siamois. Mais quelques-unes ajoutent qu'on a seulement trouvé à redire à la trop grande facilité qu'il a eue pour son ministre et pour les Français.
Quant à la famille royale, il n'y avait d'enfants qu'une seule princesse (9). Le roi avait deux frères, tous deux fort inquiets et qu'il tenait sous la clé, l'un était impotent, l'autre bien fait, mais quelques-uns disent qu'il était muet, et d'autres qu'il affectait de le paraître par politique (10). Selon la coutume de Siam, les frères du roi succèdent à la Couronne préférablement à ses enfants, auxquels néanmoins elle revient après la mort de leurs oncles. Mais le roi, connaissant l'humeur de ses frères, ne les jugeait pas propres pour lui succéder, et il faisait élever un fils adoptif, nommé Mom Pi (11), lequel apparemment il destinait pour être un jour son successeur, à quoi le ministre Constantin Phaulkon aidait de tout son pouvoir, afin de se conserver toujours la même autorité. Il se trouvait fortifié par les Français qu'il avait introduits dans le royaume et dans les principales forteresses, et il se promettait en cas de besoin un plus grand secours. Nous avons vu ci-devant quelles étaient ses étroites correspondances de ce côté-là, mais je n'ai pas fait mention d'une circonstance qui a été supprimée dans les relations de France : c'est qu'à tous les honneurs qu'il avait reçus de cette Cour, auxquels il s'était montré extrêmement sensible, on avait ajouté celui de l'Ordre de Saint-Michel (12).
Outre les personnes que je viens de nommer, il y en avait une autre qui tenait le premier rang après la personne du roi, et qui par sa conduite a su devenir le principal personnage de la révolution, en se plaçant lui-même sur le trône, malgré tout le pouvoir et tout le crédit de l'autre parti. C'était Okphra Phetracha, général de toutes les forces de Siam (13), beau-père et beau-frère du roi, dont il avait épousé la sœur, et à qui il avait donné sa fille, devenue mère de la princesse, et morte depuis quelques années (14). Ce général avait acquis une grande estime par ses bonnes qualités, outre le crédit que lui donnait son rang et sa naissance, étant habile homme de guerre, vaillant, généreux, débonnaire, et enclin au soulagement des peuples, s'étant même opposé plusieurs fois à diverses impositions qui avaient été mises par le ministre Constance ; en un mot, c'était le chef du parti contraire, d'autant plus redoutable qu'il n'affectait rien et qu'il paraissait même n'avoir aucun dessein pour le trône. Mais ce ministre n'ignorait pas ce qu'il en devait craindre, et dans les mesures qu'il prenait pour l'avenir, il ne négligeait pas les moyens de se délivrer de ce grand obstacle, ainsi qu'on le verra ci-après.
Voilà quel était alors l'état et l'intérieur de la Cour. Je ne parlerai pas de plusieurs autres personnes qui ont eu part à ce mouvement, parce qu'ils n'ont agi que comme instruments et non comme principaux mobiles de la révolution. Je remarquerai seulement que quoique le roi fût très absolu, et que par conséquent sa Cour parût au-dehors dans une grande tranquillité, cependant on peut voir par tous ces intérêts opposés qu'elle renfermait au-dedans les semences du trouble et de l'agitation qui a éclaté depuis. Le roi lui-même n'en avait que trop de pressentiments, car dans un entretien qu'il eut un jour avec M. le chevalier de Chaumont, le discours étant tombé sur la grande union de la Maison de France, il ne put s'empêcher de dire que quand les princes demeuraient unis avec leur roi, un État était invincible ; que la désunion dans les Maisons royales de Mataran et de Banten les avaient perdues, et en levant les yeux au ciel, il ajouta d'un air sérieux et triste qu'il ignorait ce que le grand dieu ordonnerait de la sienne (15).
Les choses étant dans cet état, le roi fut attaqué au commencement de l'année 1688 d'une fâcheuse maladie, qui dans la suite se changea en hydropisie. Il s'était fait porter à Louvo, mais sa Cour était restée dans la ville capitale du royaume, à qui les Portugais ont donné le nom de Siam, quoiqu'elle s'appelle autrement dans la langue du pays. Le palais y était toujours gardé, et même dès que l'on vit augmenter la maladie du roi et qu'il ne pouvait plus quitter le lit, on redoubla les gardes dans cette grande ville, afin d'y prévenir les remuements. Mais à peine eut-on donné ces premiers ordres, qu'il courut un faux bruit de la mort du roi, ce qui fut comme un signal entre les courtisans et les grands pour les mettre tous en mouvement, et pour exciter diverses pratiques et intrigues, dont les suites eussent été à craindre, si le général Phetracha n'eût promptement pris les devants, en s'assurant de quelques-uns des plus distingués qui avaient contribué à cette émotion, du nombre desquels fut Opra Soula, ou Chula (16), l'une des créatures du premier ministre Constantin Phaulkon et attaché au parti qu'il favorisait, en sorte que par ce moyen les choses se rétablirent en quelque repos.
Cependant le fils adoptif du roi, appuyé de la faveur du ministre, avait fait paraître en cette occasion qu'il avait dessein de succéder à la Couronne, et même l'on travaillait sous main à lever des milices de tous côtés pour son service, à quoi son propre père s'employait avec plusieurs autres personnes de son parti, jusque-là qu'on assure qu'il avait déjà près de 14 000 hommes, ce qui rendit le ministre plus fier qu'il n'avait été auparavant. Mais tout cela ne put être tenu si secret que le général n'en eût le vent, dont néanmoins il jugea à propos de ne rien témoigner et de laisser aller le cours des choses pendant quelque temps, jusqu'à ce que le roi se trouvant plus mal, fut contraint de se décharger sur lui de toute la direction des affaires et de lui remettre la régence du royaume. Ce fut alors que commença la décadence du premier ministre, qui par ce changement se vit éloigné tout d'un coup du maniement des affaires, abandonné de ceux qui ne l'avaient servi que par crainte, et traversé par tous les autres dont il avait excité la jalousie ou la haine.
Le nouveau régent vit au contraire augmenter sa saveur à mesure que celle de son prédécesseur allait en diminuant. Le choix que le roi avait fait de sa personne était généralement applaudi, non seulement par l'avantage que lui donnait sa naissance, son rang et sa nouvelle dignité, mais aussi par l'estime qu'on faisait de son mérite et de ses qualités personnelles. Ceux mêmes qui songeaient à s'élever, en s'attachant au parti du plus jeune frère du roi, lequel ils avaient dessein de placer sur le trône, applaudissaient comme les autres à ce choix et se joignaient au parti de la faveur pour achever d'abattre celui de Mon Pi et du ministre qui l'appuyait. Quant à ces derniers, ils comprirent que s'ils ne s'opposaient pas à ces commencements, il n'y avait plus de ressource pour eux. Le sieur Constance, surtout, sentait bien que dans le poste où il avait été élevé, il n'y avait point de chute médiocre, d'autant plus qu'il était étranger, et parmi des Orientaux, où il est encore plus rare qu'ailleurs de voir descendre un favori sans tomber dans le précipice. Il n'avait donc point d'autre parti à prendre que celui de résister ou de chercher une retraite. Il y a bien de l'apparence que le conseil des Français de sa confidence le poussait plutôt au premier qu'au dernier ; au moins on l'a cru ainsi à cause de plusieurs circonstances qu'on verra ci-après. Quoi qu'il en soit, il se détermina au premier, croyant peut-être qu'il serait toujours à temps de recourir au dernier, si l'autre lui manquait, en quoi il se trouva surpris. Et où sont les grands et les favoris qui sachent se résoudre à quitter la partie de bonne grâce quand il en est temps, et qui soient d'humeur de tourner le dos à la fortune pendant que cette perfide leur jette encore quelque œillade ? On espère toujours plus qu'on ne craint, et on se flatte encore plus qu'on n'espère ; on voit le péril et on sait bien que dans cette mer orageuse, le plus sûr serait de regagner le port,
Mais à l'ambition d'opposer la prudence,
C'est aux prélats de Cour prêcher la résidence (17).
Ce ministre n'était pas encore tellement disgracié qu'il ne se fût conservé quelque accès auprès de la personne du roi, et beaucoup de part dans sa confiance et dans son estime. Il trouva donc le moyen de s'introduire secrètement auprès de ce monarque, et de se ménager une favorable audience, dans laquelle il sut lui représenter avec tant de force le péril qui menaçait sa Cour et sa personne, par les cabales qui se formaient pour s'assurer du gouvernement, la nécessité qu'il y avait d'en prévenir les suites et le peu de confiance qu'il pouvait prendre sur la plupart de ceux qui le servaient, à cause de toutes ces divisions, qu'il obtint un ordre pour faire venir promptement les Français de Bangkok à la Cour, afin d'y garder le palais et la personne du roi et de l'assurer par ce moyen contre toutes les entreprises qu'on pourrait former au préjudice de Sa Majesté et du bien de l'État ; lequel ordre fut envoyé sur-le-champ à M. Desfarges, qui ne manqua pas d'abord de se mettre en chemin avec une partie de ses troupes, et de s'acheminer en diligence vers Louvo où était la Cour.
Le général fut bientôt averti de tout ce qui se passait (18), ou du moins assez tôt pour parer à ce coup, car avant que les Français fussent arrivés, il eut le temps d'entretenir le roi et de lui faire comprendre que tous les discours que Phaulkon lui avait tenus et tous les desseins de ce ministre et de ses adhérents ne tendaient à autre chose qu'à faire eux-mêmes ce qu'ils imputaient aux autres, et qu'à se rendre maîtres non seulement du palais et de la Cour, mais aussi de la personne de Sa Majesté et du royaume. Cette dernière crainte fut plus forte sur l'esprit du roi que la première. Il ouvrit les yeux et révoqua l'ordre qu'il avait donné, commandant à tous les Français qui étaient à Siam, ou qui se trouveraient en chemin, qu'ils eussent à retourner à Bangkok (19).
Le commandant Desfarges reçut ce contre-ordre en chemin, qui le surprit et lui donna beaucoup de chagrin, voyant ses mesures rompues et que ce changement subit ne signifiait rien de bon. Il ne laissa pas néanmoins de l'exécuter, quoiqu'à regret, ce qu'il fit assez connaître par quelques hostilités qu'il exerça en s'en retournant, lesquelles donnèrent de mauvaises impressions du dessein des Français, et confirmèrent la Cour dans la défiance qu'on en avait déjà conçue, outre ce qui se passa à Bangkok devant et après leur retour, dont il sera parlé ci-après. Cependant on regarda comme un coup d'État que le général eût pris les devants si à propos, et que le contre-ordre ne trouva point de contradiction de la part des Français, car s'ils eussent continué leur route, on croit qu'il eût peut-être été assez difficile dans ces premiers commencements de les empêcher de se rendre maîtres de la personne du roi, et de changer la disposition des affaires (20).
Sur ces entrefaites, il arriva un incident qui frappa le grand coup de la révolution. Ce fut qu'alors on découvrit le complot qui fut fait entre Mom Pi, le fils adoptif du roi, et le ministre Phaulkon, pour faire réussir leurs desseins, ce que l'on raconte de cette manière : Qu'un soir qu'ils étaient assemblés avec plusieurs mandarins de leur parti dans une des chambres du palais, ils furent écoutés par une femme et par le fils du général (21), lesquels à la faveur de l'obscurité de la nuit, s'étant approchés de la porte de la chambre sans être aperçus, et prêtant l'oreille, avaient entendu distinctement qu'il avait été comploté entre eux, que dès que le roi serait mort, ils feraient mourir son plus jeune frère, lequel plusieurs grands destinaient à la Couronne, et qu'ils se déferaient en même temps du général, de son fils, des grands de son parti et de tous les Mores qui leur étaient en obstacle. Sur cet avis, on résolut d'observer de plus près les démarches de Constance, et soit que Phaulkon en eût le vent, ou qu'ayant manqué son dessein d'introduire les Français à la Cour, il ne jugeât pas à propos de s'exposer si facilement, il y allait beaucoup plus rarement qu'à l'ordinaire, et même il laissa passer quelques jours sans y paraître, ce qui acheva de confirmer les soupçons qu'on avait conçus contre lui.
Les choses étant dans ces termes, on crut qu'il n'y avait plus de temps à perdre pour en arrêter le cours, ce qu'il fit le 19 mai au matin, s'y étant fait porter dans sa chaise d'argent. On ne sait pas ce qui s'y passa, mais un moment après il retourna dans sa maison, où il dîna, mit ordre à quelques affaires et dit à sa garde européenne que la nuit suivante, il devait arriver quelque chose de considérable qui ferait tourner les affaires d'un côté ou d'autre ; et après leur avoir dit adieu, non sans marquer quelque trouble sur son visage, il retourna à la Cour, se flattant qu'il pouvait encore se soutenir et rétablir ses affaires.
Mais on ne demeura pas longtemps sans s'apercevoir d'un mauvais présage, car sa chaise revint sans lui, ce qui fit d'abord soupçonner à ses domestiques qu'il lui était arrivé quelque disgrâce. Et en effet, ils apprirent bientôt après que non seulement leur maître, mais aussi le fils adoptif du roi et le capitaine des gardes, avaient été arrêtés et conduits le même jour au palais chargés de chaînes (22), ensuite de quoi la maison de ce ministre fut pillée par les Siamois, qui ne laissèrent pas même à sa femme les choses les plus nécessaires. Et pour comble de malheur, le régent ayant fait arrêter Okphra Sivipat (23), on trouva sur lui un écrit contenant le nom des conjurés, et l'accord signé entre Mom Pi et Phaulkon, ce qui acheva de fournir contre eux tout ce qu'il fallait pour les perdre.
Lorsque toutes ces nouvelles furent portées au roi, il eut beaucoup de douleur de voir les deux personnes qui lui avaient été les plus chères engagées dans un faux pas dont il n'était plus possible de les tirer après une conviction de cette nature. Il fut donc contraint de laisser aller le cours de la justice, et de les abandonner au pouvoir du parti contraire. Après trois jours de prison, le malheureux Mom Pi eut la tête tranchée (24), laquelle on jeta ensuite par opprobre aux pieds de son protecteur, qui était chargé de pesantes chaînes, en lui disant ces mots : Voilà ton roi (25). Ce triste spectacle continua même pendant quelque temps, jusqu'à ce que le roi, averti de la chose et touché vivement de la mort de son fils, témoigna qu'il ne voulait pas qu'on fît aucune ignominie à son corps, mais au contraire qu'on l'enterrât, ce qui fut exécuté. Quant à l'autre prisonnier, il fut jugé à propos de différer son exécution de quelques jours, parce qu'on avait dessein auparavant de retirer les forteresses des mains des Français, surtout à cause de plusieurs sujets de mécontentement qu'on en avait reçus, qui augmentaient la défiance de jour en jour, dont il est nécessaire de dire quelque chose de plus particulier.
Bangkok, qui est la clé du royaume de Siam du côté de la mer du sud, a deux forteresses, l'une à l'ouest de la rivière, l'autre vis-à-vis qui avait été rebâtie de nouveau et fortifiée plus régulièrement par les Français. Lorsque M. Desfarges reçut l'ordre de se rendre à Louvo, dont j'ai parlé ci-dessus, il avait ordonné à son major, que dès qu'il le verrait parti, il abandonnât le vieux château pour se transporter dans l'autre avec toutes les munitions qu'il pourrait emporter. Cela ne manqua pas d'être exécuté, et crainte de se trouver surpris par le temps, on s'appliqua promptement à détruire tout ce qu'on était contraint de laisser ou dont on pouvait se passer. On fit crever ou enclouer les gros canons qui ne purent être transportés, on mouilla toute la poudre qui demeura de reste, on démolit les magasins, et on détruisit enfin tout ce qu'on crut qui pouvait nuire et servir contre eux. Cette action jointe aux hostilités que les Français exercèrent en s'en retournant, lorsqu'ils reçurent le contre-ordre dont il a été parlé, fit connaître qu'on ne devait pas négliger de se précautionner contre eux. C'est pourquoi on donna ordre de travailler en diligence à la réparation du vieux château, et on y fit entrer du monde, afin de le mettre en état de défense et de le garder, et pour observer en même temps la contenance des Français.
Cependant il fut jugé à propos de faire venir M. Desfarges à Louvo afin de découvrir ses intentions et de retirer par douceur l'autre forteresse d'entre ses mains. Le régent ne souhaitait pas apparemment d'avoir cet obstacle à surmonter par la force, pendant que les choses demeuraient indécises et en suspens durant la vie du roi, et qu'il avait une autre faction à craindre qui aurait pu se prévaloir de ces inconvénients. On envoya donc un ordre à ce gouverneur de se rendre incessamment de Bangkok à Louvo. Cet ordre ne lui plut pas, et il hésita longtemps s'il y obéirait ou non, trouvant sans doute beaucoup de difficultés des deux côtés dans une conjoncture aussi délicate et imprévue, surtout après les sujets de plainte et de défiance qu'il avait déjà donnés. Mais enfin il prit le parti d'obéir à la troisième citation. L'accueil qu'on lui fit à son arrivée ne lui donna pas sujet de se repentir de son voyage, car non seulement il fut favorablement écouté, mais il fut outre cela régalé de présents magnifiques, et autre autres d'un vase ou bolsete d'or (26) (qui est une marque de faveur et de distinction extraordinaire) sur la promesse qu'il fit d'obéir fidèlement aux ordre du roi. Ensuite de quoi Sa Majesté (27) lui fit connaître qu'elle avait jugé à propos de retirer la forteresse de ses mains et qu'elle désirait qu'il la remît entre les mains de ceux qui lui seraient envoyés de sa part, et qu'il se rendît après cela avec tous les Français à Louvo, jusqu'à ce qu'on leur eût préparé des vaisseaux pour les transporter hors du royaume ; à quoi M. Desfarges ayant consenti, il fut convenu que pour sûreté de l'exécution, il laisserait ses deux fils en otage à Louvo, avec M. l'évêque de Métellopolis, ce qui fut exécuté.
On s'étonnera peut-être que les Français, n'étant qu'une poignée de monde dans un royaume aussi puissant qu'est celui de Siam, ils aient pu se faire craindre et s'attirer tous ces ménagements. Mais on n'en sera pas surpris quand on considérera ce qui a été remarqué dans les relations de France : que le royaume de Siam est dénué de forteresses et de troupes réglées, et que ce qu'il y avait de plus fort était entre les mains des Français. La puissance du roi consiste en ce que tous ses sujets sont obligés de le servir toute l'année pour rien, à quelque emploi qu'il les destine. Quand il sort dans ses balons de parade, il y aura 15 000 rameurs qui ne lui coûtent pas un sous. Quand il fait la grande chasse des éléphants, il y emploiera de même 40 ou 50 000 hommes. En temps de paix, il se contente de mettre sur les frontières quelques petites garnisons pour garder les passages, et sa garde ordinaire n'est que de deux compagnies de cavalerie de mahométans et deux de Chinois, avec quelques compagnies d'infanterie composée de Siamois, Pégouans, Cambodgiens, etc. En temps de guerre, il fait enrôler tous ceux qu'il veut, et il leur donne seulement du riz pour se nourrir. Encore nous dit-on qu'ils font la guerre comme les anges, c'est-à-dire qu'ils poussent leur ennemi hors de sa place, sans pourtant lui faire mal, et s'ils portent des armes, c'est pour faire peur en tirant contre terre ou en l'air, ou tout au plus pour se défendre dans l'extrême nécessité (28). Il est vrai qu'on ajoute que depuis quelques années, le roi les faisait battre tout de bon contre les Cambodgiens qui s'étaient révoltés et qui avaient appelé à leur secours les Cochinchinois et les corsaires chinois. Il ne faut donc pas s'étonner si les Français, maîtres des clés du royaume, et mis à la tête des milices qu'on avait levées sous main pour soutenir le parti du fils adoptif du roi et du favori, eussent pu se faire craindre. Il faut encore appliquer ici la considération que j'ai touchée ci-dessus à l'égard du général, ou prince régent, savoir qu'il convenait beaucoup mieux à ses intérêts et à son but que tout se passât tranquillement et sans émotion. Et enfin, on peut alléguer pour raison particulière du favorable traitement fait à M. Desfarges, que le roi n'ayant pas encore entièrement oublié l'inclination et les faveurs qu'il avait témoignées aux Français, il était bien aise que tout se terminât paisiblement avec eux.
À l'égard de M. Desfarges, on assure encore qu'entre les motifs qui le déterminèrent à prendre ainsi le parti d'obéir, ou du moins de le promettre, il y avait été principalement porté par le conseil du ministre prisonnier, lequel n'était pas alors tellement resserré qu'il ne pût lui donner de ses nouvelles par des messagers qui allaient et venaient dans la prison, et l'on estime que ce ministre lui donna ce conseil afin de n'aigrir pas davantage la colère des Siamois, prévoyant bien que le ressentiment qu'exciterait un refus de la part des Français retomberait sur lui et ne servirait qu'à aggraver le crime de haute trahison dont il était accusé, au lieu qu'il se flattait que si l'on avait sujet d'être content de leur procédé, cela pourrait peut-être lui procurer un traitement plus favorable, ou du moins modérer en quelque manière l'indignation de ses ennemis et calmer cette première fureur. Mais cette précaution ne lui servit guère, comme on le va voir par la suite. On n'avait pas commencé cette tragédie pour ne la pas achever. Il s'était rendu trop redoutable au parti contraire, et on le regardait comme la principale victime qui devait être immolée à la sûreté du nouveau gouvernement.
Outre les rigueurs de sa prison, on lui fit souffrir plusieurs tourments pour arracher les confessions qu'on voulait tirer de lui, touchant le crime dont on l'accusait, et pour lui faire avouer tous les complices et autres circonstances de cette nature, qu'on tâche de découvrir en pareil cas. Il n'est point dit ce qu'il avoua, ou ce qu'il n'avoua pas ; on remarque seulement que ces tourments l'avaient extrêmement affaibli, et que se voyant ainsi maltraité, il ne voulait plus prendre aucune nourriture, ce qui fit craindre à ceux qui l'examinaient qu'il ne mourût entre leurs mains et obligea de hâter le jour de son exécution (29).
Ce fut le 4 juin 1688 qu'on choisit pour cela. Au coucher du soleil, il fut premièrement porté à sa maison dans une méchante chaises (car il ne pouvait marcher), étant suivi d'une grande foule de peuple dont il eut à essuyer en chemin plusieurs outrages et moqueries, et entre autres sur les palais qu'il avait fait bâtir. Après lui avoir laissé prendre quelque repos dans sa maison, on le porta auprès de sa femme (que l'on tenait prisonnière avec son fils), soit qu'on eût jugé à propos de ne lui pas refuser cette dernière consolation, ou soit qu'on fût bien aise de voir ce qui se passerait dans leur entretien. Cette femme accablée de douleur, voyant qu'il n'y avait plus moyen de sauver son mari, ne songea qu'à sauver son fils et elle-même de la fureur du peuple, en tâchant d'attirer la compassion des Siamois par une voie aussi extraordinaire qu'affligeante, de quelque côté qu'on la puisse envisager ; car c'est à ce motif qu'on impute l'étrange résolution qu'elle prit d'agir en furieuse et non en épouse, en se déchaînant en reproches et en injures contre son mari, jusque-là qu'on remarque qu'elle lui cracha au visage et qu'elle souffrit à grand peine que ce père infortuné pût dire les derniers adieux à son fils âgé seulement de 4 ans, lequel il chérissait tendrement (30). Cruelle extrémité s'il en fût jamais, soit qu'on la regarde en elle-même, ou du côté d'une feinte qui étouffait tous les mouvements de la nature dans une occasion où ils devaient tous éclater. Aussi toucha-t-elle les Siamois, qui en furent d'autant plus surpris, que la manière dont ces époux avaient vécu ensemble ne donnait pas lieu de s'attendre à rien d'approchant de tout ce qu'on voyait, quoique quelques-uns disent que les grandes liaisons du ministre avec les Français n'avaient jamais plu à sa femme, et qu'elle l'avait averti plusieurs fois que cela causerait un jour sa ruine. Mais ces sortes de prédictions se publient souvent après coup. Quoi qu'il en soit, et quelque accablante que fut cette entrevue pour le malheureux Constance, il fallut l'en arracher pour le mener au lieu du supplice. Il ne s'y attendait pas encore, et il se flattait qu'on allait le ramener dans sa prison, mais lorsqu'il se vit conduire hors de la ville et qu'ayant demandé où on le menait, on lui eut fait réponse qu'on allait le faire mourir comme coupable du crime de haute trahison, alors il se prit à frapper sa poitrine et à marquer son étonnement, tant il est difficile aux plus malheureux de se dépouiller entièrement des douces illusions de l'espérance, dont le charme ne finit qu'avec la vie. Mais s'étant un peu remis, et se voyant arrivé au lieu où on le menait, il prit le collier de l'Ordre de Saint-Michel qu'il avait sur lui, et une relique enchâssée en or qui pendait à son col, et il les remit à l'un des mandarins qui étaient présents, avec prière de les vouloir donner à son fils, après quoi l'un des exécuteurs de Siam lui dit de se mettre à genoux ; mais soit qu'il eût encore quelque chose à dire, ou à faire, il demeura debout, et quelques-uns ajoutent qu'il voulut même se défendre, ce qui est peu croyable. Quoi qu'il en soit, pendant qu'il était encore en action, sa tête fut enlevée de son corps, lequel on coupa ensuite en trois quartiers, qu'on jeta dans une fosse ; mais comme elle fut peu couverte, les chiens déterrèrent le corps pendant la nuit, et le rongèrent de telle sorte qu'on ne trouva le lendemain que quelques restes d'os épars en divers endroits, ainsi que l'ont rapporté quelques Européens qui eurent la curiosité de s'y transporter ce jour-là, car on n'a pas appris qu'aucun d'eux n'ait été présent à l'exécution, et ce qui vient d'être récité n'a été su que sur le rapport des gens du pays.
C'est ainsi que finit ses jours l'infortuné Constantin Phaulkon, lequel ayant eu au commencement plus de naissance que de fortune, et plus de courage encore et d'ambition que de naissance, sut également s'assujettir aux plus petits emplois et se montrer digne des plus grands, ne trouvant rien au-dessous de lui pour s'élever, ni au-dessus de lui pour se maintenir dans son élévation. Favori d'un puissant roi d'Orient, caressé d'un grand monarque d'Occident qui l'avait fait chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, et honoré par le pontife romain de deux croix d'argent dans ses armes, en reconnaissance des grands services qu'il rendait à la religion, mais qui, pour avoir voulu pousser plus loin sa fortune, ou la soutenir à contretemps, a embrassé un parti qui l'a précipité tout d'un coup du faîte de sa grandeur, en sorte que pour fruit de ses travaux, de ses dignités et de sa félicité passée,
Il ne moissonne enfin qu'une tragique mort,
Faible et triste jouet des caprices du sort.
J'achèverai le reste dans la lettre suivante. Je suis, Monsieur, votre, etc.
Ce 1er février 1690.

NOTES
1 - Nous connaissons au moins un mémoire parvenu en Hollande, qui a été traduit en français sous le titre Relation succincte du changement surprenant arrivé dans le royaume de Siam en l'année 1688, daté du 30 novembre 1688. S'il y en a eu d'autres, ils suivaient vraisemblablement le même canevas, car Jean Tronchin du Breuil reprend très fidèlement les informations fournies par ce document. ⇑
2 - Voir sur ce site la page Les enfants des ambassades. ⇑
3 - Guy Tachard, Second voyage […], 1689, p. 301. ⇑
4 - Guy Tachard, Second voyage […], 1689, p. 297. ⇑
5 - Cette lettre est reproduite dans le Second voyage […] du père Tachard, pp. 282 à 286. On pourra la lire sur ce site : Lettre de Phra Naraï à Louis XIV. ⇑
6 - Cette lettre est reproduite dans le Second voyage […] du père Tachard, pp. 407 à 409. On pourra la lire sur ce site : Lettre de Phra Naraï au pape Innocent XI. ⇑
7 - Cette harangue est reproduite dans le Second voyage […] du père Tachard, pp. 404 à 406. On pourra la lire sur ce site : Harangue du père Tachard au pape Innocent XI. ⇑
8 - Ce portrait du roi Naraï est en grande partie emprunté à Guy Tachard (Voyage de Siam des pères jésuites, 1686, pp. 314-315). Vollant des Verquains en reprendra des formules entières dans son Histoire de la révolution de Siam arrivée en l'année 1668, 1691, pp. 101-102. ⇑
9 - La princesse Sudawadhi (สุดาวดี) Krom luang (princesse de 3ème rang) Yothathep (กรมหลวงโยธาเทพ) 1656-1735, fille unique du roi Naraï et de la Princesse Suriyong Ratsami (สุริยงรัศมี), une de ses concubines. ⇑
10 - Sur les frères du roi, voir le Mémoire du père de Bèze. ⇑
11 - Mom Pi (หม่อมปีย์) ou Phra Pi (พระปีย์), parfois appelé Prapié, Monpy, Monpi, etc. dans les relations françaises. Fils d'un courtisan, ce jeune garçon fut emmené très jeune au palais pour y exercer les fonctions de page et fut élevé par une sœur du roi Naraï. Toutes les relations s'accordent à reconnaître la tendresse quasi paternelle que le roi lui prodiguait et les privilèges exceptionnels dont il jouissait. ⇑
12 - La Loubère avait apporté à Phaulkon, de la part de Louis XIV le brevet de l'ordre de Saint-Michel, des lettres de naturalité, le droit de porter trois fleurs de lys d'or dans ses armes, et pour son fils, le don d'une terre de trois mille livres de rente avec le titre de comte. (Lanier, Étude historique..., 1883, p. 96). ⇑
13 - Phetracha était général en charge de la brigade des éléphants du roi, poste considérable puisqu'il commandait aux dizaines de milliers d'hommes qui prenaient soin des royaux pachydermes. ⇑
14 - Ce passage, comme tous ceux qui relatent le coup d'État siamois, est emprunté à la Relation succincte du changement surprenant arrivé dans le royaume de Siam en l'année 1688, traduite du hollandais, et dont un exemplaire est conservé aux Archives Nationales de Paris (C1/24, f° 130v° à 139v°) qu'on pourra lire ici : Relation succincte. Il est bien difficile de s'y retrouver dans l'imbroglio des familles royales siamoises, rendu plus opaque encore par les mariages plus ou moins consanguins et les nombreuses concubines des rois. Les relations s'accordent à dire que le roi Naraï avait eu pour concubine Suriyong Ratsami (สุริยงรัศมี), sœur de Phetracha (lui-même frère de lait du roi), qui lui avait donné une seule fille, la princesse Yothathep (โยธาเทพ). Pour le reste, aucune source n'est fiable, et surtout pas les sources siamoises, qui falsifient et embellissent volontiers l'Histoire pour doter leurs souverains d'un passé présentable. Il est vraisemblable que Phetracha n'avait pas une goutte de sang royal dans les veines. ⇑
15 - Cette anecdote se trouve dans le Journal de l'abbé de Choisy à la date du 19 novembre 1685. ⇑
16 - Okphra Chula (ออกพระจุฬา) : ce titre était attribué à un dignitaire musulman chef de la nation malaise. ⇑
17 - Boileau : Épître I au roi. ⇑
18 - Le général désigne ici Phetracha, et non Desfarges, qui est appelé commandant dans la lettre. ⇑
19 - Ceci est en totale contradiction avec toutes les relations françaises, qui affirment que si Desfarges est retourné à Bangkok sans aller jusqu'à Louvo, c'est parce qu'il avait eu avis par les missionnaires et Véret, le chef du comptoir d'Ayutthaya, que les Siamois étaient en arme et qu'il allait tomber dans un guet-apens. On pourra ici les justifications de l'abbé de Lionne sur le conseil qu'il donna à Desfarges, et qui marqua peut-être le tournant des événements : Mémoire sur une affaire sur laquelle on m'a demandé quelques éclaircissements. ⇑
20 - À ce moment des événements, les relations françaises ne parlent presque plus du roi, qui est représenté comme un vieillard malade, quasi prisonnier dans son palais, et qui n'a plus aucune autorité ni aucune influence dans les affaires du royaume. ⇑
21 - Sorasak ou Luang Sarasak (หลวงสรศักดิ์). Selon certaines Chroniques royales approuvées par le prince Damrong, le père de l'histoire thaïlandaise moderne, Sorasak n'était pas le fils de Phetracha, mais un fils secret du roi Naraï, conçu pendant une campagne à Chiang Maï. Le souverain, honteux de son écart de conduite, aurait confié la garde de son fils à son frère de lait Phetracha. Quoi qu'il en soit, Sorasak devint à la mort de son père, en 1703, le 29ème roi d’Ayutthaya sous le titre de Sanphet 8 (สรรเพชญ์ที่ ๘), mais il reste surtout connu sous le surnom de Phra Chao Süa (พระเจ้าเสือ : le roi tigre). W.A.R. Wood en brosse un portrait peu flatteur : Ce fut un homme cruel, intempérant et dépravé. Turpin dit qu’il a épousé la princesse Yothathep, une des veuves de son père [par ailleurs fille de Phra Naraï]. Une des portes de son palais était connue sous le nom de Porte des Cadavres en raison du grand nombre de petits cercueils qui en sortaient, contenant des enfants assassinés victimes de sa luxure et de sa cruauté. (…) Le roi Tigre, usé par l’alcool et la débauche, mourut en 1709, terminant ainsi un règne court et peu glorieux. (A History of Siam, 1924, pp. 225 et suiv.). ⇑
22 - On peut s'étonner de l'attitude résignée de Phaulkon, qui aurait pu, à ce moment, faire basculer la situation à son avantage. Beauchamp, qui était à Louvo en charge de la garde de M. Constance avec le fils cadet de Desfarges et l'officier Fretteville relate cette arrestation : Nous entrâmes dans le palais, et comme je fus à vingt pas en dedans, je dis à M. Constance : — Pourquoi, monsieur, n'avez pas voulu me donner l'ordre d'arrêter Phetracha ? Il me dit : — Ne parlons point de cela. Aussitôt nous aperçûmes Phetracha à la tête de plus de deux mille hommes, entouré de tous les officiers du palais, qui vint à nous, et nous ayant abordés, prit par la manche M. Constance, lui disant : — Ah ! le voici, et aussitôt dit à un mandarin de lui couper le col. M. Constance, à demi-mort, se tourna du côté de Phetracha en posture de suppliant, à qui il parla à l'oreille. En même temps six personnes me prirent sans beaucoup me presser, et le fils de Phetracha toucha le bout de mon épée. Aussitôt je mis les deux mains sur la garde, afin d'en être toujours maître, en regardant fixement M. Constance pour, au moindre signe qu'il m'aurait fait, la passer au travers du corps de Phetracha, croyant que c'était la volonté du roi de s'en défaire, comme il me l'avait dit. M. Constance, tournant la tête de mon côté, me dit d'une voix tremblante : — Seigneur major, rendez à Phetracha votre épée. Je la tirai, et comme je la tenais par le milieu pour la donner à Phetracha, son fils, qui était derrière moi, la prit par la garde. Je me tournai brusquement, et comme j'eus vu qui c'était je la laissai aller. (B.N. Fr 8210 f° 522r°). ⇑
23 - On trouve un Okphra Si Phiphat, commissaire du roi, parmi les officiels siamois qui négocièrent le traité de commerce établi le 11 décembre 1687 avec Céberet et La Loubère (A.N. C1/23, f° 222). Engelbert Kaempfer, de passage au Siam en 1690, évoque un Oja Pipat, Lieutenant du barcalon (Histoire naturelle, civile et ecclésiastique de l'empire du Japon, 1729, I, p. 15). Comme souvent au Siam, il s'agit plus probablement d'un titre, d'une charge, d'une fonction, que d'un nom. ⇑
24 - Le père de Bèze donne une autre version de la mort de Phra Pi : Ce mandarin, se voyant abandonné de tous ses gens (dont une partie, gagnée par Phetracha, s'était donnée à lui, l'autre avait pris la fuite avec son père), s'était réfugié dans la chambre du roi où il s'était caché ; mais ayant été obligé d'en sortir la nuit pour quelques nécessités, les gardes qui étaient à la porte le saisirent et, le lendemain matin Phetracha lui fit couper la tête, quelques prières et quelques instances que lui fit faire le roi pour obtenir la vie de ce fils adoptif qu'il aimait si tendrement. (Drans et Bernard, Relation originale de la révolution de Siam […], 1947; p. 119). ⇑
25 - D'autres sources indiquent que la tête de Mom Pi fut attachée au cou de Phaulkon, ce qui était un châtiment traditionnel au Siam pour punir les criminels en les forçant à porter sous le nez la tête de leur complice. ⇑
26 - Des boîtes à bétel appelées tiap (เตียบ) ou krop (ครอบ) en siamois. Selon leur matière, leur taille et leur décoration, elles indiquaient le niveau hiérarchique de leur propriétaire. ⇑
27 - Desfarges était accompagné de l'abbé de Lionne. Aucun des deux n'indiquent qu'ils ont vu le roi lors de cet entretien, mais seulement Phetracha et Kosapan. ⇑
28 - Journal de l'abbé de Choisy du 19 janvier 1686. ⇑
29 - Le père Le Blanc rapporte les rumeurs qui couraient sur les supplices qu'aurait enduré Phaulkon avant son exécution (Histoire de la révolution du royaume de Siam, 1692, I, pp. 226 et suiv.) : Les uns ont dit qu'on lui avait brûlé la plante des pieds pour l'empêcher de s'enfuir, et que l'ayant appliqué à la question, on lui avait serré les tempes avec un instrument de fer, et déchiré tout le corps à coups de rotin. Les autres ont cru qu'on lui avait coupé les pieds et les mains, et qu'on lui avait laissé longtemps au col la tête du malheureux Mom Pi, pour faire croire qu'il avait été son complice. Il ne faut pas douter que ces barbares n'aient exercé sur lui de grandes cruautés selon leur esprit vindicatif et sanguinaire ; ce ne sont pas des supplices trop rigoureux parmi eux que de brûler à petit feu, de faire frire les hommes dans des poêles d'huile bouillante en les y plongeant peu à peu, d'attacher un tigre affamé auprès d'un patient, de telle sorte qu'il ne puisse lui manger que les extrémités, de faire avaler des métaux fondus, et de nourrir longtemps des hommes de leur propre chair qu'il leur coupent et qu'ils font griller en leur présence. L'exécution de Damien à Paris le 28 mars 1757 prouvera que les Français pouvaient faire aussi bien que les Siamois en matière de barbarie et de cruauté. ⇑
30 - Ce comportement étonnant de Marie Guyomar est rapporté dans la Relation succincte […] hollandaise, mais sans aucun commentaire. Si les faits se sont vraiment passés ainsi, l'explication qu'en donne Jean Tronchin du Breuil est plausible, car tous les témoins s'accordent à reconnaître que Mme Constance était dotée d'une solide piété chrétienne et était décrite comme une épouse exemplaire. ⇑

14 mai 2019
