
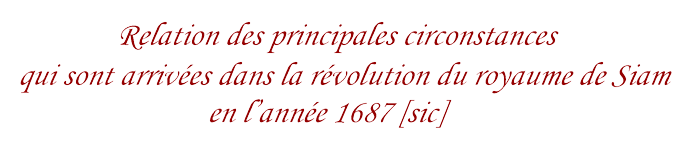
3ème partie.
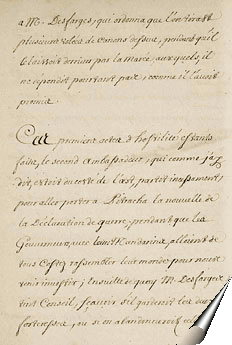
Ces premiers actes d'hostilité étant faits, le second ambassadeur, qui comme j'ai dit, était du côté de [38r°] l'ouest, partit incessamment pour aller porter à Phetracha la nouvelle de la déclaration de guerre, pendant que les gouverneurs, avec leurs mandarins, allaient de tous côtés rassembler leur monde pour nous venir investir, ensuite de quoi M. Desfarges tint conseil pour savoir s'il garderait les deux forteresses, ou si l'on abandonnerait celle de l'ouest, qui était la moins soutenable, pour se jeter tous dans celle de l'est.
L'ingénieur en chef (1) ayant été consulté là-dessus, dit que n'ayant que demi de ce qu'il leur fallait de monde pour occuper les postes du fort de l'est, qui était le meilleur, il n'était pas expédient de vouloir s'attacher à les garder tous deux, d'autant plus que la communication de l'un à l'autre ne se pouvant faire que par bateaux, on mettait en risque de faire couper la gorge à tout ceux qu'on y laisserait, sans qu'il en pût échapper un seul, si on les attaquait pendant que la marée serait basse et leurs chaloupes échouées, et qu'ainsi il n'y avait point d'autre parti à prendre que celui d'en [38v°] faire crever tout le canon, et de démolir les parapets, après qu'on en aurait tiré toutes les munitions. Ce qu'ayant approuvé M. Desfarges, tout fut fait la même nuit, et les troupes repassant le lendemain matin ne cessèrent point ensuite pendant trois jours de tirer sur ce fort, afin de le mettre tout à fait hors d'état de pouvoir servir aux ennemis, et voyant que le troisième il commençaient à le réparer, M. Desfarges ordonna d'y envoyer dans deux chaloupes un détachement de trente hommes commandés par un capitaine, un lieutenant et un enseigne (2), qui ayant passé et débarqué de l'autre côté de la rivière, montèrent dans le fort avec une échelle par les embrasures. Les Siamois [39r°] plièrent d'abord, mais se sentant soutenus d'un très grand nombre des leurs, repoussèrent si rigoureusement notre détachement que tous les soldats sautèrent du haut en bas du rempart, et s'embarquèrent avec beaucoup de confusion, qui fut augmentée par le grand feu de la mousqueterie des ennemis, et de quoi il y eut quatre de nos soldats de tués sur la place, et six de blessés, quatre desquels moururent ensuite de leurs blessures.
On ne saurait dire combien cet avantage enfla le cœur des Siamois, qui commencèrent à croire que les Français n'étaient point aussi invincibles qu'ils se l'étaient imaginé, et dès le lendemain ils élevèrent sur les ruines du cavalier de leur fort un autre construit de plusieurs corps d'arbres de bois [39v°] de coco, et dont l'assemblage était si mal entendu, qu'il ne fut pas plutôt fini que les pluies ayant affaissé le terres dont il était soutenu, le firent pencher et crever de tous côtés, jusqu'à être obligés de l'étayer pour empêcher qu'il ne tombât, travail qui leur a beaucoup nui, vu que depuis ils ne purent se servir ni de l'un ni de l'autre.
Ce grand ouvrage duquel apparemment ceux qui en avaient donné l'invention aux Siamois espéraient de gros avantages, comme ils l'auraient fait effectivement s'il avait pu subsister, vu qu'il découvrait jusqu'au pied intérieur de notre place, tant il était élevé, étant fini, ou pour mieux dire, abandonné, [40r°] ils commencèrent à faire plusieurs redoutes à deux et à trois portées de mousquet de notre forteresse, et ils en approchaient tous les jours d'autres de plus près en plus près, jusque-là que la dernière qu'ils firent était à une petite portée de pistolet de notre fossé, et M. Desfarges, qui ne voulait point qu'on tirât dessus, afin de conserver sa poudre dont il lui restait en ce temps-là seize à dix-sept milliers, de vingt que les vaisseaux du roi avaient laissés dans Bangkok avant de partir, ayant toujours refusé celle qui lui avait été offerte par M. de Constance, qui en voulait introduire suffisamment pour soutenir un siège d'un an, donna tout le temps aux [40v°] ennemis de nous enfermer et de se mettre en étant de nous insulter toutes et quantes fois qu'il le voudraient.
Ces travaux étant finis et bien munis de canon sans avoir reçu aucun empêchement, les Siamois voulant l'assurer davantage et nous ôter toute espérance de secours en France, car nous n'en attendions pas d'autre, et en vint effectivement quatre mois après notre blocus par le vaisseau du roi l'Oriflamme, barrèrent la rivière en trois endroits avec des pieux et firent depuis son embouchure jusqu'à deux lieues de Bangkok sept forteresses ou retranchements qui contenaient en tout 180 pièces de canon [41r°] dont les Hollandais leur avaient fourni une bonne partie, aussi bien que d'autres munitions de guerre.
Nous voyant ainsi bloqués de toutes manières, nous n'avions d'autre espérance que celle de périr par la faim, les Siamois n'ayant jamais osé nous venir attaquer ; mais le sieur Véret, qui lorsqu'il engagea M. Desfarges à abandonner M. de Constance lui avait promis de lui fournir tout l'argent dont il aurait besoin pour les frais de la guerre, ne crut pas que les choses en dussent venir au point où elles étaient, et se voyant engagé lui-même dans le mauvais pas où il avait mis tous les autres, résolut [41v°] de se servir de toute son adresse et de tout le crédit qu'il s'était acquis, qu'il ne tînt à rien que nous ne fussions promptement secourus (3).
Un officier qui était présent à cette conférence en donna avis au principaux de la garnison, qui furent sur-le-champ trouver M. Desfarges pour lui remontrer que le sieur Véret était un fripon, qui après avoir mis les affaires dans le mauvais état où elles étaient, n'avait d'autre envie que celle de se tirer de la presse, aussi bien que M. de Rosalie avec tous leurs effets, et de nous laisser dans le bourbier, en un mot que le prétexte d'aller chercher du secours parmi [42r°] les princes voisins était une invention trop grossière pur donner dedans, vu qu'il n'y en a pas un dans toutes les Indes qui ne voulût avoir égorgé le dernier Européen. Que si véritablement il était dans cette disposition, il pouvait laisser son argent, les aller trouver et leur promettre toutes sortes de satisfactions, tant pour leurs troupes que pour les vivres qu'ils apporteraient. Mais le sieur Véret ne trouvant pas son compte à cette proposition fit semblant d'être très satisfait de ne se point exposer à être pris ou brûlé par les Siamois.
Cependant il fut résolu le lendemain de faire partir ce petit bâtiment avec sept hommes armés et quinze d'équipage commandés par un enseigne de vaisseau, tant [42v°] pour aller chercher des vivres que pour donner avis à la côte de Coromandel de la révolution, ne comptant point en pouvoir jamais porter d'autres nouvelles en France, et il ne fut point à deux lieues de Bangkok qu'il se vit entouré de plusieurs mirousLes mirous sont de petits bâtiments d'environ 5 à 6 tonneaux qui vont à la voile et à la rame, propres à naviguer le long des côtes. et petites galères de ce pays-là, qui le talonnant de tous côtés, n'osaient en approcher, quoiqu'il n'eût que quatre petites pièces d'une livre et demie de balles. Enfin s'étant aperçu qu'il n'y avait que trois ou quatre hommes qui paraissaient sur le pont, tout le reste s'étant saoulé et endormi, se résolurent de l'aborder de tous côtés, si bien que dans un instant, il se vit plus de cinq cents hommes [43r°] sur ce petit bâtiment. L'officier qui le commandait, voyant qu'il ne pouvait le défendre seul ni éviter de tomber en leurs mains, aima mieux se brûler en mettant le feu aux poudres, et en faisant périr avec lui plus de cinq cents hommes que de s'exposer à leur cruauté (4).
Pendant que toutes ces choses se passaient à Bangkok, Phetracha qui s'était déjà défait de ses deux plus redoutables ennemis et tenait les Français bloqués d'une manière à ne devoir plus rien appréhender de leur côté, ne songeait plus qu'à se défaire des deux têtes qui pouvaient lui être d'un très puissant [43v°] obstacle à parvenir à ses premières fins. C'était les deux princes frères du roi, légitimes héritiers de la couronne, qu'il avait réservés jusqu'à ce temps-là pour être les dernières victimes de son ambition et les deux derniers degrés du trône où il voulait monter. Mais il était très dangereux pour lui de les aller attaquer à force ouverte, parce qu'il aurait trop fait connaître qu'il ne tendait qu'à la destruction de la famille royale, et qu'il était à craindre qu'il ne fût pas secondé dans cette entreprise comme il l'avait été jusqu'alors. C'est pourquoi il crut devoir se servir de tout son esprit et de toute sa conduite, et s'étant rendu au palais de Siam où [44r°] étaient les princes, il débuta par faire entendre au cadet – celui des deux qui était plus en état de régner, l'aîné était impotent de tous ses membres et muet –, qu'il était temps qu'il songeât à prendre le gouvernement de l'État en main, puisque le roi son frère, qui pour lors était fort malade, ne donnait plus grande espérance de vie, et que venant lui annoncer de la part de la princesse sa nièce, à qui seule Sa Majesté avait laissé le droit de nommer un successeur, qu'il s'en était servie en sa faveur, il était à propos qu'il s'acheminât incessamment pour se rendre auprès d'elle, et afin que ce prince n'eût aucun lieu [44v°] de douter de la vérité de sa parole, il n'hésita point à lui faire la sombaye (5), honneur qu'on ne rend aux rois de Siam qu'à leur avènement à la couronne.
Ce prince, que l'envie de règne tenait depuis longtemps, se laissa aisément éblouir à toutes ces apparences extérieures, et s'achemina pour aller à sa perte, malgré la remontrance de quelque mandarin qui pénétrait plus avant que lui dans les desseins de Phetracha.
Et ce traître, se voyant ainsi assuré, ne tarda guère à mettre la dernière fin à son entreprise par la plus grande de [45r°] toutes les perfidies, ainsi que je le vais dire. Comme il avait un très grand soin de se venir informer de l'état de la santé du roi, devant qui il avait la hardiesse de paraître, étant déjà plus roi que lui et trouvant qu'il était sur la fin de sa vie, il ordonna de faire assembler le Conseil, où il se rendit, et contrefaisant l'homme désespéré et outré de douleur, et après y avoir pris sa séance, dit d'une voix entrecoupée de sanglots que le roi était à la fin de ses jours et venait de lui déclarer ses dernières volontés, dont lui-même avait horreur ; que cependant rien ne les pouvait dispenser d'y être soumis jusqu'au dernier [45v°] moment de leur vie, et enfin que Sa Majesté venait de lui faire entendre qu'ayant tous les sujets du monde de n'avoir que de l'aversion pour les princes ses frères, qui s'étaient toujours mis à la tête de toutes les conspirations qui se sont formées pendant son règne contre sa personne, ou en avaient été les premiers auteurs, il ne voulait pas qu'aucun des deux régnât après lui, aimant mieux abandonner sa couronne à toute autre personne du royaume que de la laisser en partage à deux prince aussi peu dignes de la porter ; et enfin qu'il voulait mourir avec la satisfaction de savoir qu'ils ne possèderaient jamais [46r°] ce qui leur avait fait commettre tant d'attentats et d'infidélités, voulant absolument qu'on le fît incessamment et sans aucun délai.
Pendant que ce perfide faisait rapport au Conseil de ces prétendues intentions du roi, il observait fort exactement les contenances de tous les mandarins, afin que distinguant ceux qui pénétraient ses desseins d'avec ceux qui donnaient par une complaisance esclave dans toutes ses volontés, en vue de se défaire des uns et de se confier entièrement aux autres, mais il ne trouva point grande résistance dans ces âmes élevées dans l'esclavage [46v°] et la bassesse, et sur lesquelles il avait déjà acquis un si puissant empire qu'il ne s'en trouva presque point qui osassent s'opposer à un ordre qu'il disait d'ailleurs avoir reçu du roi. Et ainsi le Conseil consentit à la mort de ces princes, et en remit l'exécution à Phetracha, qui fit le même jour enlever l'aîné à force ouverte hors du palais de Siam, duquel il n'avait jamais voulu sortir, quelque belle espérance qu'il lui ait pu donner. Et l'ayant fait amener à Louvo, où il tenait déjà le cadet enfermé, ce perfide débuta par leur étaler leur conduite passée envers le roi, et si contraire au bien de l'État, n'en [47r°] oubliant aucunes circonstances, desquelles il faisait autant de crimes capitaux. Il les chargea ensuite d'avoir attenté récemment sur l'autorité du roi en souffrant que plusieurs mandarins, voire lui-même, leur fissent la sombaye pendant que le roi vivait encore, et qu'enfin Sa Majesté s'étant plainte à son Conseil de leurs attentats, ils avaient été déclarés indignes de régner et coupables de mort. Ensuite de quoi il les livra entre les mains d'un détachement considérable composé de sept créatures d'élite et commandés par son fils, afin d'être plus sûr de l'exécution de ses ordres, qui les menèrent devant une [47v°] pagode entre Louvo et Thale Chubson, petit lieu de plaisance du roi, et les ayant fait mettre tous deux dans chacun un sac de velours écarlate, on leur pressa l'estomac avec du bois de santal, qui est le plus précieux des Indes, avec tant de force qu'ils furent étouffés en peu de temps, la coutume ordinaire des Siamois étant celle de ne répandre jamais le sang des princes.
Phetracha, s'étant ainsi défait de tout ce qui pouvait être un obstacle à son ambition, attendait avec impatience la mort du roi pour monter sur le trône, et sachant que ce prince était sur le point de finir ses jours, il commença [48r°] à faire paraître le dénouement de son entreprise et déclara que n'y ayant personne dans le royaume d'une famille assez distinguée pour lui disputer la couronne, voulant même assurer qu'elle avait été usurpée sur ses ancêtres, il entendait être élu successeur du roi, assurant que ses peuples ne goûteraient pas moins de douceur pendant son règne qu'ils avaient eu de déplaisir dans le passé. Il promit ensuite aux talapoins d'abolir la religion chrétienne, et aux mandarins de ne souffrir aucun Européen dans le royaume, condamnant la conduite du roi d'avoir toujours marqué beaucoup de mépris sur ses sujets et donné toute [48v°] son affection et son estime aux étrangers.
Phetracha les prenait les uns et les autres par leur sensible endroit, car les talapoins n'étaient point à murmurer contre la facilité du roi pour l'établissement de la Mission, non plus que les mandarins contre celui des Français dans Bangkok et Mergui, qu'ils regardaient comme une autorité naissante de laquelle ils ne pourraient plus se soustraire s'ils lui laissaient le temps de se fortifier, aussi fut-il déclaré successeur d'une commune voix, et avec un applaudissement public. Le lendemain, le roi fit dire au révérends pères jésuites, à qui il envoya chacun cinquante écus de gratification [49r°] par son trésorier, étant tout ce qui lui restait en sa disposition, qu'il les priait d'assurer le roi de France son bon ami qu'il n'avait en mourant que le seul regret de ne lui avoir pu témoigner jusqu'au bout les sincères affections de son cœur, et qu'il n'avait eu aucune part à tout ce qui s'était passé, vu qu'ils étaient bien témoins que lui-même était enveloppé dans le même malheur. Il mourut enfin deux jours après sur les onze heures du matin, soit de sa maladie, ou de quelque remède qui ait précipité sa mort. Voilà la fin de cette sanglante tragédie, et la mort d'un prince dont les sentiments de bonté et [49v°] d'affection pour la nation française ont duré jusqu'au dernier moment de sa vie, et qui ne méritait rien moins que le triste sort qu'il a subi.
Phetracha, qui pour lors était avec M. l'évêque de Métellopolis à traiter d'accommodement, ne fut point plutôt averti que le roi expirait qu'il se rendit au palais en toute diligence pour y donner ses ordres, et n'y trouvant plus rien qui le contrebalançât, prit son empire absolu sur le gouvernement, et peu de jours après se fit déclarer roi. Mais soit que cet usurpateur se fût aperçu de quelque refroidissement dans [50r°] ses peuples et dans ses mandarins pour continuer la guerre contre les Français, soit que la conjoncture présente de ses affaires voulût qu'il n'y eût point de guerre à soutenir qu'il ne fût auparavant plus solidement établi sur le trône, il envoya dire à M. Desfarges que son prédécesseurs ayant des raisons pour avoir aimé à recevoir des étrangers dans le royaume, il avait les siennes pour n'en vouloir souffrir aucun ; que néanmoins, en considération de la bonne union qui avait été entre le roi de France et le défunt roi, il se sentait disposé à procurer aux Français toutes sortes de commodités et de soulagements pour leur sortie.
[50v°] Je ne fais aucune mention des particularités de plusieurs lettres qui se sont écrites de part et d'autre pendant deux ou trois mois après la déclaration de guerre, parce qu'on n'y parlait que de faire venir le bazar, c'est-à-dire le marché au pied de notre forteresse (6), duquel nous avions très grand besoin, tant pour les malades à qui on ne donnait plus que des bouillons de corneilles qu'on avait dans la place, que pour toute la garnison qui était à la veille d'être réduite au riz et à l'eau, et que l'on manquait de bois, ayant été dans la nécessité de brûler les casernes des soldats et les maisons de officiers pour cuire le riz et la viande.

NOTES :
1 - L'ingénieur en chef désigne Vollant des Verquains, auteur d'une relation très proche de celle-ci, qui pourrait sembler en être un brouillon ou un résumé. Il n'est pas impossible même que cette relation manuscrite soit de la main de Vollant. ⇑
2 - L'auteur de l'Abrégé de ce qui s'est passé à Bangkok pendant le siège de 1688 conservé aux Archives Nationales sous la cote Col. C1/24 mentionne ce fait d'armes et indique qu'il en faisait partie (f° 154r°-154v°) : M. Desfarges résolut deux jours après de reprendre le fort. Je fus pour cet effet commandé avec soixante hommes et trois officiers - à trois ou quatre heures de là, la chose fut réduite à moitié - commandés par M. d'Assieu avec deux officiers, lesquels firent humainement tout ce que de braves gens peuvent faire, sans reprendre néanmoins le fort. Ils se débarquèrent en plein midi sous le feu des ennemis, entrèrent par l'embrasure et y sortirent après avoir tué plusieurs Siamois de leurs mains et avoir plusieurs soldats de tués, et se rembarquèrent à leur vue. Beauchamp relate également cette péripétie, mais note que le commandant en était Des Rivières : D'abord que M. Desfarges eut fait tirer du fort de l'ouest tout ce qui y était, commença à le faire battre à coups de canon afin de le raser. Deux jours après, prévoyant que les Siamois pourraient, à la faveur d'un bourg qui était proche de notre place, beaucoup nous incommoder pour pouvoir venir à nous à couvert jusqu'à la portée du pistolet, envoya des Rivières, capitaine, à la tête de trente hommes, le brûler. Il y eut plus de deux cents maisons réduites en cendres. (B.N. Ms. Fr. 8210 f° 536v°-r°). ⇑
3 - Vollant des Verquains développe davantage cette initiative de Véret (op. cit., pp. 87 et suiv.) : Ce fut dans ces tristes conjonctures que le sieur Véret, qui ne s'était pas attendu à des suites si fâcheuses quand il avait détourné M. Desfarges de servir M. Constance, voulut employer toute son adresse et user du crédit qu'il s'était acquis sur l'esprit du général pour tirer, comme on dit, son épingle du jeu. Il tâcha de lui persuader qu'il devait lui permettre de partir de Bangkok avec M. de Rosalie et un autre missionnaire, se servant pour cet effet d'un petit bâtiment qui, faisant voile à l'île de Bornéo et ayant été obligé de relâcher, était venu mouiller au pied de Bangkok deux jours avant la déclaration de la guerre. Il lui promettait merveille de la faveur des princes voisins, qui devaient lui accorder à sa prière un secours considérable d'hommes et de vivres. Mais il ajoutait aussi que, connaissant l'humeur des Indiens extrêmement intéressée, il était à propos qu'il emportât avec lui l'argent comptant des missionnaires et du comptoir qu'ils avaient sauvé dans la place, afin qu'il ne tînt point à cela qu'il obtînt d'eux promptement les secours qu'il allait demander.
Un officier qui eut part à cet entretien en donna avis aux principaux de la garnison qui furent sur-le-champ trouver M. Desfarges pour lui remontrer que le sieur Véret leur allait jouer un mauvais tour, puisque après avoir mis les affaires au plus mauvais point qu'elle pussent arriver, il cherchait à se mettre à couvert de l'orage ; qu'il pouvait néanmoins partir, s'il était résolu d'aller chez les princes voisins solliciter le secours qu'il en espérait, auxquels il pouvait promettre toutes sortes de satisfactions tant pour les troupes que pour les vivres qu'ils lui fourniraient, mais qu'il ne fallait pas souffrir qu'il emportât l'argent.
En effet, son prétexte n'était pas recevable à des gens qui n'ignoraient pas que de tous les Indiens, il n'y en avait pas un qui, bien loin d'assister, ne voulût avoir égorgé le dernier Européen ; ainsi le sieur Véret ne put obtenir sa demande et fit néanmoins semblant qu'il était bien content de ne point s'exposer à être pris ou brûlé par les Siamois. ⇑
4 - Cette action d'éclat fut rapportée dans toutes les relations. On lira celle du père Le Blanc, qui la narre avec force détails : Une belle action du sieur Saint-Cry ⇑
5 - Les mots sombaye, ou zombaye, fréquemment employés dans les relations françaises, sont des transpositions du portugais sumbra çumbaya, sumbaïa sumba, etc. L'origine en reste obscure. Il pourrait s'agir d'une déformation du mot malais sěmbah, une salutation, une respectueuse adresse, l'acte de salutation ou d'hommage consistant à élever les mains au visage, (Dictionnaire anglais-malais de R. J. Wilkinson, Singapour, 1901, p.404) ou de son dérivé sěmbah-yang (vénération de dieu, prière, rituel). Le dictionnaire Hobson Jobson de Yule (p.850) cite les mots Somba, et Sombay, du malais présent, cadeau. Peut-être est-ce le même mot que le Sěmbah de Wilkinson, les cadeaux, les présents étant habituellement offerts en Asie aux personnes à qui l'on souhaite rendre hommage. ⇑
6 - Les Siamois avaient isolé la forteresse de Bangkok par neuf petits forts qui fermaient les routes et empêchaient le ravitaillement des Français par voie terrestre. Mais ce blocus n'eut pas l'effet qu'ils en avaient espéré, car les Chinois de la ville de Bangkok, gens déterminés à sacrifier leur liberté et leur vie à l'avidité qu'ils ont pour l'argent, venaient de nuit par la rivière qui n'était point fermée vendre des vivres dans la forteresse, malgré les défenses rigoureuses de Phetracha. (Le Blanc, op. cit., I, p. 262). Ce bazar, ainsi que l'appelaient les Français, était vraisemblablement l'ancêtre des marchés flottants qui sont aujourd'hui une image traditionnelle de la Thaïlande touristique, même s'ils n'ont plus grand-chose d'authentique.
 Souvenir du pays du sourire... ⇑
Souvenir du pays du sourire... ⇑

12 mars 2019
