
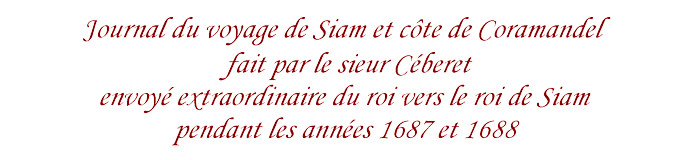
Du 1er au 13 décembre 1687.
Le 1er décembre, on nous vint avertir dès le matin pour assister à un combat d'éléphants auquel le roi, qui devait y être présent, nous envoya convier (1). Peu de temps après, nous nous mîmes en marche, accompagnés de tous les officiers français, tous, ainsi que nous montés sur des éléphants. Incontinent, après que nous fûmes arrivés dans une place de Louvo où devait être le spectacle, le roi y arriva sur son éléphant, précédé et suivi de toute sa Cour et de sa garde, tant à pied qu'à cheval. Il y avait un grand nombre de mandarins qui attendaient le roi et qui demeurèrent prosternés, ainsi que tous les soldats de la garde, dans tout le temps que le roi fut présent.
Le roi prit cette occasion pour nous donner une audience. M. Constance vint nous chercher pour nous mener auprès du roi qui était de l'autre côté d'une petite pagode, laquelle nous sépara pendant l'audience de tous les autres Français. En approchant du roi, nous le saluâmes sans descendre de dessus nos éléphants, M. Constance étant à notre gauche et nous servant d'interprète. Le roi commença à nous demander l'état de notre santé et, comme M. de La Loubère, qui portait la parole, lui témoignait avec exagération notre reconnaissance du soin que Sa Majesté avait fait prendre de nous, le roi répondit que les rois étaient obligés à prendre un soin particulier des ministres qui servaient à entretenir leurs amitiés et leurs alliances, à quoi M. de La Loubère répliqua que tous les Français étaient si bien traités à Siam qu'ils croyaient être en leur pays. Le roi répondit en souriant : — Fort bien, fort bien par deux fois ; ensuite il nous y témoigna ses bonnes intentions sur le commerce et sur l'établissement de la Compagnie dans son royaume. Les officiers des flûtes la Loire et le Dromadaire s'approchèrent pour saluer le roi, conduits par M. Constance, ce qu'ils firent sans descendre de leurs éléphants. Le roi fit présent au sieur d'Andennes d'un sabre garni d'or avec une chaîne aussi d'or, et une veste, parce que c'était son premier voyage en ce pays. Le sieur Joyeux et quelques autres eurent des vestes. Après que les officiers eurent remercié le roi, il se retira en se tournant un peu vers nous (2).
Nous apprîmes, à notre retour au logis, que la querelle de M. Constance et du père Tachard s'était passée dans le cabinet du sieur Constance, à deux heures après minuit, au sujet de quelques articles de ceux que nous signâmes à bord avec le père Tachard, dont il n'est pas content.
Le 2 décembre, j'allai sur le soir chez M. Constance pour travailler avec lui, et l'ayant trouvé occupé, j'entrai en conversation particulière avec le père Tachard, lequel, repassant avec moi sur tout ce qui s'était fait depuis notre arrivée à Siam, me dit qu'il avait représenté a Mgr le marquis de Seignelay qu'il y aurait quelques Portugais dans Bangkok, qui servaient depuis longtemps le roi de Siam et dont ce prince ne saurait que faire, et que le chevalier de Forbin devait être établi gouverneur de Bangkok, à quoi Mgr le marquis de Seignelay lui avait répondu que le chevalier de Forbin n'était point comparable au sieur Desfarges, et que les Portugais ce n'était rien. Le père prétend fonder sur cette tolérance le droit que M. Constance s'arroge de laisser les Siamois dans la garnison de Bangkok. Le père ajouta que si le roi envoie ici de nouvelles troupes, on ôterait la siamoise de la garnison de Bangkok. Je lui répondis que je ne savais point si le roi enverrait de nouvelles troupes (3), mais que je savais bien que le roi avait cru que les troupes qu'il envoyait suffisaient pour la garde de cette place où il n'y avait jamais eu la moitié tant de troupes.
Le père ne me parla point des provisions, ni des commissions que M. Constance a données aux officiers de la garnison de Bangkok, mais il me dit que M. Constance avait été fort sensible à l'article de notre mémoire qui concerne la religion, parce qu'il l'a regardé comme un reproche du peu de zèle de sa part pour l'établissement de la religion dans ce royaume ; et pour excuser M. Constance de n'avoir pas publié les privilèges accordés aux chrétiens par le traité fait avec M. de Chaumont, il me dit, de plus, que Mgr de Métellopolis l'en avait prié par écrit de ne pas le faire et qu'il avait encore cet écrit, raison que le père Tachard ne nous avait jamais dite, quoique nous lui eussions parlé deux fois au sujet de la publication dudit traité. Mgr de Métellopolis même ne nous l'a jamais dite, mais nous ne laissons pas de croire cela véritable parce que nous l'avions trouvé dans la pensée de demander à la vérité la publication du traité, mais d'y faire changer auparavant un article qui semble soupçonner la fidélité des missionnaires, en disant que s'ils prêchent quelque chose contre l'État, ils perdront leurs privilèges (4). Ce ne fut pas seulement cet article qui nous détermina à ne point demander la publication, mais bien l'exécution de ce traité, surtout dans un point considérable que Mgr de Métellopolis désirait le plus, qui est de nommer un mandarin auquel tous les nouveaux chrétiens siamois puissent s'adresser en qualité de juge pour vider tous leurs procès de différends, étant certain qu'ils n'osent se faire chrétiens par la crainte qu'ils ont d'être maltraités par leurs mandarins dont ils seraient à couvert par l'exécution de cet article. Au surplus, il est certain que ce traité ne mérite point d'être publié, parce que pour la moindre chose, la peine est de nullité du traité, style ordinaire du sieur Constance.
Le père me dit ensuite, au sujet de son voyage en France, qu'il ne savait pas encore précisément quelle qualité on lui donnerait et qu'il ne savait pas même s'il aurait aucun caractère. Nous avons cru que cet article embarrasserait M. Constance parce qu'il ne lui est pas aisé de déterminer la qualité qu'il donnera au père Tachard, avant que de savoir comment le roi le voudra recevoir, à cause que ne nous ayant pas bien traités sur les honneurs, ils craignent que le roi ne soit difficile sur ceux du père Tachard et de la lettre qu'il portera, de sorte que nous croyons que le père aura, à toutes fins, plusieurs lettres et plusieurs caractères différents pour nous montrer que ce que le roi voudra approuver et que même au besoin, il ne sera qu'envoyé de M. Constance.
Après cette conversation, je joignis M. Constance qui commença par me dire que sans doute M. de La Loubère ne songeait pas à partir si tôt, puisqu'il n'y avait que trois ou quatre jours qu'il avait reçu son premier mémoire. Je lui répondis – suivant ce que nous étions convenus, M. de La Loubère et moi – que mon dit sieur de La Loubère n'ayant rien à faire sans moi, il était résolu de partir en même temps que je partirais et de s'en aller en rade, que si M. Constance voulait répondre à ce mémoire par des effets, il y avait assez de temps, et s'il ne voulait répondre par écrit, le sieur de La Loubère recevrait fort bien sa réponse à bord des vaisseaux, cela fondé sur ce que la saison me presse pour me rendre à la côte de Coromandel et que le sieur de La Loubère sera obligé d'attendre en rade le père Tachard et les présents qu'il porte avec lui. Mais M. Constance a voulu insinuer par ce discours que nous lui représentions bien tard les intentions du roi, comme si jamais il n'en eût ouï rien dire auparavant.
Le 3, sur le soir, on nous est venu prier de la part de M. Constance d'aller voir les présents destinés pour le roi qui étaient étalés chez les pères jésuites. Ils ne nous ont pas paru être grand-chose, mais le sieur de La Loubère n'y a été qu'un moment à cause de son incommodité, et aussi pour se dispenser d'approuver et de désapprouver. Le sieur Constance me dit en me montrant quelques ouvrages d'or : — Esto no cobre dorado (5). Ils croient qu'on les veut tromper en dorant l'argent et le cuivre.
Le jeudi 4 [décembre 1687], le soir, M. de La Loubère a été rendre visite à M. de Métellopolis, lequel lui a nié qu'il eût jamais prié le sieur Constance de ne pas publier le traité de la religion et sur ce que le sieur Constance dit que mon dit seigneur évêque, lors de l'affaire des Macassars, le remercia de ne l'avoir pas fait. Mon dit seigneur a dit à M. de La Loubère qu'il ne se souvenait pas bien s'il en avait parlé au sieur Constance, mais qu'il était vrai qu'il avait dit à quelques-uns que c'était peut-être un bonheur que le traité de la religion n'eût pas été publié, parce qu'on aurait pu faire regarder les chrétiens, quoique sans raisons, comme l'occasion de la révolte. — Et qui est-ce, dit le sieur de la Loubère, qui l'aurait pu dire ainsi ? — Peut-être Monsieur Constance le premier, reprit Monseigneur l'évêque. C'est un homme incompréhensible, ajouta-t-il. Je pourrais faire un gros volume des bienfaits que la mission a reçus de lui, mais je ne sais comment il fait que tout cela s'oublie si aisément.
Il a appris alors au sieur de La Loubère que le sieur Constance nourrit les écoliers du collège de M. l'évêque, ce qui lui peut coûter par an sept à huit cents écus, et il lui confirma, ce que le sieur de La Loubère savait d'ailleurs, que le collège même est l'ouvrage du sieur Constance (6) et qu'il l'a fait bâtir depuis le départ du chevalier de Chaumont de Siam, que Mme Constance nourrit un assez grand nombre de petits garçons et de petites filles qu'elle marie quand elles sont grandes.
Le 6, M. Constance m'ayant promis de continuer à travailler avec moi au traité de commerce, m'avait donné rendez-vous le soir chez les pères jésuites afin d'y être plus en repos. Je m'y rendis. Après quelques conversations, je vis entrer Mgr de Métellopolis que M. Constance avait mandé, et ensuite vint le père Tachard et quelques-uns des révérends pères jésuites. M. Constance, au lieu de continuer à parler de commerce, changea de discours et me demanda si deux députés des chrétiens du Tonkin ne m'avaient pas présenté une requête, et à M. de La Loubère, pour demander des jésuites pour aller au Tonkin en qualité de missionnaires. Je lui répondis que je n'en avais point ouï parler. Il commença alors à expliquer l'intention des dits députés et à exagérer la cruauté qu'il y avait de laisser mourir une infinité de peuples chrétiens sans secours spirituels. Le père Tachard appuyait le discours de M. Constance qui était fort véhément, et ensuite le père, s'adressant à Mgr de Métellopolis, lui demanda un ordre pour l'envoi de sa part de quelques jésuites au royaume du Tonkin pour assister de secours spirituels les chrétiens qui demandaient avec insistance des jésuites. Mon dit Seigneur fut longtemps sans vouloir répondre rien de positif ; cependant il se détermina a dire qu'il ferait voir au père Tachard les ordres qu'il avait de la cour de Rome et qu'il s'en rapporterait à son jugement sur ce qu'il pouvait faire touchant sa demande.
M. Constance reprit la parole pour dire à Mgr de Métellopolis que la cour de Rome avait bien fait défense au général et aux supérieurs des maisons des jésuites d'envoyer de leurs religieux au Tonkin, mais que cette défense ne s'étendait point à empêcher Mgr de Métellopolis d'y envoyer des jésuites en qualité de missionnaires apostoliques, de la même manière qu'il y envoyait des prêtres séculiers de la mission, que les révérends pères s'offraient d'y aller sur ses ordres par la charité qu'ils avaient pour les chrétiens qui les demandaient avec un grand empressement, qu il ne voyait point qu'il y eût de raisons qui pût empêcher mon dit seigneur de le faire, puisque la raison qui avait obligé la cour de Rome à retirer les jésuites portugais du Tonkin ne subsistait plus dans les jésuites que l'on lui proposait, puisqu'ils avaient fait le serment que les jésuites et autres religieux portugais n'avaient point voulu faire, en ayant des défenses de l'archevêque de Goa sous peine d'excommunication (7).
Ce raisonnement, qui était le même dont M. de La Loubère et moi nous étions servis auprès de Mgr de Métellopolis pour obtenir la mission qu'il a accordée aux peres jésuites, était fort et Mgr l'évêque, se voyant pressé et n'y pouvant rien reprendre de positif ni de valable, fut quelque temps sans répliquer, pendant lequel temps M. Constance et les jésuites me pressèrent d’employer mes instances auprès de l'évêque pour obtenir ce qu'ils demandaient. Je m'y trouvai un peu embarrassé parce que je ne pouvais pas presser l'évêque d'accorder une grâce qu'il nous avait déjà accordée et dont il n'était plus question, mais qu'il désirait sur toutes choses qui fût secrète pour M. Constance et le père Tachard. De l'autre coté, ils croyaient que, n'entrant point dans leur sentiment et ne me joignant point à eux pour presser l'évêque, je ne voulais plus m'employer pour le rétablissement des jésuites au Tonkin que le roi désirait.
Je pris mon parti sur-le-champ qui fut de répondre à M. Constance et au pere Tachard que M. de La Loubère et moi avions fait plusieurs instances très fortes auprès de Mgr de Métellopolis pour obtenir ce qu'ils demandaient et que ce ne serait que recommencer à fatiguer mon dit seigneur l'évêque, n'ayant point d'autres chefs à lui représenter que ce que nous avions fait déjà plusieurs fois, que mon dit seigneur savait ce qu'il pouvait faire et que je ne doutais pas qu'il ne fît tout son possible pour donner satisfaction aux révérends pères, surtout lui en ayant fait instance de la part du roi. L'évêque prit la parole aussitôt et dit à M. Constance qu'il avait fait tout ce qu'il avait pu et qu'il ne ferait point autre chose sans s'expliquer davantage. M. Constance et les jésuites prirent cela pour un refus et M. Constance s'emporta beaucoup contre les gens qui empêchaient le rétablissement des jésuites au Tonkin (8), à quoi l'évêque ne répondit rien ; ensuite de quoi il se retira et je continuai de travailler avec M. Constance.
Le lendemain 7, étant allé à la messe chez les jésuites, M. Constance sut que j'y étais. Il me fit dire en sortant de la chapelle qu'il voudrait bien me parler. Je m'informai où il était et ayant appris qu'il était dans la même maison, j'allai au divan (9) où il était, à quelques pas de là. Je le trouvai fort échauffé sur ce qu'on avait rapporté quelques retardements et quelques difficultés pour voiturer à Louvo un mortier et quelques bombes qu'il avait demandés pour en faire voir l'expérience au roi. Il prit occasion de se plaindre que dans le mémoire que le père Tachard lui avait donné de notre part, où il était parlé de toutes les choses que le roi envoyait au roi de Siam, il y avait des bombes, des mortiers et des bombardiers, et que, cependant, on faisait difficulté de descendre les bombes et les mortiers à terre, et que l'officier commandant les bombardiers voulait retourner en France avec ses bombardiers, disant en avoir ordre du roi (10), que cela ne s'accordait pas, et me pria de lui dire comme cela se pouvait faire que le roi envoyât des choses à Siam pour le service du roi, et qu'il y eût des ordres de les rapporter en France. Il tenait à la main le mémoire que nous avions donné au père Tachard, où, effectivement, il était parlé des bombes, mortiers et bombardiers, et voulait se servir de ce mémoire qui jusqu'alors n'avait point paru et que le père nous avait dit que M. Constance n'avait point voulu recevoir.
Cela me surprit que le père ne nous eût pas dit la vérité, et que n'ayant point donné ce mémoire dans le commencement, il l'eût donné depuis à M. Constance pour s'en servir dans cette occasion pour sonder une demande qui était contre le service du roi. Cependant, je me déterminai à dire à M. Constance ce que nous étions demeurés d'accord, M. La Loubère et moi, de cet article, et je convins avec mon dit sieur Constance que les troupes du roi, les mortiers, les bombes et les bombardiers et tout ce qui était convenu dans ce mémoire avaient été envoyés par le roi pour servir le roi de Siam contre ses ennemis, mais qu'il fallait distinguer les choses que le roi n'avait envoyées que pour un temps, avec ordre de retourner en France ; que les vaisseaux de Sa Majesté, les bombes, les mortiers et les bombardiers étaient de cette dernière espèce, que les bombardiers étaient et faisaient partie des équipages, comme les bombes et les mortiers faisaient partie des armes et ustensiles des vaisseaux, et qu'il n'y avait pas plus d'apparence de vouloir faire rester à Siam lesdits bombardiers, bombes et mortiers, que de vouloir retenir les vaisseaux de Sa Majesté dont le commandant avait ordre de servir le roi de Siam contre ses ennemis, et qu'enfin l'intention du roi était que M. Desfarges et les troupes demeurassent dans le royaume de Siam et que les vaisseaux, avec les bombes, mortiers et bombardiers retournassent en France dans la saison.
Après lui avoir donné cette explication sur ce qu'il me demandât, il s'adressa aux officiers qui étaient présents avec M. Desfarges et le commissaire La Salle, et leur demanda s'ils n'avaient pas ordre du roi de suivre les ordres du roi de Siam. Comme cette demande s'adressait à tous en général et aucun en particulier, si ce n'est au sieur de La Salle, à qui il semblait parler comme étant le plus près de lui, aucun ne répondait rien ; alors il se fâcha de ce qu'on ne lui répondît point et apostropha le sieur de La Salle, lui disant : — Et vous, Monsieur, n'avez-vous pas ordre d'obéir au roi ? Le sieur de La Salle hésita à lui répondre ce qui augmenta sa colère et le sieur de La Salle lui dit que si le roi de Siam lui ordonnait quelque chose pour son service qu'il l'exécuterait.
Je pris la parole parce que cela s'allait échauffer et dis à M. Constance que M. Desfarges avait ordre de servir le roi de Siam et qu'il suivrait ses ordres, que l'usage, en France, était que les officiers subalternes ne recevaient les ordres pour le service que de leurs chefs et commandants, et que quand le roi envoyait quelques ordres dans une place de guerre ou dans une armée, les ordres étaient adressés au commandant qui les faisait exécuter par les officiers qui lui étaient subordonnés et qu'ainsi, quand le roi voudrait envoyer quelque ordre il devrait s'adresser a M. Desfarges qui le ferait exécuter. Il me demanda alors si les ministres du roi en France ne donnaient pas des ordres en leur nom pour le service du roi à tous les officiers de Sa Majesté indistinctement. Je lui répondis que les ministres en France, quoique leur autorité s'étendent sur tous les officiers du roi qui servaient sous leurs ordres, que néanmoins ils n'en donnaient jamais aucun en leur nom, mais qu'ils expédiaient tous les ordres qu'ils envoyaient au nom du roi, et ne les adressaient jamais qu'aux commandants des lieux pour lesquels lesdits ordres étaient destinés.
Je lui fis cette réponse pour lui ôter l'envie qu’il a très grande de commander directement à tous les officiers des troupes sans la participation du commandant, ce qui est contre le service du roi et ses intentions. Il répliqua, assez échauffé, qu’il ne voulait point de Français à Siam qui ne lui obéissent. Il dit cela en se retournant vers les officiers et dans le temps que le père Tachard me parlait, en sorte que je ne fis pas semblant de l'avoir entendu parce que j'aurais été obligé de lui répliquer avec fermeté et cela n'aurait pas accommodé les affaires. Je me retirai quelques pas avec le père Tachard pour lui parler et pour lui faire connaître que M. Constance n'avait pas raison et pris occasion ensuite de me retirer sans voir M. Constance auquel je parlai dès le soir même, en particulier, de la conversation du matin et lui fis comprendre de sang-froid qu'il avait une prétention qui n'avait point de fondement. Il me parut plus tranquille pour l'obéissance des officiers, mais il s'opiniâtra sur les bombes et les mortiers, disant qu'il avait promis au roi son maître de lui en faire voir l'effet et qu'ensuite on les renverrait a bord. Je ne lui répondis rien sur cela parce que je savais bien que M. Desfarges les avait envoyés chercher contre mon sentiment et que ce que je dirais ne servirait de rien qu'à aigrir les esprits inutilement.
Le même jour, je pris occasion d'une conférence avec M. Constance pour lui demander notre audience de congé. Il me dit qu'il en parlerait au roi.
Le lendemain, il me dit que le roi nous donnerait audience de congé le 10.
Le 9, il courut un bruit que le roi était malade et, le même jour, M. Constance me dit que le roi avait promis notre audience de congé pour le 10, mais que son indisposition ne lui permettait pas de nous la donner, et qu'ainsi il fallait attendre que Sa Majesté se portât mieux pour avoir audience, que cependant nous pouvions finir toutes nos affaires, parce que l'usage à Siam est qu'immédiatement après l'audience, on va s'embarquer. Je rendis compte à M. de La Loubère de cette conversation, qui m'apprit que c'était une défaite de M. Constance pour nous retenir à Siam le plus qu'il pouvait parce que les affaires n'étaient pas prêtes pour l'envoi du père Tachard, et qu'il était assuré que la maladie du roi était une maladie feinte, que la preuve qu'il en avait était que le jour qu'il promit l'audience, le sieur de La Lève (11) lui ayant dit qu'il devait partir avec moi pour s'en retourner à bord, M. Constance lui répondit que cela ne pressât point, à quoi La Lève lui ayant répliqué que nous nous attendions à avoir audience le 10 et à partir le même jour, M. Constance lui dit : — Oui, le roi sera malade et il faudra bien qu'ils prennent patience. M. de La Loubère m'expliqua que le sieur de La Lève lui avait rendu compte de cette conversation.
J'étais cependant fort en peine, parce que la saison s'avançait pour me rendre à la côte de Coromandel, et que si je ne partais dans peu de jours, je courais risque de rester une année aux Indes et de faire manquer la saison au navire le Président qui m'attendait à Mergui. Cette raison m'obligea de convenir avec M. de La Loubère que je demanderais au roi de Siam, par la voie de M. Constance, la permission de m'en aller à Mergui, ne pouvant différer mon départ, et que M. de La Loubère attendrait la commodité du roi pour avoir son audience de congé et ensuite s'en aller à bord des vaisseaux, en rade, attendre le temps du départ. Ainsi, M. de La Loubère ayant consenti, je fis la proposition à M. Constance qui l'agréa et me dit qu'il était à propos que j'écrivisse une lettre au roi de Siam et qu'il lui rendrait. J'en parlai à M. de La Loubère, et lui ayant communiqué ma lettre, je la donnai à M. Constance qui la lut au roi. Il me dit le soir que le roi consentait à mon départ, mais que Sa Majesté avait bien du déplaisir que je m'en allasse sans la voir encore une fois. Je lui témoignai que si la saison ne m'obligeait pas à partir, je demeurerais à Siam jusqu'à ce que le roi fût en état de nous donner audience, ensuite je me disposai à partir incessamment.
Le 11 au soir, M. de La Loubère et moi signâmes le traité pour l'établissement et les privilèges accordés à la Compagnie par le roi de Siam, avec le barcalon et les autres commissaires que le roi de Siam avait nommés à cet effet et non avec M. Constance, quoiqu'en sa présence, parce que tous les traités faits en siamois, passés par le barcalon et par le Conseil en cette forme, sont perpétuels et il est sans exemple qu'on y ait donné aucune atteinte, ce qui n'est pas de même des autres traités. Je n'ai point fait mention dans le présent journal de tout ce qui s'est passé dans la négociation de ce traité, non plus que de celui par lequel M. Constance prend intérêt dans la Compagnie, parce que le récit en eût été trop long et inutile, et je me suis réservé à en faire ici un article le plus court que je pourrai.
Dès le commencement que je fus arrivé à la rade de Siam, le père Tachard me demanda si la Compagnie agréerait que M. Constance s'intéressât dans son commerce. Je lui dis que oui, et alors il me dit que mon dit sieur Constance était en résolution de prendre intérêt dans le commerce de la Compagnie de la somme de cent mille écus. Je lui répondis qu'après que les affaires seraient réglées pour l'établissement des troupes du roi à Bangkok et à Mergui, nous parlerions de cette affaire. Quelque temps après, le père Tachard, voyant que je ne lui parlais plus de cette proposition qu'il m'avait faite, me demanda si lorsque nous serions à Siam, M. de La Loubère et moi, nous n'entrerions point en négociation avec M. Constance sur le traité de commerce. Je lui dis que nous n'entrerions point du tout en conférence sur cela que les affaires du roi ne fussent auparavant réglées. Nous étions convenus de cela M. de La Loubère et moi, afin d'engager M. Constance par le désir qu'il avait de voir établir la Compagnie à Siam et d'y prendre intérêt, et raccommoder les affaires qui n'avaient pas été faites à notre satisfaction. Le père m'informa après que le véritable moyen d'engager M. Constance à faire un traité avantageux pour la Compagnie était de convenir auparavant avec lui de l'intérêt qu'il prendrait avec la Compagnie. Je ne m'engageai point davantage pour lors, et il ne se parla plus de cette affaire jusqu'à ce que nous fussions à Louvo. M. de La Loubère et moi convînmes qu'il suffisait que je négociasse les conditions du traité de commerce, et parce qu'il s'était aperçu que M. Constance me ménagerait personnellement, peut-être dans l'espérance des avantages qu'il pourrait tirer de l'intérêt qu'il prendrait avec la Compagnie. Ainsi, lorsque le père Tachard recommença à me parler de cette négociation, je lui dis que quand M. Constance voudrait, nous y travaillerions. Dès le même jour, le père Tachard me proposa une conférence avec M. Constance. Ainsi, nous nous trouvâmes le soir dans la chapelle qu'il avait choisie exprès pour n'être point interrompus. Le père Tachard était en tiers dans la conférence. M. Constance commença son discours sur le désir qu'il avait que la Compagnie fût incessamment établie aux Indes, et principalement dans le royaume de Siam, ce que le roi son maître souhaitait avec empressement, qu'il y avait moyen d'y faire un commerce très avantageux pour la Compagnie par le moyen des correspondances qu'il avait en la Chine et qui pouvaient encore s'étendre davantage par la suite dans d'autres lieux ; que ce commerce, outre son utilité pour la Compagnie, était encore un moyen très propre de donner atteinte à la puissance de la Compagnie de Hollande qui faisait une bonne partie de celle de la République. Il entra même dans quelques détails de son projet et ensuite me dit qu'il avait envoyé en France, par le vaisseau le Coche, une partie considérable de marchandises de Chine à l'adresse de la Compagnie, et qu'il l'avait priée d'en faire la vente et d'en garder le provenu pour lui servir de fonds, si elle voulait lui donner intérêt, ou autrement se servir de ce fonds dans son commerce et lui en payer l'intérêt qu'elle jugerait convenable (12).
Le père Tachard prit la parole et dit qu'il m'avait proposé l'intention de Son Excellence pour la part qu'il désirait prendre dans la Compagnie. Je convins de ce que disait le père et donnai parole à M. Constance que la Compagnie accepterait sa proposition. Il me proposa d'en faire un traité particulier entre lui et moi faisant pour la Compagnie, mais qu'il me priait de lui donner un mémoire qui lui fît reconnaître quel était l'établissement de la Compagnie et comment il s'était fait, comme aussi le projet de son commerce. Je lui promis de lui donner ce qu'il me demandait, n'y ayant point trouvé de difficulté, mais il n'en était pas de même de la manière que se ferait ce traité, principalement pour régler et convenir du temps qu'il commencerait à avoir intérêt. Ainsi, sans entrer plus avant, je me déterminai à gagner du temps pour consulter M. de La Loubère et me contentai pour lors de lui faire connaître que je ne doutais point que s'il voulait employer son crédit à Siam pour la Compagnie, et son savoir-faire pour l'avantage de son commerce, il ne devînt avantageux, mais je ne voyais pas trop où pourrait être cet avantage et entrai en discussion du détail du commerce qui se pouvait faire, par lequel je lui fis comprendre que je connaissais qu'il n'y avait pas des avantages si considérables, et pris de là occasion de lui faire connaître que ce n'était point l'espérance du profit qui engageait la Compagnie de faire des établissements à Siam, mais que le roi ayant jugé que le commerce de la Compagnie pouvait être un instrument utile pour l'avancement de la religion, qui était l'unique vue de Sa Majesté, elle avait ordonné à la Compagnie de faire un établissement dans ce royaume, et que la Compagnie avait obéi avec plaisir, mais que le roi avait trop de bonté pour ses sujets, et surtout pour la Compagnie que Sa Majesté honore de sa protection, pour vouloir l'obliger de faire des établissements qui lui fussent à charge, ainsi que je ne pouvais me dispenser de lui faire connaître ; que si la Compagnie n'était pas bien traitée par des avantages particuliers à Siam, elle n'y ferait point d'établissements considérables, qui deviendraient pareillement inutiles si le roi n'approuvait pas la maniére dont ses troupes avaient été reçues et établies dans Bangkok. Le père Tachard prenait quelquefois la parole et me parut faire de son mieux pour persuader M. Constance. Nous n'avançâmes point davantage pour cette fois ; ainsi je me retirai après avoir donné parole à M. Constance de lui envoyer le mémoire qu'il me demandait, ce que je fis le lendemain après l'avoir communiqué à M. de La Loubère.
La première conférence que j'eus ensuite avec M. Constance, nous convînmes qu'il prendrait pour 300 000 livres d'intérêt dans la Compagnie, à commencer les risques, pertes et profits dans le commerce qu'elle ferait au 1er de janvier de l'année 1688. Nous convînmes ensuite qu'il vendrait à la Compagnie la moitié des marchandises qu'il avait préparées pour envoyer par les vaisseaux du roi en France pour faire son fonds, et nous demeurâmes d'accord du prix desdites marchandises suivant le mémoire que m'avait donné le sieur Véret. J'ai cru qu'il était du service du roi et de l'avantage de la Compagnie de faciliter à M. Constance les moyens de fournir son fonds afin de l'engager par cet intérêt à contribuer de tout son pouvoir à faire un traité de commerce avantageux, et aussi pour servir en quelque manière de sûreté de l'exécution du dit traité. Je donnai ensuite à M. Constance le mémoire sur le traité de commerce après en être convenu avec M. de La Loubère.
Mais dans la première conférence que j'eus avec lui, après lui avoir présenté, il me parut difficile sur cette liberté de commerce absolue et sur l'exécution de la préférence. Je lui fis comprendre que la liberté était l'unique fondement du commerce, sans quoi il ne pouvait subsister, et que la préférence qui était stipulée dans le traité avec M. de Chaumont fournirait mille prétextes aux vexations que pourraient faire les officiers des magasins du roi par la suite (13), qu'il devait considérer que ce traité devait être pour un long temps, et qu'il ne serait pas toujours, et qu'ainsi il fallait ôter tout prétexte de fatiguer la Compagnie. Il se rendit un peu à ce raisonnement et ne contesta plus que sur le style du mémoire qu'il trouva un peu dur pour être présenté au roi de Siam. Je lui dis que pour ce style et la manière, il était aisé de les changer, mais que nous n'accepterions point de traité de commerce que la liberté n'y fût accordée à la Compagnie. Il me dit qu'il ne pouvait rien changer au mémoire que de notre consentement qu'il me demanda par écrit, et qu'il me donnerait un mémoire des articles que contiendrait le traité. J'y consentis et, après qu'il m'eut donné ce mémoire, signé de lui, M. de La Loubère et moi lui donnâmes notre consentement, en vertu duquel il dressa un autre mémoire dans le style qu'il trouva convenable pour être présenté au roi son maître pour se faire donner le pouvoir de traiter. Ce mémoire nous parut peu convenable en notre manière, mais je crus cela indifférent pourvu que le traité fût fait avec les avantages et privilèges que nous demandions.
Il est à observer que quand on a fait un traité à Siam, il est difficile de revenir à le changer, et c'est ce qui embarrassait M. Constance, à cause du traité fait avec le chevalier de Chaumont, car, par notre mémoire, il avait paru au roi de Siam que le roi n'était pas content de ce traité, et cela aurait fait une affaire à M. Constance auprès du roi son maître. Ainsi, il présenta ce mémoire dont il est parlé, et ayant obtenu le pouvoir de traiter, nous dressâmes les articles de la manière dont ils sont rédigés, où la Compagnie a tout ce qu'elle a demandé. Il est vrai que nous n'avons pu nous dispenser de stipuler en détail les marchandises de contrebande à cause des privilèges des autres nations auxquels ils ne veulent point donner d'atteinte, non plus qu'aux marchandises que le roi s'est de tout temps réservé, comme pourrait être le sel en France. Quant au traité du poivre, M. Constance me dit qu'il n'y en avait point eu de fait avec le chevalier de Chaumont et qu'il avait seulement ratifié celui fait avec le sieur Deslandes (14), que ce traité était bon ; et comme je lui expliquais les inconvénients qu'il y avait, il me dit que cela ne venait que de la mauvaise translation, et qu'il traduirait le traité, qu'au surplus on n'y pouvait rien changer, ayant passé au Conseil. Il me donna la traduction qu'il avait faite, que je trouvai meilleure que la première, et lui demandai quelques articles à ajouter dans le traité de commerce, que nous crûmes, M. de La Loubère et moi, pouvoir contribuer à la sûreté de la jouissance de ce privilège, et M. Constance en convint.
Il est à remarquer que par le traité de commerce, le roi accorde à la Compagnie en toute propriété une île près de Mergui pour y faire un établissement (15). Je n'ai pas jugé à propos de refuser cet article parce que M. Constance ne prétendant pas que Mergui soit en propriété au roi, mais seulement que le roi de Siam en confie la garde à ses troupes, je ne voulais pas lui donner une autre idée qui pût lui donner du soupçon à empêcher l'exécution de la parole qu'il nous avait donnée de faire passer incessamment M. Du Bruant avec des troupes au dit Mergui pour en prendre possession.
Le 12 au soir, M. Constance me dit que le roi consentait que je m'en allasse, mais qu'il désirait auparavant me donner une audience particulière, et me pressa de l'accepter. J'y consentis après en avoir communiqué avec M. de La Loubère.
Le même jour, au soir, M. de La Loubère me fit voir un mémoire que lui avait envoyé M. Constance. Je le trouvai plein d'aigreurs et d'invectives pour ne pas dire d'injures. Je fus de sentiment de n'y point répondre qu'en marquant à M. Constance que notre départ ne permettait pas de le faire. Il aurait été inutile de répondre autrement, car il avait résolu de garder avec nous la même conduite qu'il avait commencée, et de se remettre de tout au père Tachard qui partait pour France avec des pouvoirs (16). Ainsi nous en demeurâmes dans ces termes et nous convînmes, M. de La Loubère et moi, qu'il prendrait prétexte de mon départ pour ne rien signer, au moins qu'il ne fût avantageux, et qu'il attendrait la commodité du roi pour l'audience publique et pour son départ.
Le dit jour, nous fîmes un acte à M. Desfarges en forme de sommation pour l'obliger de renvoyer les bombardiers avec les bombes, mortiers et ustensiles en France.
Il est nécessaire, avant de parler de mon départ, d'expliquer la convention faite pour le profit et le paiement des commissions que la Compagnie avait faites pour le roi de Siam (17). Je parlai de cette affaire à M. Constance en lui représentant les risques et l'avance de l'argent avec les frais. Il me dit que l'ambassadeur avait rapporté que la Compagnie avait refusé de lui fournir de l'argent pour faire ces commissions, et qu'elle s'était chargée de les faire et qu'il était convenu avec la Compagnie que le roi payerait le prix coûtant desdites marchandises avec vingt-cinq pour cent de profit ; qu'à la vérité, après cette convention, la Compagnie avait désavoué les directeurs qui avaient traité avec lui, qu'elle avait député d'autres directeurs, par ordre de Mgr le marquis de Seignelay pour convenir du paiement et du profit, et qu'il était aussi convenu avec ces derniers de vingt-cinq pour cent de profit, moyennant quoi la Compagnie courrait tous les risques. Je lui répondis sur le premier article du refus de l'argent qu'il était impossible que cela fût, puisque la Compagnie l'avait effectivement fourni et qu'elle ne s'était chargée de faire ces commissions que pour soulager les ambassadeurs qui n'en seraient jamais venus à bout, et qu'elle n'avait fait cette entreprise que pour faire une chose agréable au roi de Siam et faire en sorte que Sa Majesté fût satisfaite de ses commissions qui ont été exécutées sur l'agrément et l'approbation des ambassadeurs dont les ouvriers ont exécuté les ordres avec une exactitude extraordinaire, sans obéir aux ordres de Mgr le marquis de Seignelay, et que M. Constance même était convenu avec moi qu'on avait bien réussi pour la première fois, qu'à la vérité il y avait eu plusieurs choses de gâtées, mais qu'il n'en fallait attribuer la cause qu'aux accidents de la mer pendant un si long voyage, qu'il n'était pas véritable que l'ambassadeur fût convenu avec la Compagnie du profit en question, et que la Compagnie m'avait chargé de cette négociation quand je serais à la cour de Siam. Ensuite M. Constance me dit que le roi traiterait bien la Compagnie sur ce profit et me conseilla de ne point fixer au roi le profit et qu'elle s'en trouverait bien. Je lui dis que je le ferais ainsi volontiers, mais que je le priais de considérer les risques et les déchets considérables qu'il y avait. Il me promit qu'il le ferait. Il se passa quelque temps sans qu'il s'en parlât, ce qui m obligea de lui demander s'il en avait parlé au roi son maître. Il me dit qu'il l'avait fait et que le roi avait envoyé chercher l'ambassadeur et lui avait fait demander pourquoi il n'était pas convenu avec la Compagnie, qu'il avait répondu qu'il était convenu avec elle à vingt-cinq pour cent, comme il l'avait rapporté dans sa relation, et que le roi avait répliqué que cela étant, il fallait s'en tenir là. Je répliquai à M. Constance que l'ambassadeur n'était convenu de rien. Il envoya chercher l'ambassadeur qui apporta sa relation et me soutint qu'il en était convenu avec MM. les Directeurs, envoyés de la part de la Compagnie par ordre de Mgr le marquis de Seignelay, et lut l'endroit de son journal qui particularisait toutes choses. Je dis à M. Constance que j'étais en état de justifier le contraire par un écrit que la Compagnie m'avait donné contenant ce qui s'était passé dans cette conférence à Paris entre les ambassadeurs et les députés de la Compagnie et lus cette conférence à M. Constance qui me dit qu'il le voyait bien, mais que le roi avait réglé ce profit à vingt-cinq pour cent. Je parus fort mécontent de cela, non pas tant à cause du tort que la Compagnie souffrait, comme parce qu'il était réglé sur un exposé contre la vérité et qu'il semblait que le roi doutât de ce que je disais de la part de la Compagnie.
M. Constance me dit qu'il avait fait retrancher plusieurs choses du journal de l'ambassadeur concernant cette affaire qui aurait pu donner quelques idées désavantageuses à la Compagnie, comme par exemple qu'on avait refusé la porte de leur logis aux marchands et ouvriers qu'ils avaient envoyé chercher afin de leur ôter la connaissance du prix courant des marchandises et ouvrages, à quoi je lui ai répondu que la Compagnie lui était obligée, mais qu'il n'était pas vrai qu'elle eût jamais donné cet ordre, quelle n'avait aucun pouvoir pour cela quand elle l'aurait voulu faire – les ambassadeurs étant servis et gardés par les officiers du roi – que le bon et extraordinaire traitement qu'ils avaient reçus de Sa Majesté, dont il n'y avait point d'exemple en France, ne permettait pas qu'on pût avoir aucun fondement pour une telle pensée et que j'étais fort surpris que cela fût entré dans leur imagination, que j'avais même une preuve certaine, puisque toutes les fois que j'avais été chez eux, j'y avais toujours trouvé des ouvriers et des marchands, et que même tous ceux qui avaient travaillé ou fourni les commissions du roi avaient été souvent à leur hôtel pour savoir leurs volontés et leurs intentions, la Compagnie n'ayant en vue que de faire en cela une chose agréable au roi de Siam et de contenter les ambassadeurs, que je trouvais qu'elle était mal reconnue dans ses bonnes intentions.
M. Constance me parut persuadé de ce que je disais ; cependant le profit demeura sur le même pied et [il] fit apporter l'argent chez lui en ma présence pour le paiement, mais je jugeai plus convenable de l'employer en marchandises pour [la] France et pour la côte de Coromandel, dont je convins de prix avec M. Constance. Il n'en put faire le compte parce qu'il y avait des glaces cassées et des marchandises gâtées dont on ne peut pas faire le détail en deux mois, et que j'ai laissé à faire au sieur Véret, et que je doute qu'il puisse envoyer à la Compagnie cette année. Une bonne partie des marchandises ont passé à la côte sur le Président sur lesquelles il y a vingt-cinq pour cent de profit.
Le 13 décembre, j'allai à l'audience, conduit par le premier ambassadeur qui était en France et plusieurs autres mandarins qui me conduisirent aux mêmes lieux et avec les mêmes cérémonies qui avaient été observées à l'audience particulière que nous eûmes M. de La Loubère et moi. Le roi me témoigna le déplaisir qu'il avait de ce que la saison me pressait de partir si tôt de sa cour et ensuite me demanda si j'étais satisfait de ce qu'il avait fait pour l'établissement de la Compagnie dans son royaume, dont l'ayant remercié et témoigné que je ne manquerais point de rendre compte au roi mon maître des bonnes intentions de Sa Majesté pour la Compagnie, il me demanda si le sieur Deslandes-Boureau restait dans son royaume. Je lui répondis que la Compagnie l'avait destiné pour aller à Bengale. Il me parut que Sa Majesté avait de l'estime pour ledit sieur Deslandes et qu'elle eût bien désiré qu'il fût resté à Siam à la place du sieur Véret. Après quoi, il voulut voir mon fils qui se leva pour saluer Sa Majesté qui témoigna du plaisir de ce qu'il était élevé par les révérends pères jésuites (18) et lui fit présent d'une chaîne d'or. Sa Majesté me pria d'assurer le roi de son amitié, qu'il désirait passionnément être éternelle. Le roi se retira ensuite assez vite et M. Constance me dit que l'indisposition du roi l'avait obligé de se retirer ainsi, sans quoi il aurait été bien aise de me donner une plus longue audience.
Après l'audience, j'allai dîner chez M. Constance où nous signâmes le traité particulier de l'intérêt qu'il prend dans la Compagnie. Il me promit qu'il enverrait par les vaisseaux du roi un mémoire fort étendu, contenant le projet du commerce qu'il conviendrait [de] faire à Siam, lequel il n'avait pas eu le loisir de faire jusqu'alors, quoiqu'il eût promis de me le donner avant mon départ.
Ledit jour, sur les trois heures après midi, après avoir pris congé de M. de La Loubère dont je me séparai avec regret, je partis de chez moi où tous les officiers français, tant de la marine que de terre, qui étaient à Louvo, m'attendaient pour m'accompagner. M'étant mis en marche pour aller m'embarquer, M. Constance me joignit lorsque je passai devant son palais et me conduisit jusqu'aux balons qu'on avait préparés, accompagné de M. Desfarges et de tous les révérends pères jésuites, desquels je pris congé en m'embarquant. M. Constance et toute la compagnie ne voulut point se retirer que le balon où j'étais ne fût fort éloigné d'eux. J'arrivai sur les onze heures du soir à Siam où je demeurai tout le lendemain pour achever toutes les expéditions et mémoires que je devais laisser au sieur Véret et autres officiers de la Compagnie. Je pris congé à Siam de Mgrs de Métellopolis et de Rosalie (19) qui me vinrent rendre visite accompagnés de tous leurs missionnaires dans le moment que je m'étais mis en chemin pour aller prendre congé d'eux. Je signai le règlement de la paie des soldats à quatre sols par jour pour leur nourriture et, quoique cette paie paraisse forte, je n'ai pu, néanmoins, me dispenser d'y consentir à cause de la cherté des viandes et si, nonobstant cela, les soldats auront très grand peine à subsister (20). Le roi de Siam donne aux Portugais qui sont dans Bangkok dix sols par jour. Par la suite on pourra prendre des mesures pour faire subsister les troupes à meilleur marché. Mgr le marquis de Seignelay pourra connaître par l'état qui a été fait que l'on ne pouvait pas moins donner aux soldats.

NOTES
1 - Le père Tachard relate ce spectacle qui faisait suite à la capture d'un éléphant sauvage : Ce spectacle fut suivi d'un autre bientôt après, où l'on fit combattre deux éléphants de guerre en présence du roi de Siam et de MM. les envoyés. Ces deux animaux excités par les cris de deux femelles et par les paroles de leurs pasteurs, qui les animaient au combat, s'élançaient l'un contre l'autre avec tant de fureur et de force qu'ils se fussent bientôt tués l'un l'autre si on ne les eût retenus. On leur avait attaché aux pieds de derrière un gros câble, que plusieurs Siamois tenaient par le bout, ne leur en laissant filer qu'autant qu'il en fallait pour les laisser approcher à la portée de leurs grosses dents, lesquelles furent bientôt en pièces par les coups qu'ils se donnaient, entrelaçant ces dents les unes avec les autres. (Second voyage du père Tachard […], 1689, pp. 229-230). ⇑
2 - Cette cérémonie, qui suivit le combat d'éléphant, est également relatée par le père Tachard : Ce fut dans cette occasion que le roi de Siam vit MM. de Saint-Clair et de Joyeux, capitaines de frégates légères, et MM. de la Lève et Dandennes, dont le premier était lieutenant de vaisseau, et l'autre capitaine de brûlot. Il fit donner à chacun d'eux une veste de brocart garnie de boutons d'or, et fit encore un présent particulier à MM. de Joyeux et Dandennes, comme capitaines des vaisseaux qui avaient amené les troupes à Siam. M. Dandennes eut un sabre et une chaîne d'or qui servait de baudrier, toute pareille à celle que l'on avait donnée à M. de Joyeux le voyage passé, et celui-ci eut des curiosités de la Chine et du Japon par ordre du roi qui leur volait témoigner par-là sa reconnaissance. (Op. cit., p. 230). ⇑
3 - Deux mois plus tard, au début février 1688, l'Oriflamme quittait la rade de Brest avec 200 hommes de troupe en renfort pour le Siam. ⇑
4 - Ce traité, plutôt favorable aux missionnaires dans sa première mouture, fut considérablement affaibli par des clauses ajoutées par Phaulkon à la dernière minute, alors qu'il n'était plus temps de négocier. C'est ce qu'expliquent des réflexions sur le traité, sans nom d'auteur, reproduites dans l'Histoire de la Mission de Siam d'Adrien Launay, pp. 170-171 : Les conditions choquantes auxquelles les privilèges ont été accordés, dans le traité fait à Louvo le 2 décembre 1685, ont été ajoutées par M. Constance. Il n'y a qu'à voir le mémorial que présenta M. de Chaumont. Si ce traité avait été fait par quelqu'autre du royaume que par M. Constance, les conditions, selon toutes les apparences du monde, n'y auraient pas été insérées. (…) Si M. Constance eût donné ce traité de bonne heure, M. de Chaumont eût eu le temps de discuter ces sortes de conditions, mais on lui donnait ce traité lorsqu'il partait, et la crainte sans doute que son ambassade n'aboutît pas le lui fit recevoir tel qu'il était ; encore le lui donna-t-on si mal écrit, avec tant de ratures, qu'à peine eut-on le temps d'en faire une copie nette. ⇑
5 - Isto não é cobre dourado : Ce n'est pas du cuivre doré. ⇑
6 - Par une requête adressée au roi Naraï le 29 mai 1665, Pierre Lambert de La Motte avait demandé la permission de bâtir un collège afin d'enseigner les sciences qui sont nécessaires à un État pour le rendre recommandable par toutes les nations de la terre (Launay, Histoire de la Mission de Siam, 1920, I, p. 16). Naraï accorda la demande et offrit un terrain situé dans un secteur d'Ayutthaya nommé Banplahet (บ้านปลาเห็ด). Outre le collège, les missionnaires y firent construire une église, un évêché et un presbitaire, et l'ensemble fut appelé Camp Saint-Joseph. En 1680, le collège devenu trop petit fut transféré à Maha Pram (มหาพราหมณ์), à environ 7 kilomètres au nord d'Ayutthaya. Une note du Journal de la mission de 1686 indique que l'établissement se portait fort bien (Launay, op. cit. p. 101) : Il y a dans le collège de Mahapram 58 écoliers en 6 classe : la première comprend ceux qui apprennent à lire ; la seconde ceux qui apprennent les rudiments ; la troisième ceux qui commencent à composer ; la quatrième est celle des humanistes rhétoriciens ; la cinquième celle des philosophes ; et la sixième celle des théologiens. M. Chevalier a soin des trois premières ; M. de Mondory est chargé de la quatrième et de la cinquième, et M. Joret de la sixième. Parmi les écoliers, il y a 1 diacre, 1 acolyte, 2 lecteurs, 5 portiers et 1 clerc. Le collège déménagea une fois encore dans le courant 1686 et fut transféré à Ayutthaya même, à la demande de Phaulkon, comme l'indique une lettre de Louis Laneau aux directeurs du séminaires des Missions Étrangères de juillet 1686 (Launay, op. cit. p. 124) : M. Constance est toujours fort affectionné à la mission ; il a fait transporter dans la ville de Siam le collège de Maha Pram, et fait bâtir à ses propres dépenses et frais la maison et l'église. Dans la relation de son second voyage, le père Tachard cite un extrait d'une lettre du jésuite Jean de Fontaney au père Verjus (Second voyage des pères jésuites […], 1689, p. 261) : M. Constance a fait cette année des biens extraordinaires à l'Église en ce Royaume. Il a obtenu du Roi un grand emplacement à Siam, où il a bâti un Collège à messieurs du séminaire, pour y élever les enfants des nations étrangères, auquel il a donné son nom, l'appellant le Collège Constantinien. Cinq cents ouvriers travaillent actuellement à cet ouvrage. C'est lui qui nourrit universellement tous les écoliers du séminaire, auxquels il donne quinze cents écus tous les ans : il y a mis un pourvoyeur de sa main, qui fait la dépense de toute la maison. ⇑
7 - L'arrivée des vicaires apostoliques investis de l'autorité conférée par le pape fut très mal vécue par les jésuites, qui officiaient au Tonkin sur les traces d'Alexandre de Rhodes depuis 1624. Ce royaume fut sans doute un des pays où l'affrontement entre jésuites et missionnaires de la Propaganda fide fut le plus violent. On peut s'en faire une idée en lisant la lettre adressée aux cardinaux de la Propagande le 14 septembre 1674 par les directeurs du séminaire des Missions Étrangères de Paris, relayant les plaintes des prêtres sur le terrain : Nous nous sommes tus tant que nous avons cru qu'il nous était permis de le faire. Mais il ne nous est plus possible de dissimuler les pernicieux effets d'un aussi grand schisme que celui que les jésuites ont introduit dans ces Églises. Les pères Fuciti et Marini, en particulier, ont conçu une si grande haine contre les vicaires apostoliques et contre leurs missionnaires, qu'ils paraissent résolus d'en venir aux dernières extrémités pour détruire absolument cette mission. Une pareille disposition, qui manifeste un esprit de domination si excessif, est absolument indigne d'hommes apostoliques, dont l'humilité doit faire le principal caractère, et le père Marini étant aujourd'hui à la tête des missionnaires jésuites de la Chine, n'est-il pas à craindre qu'il infecte tous ses confrères de ce venin ? (Œuvres de Messire Antoine Arnaud, tome XXXII, 1780, p. LXXVI).
La situation s'envenima au point de déchirer la communauté chrétienne, ce qui obligea Rome à prendre des mesures radicales : En décembre 1677, la Congrégation particulière de la Propagande sur la Chine publia un décret visant à expulser du Tonkin les jésuites rebelles : leurs éminences ont ordonné, sous le bon plaisir de Sa Sainteté, qu'il fallait déclarer au général des jésuites que Sa Sainteté avait ordonné et ordonnait par ce présent décret, que l'on fît venir incessamment à Rome les pères Joseph Lessanier [Tissanier], Emmnuel Ferreira, Dominique Fuciti et Philippe Marini, et que du jour que le présent ordre leur sera signifié, ils ne soient pas assez téméraires pour faire la moindre fonction de missionnaire en vertu des facultés accordées, ou par lui, ou par quelqu'autre que ce soit. Ainsi, ils ne pourront ni entendre les confessions, ni prêcher, ni administre aucun sacrement, même en qualité de député des évêques ou des ordinaires des Indes, ni comme simples prêtres ou religieux de la Société, ni sous quelque autre titre ou couleur que ce soit De plus, la congrégation imposait une formule de serment que tous les jésuites qui se trouveront dans les provinces et dans les royaumes dépendant des vicaires apostoliques seront obligés de prêter et de signer, de quelque qualité et de quelque rang qu'ils soient. (Anecdotes sur l'état de la religion dans la Chine, 1742, VII, pp. 13 et 16). Bien évidemment, cette disposition ne contribua pas à calmer la situation, qui ne se détentit qu'en 1689, quand les jésuites obtinrent d'être dispensés de ce serment d'obéissance. ⇑
8 - Il fallut attendre 1692 pour que deux jésuites français, Abraham Le Royer et Hughes Parégaud, reviennent au Tonkin. ⇑
9 - Chambre du Conseil, tribunal où l'on rend la justice dans les pays orientaux (Dictionnaire de Trévoux). ⇑
10 - L'escadre du roi avait amené à Siam des bombes, des mortiers et dix bombardiers sous les ordres du sieur Du Laric. L'Ordre du Roy remis à ce dernier à Brest, lui enjoignait formellement de se rembarquer avec les bombardiers, quand les vaisseaux seraient près de revenir en France, « Sa Majesté n'estimant pas que leur présence fût nécessaire en ce pays (Siam) après le départ des vaisseaux. » Les instructions de Desfarges et des ambassadeurs étaient rédigées dans le même sens. (Lanier, Étude historique sur les relations de la France et du royaume de Siam de 1662 à 1703, 1883, p. 124). Conformément à ces instructions, les envoyés refusèrent de livrer ces armements à Phaulkon et les conservèrent à bord de l'Oiseau au grand mécontentement du roi qui comptait dessus pour réprimer un soulèvement à Pattani. Ces bombardiers, instamment demandés par Phaulkon, constituèrent un point d'achoppement qui envenima les rapports entre M. Constance et les envoyés pendant tout leur séjour au Siam. ⇑
11 - Le sieur de La Lève était lieutenant sur le vaisseau le Gaillard. ⇑
12 - Les Archives Nationales conservent un très volumineux dossier contenant les pièces du procès qui opposa la Compagnie des Indes aux héritiers Phaulkon. Ces héritiers étaient Mme Constance – Maria Guyomar de Pinha –, son fils Georges, sa bru Luisa Passagna, tous deux agissant également au nom de leur fils Constantin. Le différend s'éternisa et ne prit fin que le 17 juin 1717 par un arrêt du Conseil d'État. Georges Phaulkon était alors mort, et sa veuve s'était remariée avec un certain sieur de Crouly. Quant à Marie Guyomar, elle devait avoir environ 55 ans.
Parmi les pièces figurant dans le dossier, se trouve une copie du contrat par lequel Phaulkon devenait actionnaire de la Compagnie et s'engageait à verser à ce titre une somme de 300 000 livres :
Nous, soussignés etc., reconnaissons avoir fait et accordé entre nous ce qui suit ; c’est à savoir :
Que moi, Constantin Phaulkon, promets m’intéresser dans la Compagnie française des Indes-orientales pour la somme de trois cent mille livres que je promets de faire délivrer incessamment entre les mains du caissier général de ladit Compagnie à Paris, pour partager avec les autres associés en ladite Compagnie les pertes et profits qu’il plaira à Dieu envoyer, au prorata de mon dit intérêt, tant et si longuement que durera ladite Compagnie, ce que moi, Céberet, ai accepté tant en mon nom qu’en celui de la Compagnie, en ladite qualité de directeur général d’icelle et promets qu’incessamment après mon retour en France, ou après le premier avis que la Compagnie aura du présent traité, elle fera un bilan ou balance générale du fonds capital qui sera trouvé effectif au premier janvier prochain 1688 que ledit seigneur Constantin Phaulkon commencera à être intéressé : savoir que supposé qu’après la balance faite, la Compagnie trouve son fonds être effectif de trois millions, sans y comprendre aucun profit d’actions ni autres avantages, ledit seigneur Phaulkon mettant pour sa part trois cent mille livres de fonds aura l’onzième partie dans ledit fonds de trois millions [note en marge : auquel cas le fonds effectif de la Compagnie serait de trois millions] trois cent mille livres, ou si le fonds se trouvait plus fort ou plus faible par le bilan, ledit seigneur Phaulkon demeurera intéressé à proportion des dites trois cent mille livres qu’il met de fonds dans la Compagnie, et partagera les pertes et profits à proportion dudit fonds. (AN C1/26, f° 217v°-218r°).
Phaulkon ne paya pas cette somme, mais envoya en France des marchandises dont le produit de la vente devait servir à abonder le fonds promis :
En exécution de ce traité, ledit sieur Constance fit charger sur le vaisseau le Coche des marchandises dont le provenu de la vente faite en France en [avril] 1688 s’est trouvé monter à la somme de 53 622 livres qui est entré dans le fonds du commerce de la Compagnie et pour lequel il lui a été expédié le 28 janvier 1688 une quittance d’action qui lui a été envoyée par le vaisseau l’Oriflamme, parti de France en février suivant.
En octobre 1688, la Compagnie fit une seconde vente de plusieurs marchandises que le sieur Constance avait envoyées par les vaisseaux l’Oiseau, le Président, le Gaillard, le Dromadaire et la Loire dont le provenu a monté à 58 125 livres 2 sols, laquelle somme a été passée à son compte en augmentation d’action, et la quittance en a été remise au père Tachard, suivant sa reconnaissance du 4 avril 1689 (AN C1/26, f° 166r°).
Les documents nous donnent peu d'indications sur les marchandises vendues en avril 1688, en revanche, celles négociées en octobre sont largement détaillées. Elles consistaient en trois lots, les deux premiers en nom propre de Phaulkon, le troisième à moitié avec la Compagnie.
Le premier lot, ramené par les navires l'Oiseau et le Président et qui complétait la cargaison du Coche, comprenait 26 caisses de soie de Bengale – ce fil extrêmement doux et délié, qui sert à faire de belles étoffes pour les gens de qualité (Furetière) –, vendue au poids en balles pour 4 231 livres ½ (plus de 2 tonnes), valant entre 5 livres 6 sols et 5 livres 16 sols la livre, le tout pour un total de 23 030 livres 1 sol. Sur cette somme, étaient prélevés 7,5% d'escompte pour la Compagnie et encore 20% de fret. Il restait net à Phaulkon 17#8239;043 livres. Le taux très élevé de fret s'expliquait par les exigences du roi qui louait ses navires jusqu'à 3 000 livres par mois selon leur tonnage, sans compter la poudre qu'il fournissait. Ainsi 17 mois et 21 jours de fret pour le seul Oriflamme furent facturés 53 100 livres, plus 375 livres de poudre. On voit donc que la Compagnie avait tout intérêt à posséder ses propres navires, afin d'économiser leur ruineuse location. C'est d'ailleurs ce qu'elle fit à quelques reprises, en achetant le navire les Jeux en 1687 pour 33 000 livres et la flûte le Coche l'année suivante pour 31 787 livres 15 sols.
Le second lot, beaucoup plus hétéroclite, avait été ramené en France sur les vaisseaux de l'escadre Vaudricourt, le Gaillard, la Loire et le Dromadaire. Il comprenait : 1 caisse contenant 273 pièces d'étoffes diverses, taffetas du Tonkin, crépon de soie blanche et de couleur, satins de Perse et de Chine, étoffes de Damas, étoffes fleurs d'or, pour un total de 9 314 livres 17 sols. Une caisse de cannelle pesant 277 livres s'avéra n'être que de la casse, Lignum Cassia, de qualité inférieure, et ne trouva preneur qu'à 17 sols la livre. Le gros de la cargaison était constitué par 19 caisses contenant 17 700 pièces de porcelaine, dont 13 429 furent vendues pour 31 678 livres 17 sols. De ce deuxième lot, demeurèrent invendus 4 271 pièces de porcelaine, 2 caisses de gomme-gutte, 2 caisses de soie, et 94 caisses de thé. Défalqués les 7,5% d'escompte à la Compagnie et les 20% de fret, il revenait encore à Phaulkon 30 509 livres 12 sols.
Enfin, le troisième lot, qui était pour moitié à Phaulkon et pour moitié à la Compagnie, avait lui aussi été apporté en France sur le Gaillard, la Loire et le Dromadaire. il comprenait 19 caisses de soie du Bengale pour un total de 5 154 livres, vendues entre 5 livres et 5 livres 11 sols la livre, qui rapportèrent 28 579 livres 15 sols. Ôtés l'escompte de 7,5% et les droits de fret, la part qui revint à Phaulkon fut de 10 574 livres 10 sols.
Le solde des marchandises qui n'avaient pu être vendues en octobre 1688 le fut en décembre, pour une somme d'environ 14 030 livres. Enfin, un reliquat fut cédé en 1695 et 1696 pour une somme de 16 414 livres.
La Compagnie, à qui l'ensemble de ces ventes n'avait rapporté qu'à peine la moitié des 300 000 livres promises par Phaulkon, estimait qu'il appartenait aux héritiers de payer la différence : Ainsi, il s’en faut de 157 808 livres que le sieur Phaulkon n’ait satisfait à l’engagement qu’il a contracté avec la Compagnie, duquel engagement il est d’autant plus certain, suivant les règles les plus inviolables du droit commun et universel, que ses héritiers sont tenus indispensablement que, la Compagnie ayant réglé son commerce sur cet engagement, il ne se peut faire qu’elle n’ait beaucoup souffert de ce qu’il n’y a pas été satisfait. (AN, C1/26, f° 182r°).
Les jésuites volèrent au secours de Mme Constance. Sans même que la Compagnie soit convoquée et puisse faire entendre ses arguments, ils portèrent l'affaire devant Louis XIV, réclamant en outre une pension pour la veuve de Phaulkon. On peut penser que le roi fut assez embarrassé par cette requête, dont il ignorait les tenants et les aboutissants. Par un arrêt du 30 mars 1700, il se contenta de mettre les sommes litigieuses sous séquestre et ordonna le paiement d'une pension pour Marie Guimard et son fils : Sa Majesté, étant en son conseil, a fait très expresses inhibitions et défenses aux directeurs de la Compagnie des Indes-orientales de disposer des deux sommes de 53 622 livres et 58 027 livres et 11 sols et des intérêts qu’elles ont produits, ni du montant de la vente des effets qui n’avaient pas encore été liquidés au temps de la nouvelle de la mort dudit sieur Constance, dont ils remettraient incessamment à Sa Majesté un état signé d’eux, jusqu’à ce qu’elle ait décidé sur les demandes respectives desdits directeurs et de ladite veuve Constance et son fils, ou du porteur de leur procuration, et en attendant et jusqu’à la décision desdites contestations, veut Sa Majesté que lesdits directeurs seront tenus de faire tenir par chacun an la somme de 3 000 livres à la dame Constance et à son fils, pour leur donner le moyen de subsister. (AN, C1/26, f° 164v°-165r°).
Dans un factum rédigé pour le procès de 1717, Aubry, l'avocat de la Compagnie, écrivait : Il est plus clair que le jour que c’est principalement, ou même uniquement, pour mettre la succession du sieur Phaulkon à couvert de toutes ces saisies et oppositions (…) que les supérieurs des jésuites, (qui d’ailleurs avaient des vues importantes pour eux, afin de tâcher de se maintenir dans le royaume de Siam), ont sollicité et obtenu l’arrêt du 30 mars 1700, qui a été rendu sur ce qu’ils ont jugé à propos de représenter au roi à l’insu des Directeurs de la Compagnie et sans que Sa Majesté ait été aucunement instruite des droits et des intérêts de la Compagnie. (AN C1/26, f° 185v°-186r°).
La Compagnie cessa de payer la pension de Mme Constance en 1702, considérant qu'un nouvel arrêt du Conseil d'État obligeant les actionnaires à augmenter son capital mettait fin à son obligation de paiement. De plus, ajoutait l'avocat : … il est très certain que la veuve du sieur Phaulkon n’a nul besoin, et qu’au contraire elle est en faveur et jouit de tous les avantages d’une place très honorable, en ce qu’elle est gouvernante du fils du roi de Siam. Il est certain aussi que le sieur de Crouly, qui a épousé la veuve du fils du sieur Phaulkon, est fort opulent. (AN C1/26, f° 187r°).
Le dernier acte se joua au Conseil d'État le 26 juin 1717. Par la voix de Granier, son avocat, le sieur de Crouly, venu du Siam avec procuration pour représenter les héritiers Phaulkon, demandait à la Compagnie 45 500 livres pour arrérages de la provision alimentaire accordée à Mme Constance par le décret du 30 mars 1700. De leur côté, Soullet, Mouffle de Champigny, Foucherolle et Aubry, les avocats de la Compagnie, demandaient aux héritiers le paiement de 64 387 livres, 13 sols et 6 deniers (les produits des ventes de marchandises avaient généré des intérêts), et 150 000 livres pour l'augmentation de capital imposé par le décret de 1702. Les uns et les autres obtinrent satisfaction. La pension alimentaire pour la veuve Phaulkon et son fils fut confirmée pour leur donner le moyen de subsister et les héritiers Phaulkon furent condamnés à payer à la Compagnie la somme qu'elle exigeait, soit 214 387 livres, 13 sols. Et 6 deniers. ⇑
13 - La demande du chevalier de Chaumont exprimée dans l'article II de son traité de commerce était claire : Le sieur ambassadeur de France demande que ladite Compagnie ait la liberté entière de commerce dans le royaume, avec toutes exemptions de droits d'entrée et de sortie. Le roi l'accorda, en y ajoutant toutefois quelques restrictions qui suscitèrent de vives critiques en France : Le Roi de Siam, par la grande estime qu'il fait de Sa Majesté très chrétienne, accorde à la Compagnie française l’entier et libre commerce dans son royaume sans payer de droits d’entrée ni de sortie, en souffrant la visite par les officiers des douanes conformément aux coutumes du royaume. (…) … quant à la liberté de commerce, cela s'entend que la Compagnie ait la liberté d'acheter et de vendre toutes sortes de marchandises pourvu qu'elle soient point de contrebande, lesquelles elle ne pourra acheter que des gardes-magasins du roi ou des marchands qui les auront eues de leurs mains. Et la Compagnie pourra vendre et acheter à sa volonté toutes les marchandises qui seront apportés dans le royaume par des étrangers ou par des naturels du pays, ou qu'elle fera venir pour son compte, et en cas que le roi ait besoin pour son service de quelques-unes desdites marchandises, il les pourra prendre avec toute préférence. (Archives du Ministère de la Marine et des colonies, Fonds des colonies, III, p. 177). Céberet parvint à assouplir le texte, mais le roi se réserva le monopole de quelques marchandises, le calin hors de Phuket, les défenses d'éléphant, les salpêtre, le plomb, l'arec et le bois de sappan. Sa Majesté pourtant ne permet pas que la Compagnie achète ces sortes de marchandises d'aucun marchand, mais seulement de ceux qui les prennent dans les magasins, puisqu'elles sont produites par les rentes du roi, et ainsi nul n'a permission de les vendre, mais seulement les officiers du roi. Par ailleurs, le monopole du commerce des cuirs à Ayutthaya avait été accordé aux Hollandais, ainsi la Compagnie de France ne commercera pas en cette marchandise à Siam, mais en quelque autre poste qu'elle voudra du royaume, hors de la barre de Siam, elle a liberté entière de les acheter. (AN C1/26, f° 227). ⇑
14 - Ce traité, conclu le 3 décembre 1684 par le barcalon Kosathibodi et André Deslandes-Boureau, le premier directeur du tout nouveau comptoir de la Compagnie des Indes à Ayutthaya, accordait à la Compagnie, sous quelques conditions, notamment de paiement de droits uniquement en pataques d'Espagne, parce que cet argent est plus pur, et qu'on y perd moins au change, le monopole du commerce de tout le poivre qui provient du royaume de Siam, savoir tout le poivre des provinces et terres sujettes à Sa Majesté depuis les extrémités du nord jusqu'à Ligor. (Reinach, Recueil des traités conclus par la France en Extrême-Orient, 1902, p. 1 et 2). ⇑
15 - Ce don fait l'objet de l'article 9 du traité de commerce : Le roi de Siam donne libéralement à la Compagnie de France la propriété entière de quelque île commode distante de 10 lieues au plus du port de Mergui, pour la fortifier, y bâtir et en user selon ses intentions, et ladite Compagnie s'oblige devant Dieu de ne s'en servir jamais contre les droits ou les intérêts du roi de Siam, ni de recevoir ses ennemis, ni de leur donner quelque secours que ce soit qui puisse aller au préjudicie dudit roi, lui accordant toute souveraineté, droits et justice et tout le reste qui peut contribuer à rendre ladite Compagnie absolue dans ladite île, et Sa Majesté, sachant le plan et le nom de ladite île, donnera patente du don entier de ladite île pour lui et ses successeurs. (Reinach, op. cit., p. 12). ⇑
16 - Les pouvoirs conférés au père Tachard, présenté par Phaulkon comme Ambassadeur extraordinaire du roi de Siam, restent assez vagues. Une lettre du roi Naraï datée du 22 décembre 1687 et adressée au père de La Chaize, reproduite par Tachard lui-même, indique : Nous avons député le père Tachard de la Compagnie de Jésus auprès du roi et auprès du saint Pape pour leur présenter de notre part nos lettres royales et nos présents. (…) Nous désirons particulièrement qu'il ménage une voie sûre et libre, afin de faire venir le plus grand nombre de pères de votre Compagnie qu'il se pourra, pour être comme les gages de la bonne et royale correspondance que nous souhaitons ardemment d'entretenir avec le roi de France, notre bon ami et allié. (Second voyage du père Tachard […], 1689, p. 289). Pour sa part, Tachard écrit à propos d'une audience particulière qu'il eut avec le roi : Il m'ordonna enfin d'agir en France pour sa gloire et pour l'intérêt de ses peuples, dans les différentes occasions qui se présenteraient, me disant qu'il m'autorisait comme si j'avais des ordres exprès pour chaque chose en particulier. (span class="italic">ibid., pp. 295-296). ⇑
17 - Il s'agit ici de la très importante commande que le père Tachard avait été chargé de faire exécuter en France pour le roi Naraï, et dont beaucoup de pièces arrivèrent brisées au Siam. Voir à ce sujet la note 1 de la 1ère partie. ⇑
18 - Le père Tachard, qui assistait à cette audience (ce que ne mentionne pas Céberet) écrivit à ce propos : Ensuite, le roi ordonna au fils de M. Céberet de se lever pour le voir plus à loisir. Il demanda son âge, et s'il avait étudié, et il prit plaisir d'apprendre qu'il ne faisait que de sortir du collège Louis-le-Grand, disant qu'il ne pouvait pas tomber en de meilleures mains pour être bien élevé. Il lui fit présent d'une chaîne d'or d'un ouvrage fort délicat. (span class="italic">Second voyage du père Tachard […], p. 280). Le fils unique de Claude Céberet avait eu l'occasion de réciter un compliment en galibi (langue des Kali’nas, ethnie amérindienne de culture caraïbe établie sur la région nord-ouest du continent sud-américain) lors d'une réception donnée au collège Louis-le-Grand en l'honneur des ambassadeurs de Siam venus visiter l'institution à la fin de leur séjour. Il devait être alors âgé d'une quinzaine d'années. ⇑
19 - Louis Laneau et l'abbé de Lionne. ⇑
20 - C'était effectivement le double de ce qui était prévu dans les instructions de Versailles données à Desfarges le 25 janvier 1687 : Il sera à propos qu'il [Desfarges] règle avec ledit sieur Céberet et le commissaire ce qui sera nécessaire par jour à chaque soldat eu égard au prix des vivres à Siam, n'étant pas juste que la solde soit aussi forte en ce pays qu'en France, où les vivres sont infiniment plus chers. Il paraît même plus avantageux au service de leur faire distribuer journellement le riz et l'eau-de-vie nécessaires et de leur faire donner deux sols en argent pour acheter ce qu'il leur faudra d'ailleurs. (AN Col. C1/27 f° 19r°). ⇑

28 février 2020
