
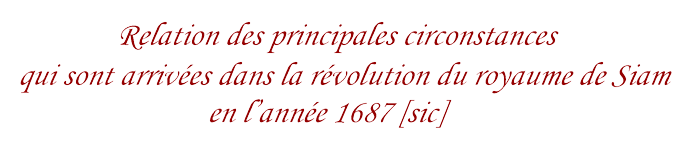
1ère partie.
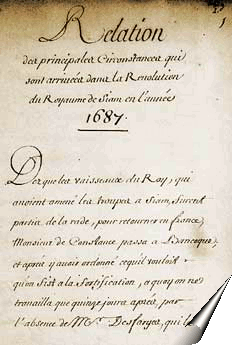
[1r°] Dès que les vaisseaux du roi qui avaient amené les troupes à Siam furent partis de la rade pour retourner en France, M. de Constance passa à Bangkok et après y avoir ordonné ce qu'il voulait qu'on fît à la fortification, à quoi on ne travailla que quinze jours après, par l'absence de M. Desfarges qui le [1v°] suivit à Louvo, lieu de plaisance du roi de Siam, et d'où il ne revint que vers la fin du mois de janvier. Cependant M. de Bruant, commandant destiné pour Mergui, sollicitait fortement M. de Constance de l'expédier avec son détachement pour se rendre à son poste. Mais ce ministre, qui connaissait mieux que personne qu'être maître de Bangkok et de Mergui n'était point le plus sûr moyen de se maintenir en ce royaume, et qu'il consistait uniquement à l'être du lieu ou du palais où résidait le roi, différa autant qu'il le put de séparer les troupes qui étaient plus à sa portée dans Bangkok en cas de révolution [2r°] qu'à Mergui, d'où il ne fallait pas moins de six semaines pour se rendre à Louvo, et encore fallait-il faire diligence et n'avoir pas les vents contraires. Mais les continuelles instances de M. du Bruant l'emportèrent au-dessus d'une aussi bonne politique, et M. de Constance, ne voulant point donner au roi lieu de croire qu'on ne tînt point ce que l'aurait promis à ses envoyés, consentit enfin, malgré ses propres lumières, qu'il partît avec trois compagnies (1).
On ne tarda guère à s'apercevoir que ce n'était point sans raison que M. de Constance n'était nullement d'avis qu'on séparât les troupes, et qu'il n'avait eu d'autre vue en [2v°] les retenant unies dans Bangkok que l'intérêt du roi et l'infaillible établissement de ses sujets en ce royaume ; car M. du Bruant ne fut point parti de huit jours, qu'on s'aperçut qu'un nommé Okphra Phetracha, grand mandarin du royaume et qui avait un très libre accès auprès du roi de Siam, commençait à se faire des créatures. Cet homme était fort aimé des talapoins, qui sont les prêtres du pays, et parmi lesquels il avait demeuré très longtemps, aussi bien que du peuple, en ce que sa famille était l'unique du royaume qui depuis un temps presque immémorial s'était soutenue dans les honneurs et dans les dignités, quoique la coutume [3r°] de ce pays-là soit que les enfants des plus grands mandarins deviennent de la lie du peuple après la mort de leur père, s'ils n'ont soin de leur procurer quelque dignité pendant leur vivant.
M. de Constance, qui s'aperçut de ce commencement d'entreprise et qui ne crut point le devoir donner à connaître, en faisant monter quelques troupes françaises à Louvo, se contenta pour donner moins d'ombrage, de deux compagnies moitié siamoise et moitié portugaise des Indes commandées par des officiers français, se réservant à prendre de plus fortes mesures dès qu'il s'apercevrait que cette émotion prendrait le chemin d'une conspiration et qu'il [3v°] serait muni de pièces assez convaincantes pour le dénoncer au roi. Mais il ne tarda guère à découvrir entièrement le dessein de Phetracha, qui travaillait le plus sourdement qu'il lui était possible à se faire un puissant parti dans le royaume, en y engageant les plus grands talapoins et les principaux mandarins à qui il ne découvrit rien moins que les vues qu'il avait de se mettre la couronne sur la tête, parce qu'il était à craindre qu'il ne les trouvât nullement disposés à la transporter hors de la famille royale. c'est pourquoi il crut devoir se servir envers les talapoins du pieux prétexte de rétablir la pagode, c'est-à-dire la [4r°] religion dans sa première pureté, qui avait eu plusieurs atteintes par la trop grande indulgence du roi qui avait permis une mission publique et donné la liberté à tous ses sujets de se faire chrétiens, ce qui tendait à son entière destruction.
Il se servit d'un autre prétexte envers les mandarins et grands du royaume qui n'était pas moins capable de les attirer dans son parti, savoir qu'il était sûrement instruit que M. de Constance avait appelé les Français pour se rendre leur maître, vu qu'il les avait mis en possession des deux plus importantes places du royaume ; que le roi était un bon prince qui ne pénétrait pas beaucoup dans les suites [4v°] que pourrait avoir cette facilité d'introduire ainsi dans ses terres des étrangers et des sujets du plus puissant prince de l'Europe, et qu'ainsi ils étaient donc obligés, comme zélés défenseurs de leurs libertés, de se joindre à lui pour prévenir les pernicieux desseins de ce ministre, et de s'affranchir d'une espèce d'esclavage dans lequel ils tomberaient infailliblement si le roi qui succèderait au régnant avait la même facilité de se laisser conduire par celui qui n'avait d'autre vue que celle de s'agrandir par leur abaissement, et duquel il était de la dernière importance pour le bien public de se défaire.
Ces paroles avaient les plus belles [5r°] apparences du monde, et il n'y en eut pas un qui n'y donnât dedans tête baissée, se sentant d'ailleurs naturellement portés à haïr M. de Constance pour leur avoir fait ôter la liberté du commerce, afin de rendre celui du roi plus fructueux. Aussi Phetracha ne fut-il pas longtemps à engager presque tout le royaume dans son parti, voire même ceux qui étaient le plus étroitement attachés à la personne du roi. Cette entreprise ne put pourtant être conduite avec autant de secret qu'elle ne vînt à la connaissance de M. de Constance par plusieurs mandarins que ni l'intérêt ni les belles espérances n'avaient pu détourner de son [5v°] parti, qui songea de son côté aux moyens de la prévenir en s'assurant de celui qui la tramait, mais il fallait des pièces plus justificatives que des paroles avant que de le dénoncer au roi de Siam, parce que c'est une coutume établie en ce royaume de punir un accusateur du même supplice qu'aurait subi l'accusé s'il avait été convaincu. D'ailleurs il appréhendait que les menaces de Phetracha, qui commençait à se faire craindre, n'intimidassent si fortement ceux qui lui avaient révélé le secret, qu'ils n'osassent soutenir la chose devant le roi avec autant de fermeté qu'il en fallait pour le persuader. Mais le bonheur voulut que [6r°] peu de jours après, il reçut par un exprès du gouverneur de la ville de Siam ce qui lui était nécessaire pour convaincre le roi des desseins du conspirateur. C'était un faux ordre ayant les sceaux du royaume contrefaits, dans lequel Phetracha lui enjoignait de tenir toujours prêts deux cents milliers de poudre, bon nombre de bombes et de grenades, et plusieurs autres munitions de guerre. Deux jours après, il en reçut un autre de la même fabrique, que lui envoyait le gouverneur de Pipely Phetchaburi (เพชรบุรี), ou Phetburi, la Cité des pierres précieuses, à environ 160 km au sud de Bangkok, à l'extrémité nord de la péninsule Malaise., place sur les confins du royaume, qui portait d'ordonner à tous les hommes tant de gouvernement que de ses dépendances, de s'armer [6v°] incessamment et de se tenir prêts à partir au premier ordre qu'ils en recevraient.
De pareilles pièces étaient plus que suffisantes pour convaincre le roi des pernicieux desseins de Phetracha et pour le porter à le punir ainsi qu'il le méritait ; mais comme on venait rendre compte chaque jour à M. de Constance des mandarins que le conspirateur engageait dans son parti, il crut ne devoir point attendre davantage à le prévenir. D'un autre côté, prévoyant que ce serait beaucoup hasarder à commettre l'autorité du roi que d'entreprendre de le faire arrêter par le peu d'officiers français [7r°] qu'il avait auprès de lui, en un lieu où il pouvait avoir plusieurs gens prêts à embrasser ses intérêts, il crut que le plus sûr moyen était celui d'avoir des troupes françaises, ne se fiant pas beaucoup aux deux compagnies moitié siamoise et moitié portugaise des Indes, qui comme j'ai dit, il avait fait venir de Bangkok lorsqu'il s'aperçut des premiers mouvements. C'est pourquoi il écrivit à M. Desfarges qu'ayant une affaire de la dernière importance pour le bien des deux couronnes à lui communiquer, il le priait de se rendre à Louvo avec peu de suite ; ce qu'ayant fait ce général, M. de Constance lui [7v°] déclara qu'il apprenait de tous côtés que Phetracha faisait son parti et qu'il ne doutait pas que ce conspirateur ne tendît à se rendre maître du palais et de la personne du roi, comme aussi à détruire les desseins du roi du France en ce pays-ci ; ainsi qu'il était de la dernière conséquence de prévenir une pareille entreprise avant qu'elle eût le temps de se former davantage, et que pour cet effet, il était expédient qu'il montât à Louvo avec quatre-vingts de ses meilleurs hommes et plusieurs officiers pour le faire arrêter sans qu'il pût échapper de leurs mains, n'y ayant personne qui osât entreprendre de le [8r°] sauver à la face de 80 ou 100 Européens.
Il le pria ensuite de ne se point arrêter aux faux bruits que Phetracha faisait courir dans le royaume touchant la mort du roi, qui ne les semait que dans la vue d'observer nos démarches et de trouver occasion de jeter dans l'esprit de ce prince des soupçons de notre fidélité pour son service, et de la sincérité de sa propre conduite, puisqu'il était la cause de l'établissement des Français dans ce royaume. Et afin qu'il fût entièrement convaincu de la parfaite santé du roi, il lui en procurerait une audience avant que de partir, comme il fit effectivement [8v°] le matin du jour de son départ.
M. Desfarges étant venu de Louvo à Bangkok, il fit mettre le lendemain matin toute la garnison sous les armes, et en ayant tiré les 80 meilleurs hommes et 10 officiers, il en partit le jour suivant dans plusieurs bateaux. Dès qu'ils furent arrivés à la ville de Siam, il alla descendre à la faiturieFaiturie, ou factorie : bureau où les facteurs, les commissionnaires, faisaient commerce pour le compte d'une Compagnie. L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert précise également : On appelle ainsi dans les Indes orientales et autres pays de l'Asie où trafiquent les Européens, les endroits où ils entretiennent des facteurs ou commis, soit pour l'achat des marchandises d'Asie, soit pour la vente ou l'échange de celles qu'on y porte d'Europe. La factorie tient le milieu entre la loge et le comptoir ; elle est moins importante que celui-ci et plus considérable que l'autre. française où le sieur Véret, chef du comptoir et ennemi juré de M. Constance, parce qu'il avait trop de connaissance de son manque de droiture dans l'administration des affaires du comptoir, crut ne pouvoir trouver une occasion plus favorable [9r°] pour satisfaire sa passion et se mettre à l'abri des disgrâces qu'il devait attendre de la part de MM. les intéressés de la Compagnie royale des Indes, pour n'être pas de bon compte ; et connaissant assez M. Desfarges pour un homme qui s'attache à la superficie des choses sans les vouloir pénétrer, lui dit d'un ton effaré qu'il risquait tout pour sa personne et pour ses troupes en voulant entreprendre de monter à Louvo, que c'était avoir trop de confiance en un homme qui n'avait jamais fait paraître que de la fourberie et de la mauvaise foi dans toutes ses actions, et s'il ignorait [9v°] que le roi fût mort et tout le royaume sous les armes qui l'attendait entre Siam et Louvo pour lui couper la gorge à son passage, et enfin qu'il était très sûrement informé que M. de Constance, se voyant perdu sans ressource, voulait faire périr tous les Français avec lui, et qu'il le priait au nom de Dieu, pour l'amour de lui-même, de ne point avancer plus avant, s'il voulait conserver la mission, les intérêts du roi et ceux de la Compagnie.
Mais quoique M. Desfarges dût être très persuadé de le roi était plein de vie et que M. de [10r°] Constance n'avait d'autres vues que celles de servir le roi son maître et l'établissement des Français, ne laissa pas néanmoins d'ajouter foi aux remontrances de Véret, sans faire réflexion qu'outre le dessein qu'il avait de perdre M. de Constance à quelque prix que ce soit, il avait encore pris la résolution de profiter de cette conjoncture pour s'approprier tous les effets du comptoir, sous prétexte qu'ils avaient été pillés, comme la suite l'a trop confirmé, en ce qu'il n'a pu rendre aucun compte au directeur du comptoir de Pondichéry, alléguant pour raison que tout ses papiers avaient été enlevés pendant la révolution (2).
[10v°] Véret, voyant qu'il avait mis M. Desfarges au point de balancer s'il monterait à Louvo ou s'il s'en retournerait sur ses pas, jugea à propos de lui proposer de voir MM. les évêques, prélats de piété et de vertu, qui s'étant laissés prévenir par cet homme, croyaient effectivement la chose aussi véritable qu'il la leur avait persuadée. C'est pour cela que M. de Rosalie (3), le plus jeune des deux évêques, voyant M. Desfarges, s'écria tout surpris : Comment, Monsieur, vous osez vous exposer à venir ici pour vous faire couper la gorge, et à toutes vos troupes ? Ignorez-vous les bruits [11r°] qui courent ici de la mort du roi, et que tout le royaume est en armes ? Il n'y a point de sûreté pour vous ici, et si vous m'en croyez, vous vous en retournerez sur vos pas. Ce second avis, qui confirmait celui de Véret, fit tant d'impression sur l'esprit de M. Desfarges qu'il était sur point de se désister de son entreprise, lorsque M. l'évêque de Métellopolis, homme assurément d'une très grande vertu et d'une piété consommée, lui dit qu'il ne fallait point donner si légèrement dans ces bruits et qu'il était bon, avant que d'abandonner la partie, d'en être bien convaincu, vu qu'il y avait beaucoup lieu de douter que le roi fût mort, M. [11v°] Desfarges en ayant eu une audience depuis cinq jours, et que ce bruit courait dans Siam devant ce temps-là, et que pour s'éclaircir entièrement s'il était vrai que tout le royaume attendît M. Desfarges sous les armes entre Siam et Louvo, il était à propos d'en écrire à M. de Constance, et de lui mander ce qu'on avait appris à Siam.
Cependant M. Desfarges n'ignorait point, comme j'ai dit, que le roi fût vivant, et ce bruit n'était point une chose sur laquelle ont ait manqué de le prévenir, jusque-là que M. de Constance le pria tant de fois de ne s'y point arrêter, qu'il commençait à s'en lasser et lui dit qu'il n'avait pas besoin qu'on lui répétât si [12r°] souvent la même chose, et qu'il lui engageait sa parole de faire ce qu'il souhaiterait de lui. Il fut donc résolu qu'on enverrait un officier à Louvo, tant pour observer si les avis de Véret étaient véritables que pour donner avis à M. de Constance de la causes du retardement, et que pendant ce temps-là, M. Desfarges sortirait de Siam avec ses troupes pour s'aller poster deux lieues en deçà de la ville. Un lieutenant d'infanterie (4) fut destiné pour porter la lettre, et ayant pris toutes les précautions d'un hommes qui ne voulait point être surpris, la cacha dans un nœud de sa perruque, et n'alla que à travers les champs, mais il fut fort étonné de voir qu'elles avaient été inutiles [12v°] et que tout ce qu'il avait rencontré dans son chemin était des éléphants, des chevaux, des balons et des palanquinsSortes de chaises, ou de litières, portées par des hommes ou par des animaux et dont les personnes importantes se servent, dans une grande partie de l'Asie, pour se faire transporter d'un lieu à un autre. que M. de Constance avait envoyés à mi-chemin pour recevoir M. Desfarges et ses troupes.
que M. de Constance avait envoyés à mi-chemin pour recevoir M. Desfarges et ses troupes.
Dès que cet officier fut arrivé à Louvo, où tout au moins il s'attendait de voir tout en armes et en rumeur, il fut fort surpris d'y trouver toutes choses dans la dernière tranquillité. Tant chez les pères jésuites qui observaient une éclipse de lune en même temps que le roi en faisait de même en son palais et qu'il les envoyait questionner de temps en temps sur cette éclipse (5), que chez M. de Constance, tout était dans la situation ordinaire.
[13r°] Dès que ce ministre sut qu'il y avait un officier français arrivé de la part de M. Desfarges, il vint lui-même recevoir sa lettre, et il y répondit sur le champ, où il le priait avec les dernières instances de ne point avoir ces terreurs paniques, qu'il croyait l'avoir assez prévenu là-dessus, et enfin qu'il ne doutait point que ne dût être suffisamment convaincu par l'officier porteur de la présente qu'il ne devait point s'arrêter aux bruits qui couraient à Siam, et que tout était à Louvo dans la même situation qu'il l'avait laissé. M. de Constance pria même l'officier de s'en retourner avec la réponse de sa lettre par les chemins des routes, afin qu'il pût rendre compte à [13v°] M. Desfarges de ce qu'il aurait vu, mais il ne rencontra rien de plus par ce chemin que par l'autre.
Après que cet officier fut parti pour aller faire sa commission, on jugea à propos, pour s'éclaircir davantage de la situation de toutes choses, d'en envoyer un autre dans la ville de Siam, sous prétexte de chercher des vivres pour les soldats du détachement, avec ordre d'observer s'il ne s'apercevait point de quelque mouvement. Cet officier ayant parcouru pendant une après-dînée tout les quartiers des différentes nations, rapporta que tout restait dans la situation ordinaire, et n'avait rencontré un seul homme [14r°] autrement armé que de coutume.
Il paraît que tous ces indices si contraires aux avis de Véret et aux bruits qui couraient à Siam auraient bien dû faire perdre toute crainte à M. Desfarges et le porter à s'acquitter de la promesse qu'il avait faite à M. de Constance de seconder ses desseins, mais il était trop prévenu et ne put se déterminer à rien de plus qu'à envoyer un capitaine d'infanterie à Louvo avec une seconde lettre, où il le priait de ne pas trouver mauvais s'il ne l'allait pas joindre, parce qu'il ne pouvait sortir de sa place sans se mettre en risque de perdre sa tête en France, et [14v°] que s'il voulait venir à Bangkok, il l'y recevrait avec plaisir.
Cet officier, en qui depuis quelque temps M. Desfarges avait quelque confiance (6), lui dit avant que de partir qu'il ne croyait point qu'il fût de l'intérêt du roi ni du sien propre d'abandonner M. de Constance, particulièrement dans une conjoncture où il s'agissait du coup de partie, et qu'il devait être assez persuadé de la fausseté des bruits qui couraient pour n'appréhender aucun accident ; et que s'il croyait avoir fait une grande faute d'être sorti de sa place, elle ne serait point plus approuvée de s'en être éloigné de quarante lieues que de cinquante-cinq. Mais M. Desfarges, ne sachant que répondre à cela, [15r°] dit que son parti était tout pris, qu'au surplus MM. les évêques, de qui il avait ordre de suivre les avis, et qui étaient gens de considération, s'étaient chargés de le disculper envers la cour. Mais il semble qu'il aurait bien dû réfléchir que si le roi avait voulu que toutes choses se fissent par l'avis de ces prélats, qui savent bien mieux convertir un idolâtre que conduire de pareilles affaires, il ne l'aurait point fait maréchal de camp pour l'envoyer à la tête de ses troupes.
M. Desfarges, après avoir donné ses ordres, s'embarqua pour s'en retourner à Bangkok, pendant que de son côté [15v°] cet officier prit le chemin de Louvo, où il arriva sans rencontrer plus d'apparence de soulèvement que le premier. Et après avoir rendu à M. de Constance la lettre dont il était chargé, il lui fit un petit détail de la conférence qu'il avait eue avec lui avant que de partir de Siam sur son sujet ; ce qui surprit extrêmement M. de Constance, et l'obligea de dire que M. le général n'avait point de raison de l'abandonner, puisque c'était la cause des deux rois qu'il entreprenait, et que si une pareille démarche n'était point soutenue, elle plongeait le roi de Siam, les intérêts du roi et tous les Français dans une suite de malheur dont on ne [16r°] se relèverait jamais, comme la suite ne l'a que trop confirmé. Et ayant quitté cet officier sous prétexte d'aller répondre à la lettre, il s'alla abandonner à toute sa douleur, prévoyant les malheurs des suites de cette affaire. Cependant, il crut devoir faire un dernier effort pour porter M. Desfarges à achever ce qu'il avait commencé. Pour cet effet, il se servit du major de Bangkok (7) qui depuis notre arrivée en ce pays-là était auprès de lui, et sachant que M. Desfarges avait la dernière confiance en cet officier, étant une de ses créatures, il le pressa fortement de l'assurer sitôt qu'il serait arrivé à Bangkok, qu'il n'y avait rien de gâté, la chose se pouvant [16v°] encore réparer, et qu'il était absolument nécessaire pour le bien des deux couronnes qu'il se rendît à Louvo avec son détachement.
Ce major qui avait été témoin de tout ce qui s'était passé, demeura très convaincu de l'extrême importance de seconder M. de Constance et de prévenir la conspiration en arrêtant Phetracha, aussi l'assura-t-il avant que de partir d'employer tous ses soins et tout le crédit qu'il s'était acquis sur l'esprit de M. Desfarges pour le porter à faire ce qu'il souhaiterait. Mais dès qu'il fut arrivé à Bangkok, il n'eut pas plutôt fait l'ouverture du sujet de son voyage qu'on lui ferma la bouche, et voyant que prendre le parti de [17r°] M. de Constance n'était point le secret de se faire écouter, il changea tout pour tout et prit celui d'approuver autant la démarche de M. Desfarges en sa présence, comme il l'avait condamnée avant que de partir de Louvo, et ainsi il semblait que tout était de concert à abandonner M. de Constance à la tragique destinée que nous verrons qu'il a eue par la suite.
Ce ministre ayant enfin perdu toute espérance de secours du côté qu'il en devait le plus attendre, et voyant que la conspiration devenait tous les jours plus puissante, ne songea plus qu'à donner [17v°] avis au roi de tout ce qui se passait, à qui il l'avait caché jusqu'à cette heure, sachant bien que quelque assurance que ce prince leur eût donné de ne point éclater ni faire paraître que la chose fût venue jusqu'à lui, il le connaissait assez peu maître de son ressentiment pour avoir autant de modération que le demandait la réussite du dessein qu'il avait toujours eu de faire arrêter Phetracha.
Mais il ne lui était point facile de déclarer toutes choses au roi son maître, parce que ne le pouvant voir que rarement, il ne l'approchait jamais qu'il ne le trouvât obsédé et entouré des [18r°] créatures de Phetracha, devant qui il savait qu'il n'y avait point de sûreté pour sa personne de faire aucune mention de ce qui se passait dans le royaume. Cependant il fut assez heureux pour se trouver un jour seul avec lui, et s'étant approché de son lit, où il était malade depuis peu de temps, il lui déclara que Phetracha soulevait tout le royaume contre lui, qu'il ne tendait à rien moins qu'à se rendre maître de sa personne et le détrôner ; et qu'étant destitué de toutes forces et de tout secours pour s'opposer ouvertement à la faction, tant elle était déjà puissante, il ne voyait d'autre moyen pour la détruire que de déclarer en plein Conseil sa fille [18v°] reine, et que celui de ses oncles qu'elle épouserait lui succèderait, que c'était l'unique ressource qu'il y avait pour détacher de la conspiration plusieurs grands du royaume qui s'y étaient engagés sous les assurances que leur avait données Phetracha, qu'il n'avait d'autre voie que de maintenir la couronne dans la famille royale.
Le roi, ayant approuvé cet expédient, fit des reproches à M. de Constance d'avoir attendu à l'informer de la chose, dans un temps qu'on ne pouvait plus y remédier. Mais ce ministre, lui ayant rendu compte de toutes les mesures qu'il avait prises avec M. Desfarges [19r°] pour prévenir cette entreprise, il en parut fort surpris et encore plus touché, et ne put s'empêcher de dire ces paroles : Comment, le général des Français nous abandonne dans un pressant besoin, lui que vous m'aviez tant de fois assuré avoir ordre du roi son maître de me donner tout le secours dont j'aurais besoin ? Vous avez donc servi à me tromper, mais je vous vois enveloppé dans le même malheur que moi. M. de Constance qui n'avait rien d'avantageux à dire de M. Desfarges, lui répondit que si ce général ne se fût point arrêté aux mauvaises intentions de ses ennemis, les choses n'en seraient pas au point où elles en font ; et qu'à l'égard d'avoir [19v°] servi à la tromper, c'est ce qui avait toujours été très éloigné de sa pensée, puisqu'il en avait été le premier surpris ; que cependant il le priait, pour sa propre sûreté, de ne point éclater, parce que ce serait le moyen de faire avorter toutes les mesures qu'on pouvait prendre pour faire un dernier effort ; ce qui lui ayant promis le roi, il le fit porter dans le Conseil qu'il avait fait assembler, où après avoir déclaré ses intentions sur la reine princesse, sa fille, il excita ses mandarins à lui être fidèles et à porter les autres à rentrer dans leur devoir ; il dit que Phetracha était un traître et un perfide qui les amusait par des beaux motifs, et que la vérité était qu'il n'avait d'autre envie que [20r°] de monter sur le trône au préjudice de la famille royale, qui avait droit d'y prétendre, et enfin qu'il avait toujours été trop persuadé de leur zèle et leurs bonnes intentions pour croire qu'ils persistassent davantage à suivre le parti d'un usurpateur.

NOTES :
1 - Du Bruant quitta Bangkok vers la mi février 1688 - probablement le 17 - pour aller prendre possession de Mergui avec trois compagnies de 40 hommes chacune, commandées par Du Halgouët, Hiton et De Launay. ⇑
2 - Il est de fait que cette révolution était une aubaine pour Véret, qui avait tout intérêt à la disparition des traces de ses malversations. Lanier mentionne des Ordres du Roy des 20 mars et 22 décembre 1689 qui ordonnent son rapatriement (Étude historique sur les relations de la France et du royaume de Siam de 1662 à 1703, 1883, note p.171) : Quant au fripon Véret, la Compagnie ne put obtenir de lui qu'il rendît ses comptes. Il n'avait pas pris une part si active à la chute de Constance et à la révolution de Siam pour en revenir les mains nettes. Ordre fut donné par le roi à Martin de saisir ses papiers, effets, d'informer contre lui, de le saisir et de le ramener en France. ⇑
3 - L'abbé de Lionne. ⇑
4 - Il s'agissait du lieutenant Le Roy. ⇑
5 - Cette éclipse de lune partielle eut lieu le 15 avril 1688.
 L'éclipse de soleil à Siam en 1688 au mois d'avril.
L'éclipse de soleil à Siam en 1688 au mois d'avril.
Elle fut spéculée par les missionnaires jésuites et mathématiciens envoyés par le roi aux Indes orientales en 1687. Ce fut à Louvo dans le palais du roi qu'on l'observa en présence de ce prince qui était à une fenêtre d'une grande salle de son palais, assis sur un fauteuil, et les jésuites avec M. Constance qui leur servait d'interprète était assis les pieds croisés sur un grand tapis où était une rangée de mandarins prosternés la tête contre terre des deux côtés. On se servait en cette occasion de la belle machine parallactique qui est une espèce d'horloge où est attachée une lunette d'approche qui suit le mouvement du soleil. L'on voit là le mandarin Opra Pitracha qui vint voir de près cette machine. C'est celui qui s'est emparé du royaume de Siam et a chassé les Français. (Bibliothèque Nationale, Paris, Cabinet des Estampes). ⇑
6 - Il s'agissait du sieur d'Assieu. On trouve de multiples épellations de ce nom : d'Acieux, Dacieux, Dacieu, Dacia ou encore d'Assieux, qui sont toutes plausibles. Les documents officiels rédigés à Versailles mentionnent d'Assieu, c'est l'orthographe que nous avons retenue. ⇑
7 - Beauchamp. ⇑

12 mars 2019
