

2ème partie.
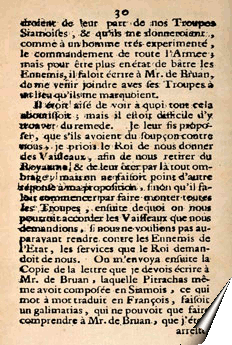
Il était aisé de voir à quoi tout cela aboutissait, mais il était difficile d'y trouver du remède. Je leur fis proposer que s'ils avaient du soupçon contre nous, je priais le roi de nous donner des vaisseaux afin de nous retirer du royaume et de leur ôter par-là tout ombrage, mais on ne faisait point d'autre réponse à ma proposition, sinon qu'il fallait commencer par faire monter toutes les troupes, ensuite de quoi on pourrait nous accorder les vaisseaux que nous demandions, si nous ne voulions pas auparavant rendre contre les ennemis de l'État les services que le roi demandait de nous. On m'envoya ensuite la copie de la lettre que je devais écrire à M. du Bruant, que Phetracha même avait composée en siamois, ce qui traduit mot à mot en français faisait un galimatias qui ne pouvait que faire comprendre à M. du Bruant que j'étais arrêté et que nos affaires étaient en mauvais état ; et c'est ce qui me fit accepter de l'écrire avec toutes les manières siamoises, dont le grand mandarin se trouva satisfait, tout habile homme qu'il était ; mais il ignorait nos coutumes et s'imaginait que ce qu'il avait écrit en bonne forme en siamois ne pouvait être que bien en français.
J'appris encore à Louvo, pour surcroît d'affliction, une méchante affaire qui était arrivée à nos Français qui avaient été retenus, et qui après le départ de M. l'abbé de Lionne et des mandarins siamois, craignant que je ne voulusse pas monter, s'étaient résolus de tout hasarder pour se rendre à Bangkok. Ils prirent pour cela des chevaux à Louvo, se rendirent en toute diligence à cinq ou six lieues de là, se saisirent d'un bateau et de quelques Siamois pour ramer et forcèrent trois ou quatre corps de garde jusqu'à ce qu'enfin, étant venus proche de Siam, ils se trouvèrent environnés de près de huit cents hommes qui s'étaient assemblés pour les arrêter. Quelques mandarins s'approchèrent d'eux et leur donnèrent parole qu'on ne leur ferait rien s'ils voulaient rendre leurs armes, et que le grand mandarin, ignorant la cause de leur fuite, n'avait envoyé après eux que pour les ramener à Louvo, ce qui les porta à ne se pas défendre, voyant bien d'ailleurs qu'il ne pourraient que succomber ; mais les Siamois ne s'en furent pas plutôt saisis, qu'ils les traitèrent de la manière du monde la plus indigne et la plus cruelle, les dépouillant, leur mettant la corde au cou et les reconduisant à Louvo attachés à la queue de leurs chevaux, qu'ils faisaient souvent courir, sans aucun égard pour mon propre fils le chevalier qui était du nombre, n'épargnant pas les coups de bâton et de pertuisane pour faire relever ceux qui tombaient accablés d'un pareil traitement ; en sorte que l'un d'entre eux mourut en chemin (1). Ils les avaient ensuite exposés à Louvo à une multitude de coquins qui, pendant trois heures, leur avaient craché au visage et fait tous les outrages imaginables.
Cette histoire, dont j'avais déjà appris confusément quelque chose en passant à Siam, me fit assez juger de l'extrémité de nos affaires par cette haine extrême dont le peuple se montrait animé contre nous. Je fis donc toutes mes diligences pour hâter mon retour à Bangkok, et fus contraint de sacrifier mes deux enfants, qu'on m'obligeait de laisser pour otages, afin de me rendre au plus vite où je croyais ma présence plus nécessaire pour l'honneur du roi et le bien public.
Je rencontrai en chemin M. l'évêque de Métellopolis, que le grand mandarin avait obligé de se rendre à Louvo, sous prétexte que le roi voulait conférer avec lui sur des affaires de conséquence. Son dessein était de s'assurer de sa personne pour l'envoyer à Bangkok quelque temps après moi, afin que si nonobstant toutes les raisons qu'il m'avait données et les gages que j'avais laissés, je manquais à me déterminer, il pût m'intimider par les suites fâcheuses qui allaient suivre mon refus. Car il lui déclara tout net dès la première audience qu'il croyait, à la vérité, que je monterais avec les troupes ; mais qu'il voulait encore le renvoyer après moi pour me déclarer que si je ne montais pas, il le ferait mettre lui, ses missionnaires, les pères et tous les chrétiens à la bouche du canon ; mais qu'au contraire tout irait bien si je montais (2).
Les dures extrémités que j'avais à craindre de mon refus n'empêchèrent pas qu'à mon arrivée à Bangkok, nous ne prissions tous unanimement la résolution de périr plutôt que de nous remettre à la discrétion des Siamois qui venaient de nous donner tant de preuves de leurs mauvaises intentions. On se hâta de pourvoir, du mieux qu'il fut possible, à la sûreté de la place. En même temps, les hostilités commencèrent par l'attaque d'un bâtiment appartenant au roi de Siam, dont l'équipage avait refusé de nous vendre des vivres, en nous outrageant de paroles (3).
Ce signal donné pour la guerre, je retirai les troupes que nous avions dans le vieux fort, situé à l'ouest de la rivière, parce qu'il ne nous était pas possible de le conserver (4). En même temps, j'ordonnai de démolir les parapets et d'enclouer toutes les pièces de canon qui ne crèveraient pas (5). Tout cela ne put si bien s'exécuter que les Siamois n'en tirassent encore beaucoup d'avantage. On ne tarda pas de s'apercevoir qu'ils travaillaient à réparer le fort, et à désenclouer le canon : ainsi l'on fut obligé de les aller attaquer avant qu'ils s'y fussent logés. Trois officiers, à la tête de trente hommes, furent commandés, dans deux chaloupes, pour cette expédition. Ces braves gens firent tout ce qu'on pouvait attendre de leur courage et de leur vigueur, mais accablés par la multitude des ennemis qu'on croyait en petit nombre, ils se virent contraints de se retirer avec perte de trois ou quatre hommes. Il ne resta aucun Français ni dans le fort, ni sur le rivage ; deux furent tués dans les chaloupes, et il y en eut deux ou trois de blessés.
Nous fimes ensuite un grand feu contre ce même fort, pour empêcher qu'ils n'y élevassent un cavalier auquel ils travaillaient, et qui aurait découvert toute notre place, et nous eûmes le plaisir de leur détruire plusieurs fois tous leurs travaux auxquels ils s'opiniâtraient toujours, quoiqu'ils perdissent un grand nombre de gens. Le feu que nous faisions de notre côté ne les empêchait pas non plus de charger et de tirer sans cesse contre nous les canons qu'ils avaient désencloués, et ceux qu'ils avaient fait venir de Siam avec des mortiers et des bombes, à quoi nous ne nous attendions pas, dont ils ne cessèrent de tirer pendant trois ou quatre jours ; ce qui nous fit beaucoup appréhender pour nos magasins et autres maisons qui n'étaient couvertes que de feuilles.
Il ne se passait guère de nuits qu'ils ne vinssent nous donner quelques fausses attaques pour nous lasser et faire toujours tenir notre garnison sur pied, et qu'ils ne fissent paraître des mèches allumées, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, pour nous ôter tout moyen de prendre aucun repos ou pour nous surprendre en effet, après tant de fausses attaques. Il serait difficile d'exprimer l'extrémité des fatigues où nous nous trouvions, tant par ces fréquentes alarmes et par le travail qui était presque continuel, que par le manque de nourriture et par la guerre que nous faisaient les maringouinsLes moustiques., qui est assurément une chose cruelle ; comme aussi par les grosses pluies qu'il faisait incessamment, pendant lesquelles nous avions beaucoup à craindre les surprises ; car les armes à feu auraient été inutiles et l'on n'eût pas pu distinguer un Siamois à un pas de soi.
Ce fut dans l'un de ces temps fâcheux qu'il entra dans notre place trois soldats siamois, qui par divers charmes dont ils avaient le corps garni, s'étaient crus invulnérables, et avaient entrepris de venir brûler nos maisons et nos magasins. Une de nos sentinelle se sentit plutôt blessée d'un de leurs coups qu'elle n'eût pu les apercevoir. On leur fit cependant sentir que nos armes avaient plus de pouvoir que leurs charmes. Il en mourut un sur la place, le second alla mourir dans le fossé, et le troisième fut détromper ceux qui se confiaient en ces sortes de secrets (6).
Nous restâmes ainsi les dix ou onze premiers jours, sans pouvoir apprendre la moindre nouvelle de qui que ce fût, et dans la croyance qu'on avait fait main basse sur tous les Français, et peut-être aussi sur tous les autres chrétiens, ne mettant plus notre espérance qu'à nous bien défendre et à nous empêcher de tomber vifs entre les mains de cette cruelle nation ; car nous ne pouvions recevoir du secours de dehors, ni retraite, ni composition de nos ennemis.
Dans ces circonstance, nous résolûmes de hasarder une petite barque appartenant à la Compagnie, et qui avait depuis peu relâché à Bangkok. Je l'envoyai sous la conduite du sieur de Saint-Crik, lieutenant, avec neuf soldats, pour tâcher de sortir de la rivière et de trouver, s'il y avait moyen, deux vaisseaux siamois montés par des Français qu'on avait envoyés depuis deux mois en course contre des corsaire. On voyait bien la difficulté et le péril qu'il y avait à descendre la rivière, mais dans des affaires désespérées comme les nôtres, il fallait beaucoup hasarder. Cette barque, après avoir essuyé quelques coups de canon du fort des ennemis, descendit hors de notre vue, ensuite de quoi elle fut si vigoureusement attaquée que nos gens ne purent empêcher l'abordage. Le sieur de Saint-Crik, homme d'une piété extraordinaire et dont la vertu ne diminuait en rien le courage, fit pour se défendre tout ce qu'un très vaillant homme peut faire, et mit enfin le feu à quantité de poudre et à toute les grenades qu'il avait semées sur le pont, pour dissiper la multitude dont il était accablé. La barque ayant ensuite échoué, et une infinité de galère l'ayant derechef environnée, en sorte qu'il ne restait aucune espérance de se tirer d'affaires, le sieur de Saint-Crik, après avoir fait quelques prières, les enferma tous la chambre. Quand le bâtiment fut entièrement rempli de Siamois, qui y montaient de tous côtés, et qu'il vit qu'il n'y en pouvait plus entrer et qu'ils se réjouissaient de leur prétendue victoire, il mit le feu aux poudres et fit sauter et la barque et tous les Siamois qui étaient dessus, qui pour la plupart moururent avec lui. Cette action généreuse étonna cette nation plus qu'on ne peut dire, et se répandit bientôt par tout le royaume (7).
Okphra Phetracha, de son côté, sur la première nouvelle que lui avait écrite le second ambassadeur dès qu'il fut arrivé avec moi à Bangkok, que je faisais difficulté de monter, n'avait pas manqué d'envoyer M. de Métellopolis, comme il s'était proposé. Mais ce prélat ne servit à Bangkok que de victime à la fureur dees Siamois, lesquels irrités extrêmement du nombre de leurs gens que notre canon tuait incessamment, se jetèrent sur lui, lui pillèrent tout ce qu'il avait dans son balon, lui arrachèrent sa croix pectorale et son anneau, prirent tous ses gens prisonniers et lui mirent enfin la corde au cou, le menaçant de l'exposer à notre canon (8).
Deux ou trois jours après mon arrivée à Bangkok, j'avais écrit une lettre au grand mandarin, par laquelle je lui avais fait savoir que tous les Français ayant appris les outrages qu'on avait faits à ceux de leur nation, et les bruits qui couraient publiquement qu'on ne les voulait tirer de la forteresse que pour les faire tous périr, n'avaient pas voulu accepter le parti de monter, et qu'ils étaient tous bien résolus à vendre cher leurs vie si on les poussait à bout. Que ce qu'ils avaient fait néanmoins, et faisaient encore, n'était que pour la défendre, et qu'ils étaient toujours prêts d'accepter des vaisseaux et de se retirer paisiblement, si on les leur voulait accorder. Après qu'il eut reçu ma lettre et que les mandarins lui eurent fait savoir notre entière détermination, il voulut tenter encore un dernier moyen, qui fut de me faire écrire par mes enfants, lesquels il avait fait mettre aux fers avec les autres officiers qui étaient à Louvo. Il leur fit lui-même cette lettre, qui portait : Qu'il n'y avait plus de vie pour eux, si je ne montais conformément à la parole que j'en avais donnée ; et que c'était encore une grâce qu'il leur faisait d'avoir différé leur châtiment et de leur avoir permis de me faire savoir l'état et le péril où ils se trouvaient. Je leur écrivis pour réponse : Que je donnerais volontiers ma vie, pour conserver la leur ; mais que quand il s'agissait de l'honneur du roi et de la conservation de ses troupes, il n'y avait nuls intérêts qu'il ne fallût sacrifier, qu'il leur devait suffire pour leur consolation de n'avoir point de crimes, et que le roi saurait bien venger quand il lui plairait les outrages qu'on leur pourrait faire.
Phetracha n'attendit pourtant pas cette réponse avant que de changer d'idée. Les nouvelles qui lui venaient incessamment de la manière dont nous nous y prenions le firent entièrement désespérer de nous avoir par aucun de ses artifices, et lui donnèrent apparemment le repentir de ne m'avoir pas arrêté lorsqu'il m'avait entre ses mains. Il jugea bien d'ailleurs qu'il ne lui serait pas si facile de nous avoir à force ouverte, par tous les travaux que nous faisions incessamment. Il avait à craindre que s'il faisait donner quelque assaut et qu'il s'y perdît un grand nombre de Siamois, cela ne les dégoûtât et ne leur fît peut-être détourner sur lui la fureur qu'il avait allumée contre nous. Il crut donc qu'il y avait moins de hasard pour lui, et qu'il lui serait plus facile pour le présent de travailler à se défaire des princes, car il en avait un entre ses mains et il avait déjà envoyé un grand mandarin nommé Okphra PolothepOkphra Pollathep (ออกพระพลเทพ). Dans son journal du 18 janvier 1686, l'abbé de Choisy mentionne ce dignitaire qui a soin des revenus du roi., qui était à sa dévotion, avec mille soldats, et avec ordre d'en lever encore mille dans la ville de Siam, prétextant qu'il savait qu'il y avait des séditieux. Il avait encore détaché plusieurs mandarins affectionnés au prince qui était dans cette ville, pour les envoyer à Bangkok contre nous, et il avait de plus fait arrêter sous divers prétextes les principaux mandarins, desquels il se pouvait défier, de sorte qu'il s'était rendu par ses adresses le maître de la ville et du palais de Siam, et avait réduit le prince hors d'état de lui résister.
Il fit donc assembler les principaux mandarins qui étaient à Louvo, et se plaignant fortement devant eux des princes, de ce qu'il disait avoir appris pour certain, que pour remerciement des bons services qu'il leur avait rendus ils avaient résolu de se défaire de lui, leur demandant ce qu'ils trouvaient à propos de faire là-dessus. Je pense bien que beaucoup d'eux virent pour lors où il en voulait venir, mais sa puissance était trop grande pour qu'aucun osât rien faire paraître qui pût en attirer un mauvais parti. Il avait eu soin d'engager les principaux en leur faisant espérer de nouvelles charges et dignités, et il n'avait mis à la tête de ses troupes et à la garde des endroits les plus importants que ceux qu'il savait bien être entièrement à lui. Tous conclurent donc que ces princes étaient des ingrats qu'il fallait punir. Il envoya aussitôt ses ordres pour se saisir de celui qui était à Siam et l'amener à Louvo ; puis il les envoya tous deux sur le champ à une certaine pagode près de Thalep Chubson, pour les faire mourir à coups de bois de santal, enveloppés dans des sacs d'écarlate, suivant la coutume du royaume de se défaire des princes de sang (9).
Voilà comme cet adroit politique s'ouvrit incessamment le chemin pour monter sur le trône où il aspirait, quoiqu'on ne puisse nier qu'il n'ait eu bien du bonheur d'avoir pu mettre tant de têtes à bas sans exciter le moindre remuement dans le royaume. On ne peut douter aussi qu'il ne s'y soit pris fort adroitement et en homme de grand esprit, quoique le sieur Constance me parlant de lui dit que c'était une bête, qui n'était pas capable de rien faire réussir. Il avait joué au plus sûr, et de la manière qu'il s'y était pris, s'il n'avait pu s'emparer de la couronne sans trop hasarder, il aurait pu se contenter de la seconde place du royaume, qui ne lui pouvait manquer sous le règne des princes.
L'ancien roi était encore en vie quand il se défit d'eux. Il mourut le jour suivant (10), après quoi Phetracha donna de grandes charges à tous ceux qui l'avaient servi, éleva tous les mandarins qu'il avait à ménager, et délivra même tous ceux qu'il avait fait arrêter prisonnier, pour se gagner le cœur de tous par des actions de clémence. Il soulagea le peuple de ses servitudes et leur fit faire même des aumônes publiques, lesquelles, quoique de peu de dépense, ne laissèrent pas de le faire louer et estimer ; de sorte qu'il n'est pas arrivé dans le royaume la moindre sédition ni révolte à son occasion.
Pour la princesse, il aima mieux la garder pour en faire son épouse que de lui faire le même parti qu'il avait fait aux princes. Il s'attacha à gagner ses bonnes grâces. On croyait qu'il la réservait pour son fils, mais il aima mieux la prendre pour lui. On dit que cette princesse ressentit une douleur extrême de la mort de celui qui était ou devait être son époux, et que dans ces emportements, elle ne gardait nulles mesures contre celui qui en était l'auteur, et se repentait fort d'avoir été si contraire aux Français. Mais après tout, elle a mieux aimé vivre reine que de mourir malheureuse. La cérémonie publique du mariage n'était pas encore faite avant notre départ, mais on ne doutait pas que les choses n'en vinssent là.
Phetracha n'eut pas plutôt pris le parti de travailler à se défaire des princes qu'il pensa au moyen de s'accommoder avec nous, et de nous faire sortir de son royaume en paix. Il résolut pour cela de m'envoyer mes enfants, comme une marque de considération qu'il avait pour moi. Il les fit donc venir devant lui, et les ayant d'abord voulu intimider de la mort, pour éprouver leur constance, il leur dit : Qu'il se sentait ému de compassion pour eux, et qu'il connaissait d'ailleurs la droiture de mon cœur, et savait bien que je n'étais pas capable de manquer à ma parole ; mais que c'étaient les troupes qui, sur des terreurs paniques, n'avaient pas voulu obéir, qu'il leur donnait la vie, et voulait bien même en ma considération et par amitié pour eux, me les renvoyer. Il ne leur fit pourtant encore aucune proposition pour nous.
La réponse que j'avais faite à leurs lettres les rencontra en chemin et fut néanmoins rendue au grand mandarin. Ils se rendirent à Bangkok le jour de saint Jean-Baptiste (11), apportant avec eux une grande joie à toute la garnison, qui les avait crus morts aussi bien que tous les autres Français qui étaient entre les mains de cette nation. J'eus de la peine à concevoir pourquoi le grand mandarin en avait usé de la sorte, mais dans la suite, ayant appris la prise et la mort des princes, je conjecturai qu'il avait voulu par cette action de générosité, s'ouvrir un chemin à la paix avec nous ; et les deux mandarins que nous avons interrogés sur ce point m'ont confirmé dans mes sentiments.
Depuis ce temps-là, le feu cessa un peu de part et d'autre. Il se fit diverses propositions d'accommodement. Le temps, le feu mis à la barque et la mort des princes ralentissaient beaucoup la fureur des Siamois contre nous, qui dans les commencements était si grande et si générale, que jusqu'aux femmes mêmes, elles venaient de leur bon gré, et comme par dévotion, apporter et préparer à manger aux soldats et aux autres qui travaillaient à leurs forts, voulant par ce moyen avoir part à notre défaite. Toutefois, depuis le commencement de la guerre jusqu'à notre entière sortie, qui ne fut que cinq mois après, nous n'avons jamais été aucun temps où il n'y eût à craindre et où il ne fallût toujours tenir presque toute notre garnison sur pied, nonobstant les paroles et les assurances qu'ils nous donnaient et qu'ils rétractaient aussi quand il leur plaisait. Les bruits étaient si forts qu'ils ne nous parlaient d'accommodement que pour nous tromper et pour nous surprendre par cet artifice que nous ne pouvions nous assurer de rien. Je crois que la plus cruelle chose qui soit au monde est de se voir comme nous étions, en nécessité de traiter avec des gens en la parole desquels on sait qu'on ne se doit pas fier.
Sur la fin de ces longues et ennuyeuses négociations, pendant lesquelles je trouvai le secret de garnir la place de vivres (12), les deux vaisseaux montés par des Français arrivèrent, et ceux-ci se rendirent avec nous dans la place. On nous rendit de même les officiers qui avaient été détenus prisonniers à Louvo. Quelques autres Français qui étaient aussi à Louvo et à Siam trouvèrent le secret de nous rejoindre, et nous apprîmes alors tous les mauvais traitements des Siamois à leur égard, la persécution que les chrétiens siamois, pégous et portugais avaient soufferte et souffraient encore dans un cruel esclavage ; que le séminaire de M. l'évêque de Métellopolis avait été entièrement pillé et qu'ils avaient exigé ou pris par force du camp portugais des jeunes filles chrétiennes pour en faire des concubines. On sut aussi par un missionnaire qui avait été pris et mis à la cangue avec tous les chrétiens d'une province nommé PorcelouPhitsanulok (พิษณุโลก) dans le nord de la Thaïlande., qui est à l'extrémité du royaume, que dès le mois de janvier ils avaient été sur le point d'être arrêtés, et que depuis on n'avait point cessé de les intimider de ce qui est arrivé dans la suite (13). Ce qui marque qu'il y avait longtemps que Phetracah avait pris les mesures pour faire ce qu'il a exécuté depuis.
Nous apprîmes aussi par un Français qui avait été fait prisonnier à Mergui, que M. du Bruant et les Français qui étaient sous son commandement avaient souffert un assaut et que manquant d'eau et commandés dans leur place par une batterie que les Siamois avaient faite, ils s'étaient retirés à travers du feu des ennemis, et s'étaient emparés d'un vaisseau du roi de Siam.
Peu de temps après, nous eûmes la nouvelle de l'arrivée d'un vaisseau du roi nommé l'Oriflamme, commandé par M. de l'Estrille (14), qui demeura assez de temps à la rade, fort en peine de ne recevoir aucune de nos nouvelles, ni des officiers qui étaient descendus les premiers et que les Siamois, qui savent mentir et fourber autant qu'aucune nation du monde, avaient fait adroitement conduire à Siam, sans passer devant notre forteresse ni leur rien dire de tout ce qui était arrivé. Si nos affaires n'eussent pas été en termes d'accommodement, ces officiers et la chaloupe auraient couru grand risque, et ce vaisseau ne nous eût pu donner aucun secours, par l'impossibilité où il était d'entrer dans la rivière, et d'avoir même la moindre communication avec nous. Ce qui marque combien le poste où nous étions était mal situé et peu avantageux, et que tôt ou tard il nous aurait fallu l'abandonner.
Sur ces entrefaites, il nous arriva une nouvelle affaire qui pensa derechef tout rompre. La femme du sieur Constance, après avoir été cruellement tourmentée pour lui faire déclarer tous les effets de son mari et avoir souffert divers autres outrages, tant de la part de ces misérables bras-peints à qui l'on avait confié sa garde, que de la part du fils de Phetracha, qu'on nomme à présent le prince et qui s'en trouva brutalement passionné, avait trouvé le moyen de s'évader et de se rendre à Bangkok ; ce qui fut su des mandarins, et ensuite du roi, qui nous fit déclarer qu'il n'y avait aucun accommodement à moins qu'on ne la rendît. Ils craignaient qu'étant hors du royaume, elle ne s'emparât et ne leur fît perdre les deniers que son mari en avait fait sortir. Quoique je fusse extrèmement inquiété de cette nouvelle affaire, qui s'était faite sans ma participation et qui venait dans un contretemps très fâcheux (les Siamois nous retenant à sa considération les matelots, câbles, ancres et autres choses qui nous étaient absolument nécessaires pour notre sortie et que j'avais eu toutes la peine du monde à ménager), je crus pourtant que je ne la pouvais rendre sans pourvoir à sa sûreté. Je voulus même tenter d'obtenir du roi sa sortie, mais on ne voulut jamais écouter ma proposition, et la guerre allait se rallumer de nouveau et plus cruellement que jamais. On avait déjà fait arrêter à Siam le sieur Véret, que j'y avais envoyé pour achever nos affaires, tous les missionnaires et un père jésuite qui y était encore, et on menaçait de cruels châtiments tous les parents de cette veuve, dont les Siamois s'étaient saisis ; de sorte que sa mère m'écrivit et me pria instamment d'accommoder cette affaire ; ce que je fis par un traité dans lequel le roi de Siam même engagea sa parole qu'il la laisserait, elle et toute sa famille, en liberté de conscience, et de se marier à qui elle voudrait, et empêcherait qu'il ne lui fût fait aucune violence par qui que ce fût ; moyennant quoi je la renvoyai (15).
Enfin toutes nos affaires s'était diverses fois interrompues et raccommodées, les Siamois s'accordèrent à nous donner trois vaisseaux, des vivres et tout ce qui nous était nécessaire, et deux grands mandarins en otages, pour nous conduire jusque hors du royaume. Et nous, à ne faire aucun mal à leur place et d'en sortir tambour battant, mèche allumée, armes et bagages (16). Ce que nous fîmes le jour des morts (17). On disait encore pour lors que les Siamois nous attaqueraient infailliblement dans notre sortie, ou à la descente de la rivière. Nous nous tenions toujours sur nos gardes, et ils n'entreprirent rien. Ils nous firent seulement une nouvelle chicane après que nous fumes en rade, nous retenant quelques mirous, où il y avait même de notre canon, qui avaient échoué dans une basse-eau proche de leurs forts. Ce qui nous a fait retenir leurs mandarins qui nous reconduisaient et devaient nous répondre de tout notre bagage.
Il est presque incroyable combien de travaux ils ont été obligés de faire contre nous. Outre ce cavalier de terre qu'ils avaient élevé de nuit, nonobstant notre canon, sur le fort de l'ouest dont ils étaient les maîtres, ils nous avaient de plus environnés de palissades à une petite portée de canon, et ensuite investis de neuf forts qu'il avaient garnis de canon et qui nous battaient de revers dans toute la place. Ils avaient de plus fait, depuis Bangkok jusqu'à l'embouchure de la rivière, plusieurs forts pour empêcher le secours qui nous aurait pu venir de dehors, où il y avait plus de cent quarante pièces de canon en batterie, qu'ils avaient fait descendre de Siam, et ils avaient pour cela ouvert un bras de la rivière pour n'être pas obligés de la passer à notre vue.
Ils avaient de plus, par un travail terrible, garni toute la barre par où les navires peuvent entrer de cinq ou six rangs de gros et hauts arbres qu'ils y avaient plantés en basse marée et qui tenaient si fort qu'il n'était pas possible de passer par-dessus, n'y ayant laissé qu'un endroit à passer, qu'ils pouvaient aisément fermer avec une chaîne de fer, et y tenant toujours un grand nombre de galères armées pour le garder. On n'aurait assurément pas cru ces peuples capables de toutes ces choses. Il est vrai que presque tous les étrangers qui étaient dans le royaume les avaient beaucoup aidés contre nous. Ils avaient des Anglais et des Portugais sur leurs bâtiments pour les commander et pour garder l'entrée de la rivière, des Hollandais pour tirer leurs bombes, et nous étions bloqués, outre l'armée des Siamois, par les Pégous, Malais, Chinois, Mores, et autres, qui avaient chacun leurs forts où ils étaient retranchés.
À la vérité il eût été facile d'empêcher la construction de ces forts si nous avions eu de la poudre en quantité, mais nous n'en aurions pas eu pour huit jours si nous avions fait jour et nuit le feu qui était nécessaire pour en empêcher la construction. Et ainsi, quoiqu'ils continuassent toujours d'y travailler, même depuis le renvoi de mes enfants, et dans le temps qu'ils faisaient des propositions d'accommodement, ce qui nous les rendaient fort suspectes, j'aimai mieux ménager la poudre et gagner du temps que de m'exposer à nous voir au bout de peu de jours hors d'état de les repousser s'ils en venaient à un assaut. Et la suite a bien fait voir qu'on ne pouvait prendre un autre parti dans les circonstances où nous étions.
Il était à la vérité fort douteux et fort incertain, si leurs propositions étaient sincère ; mais il était encore plus certain que c'était tout perdre que de ne les pas écouter, et c'était ce qui me faisait souvent dire à la plupart des officiers qui ne respiraient que le feu, que nous serions toujours à temps de faire le coup de désespoir, mais que le temps pourrait peut-être apporter ce que nous ne pouvions espérer de tous les efforts que nous aurions pu faire. Je faisais assez savoir à nos ennemis, par les lettres que je leur écrivais, que s'ils n'agissaient de bonne foi et ne m'accordaient mes demandes, je commencerais de faire sauter leur fort, crever tous leurs canons de fonte que j'avais à ma disposition, et que j'irais avec toute ma garnison fondre sur eux, leur demandant en ce cas l'unique grâce de ne faire quartier à aucun Français, de même que je leur promettais de n'en faire à aucun de ceux d'entre eux qui tomberait entre nos mains. Mais je ne croyais pas qu'il en fallût venir là qu'à la dernière extrémité, et quand il n'y aurait plus d'espoir d'aucune meilleure composition. La suite m'a bien confirmé que quoiqu'on ne voie aucun moyen de se tirer d'une méchante affaire, il n'en faut pourtant jamais désespérer, mais au contraire se confier toujours que le temps y pourra apporter quelques changements.
Celui qui arriva à la mort des princes commença à mettre nos affaires en meilleur état. La résolution où nous leur faisions savoir que nous étions tous, et dont le sieur de Saint-Crik leur avait donné des preuves, ne servit pas peu encore à les intimider ; mais je dois avouer en finissant cette relation, que la crainte de la vengeance de notre auguste monarque, dont les ambassadeurs Siamois avaient vu la puissance, a contribué plus que toute autre chose aux conditions avantageuses qu'ils ont été contraints de nous accorder.
Fin de la relation de Desfarges.

NOTES :
1 - On ignore la date exacte de cet incident. Dans la relation de La Touche, rapportée par Robert Challe, on peut lire : (...) il y avait à Louvo six officiers français qui sont MM. les chevaliers Des Farges, de Fretteville, Beauchamp, de Lasse, Des Targes et Saint-Vendry [Saint Vandrille], et un ingénieur nommé de Bressy [parfois de Brécy], lesquels, depuis que M. Constance avait été arrêté, n'avaient pu obtenir la licence de s'en retourner à Bangkok, et quoiqu'ils fussent bien traités, ils ne laissaient pas de craindre dans la suite un pareil ou plus méchant sort que les chrétiens. C'est pourquoi ils se résolurent de tenter le hasard pour se sauver, et pour cet effet, ils se mirent en chemin de nuit pour se rendre à Siam, faisant leur compte qu'y étant arrivés, ils prendraient un balon au comptoir de la Compagnie pour les porter à Bangkok. C'était à la vérité une entreprise de jeunesse : elle aurait été approuvée si elle avait réussi, mais il faut remarquer que de Louvo à Siam il y a quatorze grandes lieues, que tout le pays est presque inondé dans un temps pareil ; que de Siam à Bangkok il y a trente lieues et tout le bord de la rivière rempli de corps de garde, de sorte qu'il ne pouvait passer un balon, de nuit ni de jour, qu'il ne fût arrêté et visité. Mais ils furent exempts de tous ces embarras, car le lendemain à la pointe du jour, ils se trouvèrent environnés de plus de huit à neuf cents hommes, tant cavalerie qu'infanterie, que Phetracha avait envoyé après eux, ayant eu avis de leur fuite. Ces six messieurs ne trouvèrent point d'autre parti à prendre que de se bien défendre si on les approchait et qu'on voulût les insulter, de sorte qu'un mandarin jugeant de leur dessein à leur posture s'approcha seul d'eux pour leur dire qu'il ne venait pas après eux pour leur faire du mal, mais bien par ordre du roi pour les ramener à Louvo. Ils se rendirent à ces belles paroles, la partie d'ailleurs n'étant pas égale. Ils furent ce jour-là traités avec assez de douceur et d'honnêtetés, mais le lendemain, comme ils ne se tenaient plus sur leurs gardes, ne se méfiant de rien, les Siamois les ayant tous surpris, les dépouillèrent tout nus, les attachèrent à la queue de leurs chevaux, et les maltraitèrent si fort que le sieur de Bressy, ingénieur, mourut par le chemin de la fatigue, et que peu s'en fallut que les autres n'en fissent autant et ne payassent de leur vie leur tour de jeunesse, ayant beaucoup souffert. (Cité par Popin et Deloffre, Journal du Voyage des Indes orientales de Robert Challe, 1998).
Quelques années plus tard, dans une lettre du 27 décembre 1693 adressée à Jacques de Brisacier, le directeur du séminaire des Missions Étrangères, Kosapan, devenu phra khlang de Phetracha, donnera la version siamoise de cet incident : De plus, les fils de M. le général et les autres officiers qu'il avait laissés à Louvo pour gage de sa parole, étant allés se promener à cheval comme ils faisaient quand ils le désiraient, s'enfuirent et voulurent se rendre à Siam, et ne sachant pas que c'était les enfants de M. le général, ni des officiers français, mais croyant voir là quelques Anglais et gens de la faction de M. Constance, les poursuivirent, se saisirent de plusieurs d'entre eux qui s'étaient déjà embarqués sur la rivière et de plusieurs qui étaient encore à terre ; les ayant attachés, elles les ramenèrent à Louvo. Aussitôt que les mandarins eurent connus que ce n'étaient pas des gens de la faction de M. Constance, mais les enfants de M. le général avec les officiers français, ils les firent détacher, et leur donnèrent des hommes qui eussent soin de les traiter et nourrir, comme auparavant, dans leur maison. Il est vrai que l'ingénieur, se voyant poursuivi et pressé par les sentinelles, donna plus de peine à prendre que les autres ; mais après avoir bien couru de côté et d'autre, étant extrêmement fatigué, il s'arrêta pour se reposer ; aussi il tomba comme évanoui ; on fit ce qu'on put pour le soulager, mais les remèdes qu'on lui donna furent inutiles : il mourut. (Cité par Launay, Histoire de la mission de Siam), I, p. 285). ⇑
2 - On se souvient que Mgr Laneau, malade, n'avait pu se rendre à Lopburi à la fin du mois de mai, et que seul l'abbé de Lionne s'y rendit pour rencontrer Phetracha. Cette rencontre entre Desfarges et Mgr Laneau, évêque de Métellopolis, est confirmée dans une lettre de Bernard Martineau aux directeurs du séminaire des Missions-Étrangères du 12 juillet 1689 (Launay, op. cit., I, p. 206) : Pour Mgr de Métellopolis, il fut derechef appelé à Louvo, nonobstant sa maladie, avec ceux des missionnaires qui savent le mieux la langue de Siam. L'appel étant très pressant, il s'y rendit, partit du séminaire le 4 juin avec MM. Ferreux et Le Chevalier. À moitié chemin de Louvo, ils rencontrèrent M. le général avec l'accompagnement que j'ai dit ci-dessus [l'abbé de Lionne, M. de la Vigne, les deux mandarins et cinq grands balons d'escorte] qui s'en retournait à Bangkok. Il semble que l'abbé de Lionne ait reçu les mêmes menaces que Mgr Laneau quelques jours auparavant. ⇑
3 - Vollant des Verquains confirme l'attaque de ce navire qui marqua le début des hostilités (Histoire de la révolution de Siam, 1691, pp. 80 et suiv.) : Sur l'heure même on commença de songer aux moyens de soutenir la guerre, puisqu'il fallait l'entreprendre, et de subsister dans la suite ; on délibéra de tuer 80 ou 100 vaches, dont on était redevable à la prévoyance de M. Constance, et de les saler, mais il se trouva qu'il manquait de sel dans les magasins. Dans l'embarras où l'on était, il passa devant Bangkok une somme chinoise, c'est un grand bâtiment à trois mâts fort relevé de bord, et fait à plate varangue afin d'entrer facilement dans toutes les rivières qui sont au-delà des détroits, lesquelles sont toutes barrées à leur embouchure.
Ayant eu avis que sa cargaison était de sel et de poivre, on envoya un officier avec quatre mousquetaires à bord de ce bâtiment pour y acheter ce qui était nécessaire, mais le capitaine en refusa à quelque prix que ce fût, et on n'en put rien obtenir, ni par prière ni par menaces ; au contraire l'officier lui ayant dit en le quittant qu'on allait tirer sur lui avec le canon de la forteresse, il répondit fièrement qu'il en avait aussi dans sa somme, se laissant néanmoins toujours dériver par la marée. Son refus ayant été rapporté à M. Desfarges, il ordonna de lui envoyer plusieurs volées de canon qui furent sans effet, mais le Chinois ne répondit pas des siens, comme il l'avait promis.
Bangkok, qui est la clé du royaume de Siam du côté de la mer du sud a deux forteresses, l'une à l'ouest de la rivière, l'autre vis-à-vis, qui avait été rebâtie de nouveau et fortifiée plus régulièrement par les Français. Les mandarins qui étaient demeurés dans le fort de l'ouest, ayant ouï le bruit du canon, jugèrent que c'était le signal de la guerre et partirent promptement pour en porter la nouvelle à Phetracha, pendant que le Siamois gouverneur de la contrée allait de tous côtés ramasser des milices et prendre les précautions nécessaires pour prévenir la suite des hostilités qui commençaient. ⇑
4 - Deux raisons présidèrent à l'abandon de ce fort : d'une part, les troupes n'étaient pas assez nombreuses pour défendre deux places (La Touche indique qu'il n'y avait plus alors que deux cent cinquante hommes, tant officiers que soldats), et d'autre part, les deux forts se faisant face, les Français risquaient de se tirer dessus d'un fort à l'autre. ⇑
5 - Enclouer, c'est boucher la lumière d'une pièce d'artillerie avec un clou d'acier de forme carrée que l'on y fait entrer de force, de manière qu'il la remplisse exactement. Lorsqu'on ne peut plus l'enfoncer plus avant, on donne un coup de marteau sur le côté, afin de le casser net, pour que l'ennemi ne puisse l'accrocher avec les tenailles et l'arracher. (...) On encloue ses propres canons, lorsque l'on est forcé de les abandonner, comme on les encloue à l'ennemi pour qu'il ne puisse s'en servir. (Alexis Toussaint de Gaigne, Nouveau dictionnaire militaire, 1801, p. 199). ⇑
6 - Le père Le Blanc relate cet épisode mais ne mentionne que deux soldat malais (Histoire de la révolution du royaume de Siam, pp. 260-261) : Il y eut même deux Malais, qui s'étant enivrés d'opium, furent assez hardis pour passer les fossés de la place à la nage et attaquer une de nos sentinelles dans une nuit obscure et orageuse. Un d'eux blessa la sentinelle d'un coup de kriss et ils se colletèrent ensemble longtemps jusqu'à ce qu'un cadet nommé Courtin tira au hasard du côté qu'il avait entendu du bruit, et tua heureusement le Malais sans blesser le Français. On battit aussitôt la générale de crainte de surprise et l'autre Malais s'enfuit ; mais en fuyant, il fut blessé par le grand feu qu'on fit en cet endroit, car le lendemain on trouva des traces ensanglantées. ⇑
7 - On trouve également dans d'autres relations l'orthographe Saint-Cry, Saint-Cri, Saint-Cric, Saint-Cricq ou encore Saint-Christ. Il existe plusieurs variantes de cet épisode. On pourra comparer avec les versions de Vollant des Verquains, du père d'Orléans, du père Le Blanc, de Beauchamp, etc. qui différent par quelques détails ou qui apportent quelques précisions supplémentaires. Nous reproduisons ici la version de l'officier la Touche, rapportée par Robert Challe : Il y avait en mer deux vaisseaux du roi de Siam commandés par des Français. M. Des Farges s'étant persuadé que ces deux vaisseaux-là lui seraient d'un grand secours s'ils étaient devant sa forteresse, résolut de faire sortir une double chaloupe de la Compagnie qui était à Bangkok pour aller chercher ces deux vaisseaux, et la donna à commander au sieur de Saint-Christ, lieutenant d'une compagnie et enseigne de vaisseau, et lui donna douze soldats avec lui et quelques autres Français pour faire la manoeuvre. On ne savait pas pour lors que la barre de la rivière fut si bien gardée qu'elle était. Le sieur de Saint-Christ fut donc jusque proche de la barre sans que personne lui dît rien. Mais là il trouva à qui parler, car son maître [dans la marine, le maître est le commandant des manœuvres d'un vaisseau], lui ayant déserté après avoir échoué sa barque, se jeta dans le parti des Siamois, leur dit le fort et le faible, et d'un d'un coup, cet officier se vit aborder par une très grande quantité de galères, et comme ses soldats qui étaient Bretons ne le pouvaient seconder en rien, tous étant ensevelis dans le vin, il déclara à tous ceux de sa barque qu'il n'empêchait point qu'ils tâchassent de se sauver s'ils le pouvaient, et ensuite se retira où étaient les poudres, et lorsqu'il vit sa barque toute entourée de galères et comblée de Siamois haut et bas, il mit le feu aux poudres, et la fit sauter. De sorte que les Siamois ont eux-mêmes estimé la perte qu'ils firent d'hommes dans ce moment-là, tant de tués, de noyés que d'estropiés, à plus de quatre cents. Ce pauvre officier périt avec eux par la trahison de son maître et la brutalité de ses soldats ; il ne s'en sauva que deux personnes seulement, que les Siamois firent prisonniers et qu'ils ont ensuite rendus à M. Des Farges. (Cité par Deloffre et Popin, Journal du voyage des Indes orientales de Robert Challe, Droz, 1998). ⇑
8 - Épisode confirmé par La Touche (Deloffre et Popin, op. cit. : Je vous dirai aussi que dès le commencement du siège, tous les Français qui étaient à Siam et à Louvo furent tous faits prisonniers et traités de la dernière rigueur. Mgr l'évêque de Métellopolis fut conduit à Bangkok, dans l'armée ennemi. Il fut dépouillé nu, fort maltraité, attaché à un poteau et exposé pendant vingt-quatre heures à l'endroit où nous batteries faisaient le plus de feu, les Siamois s'imaginant que cela nous obligerait de cesser. Tous les prêtres missionnaires français qui étaient à Louvo ont tous été faits prisonniers après qu'on leur a eu tout pris, et pillé leur séminaire. ⇑
9 - Vollant des Verquains écrit (op. cit. pp. 97-98) : Phetracha tenait les deux frères enfermés, et toutes choses prêtes pour leur supplice ; il ne jugea pas qu'il fût à propos de le différer plus longtemps, c'est pourquoi le 19 juillet il les livra à un gros détachement de ses plus affidés sous les ordres de Soyatan son fils, qui les conduisit vis-à-vis d'une pagode entre Louvo et Thale Chubson, maison de plaisir du roi de Siam, où ayant été mis chacun dans un sac de velours écarlate, on leur pressa l'estomac avec du bois de santal, qui est le plus précieux des Indes, et ainsi on les étouffa selon la coutume de ces nations, qui ne répandent jamais le sang de leurs princes et estiment ce genre de mort le plus honorable. La date du 19 juillet indiquée par l'ingénieur est très certainement fausse. Toutes les relations situent l'exécution des princes avant la mort du roi Naraï, qui arriva le 10 ou le 11 juillet. On peut dater cette double exécution vers le 8 juillet 1688.
Dans son ouvrage Du Royaume de Siam (I, p. 402), La Loubère confirme ce mode d'exécution : S'il est question de faire mourir un prince dans les formes, comme il peut arriver, ou lorsqu'un roi veut se défaire de quelqu'un de ses proches, ou lorsqu'un usurpateur veut éteindre la race à laquelle il a ravi la couronne, ils se font une religion de ne pas répandre le sang royal, mais ils feront mourir le prince de faim, et quelquefois d'une faim lente en lui soustrayant tous les jours quelque chose de ses aliments, ou ils l'étoufferont avec des étoffes précieuses, ou bien ils l'étendront sur de l'écarlate, dont ils font grand cas, parce que la laine y est rare et chère, et là ils lui enfonceront l'estomac avec un billot de bois de santal. Ce bois est odoriférant et fort estimé. ⇑
10 - Vollant des Verquains (op. cit. p. 99) date la mort du roi au 11 juillet, date conforme à celle donnée par l'Abrégé de ce qui s'est passé à Bangkok pendant le siège de 1688 conservé aux Archives Nationales sous la cote Col. C1/24 (f° 158r°). Le père de Bèze (Drans et Bernard, 1947, p. 144) indique le 10 juillet à 10 heures du soir. ⇑
11 - Le 24 juin. Cette date est confirmée par l'Abrégé de ce qui s'est passé à Bangkok pendant le siège de 1688 (f° 156v°) : Le 24, nous vîmes arriver M. l'évêque de Métellopolis de l'autre bande avec MM. Desfarges que Phetracha renvoyait très généreusement avec une lettre à M. Desfarges où il se plaignait qu'il ne lui avait pas tenu sa parole. Ces messieurs passèrent le même jour de notre côté et M. l'évêque resta détenu de l'autre. ⇑
12 - Dans le but d'affamer les Français, les Siamois avaient encerclé le fort et interdiction de vendre des vivres à la garnison. Toutefois, comme le note le père Le Blanc (op. cit., I, p. 262) : Mais ce blocus n'eut pas l'effet qu'ils en avaient espéré, car les Chinois de la ville de Bangkok, gens déterminés à sacrifier leur liberté et leur vie à l'avidité qu'ils ont pour l'argent, venaient de nuit par la rivière qui n'était point fermée vendre des vivres dans la forteresse, malgré les défenses rigoureuses de Phetracha. ⇑
13 - Les pères Monestier et Angelo, qui administraient une petite communauté chrétienne à Phitsanulok, furent arrêtés avec une quarantaine de leurs fidéles, et avec un luxe de moyens assez disproportionné, s'il faut en croire le journal de la mission tenu par Bernard Martineau : Je dirai seulement que les Siamois, pour ne pas manquer leur coup, vinrent à eux au nombre de 300 armés de mousquets, lances, sabres, avec trois éléphants portant chacun une pièce de canon ; il est vrai qu'il prirent encore 42 chrétiens qu'ils mirent aux fer avec eux. (Cité par Launay, Histoire de la mission de Siam I, p. 236). ⇑
14 - Parti de Brest au mois de janvier 1688, le vaisseau du roi l'Oriflamme, commandé par M. de l'Estrille, arriva au Siam vers le 10 septembre. Une de ses missions était de venir renforcer la garnison du Siam. À cet effet, l'Oriflamme avait embarqué 200 hommes de troupe, dont beaucoup moururent en route. L'apparition de l'imposant vaisseau puissamment armé fit une grosse impression sur les Siamois. ⇑
15 - Desfarges ne s'attarde pas beaucoup sur cet épisode, qui reste sans doute le plus honteux, le plus accablant, et le plus contraire à l'honneur que la postérité puisse lui reprocher. Il est probable que la décision du général a été très largement dictée par la cupidité, ce qui rend le geste encore plus inexcusable. Desfarges était très certainement en possession d'une partie des pierres précieuses que lui a confiées Phaulkon. Dans sa relation, Robert Challe citant La Touche écrit : Madame Constance n'a pas été exempte de ces tyrannies, car après la mort de son mari, ses biens lui ont tous été ravis. Elle a été faite prisonnière, soumise à de très rudes questions, et cela pour l'obliger de dire ce qu'étaient devenues toutes les pierreries et bijoux de son mari. Elle en a déclaré à la vérité qui avaient été confiés par M. Constance à quelque personnage que je ne nomme point et qui ne lui profiteront pas beaucoup. On ne peut être plus clair. En accueillant Mme Constance, Desfarges se voyait contraint de restituer le trésor et de renoncer à une fortune qui, en toute justice, ne lui profita guère.
Les missionnaires, et particulièrement Louis Laneau, l'évêque de Métellopolis, eurent une grande responsabilité dans l'abandon de Mme Constance. Pour répondre à l'indignation suscitée en France par une décision aussi indigne et aux virulentes critiques des jésuites, l'abbé de Lionne rédigea une laborieuse justification : Mémoire sur l'affaire de Mme Constance Phaulkon. ⇑
16 - Un traité de capitulation, appelé Papier de répondance fut négocié par Louis Laneau et Véret pour fixer les modalités du retrait de la garnison française. ⇑
17 - Le 2 novembre 1688. ⇑

21 février 2019
