

1ère partie.
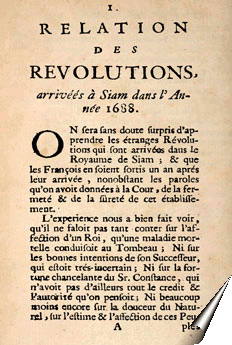
On sera sans doute surpris d'apprendre les étranges révolutions qui sont arrivées dans le royaume de Siam et que les Français en soient sortis un an après leur arrivée, nonobstant les paroles qu'on avait données à la cour de la fermeté et de la sûreté de cet établissement.
L'expérience nous a bien fait voir qu'il ne fallait pas tant compter sur l'affection d'un roi qu'une maladie mortelle conduisait au tombeau, ni sur les bonnes intentions de son successeur, qui était très incertain (1), ni sur la fortune chancelante de M. Constance, qui n'avait pas d'ailleurs tout le crédit et toute l'autorité qu'on pensait ; ni beaucoup moins encore devait-on faire fond sur la douceur du naturel, sur l'estime et l'affection de ces peuples envers les Français, puisque nous les avons vus, au contraire, pleins de haine et de fureur pour nous perdre.
J'ai cru devoir faire le récit moi-même de ce qui s'est passé, personne ne pouvant savoir mieux que moi les raisons qui m'ont porté à faire ce que j'ai fait ; ce qu'il n'était pas à propos de communiquer à beaucoup de gens, qui ne laisseront pas toutefois d'en vouloir écrire ce qu'ils en pensent.
On va trouver dans la suite de ce discours des couronnes renversées, deux princes et un fils adoptif du roi massacrés, la perte de la maison et de la vie du sieur Constance, plusieurs grands mandarins dans les fers, un Siamois monter adroitement sur le trône, tout le royaume enfin s'armer avec une infinité d'étrangers pour nous faire périr à force ouverte et l'avoir inutilement tenté par toutes sortes d'artifices. On y verra aussi, au milieu de toutes ces étranges révolutions, le nom de notre grand roi, formidable jusque dans cette extrémité du monde, une poignée de Français, presque sans vivres, sans munitions et sans moyen d'en avoir, dans une méchante place très mal fortifiée, au milieu des boues et des pluies presque continuelles et d'une infinité d'autres incommodités, faire tête à tout un royaume qui les avait bloqués et l'obliger enfin, après un siège de cinq mois, malgré la résolution prise de les détruire, et malgré le secours de quantité de nations étrangères qui étaient accourues pour le même dessein, à se soumettre à la nécessité de leur accorder des vaisseaux et des vivres pour se retirer.
Mais il faut, avant toutes choses, donner quelque connaissance de l'état où se trouvait la cour de Siam à mon arrivée, pour rendre plus faciles à entendre les changements qui y sont survenus.
Le roi de Siam m'a toujours paru plein d'estime pour notre auguste monarque, dont les actions héroïques l'avaient charmé dans les récits qu'il s'en était fait faire. Ce prince portait assurément sur son visage des marques d'une grandeur et d'une élévation distinguée : il aimait naturellement plus les étrangers que ses propres sujets, qu'il traitait même avec un peu de cruauté, ce qui faisait qu'il était plus craint qu'aimé dans son royaume. Quoiqu'il ne fût âgé que de cinquante-quatre ans, il était néanmoins atteint d'une maladie sous laquelle il était aisé de voir qu'il devait bientôt succomber (2).
Deux princes, ses frères, étaient ceux qui suivant les coutumes du royaume devaient succéder à la couronne, parce que le roi n'avait point d'enfant mâle. L'aîné était perclus de tous ses membres. Le cadet contrefaisait le muet pour ne pas s'exposer à perdre la vie sur le premier soupçon que le roi eût pu prendre contre lui. Ils étaient tous deux parfaitement unis ; l'aîné cédait volontiers tout le royaume à son cadet, à cause de ses infirmités, mais tous deux n'étaient pas trop dans les bonnes grâces du roi. Ils ne se mêlaient d'aucunes affaires, et ne voyaient presque personne que leurs propres domestiques (3).
Le roi de Siam avait une fille, que le bruit commun disait être secrètement mariée avec le jeune prince, quoique la chose ne fût pas entièrement constante. Cette princesse, âgée d'environ vingt-huit ans, était d'un naturel fier et hautain, attachée à la religion et aux coutumes de ses ancêtres. Elle s'était aussi retirée de la cour, pour quelque mécontentement qu'elle avait reçus de son père, et elle était portée de haine contre le sieur Constance qu'elle croyait en être l'auteur (4).
Phra Pi, fils adoptif du roi (que quelques-uns, sans fondement, voulaient faire passer pour son fils naturel) était celui de toute la cour qui était le plus dans les bonnes grâces de son prince. Il y a même apparence que le roi lui eût fait avoir la couronne, s'il l'eût pu ; mais comme il était d'une basse naissance, son parti dans l'occasion ne pouvait être que fort petit, et ni les mandarins, ni le peuple, qui connaissaient son origine, n'auraient jamais pu se résoudre à le reconnaître contre le droit et la justice qui était due aux princes, lesquels étaient assez aimés (5).
Entre tout le reste des grands de la cour, il y en avait un qui se distinguait aisément et qui me parut, dès la première fois que je le vis, avoir quelque chose de grand et d'élevé par-dessus les autres. Son nom était Okphra Phetracha. Sa famille était des plus anciennes et des plus considérables. Il était frère de lait du roi et environ de son âge. Quelques-uns même disent qu'il descendait de la véritable race royale, sur laquelle le père de celui qui régnait avait envahi la couronne (6). Par l'attachement qu'il affectait de faire paraître pour sa religion, ce mandarin s'était acquis l'estime et l'affection universelle de tous les talapoins, qui sont en grand nombre et d'un grand crédit parmi le peuple, lequel d'ailleurs remontrait en lui un cœur véritablement siamois, plein d'estime pour sa nation et de mépris pour les autres. Comme il était néanmoins grand politique, il n'avait garde de faire aucunement paraître le dessein qu'il avait en son cœur, et qu'il n'a fait éclater qu'en son temps. Il savait dissimuler auprès de son prince ses véritables sentiments, affectant toujours, pour ôter tout soupçon, de paraître ne désirer rien tant qu'une vie privée et retirée de toutes les affaires, et refusant constamment pour lui, et même pour son fils, les charges et les dignités les plus considérables auxquelles le roi les voulait élever. Il n'en était pas pour cela en moindre considération. Il était toujours des premiers du Conseil et avait bien d'autres accès et d'autre crédit en cour que le sieur Constance, lequel on croyait tout puissant, et qui de son côté tâchait aussi à nous le persuader, rabaissant autant qu'il pouvait l'autorité de tous les autres afin qu'on n'eût d'estime et de confiance qu'en lui seul.
Cependant, quoiqu'il fût un grande faveur auprès du roi de Siam, parce que ce prince ne trouvait que lui seul capable de traiter avec les étrangers, à cause de la grande connaissance qu'il disait avoir de toutes leurs coutumes et de toutes les cours de l'Europe, il ne laissait pas d'y avoir grand nombre de mandarins plus élevés dans les charges et d'une plus grande autorité que lui, auxquels il lui fallait faire sombaie (7), c'est-à-dire rendre en toutes occasions un témoignage de soumissions ; et il ne pouvait pas entrer comme eux dans la chambre du roi, à moins qu'il n'y fût appelé.
À la vérité, cet étranger était d'un esprit vif et étendu, capable de bien des affaires, et porté aux grandes entreprises. Son abord était fort engageant, quand il voulait, sa conversation très agréable, et il savait fort bien se faire valoir sur tout auprès de roi, dont il tenait une fortune assez considérable pour le pays. Il fallait du temps pour le bien connaître. La suite m'a fait remarquer en lui un manque de droiture et de sincérité, une ambition démesurée et une trop grande délicatesse à se choquer et à poursuivre ceux dont il se croyait méprisé, ce qui lui avait attiré la haine de tous ces peuples et de la plupart des étrangers.
Voilà en peu de mots ce qui m'a paru de plus remarquable de la cour de Siam, pour l'intelligence de ce qui suit.
À l'égard des Français, je n'avais dans Bangkok que deux cents soldats avec les officiers. M. du Bruant était à Mergui avec trois de nos meilleures compagnies (8), et depuis son départ, j'avais encore été obligé de donner trente-cinq de nos meilleurs hommes, avec trois ou quatre officiers, pour mettre sur des vaisseaux que le roi de Siam envoyait en course contre quelques corsaires, suivant un ordre que le sieur Constance m'avait envoyé de sa part (9). De ce petit nombre qui me restait, il y en avait encore quantité de malades, qui le diminuaient tous les jours, et cependant la place où nous étions n'avait que des fortifications commencées et si vastes qu'il eût été besoin de plus de douze cents hommes pour la bien garder. J'avais fort souhaité qu'on ne prît pas une si grande enceinte, afin de nous voir plutôt à couvert et mieux en état de nous défendre contre ce qui nous pourrait arriver, mais je ne pus gagner sur le sieur Constance de changer un dessein qu'il avait déjà fait commencer avant notre arrivée, et quelque instance que je fisse pour avoir des travailleurs, comme aussi quelque peine que je me donnasse, nonobstant mon âge et les ardeurs du soleil (10), de demeurer moi-même tout le jour sur les travaux pour les faire avancer, il nous restait encore, quand les affaires se brouillèrent, deux bastionsEn terme de fortication, un bastion est une grande masse de terre ordinairement revêtue de maçonnerie ou de gazon, qu'on construit sur les angles de la figure que l'on fortifie, et même quelquefois sur les côtés lorsqu'ils sont fort longs. Sa figure est à-peu-près celle d'un pentagone ; il est composé de deux faces qui forment un angle saillant vers la campagne, et de deux flancs qui joignent les faces à l'enceinte. Son ouverture vers la place se nomme sa gorge. (Encyclopédie de Diderot et d'Alembert)., deux courtinesLa courtine est la partie de la muraille ou du rempart comprise entre deux bastions, dont elle joint les flancs. La courtine est ordinairement bordée d'un parapet de six ou sept pieds de haut comme le reste de l'enceinte, qui sert à couvrir les soldats qui défendent le fossé et le chemin couvert. (Encyclopédie de Diderot et d'Alembert). et un cavalierTerme de fortification : un cavalier est un amas de terre dont le sommet compose une plate-forme sur laquelle on dresse des batteries de canon pour nettoyer la campagne ou pour détruire quelque ouvrage de l'ennemi. à relever. Je m'étais muni d'environ deux mille palissades qui nous ont été d'une grande utilité dans la suite, mais on n'en avait encore planté aucune.
Dans le mois de mars, le roi s'étant trouvé plus mal qu'à l'ordinaire et presque hors d'état de vaquer aux affaires, Phra Pi commença à vouloir faire quelque parti et à assembler quelques gens qui étaient à sa dévotion. Okphra Phetracha, de son côté, qui depuis longtemps avait pris ses mesures, et qui avait en sa main le mandarin qui garde les rôles de tout le peuple, fit aussi approcher secrètement dans les pagodes qui étaient autour de Louvo le plus de monde qu'il pût avoir. Il ne lui fut pas difficile d'attirer à lui presque tout le royaume, car loin de déclarer son véritable dessein, il témoignait toujours de ne désirer rien tant que de s'enfermer dans quelque pagode avec les talapoins, pour y mener, disait-il, une vie solitaire. Mais il insinuait à ces peuples qu'avant que d'exécuter ce dessein, il voulait employer tout son esprit et ses forces, et la vie même s'il en était besoin, pour mettre les princes sur le trône qui leur appartenait, et qu'il savait que Phra Pi et M. Constance voulaient leur faire perdre. Pour gagner encore davantage les esprits, il avait fait courir le bruit sous main par tout le royaume que les Français n'étaient venus que pour détruire la race royale, leur religion et leur coutumes, en les assujettissant à Phra Pi et au sieur Constance, qui devait être le second du royaume en cas que la chose réussît. Il lui fut aisé par ces artifices de mettre tous les grands et les petits dans son parti et de les animer étrangement contre nous, d'autant plus que les princes, vrais héritiers de la couronne, le regardaient toujours comme un sujet fidèle qui n'agissait que par le zèle qu'il témoignait avoir pour eux, et ne regardaient Phra Pi et le sieur Constance que comme leurs plus grands ennemis.
Le sieur Constance, à qui une bonne partie de ce qui se passait ne pouvait être caché, quelque bonne mine que lui fît toujours ce grand mandarin pour l'amuser, m'envoya vers la mi avril un ordre de la part du roi de Siam de monter à Louvo avec la meilleure partie de mes troupes. Je partis de Bangkok avec soixante-dix hommes et cinq officiers (11), plein d'inquiétude pourtant pour le reste de ma garnison que j'étais obligé de laisser en si petit nombre. On ne nous vit pas plutôt arrivés près de Siam, par où il fallait passer pour nous rendre à Louvo, qu'on en ferma toutes les portes et que tout y fut en tumulte, comme à la vue de leurs plus grands ennemis. J'appris aussitôt de M. l'évêque de Métellopolis, de M. l'abbé de Lionne (12) et du sieur Véret, chef de la loge française (13), qu'il courait un bruit public que le roi de Siam était mort, que tout était en armes à Louvo et sur les chemins, qu'on parlait d'arrêter le sieur Constance, et qu'il se débitait mille choses très désavantageuses pour les Français ; qu'on avait aussi nouvelle qu'il était descendu des soldats vers Bangkok en bon nombre et qu'on disait être pour surprendre et pour massacrer les Français qui y étaient.
Je ne crus pas sur ces nouvelles qu'il fût de la prudence de continuer mon chemin. Je m'arrêtai donc aux environs de Siam, et j'écrivis en toute diligence au sieur Constance les bruits fâcheux qui couraient si publiquement, et que je croyais beaucoup plus à propos pour son bien et pour le nôtre qu'il se rendît lui-même où je l'attendais, pour aller offrir nos services aux princes, vrais héritiers de la couronne, qui étaient tous deux dans la ville de Siam, et dissiper par-là les soupçons qu'on avait conçus contre nous.
Mais soit que le sieur Constance ne crût pas le mal si grand qu'il était, soit qu'il ne fût plus en état de se retirer de Louvo, soit qu'il fût d'intelligence avec Phra Pi (comme on dit qu'il en est demeuré d'accord dans la suite), il ne voulut pas entendre mes conseil, et je me retirai incontinent après sa réponse à Bangkok, pour tâcher d'y conserver les troupes que le roi m'avait fait l'honneur de me confier (14).
La suite a bien fait voir que je ne pouvais agir autrement sans m'engager dans un mauvais et injuste parti, et sans la perte presque assurée de tout ce qu'il y avait de Français dans le royaume ; car il s'est trouvé constant par les interrogations que j'ai fait faire à deux mandarins siamois que nous avions entre les mains, que dans le temps que le sieur Constance nous voulait faire monter, Phetracha était entièrement maître du palais et avait en main plus de 30 000 hommes, tant à Louvo que sur les chemins, sans les forces des princes qui étaient pour lors jointes aux siennes contre l'autre parti, dans lequel apparemment le sieur Constance voulait m'engager, sans qu'il osât me le déclarer.
Okphra Phetracha, voyant que nous étions retournés à Bangkok et qu'il ne serait pas si facile de nous avoir tant que nous ne serions pas divisés, commença à se servir de tous les artifices imaginables pour obliger les deux princes et les princesse de monter à Louvo, afin de les voir là entre les mains. Il lui était de la dernière conséquence que ces princes et les Français ne s'unissent pas ensemble, et c'était ce qui lui faisait chercher tous les moyens de voir les uns et les autres dans sa disposition. Il lui était impossible d'avancer ses affaires tant que les princes demeureraient dans la ville de Siam, dont ils étaient les maîtres, et les Français à Bangkok, par les secours réciproques qu'on pouvait aisément se donner, et qu'on se serait donnés en effet au premier sujet de soupçon qu'il eût donné de lui et qui eût en même temps détruit celui qu'il avait donné de nous. Il envoya donc plusieurs mandarins, et écrivit plusieurs fois à ces princes pour les inviter de monter à Louvo, alléguant que le roi, (qui véritablement n'était pas encore mort, mais hors d'état d'agir dans l'accablement où sa maladie l'avait réduit) les voulait voir, et mettre l'un d'eux sur le trône de son vivant ; qu'il leur était de grande conséquence de ne pas perdre de temps et de venir à Louvo recevoir de toute la cour qui y était le serment de fidélité, pour ne pas laisser l'occasion à Phra Pi d'avancer ses affaires à leur préjudice ; et que, comme un sujet fidèle et zélé pour leur service, il avait mis les choses dans un état à n'y avoir rien à craindre pour eux.
Les princes hésitèrent beaucoup à se rendre à ces pressantes sollicitations, non par aucune défiance qu'ils eussent alors de Phetracha, mais parce qu'ils se voyaient entièrement maîtres de la ville de Siam (15), et qu'ils ne savaient pas si sûrement de quelle manière ils seraient à Louvo, où étaient Phra Pi et le sieur Constance, dont ils craignaient quelque fâcheuse affaire. Cela les faisait beaucoup plus incliner à faire leur entrée publique dans le palais de Siam, pour y faire proclamer roi le jeune prince, et ensuite obliger les mandarins qui étaient à Louvo à le venir reconnaîttre ; ce qui était aussi fort du goût de la princesse, qui était ou devait être son épouse. Et certes la suite a bien montré que c'était le seul parti qu'ils devaient prendre, mais ils ne purent résister aux dernières instances qui leur furent faites par un homme qu'ils estimaient le plus fidèle, le plus équitable et le plus désintéressé du royaume.
Le jeune prince monta donc à Louvo avec la princesse. Okphra Phetracha leur avait envoyé une grande et fort belle escorte sur le chemin. Il les reçut avec toutes les marques de soumission possibles, leur fit le premier la sombaie, et la leur fit faire par tous les grands mandarins. On dit qu'il n'y eut que les seuls Phra Pi et Constance qui ne s'empressèrent pas pour cela, et que ce second y étant venu quelque temps après, le prince ne voulut pas le recevoir.
Il est assez probable que Phetracha, se voyant comme maître et assuré de ceux qui pouvaient aspirer à la couronne, voulait attendre la mort du roi, qui ne pouvait guère plus tarder, avant que d'en venir aux mains. Mais ayant eu avis que Phra Pi, qui voyait bien le mauvais état de ses affaires, faisait approcher quelques troupes de gens armés pour hasarder sa fortune, laquelle ne pouvait être que funeste sous la domination des princes irrités contre lui, cet habile politique prit aussitôt ce prétexte pour faire agréer aux princes et aux grands mandarins de le faire arrêter et s'en défaire, et il ne demanda pas mieux pour faire valoir son prétendu zèle que de s'en charger. Il n'y perdit point de temps, et quoique Phra Pi fût alors dans la chambre du roi, dont il ne sortait guère à cause des services qu'il lui rendait dans sa maladie, il fit si bien qu'il l'en retira par artifice jusqu'à la porte, et de là, par violence, il le fit massacrer sur le champ, sans s'arrêter à la prière qu'on dit que lui en fit faire ce pauvre roi mourant, à qui il pesait beaucoup de voir traiter de la sorte celui du royaume qu'il aimait le mieux (16).
Cette première action de la tragédie étant faite, Okphra Phetracha crut qu'il ne fallait pas manquer l'occasion de se saisir du sieur Constance. Il donna ses ordres pour qu'on ne sût rien de ce qui s'était passé dans le palais, et lui envoya dire de la part du roi qu'il eût à s'y rendre. Le sieur Constance, qui ne savait rien de ce qui était arrivé, et qui était pourtant dans la crainte de quelque fâcheux accident, pria trois officiers français qui étaient à Louvo de l'accompagner, entre lesquels était mon fils le chevalier (17). D'abord qu'il fut entré dans le palais, Okphra Phetracha s'avança vers lui avec quantité de gens armés, dont la cour était toute pleine, le prit par le bras, et d'un ton fier et méprisant lui dit qu'il l'arrêtait prisonnier pour avoir conspiré avec Phra Pi contre le royaume, et pour en avoir dissipé les deniers. Dans le même temps qu'il lui parlait, il s'en trouva plusieurs qui avaient le sabre sur la tête, prêts à lui donner le coup à la première parole de ce mandarin. Les officiers français, qui ne s'attendaient à rien moins qu'à cela, lui demandèrent aussitôt ce qu'ils désiraient qu'ils fissent pour son service, mais il leur répondit de ne rien faire, et de rendre même leur épée qu'on leur demandait. Phetracha eut pour lors encore assez de présence d'esprit pour voir qu'il lui importait de ne pas faire connaître aux Français la mauvaise volonté qu'il avait contre eux. Il ordonna donc qu'à leur égard on les conduisît à Thlée-Poussonne (18), qui est une maison royale à une lieue de Louvo, et que là on s'assurât de leurs personnes ; et il les fit accomapgner par le mandarin qui avait été second ambassadeur en France, pour leur faire entendre qu'on n'en usait ainsi qu'afin de pourvoir à leur propre sûreté, de peur, disait-il, que le peuple animé comme il était contre les étrangers et contre le sieur Constance ne se portât à quelque excès contre eux, dont la cour serait ensuite fâchée.
Il ne manqua pas aussitôt de faire éclater la prise qu'il venait de faire, et afin que personne n'en pût ignorer, il fit promener le sieur Constance sur les murailles du palais à ses côtés, suivi de quantité de bras-peints, qui sont gens dont ils se servent quand ils veulent faire arrêter quelqu'un (19). Ensuite il le renvoya pour être attaché avec cinq chaînes de fer, et gardé sûrement dans le palais même, où depuis on ne l'a laissé voir ni avoir de communication avec aucun de ses amis. Il a souffert plusieurs fois la question en diverses manières, dans lesquelles suivant le bruit communs et la déposition de nos deux mandarins, il a été contraint d'avouer son intelligence avec Phra Pi et d'avoir dissipé et fait sortir hors du royaume de grosses sommes d'argent des magasins royaux. On tira de lui toutes les lumières qu'on put sur les affaires des étrangers, après quoi on le coupa par morceaux (20). Sa maison ne manqua pas d'être pillée, sa femme et presque tous ses parents cruellement tourmentés par diverses questions qu'on leur donnait pour avoir connaissance de tous ses effets. Il restait encore trois mandarins de ce parti. Okphra Phetracha ne les voulut pas laisser évader, et il envoya de si bons ordres que sans coup férir, ils furent tous trois mis aux fers dès la nuit suivant qu'on eût arrêté M. Constance. L'un des deux qui était à Louvo s'était déjà mis en fuite, mais il fut arrêté en chemin, et les deux autres dans leurs maisons, sans que tout cela causât le moindre bruit.
Après avoir achevé de détruire ce parti, ce qui augmenta son crédit et son autorité, par l'adresse avec laquelle on l'avait vu en venir à bout si facilement, il s'appliqua uniquement à chercher des moyens pour détruire les Français, qu'il envisageait comme le plus grand obstacle qui lui restait à ses intentions. Il n'avait pu réussir à faire monter à Louvo l'aîné des princes, qui semblait même être entré en quelque soupçon, à cause des instances et tant réitérées sollicitations que ce mandarin lui avait faites de s'y rendre, ce qui aussi n'avait pas plu au second prince, ni à la princesse qui n'avait pu s'empêcher d'en témoigner quelque chose, et cela avait obligé Phetracha, pour ne pas laisser prendre racine à un soupçon qui lui pouvait être si préjudiciable, de cesser d'en écrire davantage à l'aîné des princes et de faire de plus, en présence du second prince et des mandarins, un serment solennel davant une idole qu'il fit apporter : Qu'il reconnaissait et reconnaîtrait toujours les princes pour ses véritables seigneurs, et qu'il ne voulait rien faire que pour leur service ; ce qui leva tout soupçon contre lui et le mit encore plus en état d'agir que jamais. Cependant, quoique la vie du second prince et de la princesse fût entre ses mains, celui qui était à Siam pouvait avec les Français lui donner trop d'exercice pour qu'il osât hasarder le coup. Et voilà ce qui le détermina à se servir de la haine qu'il avait lui-même allumée contre nous dans le cœur des princes, des mandarins et du peuple, pour les porter tous à entreprendre absolument notre perte, leur faisant entendre que le royaume ne serait jamais paisible que nous ne fussions détruits. On nous a dit que la princesse fut la première à donner dans ce dessein, et qu'elle s'en est bien repentie depuis.
Avant que d'en venir à la force ouverte, ce que Phetracha trouvait un peu difficile, il voulut se servir de tous ses artifices, et nous avait par son esprit, comme il le disait ; Et c'est ce qui lui avait toujours fait dissimuler aux Français ce qu'il avait dans le cœur, afin de les mieux disposer à donner dans le piège qu'il leur tendait.
Un jour après la prise du sieur Constance, il avait écrit à M. l'évêque de Métellopolis et au sieur Véret, qu'à la vérité il était arrivé quelque brouillerie à Louvo, et que le roi y avait fait arrêter le sieur Constance pour un crime qu'il avait commis contre l'État, mais que ce n'était rien que cela, et que Sa Majesté lui avait ordonné de leur faire savoir qu'on n'en voulait aucunement ni aux Français, ni à la religion chrétienne, afin qu'ils ne se missent en peine de rien. Deux ou trois jours après, il écrivit une seconde lettre à M. l'évêque et à M. l'abbé de Lionne, en cas que M. de Métellopolis fût indisposé. M. l'abbé de Lionne étant monté, apprit avec étonnement que tous les Français qui étaient à Louvo avaient été arrêtés, et que tous les autres chrétiens siamois, pégous, portugais ou autres, étaient fort maltraités dans les prisons ; et le mandarin siamois qui avait été premier ambassadeur en France (21), l'étant venu saluer peu de temps après son arrivée, il lui en marqua ses ressentiments et lui en demanda raison. Ce mandarin, qui était un des plus dévoués à Okphra Phetracha, et qui a été fait barcalon pour récompense des services qu'il a rendus en toutes ces affaires, attribua tout ce qui s'était fait à l'égard des chrétiens à la fureur de la populace, et l'assura qu'il les allait tous faire mettre en liberté ; mais pour les Français, on n'en avait ainsi usé que par la considération que la cour avait pour leurs personnes, qu'on n'avait pas voulu exposer aux insultes.
Il délivra en effet sur-le-champ tous les prisonniers, et peu de temps après, M. l'abbé de Lionne étant allé au palais, le grand mandarin l'y reçut fort bien au milieu d'une cour magnifique, d'autres mandarins étant presque tous prosternés à ses côtés ; mais après beaucoup de compliments, il déclara que l'intention du roi était que je montasse à Louvo ; qu'à la vérité le roi ne me blâmait pas de m'en être retourné de Siam, à cause des bruits fâcheux qui couraient pour lors, et qu'il savait aussi que je n'avais pas pu monter depuis, à cause d'une maladie qui m'était survenue, ce qui l'avait porté à m'envoyer de ses médecins pour marque de l'estime et de la considération qu'il avait pour ma personne ; mais qu'après qu'il savait que je me portais bien, il était nécessaire que je ne différasse pas davantage d'obéir aux ordres de Sa Majesté, qu'il m'envoyait pour cela les deux mandarins qui avaient été ambassadeurs en France, pour me faire plus d'honneur et marquer à tout le monde combien j'étais dans son estime et dans son amitié ; ajoutant ensuite que si je ne montais pas, je donnerais par mon refus un juste sujet de me soupçonner de quelque entreprise contre l'État, et qu'il en pouvait arriver de fâcheuses affaires, au lieu que tout irait bien si je voulais monter. Qu'il croyait que je ne ferais pas davantage de difficulté, et qu'il retenait toujours en m'attendant mon fils le chevalier en sa compagnie. Le premier ambassadeur ajouta de plus dans une autre visite qu'il fit à M. l'abbé de Lionne que le roi avait fait arrêter le sieur Constance pour quelque crime, et aussi parce qu'il ne contentait pas les étrangers et qu'il avait dessein de mettre mon fils aîné en sa place, que c'était pour cela qu'il était besoin que je demeurasse quelque temps avec lui à Louvo, pour le styler dans les affaires (22) ; et que c'était une des principales raisons pourquoi on me faisait monter.
De quelques artifices néanmoins dont ils se servirent, il ne fallait pas être trop éclairé pour voir que les affaires n'allaient pas bien. Et j'avoue que je demeurai fort chancelant sur ce que j'avais à faire touchant la proposition de ces ambassadeurs qui avaient été en France. J'aurais bien souhaité qu'ils se fussent contentés du refus que je faisais d'accepter pour mon fils les charges qu'on lui présentait ; mais ils voulaient absolument que je montasse, et M. l'abbé de Lionne, que les mandarins avaient obligé de descendre avec eux, m'en sollicitait aussi, eu égard à l'état où étaient les affaires. D'un côté, je voyais bien le péril où je m'exposais en me mettant entre leurs mains ; d'un autre côté aussi, je ne pouvais refuser de monter sans tout rompre, et nous n'étions nullement en état de soutenir un siège étant sans vivres, sans aucun affût dans la place, qui d'ailleurs était ouverte de tous côtés.
Après avoir bien balancé, je crus qu'il était de mon honneur et de mon devoir de m'exposer, moi et mes deux enfants, à toutes sortes de périls pour tenter si, par cette marque de confiance, je ne pourrais pas lever leurs soupçons et conserver les troupes, ce qui paraissait impossible par tout autre moyen. Je trouvais qu'en m'exposant ainsi, j'avais au moins ces deux avantages : le premier de faire connaître à toute la terre la bonne foi des Français, qui aurait peut-être été un peu soupçonnée par mon refus de monter ; le second de ménager toujours quelques temps, pendant lequel on pourrait se munir d'un peu de vivres, préparer des affûts, planter des palissades et mettre la place dans un état un peu moins mauvais. Je fis donc venir M. de Vertesalle (23) qui commandait après moi, et je lui donnai tous les ordres que je crus nécessaires pour le bien public, ajoutant en présence des officiers que je voyais bien le péril où je m'exposais en montant ; mais qu'aussi, en refusant de monter, le péril qui suivait mon refus était plus général, et plus certain ; et que je lui recommandais de bien faire son devoir en mon absence et de me laisser plutôt pendre moi et mes enfants à la vue, si la chose en venait jusque-là, que de rendre la place dont je lui confiais la garde jusqu'à mon retour.
Okphra Phetracha apprit ma résolution, m'envoya un beau palanquinSorte de chaise, ou de litière, portée par des hommes ou par des animaux et dont les personnes importantes se servent, dans une grande partie de l'Asie, pour se faire transporter d'un lieu à un autre. pour être porté plus commodément avec d'autres voitures convenables pour ceux qui m'accompagnaient. Je rencontrai aux portes de Louvo un mandarin qui me vint complimenter de la part du roi, et m'inviter d'aller descendre droit au palais, ce qui me parut d'un mauvais présage et me fit croire qu'on me voulait arrêter. Je traversai plusieurs cours remplies de gens armés, et fus d'abord fort bien reçu du grand mandarin (c'est ainsi que Phetracha se faisait pour lors appeler) dans la salle où il donnait ses audiences. Mais après plusieurs compliments qu'il me fit sur l'honneur que le roi mon maître m'avait fait sur mon mérite et sur l'affection des Siamois, qu'il disait que j'avais entièrement gagnés, il me demanda comme par manière de conversation, si j'étais bien le maître des officiers et des soldats qui étaient à Bangkok, et si aucun d'eux n'osait me désobéir. Je lui répondis, sans penser où il en voulait venir, que la discipline en ce point était fort exactement observée dans les armées du roi mon maître, et qu'il fallait que tous obéissent à la première parole d'un commandant. Et bien, dit-il, j'en suis bien aise. Le roi vous avait envoyé ordre de monter avec vos troupes ; pourquoi donc êtes-vous monté seul avec votre fils ? Je me trouvai bien étonné d'une telle propositon, et encore plus quand le premier ambassadeur, que je croyais devoir rendre témoignage qu'il avait laissé à ma liberté de monter seul ou avec tel nombre de gens que je voudrais, assura au contraire qu'il m'avait sollicité de monter avec toute ma garnison. Je vis bien que c'était un peu joué, et je n'avais presque plus d'espérance de me tirer d'un si mauvais pas. Et bien, reprit le mandarin, c'est un malentendu. Il faut seulement que vous écriviez tout présentement à tous vos officiers et soldats de se rendre auprès de vous. Vous m'avez assuré qu'aucun d'eux n'aurait garde de ne vous pas obéir. Je lui répondis sans m'émouvoir par le péril où je me trouvais, que si j'étais dans la place, cela serait vrai comme je l'avais dit, mais qu'un gouverneur hors de sa place n'a plus de droit, suivant nos coutumes, de commander, et qu'avant que d'en sortir, j'avais averti le premier ambassadeur de me déclarer si le roi avait quelque ordre à m'y donner, afin de le faire exécuter avant mon départ ; parce qu'assurément M. de Vertesalle n'obéirait à aucun de mes ordre, à moins que je ne fusse présent.
pour être porté plus commodément avec d'autres voitures convenables pour ceux qui m'accompagnaient. Je rencontrai aux portes de Louvo un mandarin qui me vint complimenter de la part du roi, et m'inviter d'aller descendre droit au palais, ce qui me parut d'un mauvais présage et me fit croire qu'on me voulait arrêter. Je traversai plusieurs cours remplies de gens armés, et fus d'abord fort bien reçu du grand mandarin (c'est ainsi que Phetracha se faisait pour lors appeler) dans la salle où il donnait ses audiences. Mais après plusieurs compliments qu'il me fit sur l'honneur que le roi mon maître m'avait fait sur mon mérite et sur l'affection des Siamois, qu'il disait que j'avais entièrement gagnés, il me demanda comme par manière de conversation, si j'étais bien le maître des officiers et des soldats qui étaient à Bangkok, et si aucun d'eux n'osait me désobéir. Je lui répondis, sans penser où il en voulait venir, que la discipline en ce point était fort exactement observée dans les armées du roi mon maître, et qu'il fallait que tous obéissent à la première parole d'un commandant. Et bien, dit-il, j'en suis bien aise. Le roi vous avait envoyé ordre de monter avec vos troupes ; pourquoi donc êtes-vous monté seul avec votre fils ? Je me trouvai bien étonné d'une telle propositon, et encore plus quand le premier ambassadeur, que je croyais devoir rendre témoignage qu'il avait laissé à ma liberté de monter seul ou avec tel nombre de gens que je voudrais, assura au contraire qu'il m'avait sollicité de monter avec toute ma garnison. Je vis bien que c'était un peu joué, et je n'avais presque plus d'espérance de me tirer d'un si mauvais pas. Et bien, reprit le mandarin, c'est un malentendu. Il faut seulement que vous écriviez tout présentement à tous vos officiers et soldats de se rendre auprès de vous. Vous m'avez assuré qu'aucun d'eux n'aurait garde de ne vous pas obéir. Je lui répondis sans m'émouvoir par le péril où je me trouvais, que si j'étais dans la place, cela serait vrai comme je l'avais dit, mais qu'un gouverneur hors de sa place n'a plus de droit, suivant nos coutumes, de commander, et qu'avant que d'en sortir, j'avais averti le premier ambassadeur de me déclarer si le roi avait quelque ordre à m'y donner, afin de le faire exécuter avant mon départ ; parce qu'assurément M. de Vertesalle n'obéirait à aucun de mes ordre, à moins que je ne fusse présent.
M. l'abbé de Lionne qui m'avait accompagné et qui vit bien le péril où nous étions, s'approcha du premier ambassadeur, et lui représenta que tout était perdu si l'on me retenait ; que M. de Vertesalle était un homme à ne rien entendre et à pousser ensuite les choses aux dernières extrémités. Je crois que cela ne servit pas peu à les faire changer de résolution. Ils crurent qu'il était plus à propos de me renvoyer, en gardant mes deux enfants pour gage de la parole qu'ils exigeaient de moi que je ramènerais toutes les troupes, excepté les malades, s'imaginant que je n'y manquerais pas tant qu'ils seraient les maîtres de la vie de mes deux enfants. Ils me proposèrent ensuite une guerre imaginaire qu'ils disaient avoir avec les Akhas (24), et que puisque j'étais venu pour le service du roi de Siam, ils voulaient donner à tous les Français cette ocassion d'acquérir de la gloire ; qu'ils y joindraient de leur part de nos troupes siamoises, et qu'ils me donneraient comme à un homme très expérimenté, le commandement de toute l'armée, mais pour être plus en état de battre les ennemis, il fallait écrire à M. du Bruant de me venir joindre avec ses troupes à un lieu qu'ils me marquaient.

NOTES :
1 - Incertaine est également l'adjectif employé par La Loubère pour évoquer la succession souvent sanglante des rois de Siam (Du royaume de Siam, 1691, I, pp. 390-391) : Les filles ne succèdent point à la couronne ; à peine y sont-elles regardées comme libres. Ce serait le fils aîné de la reine qui y devrait toujours succéder, par la loi. Néanmoins, parce que les Siamois ont de la peine à concevoir qu'entre des princes à peu près de même rang, le plus âgé se prosterne devant le plus jeune, il arrive souvent qu'entre frères, quoiqu'ils ne soient pas tous fils de la reine, et qu'entre oncles et neveux, le plus avancé en âge est préféré, ou plutôt c'est la force qui en décide presque toujours. Les rois mêmes contribuent à rendre la succession royale incertaine parce qu'au lieu de choisir constamment pour leur successeur le fils aîné de la reine, ils suivent le plus souvent l'inclination qu'ils auront pour le fils de quelqu'une de leurs dames dont ils seront amoureux. Cette pratique est confirmée par le père Tachard (Voyage de Siam des pères jésuites, 1686, p. 377) : Dans le royaume de Siam, les frères du roi succèdent à la couronne préférablement à ses enfants, mais elle revient à ceux-ci après la mort de leur oncle. W.A.R. Wood avance l'hypothèse que Phaulkon pressait le roi de désigner sa fille Yothathep pour lui succéder, alors que Petratcha soutenait la succession de Chaofa Aphaïtot, le demi-frère aîné de Naraï. Il paraît assez invraisemblable que le roi Naraï ait pu désigner une femme pour lui succéder, et c'eût été la première fois depuis la création du royaume d'Ayutthaya. Il n'est pas absurde de penser, en revanche, que le roi envisageait plutôt de désigner son favori, Phra Pi, quitte à le marier d'abord à sa fille, pour le doter d'un semblant de légitimité. ⇑
2 - Selon le père Le Blanc (Histoire de la révolution de Siam, 1692, I, p. 45), le roi Naraï souffrait d'une poumonie invétérée, nous dirions de problèmes respiratoires chroniques, qui furent aggravés par un asthme contracté au mois de février 1688, lequel donnait peu d'espérance qu'il pût encore vivre longtemps et le mettait hors d'état d'agir. ⇑
3 - Il s'agissait en fait de demi-frères, Chao Fa Aphaï Tot (เจ้าฟ้าอภัยทศ) et Chao Fa Noï (เจ้าฟ้าน้อย). Dans les Particularités de la Révolution de Siam (1691, pp. 40-41), Vollant des Verquains écrit : … il y avait deux princes frères du roi, tous deux d’une humeur inquiète, et qu’il était obligé de tenir sous bonne garde dans ses palais. L’un était impotent, l’autre plus jeune était bien fait et sans aucun défaut naturel en sa personne, quoique quelques-uns disent qu’il était muet, et d’autres qu’il affectait de le paraître. La mauvaise conduite de ces princes ayant plusieurs fois désobligé le roi, il avait conçu beaucoup d’aversion pour tous deux ; et quelques-uns avaient tellement pris soin d’augmenter les soupçons qu’il en pouvait avoir, qu’ils avaient entièrement éloigné d’eux la bonne volonté du prince ; c’est pourquoi il faisait élever un fils adoptif nommé Mompi, [Phra Pi] lequel apparemment il destinait pour être un jour son successeur.
Le père Le Blanc nous en apprend davantage sur les mésaventures de ces deux princes : Il y avait à la cour un mandarin qui avait la dignité d'Opra et se nommait Pitracha [Phetracha] ; il était d'une naissance à servir sur un balon plutôt qu'à monter sur un trône. Sa mère avait été nourrice du grand barcalon , et parce qu'elle avait réussi à nourrir cet enfant, elle fut choisie pour être encore nourrice du roi qui vint au monde peu de temps après. Cette femme avait deux enfants, un fils qui fut l'Opra Pitracha dont je parle, et une fille ; ils étaient élevés par leur mère au palais et entraient dans tous les divertissements du petit prince, qui prit pour l'un et pour l'autre une inclination que la nourrice, femme adroite, prit grand soin de cultiver. Le jeune Pitracha demeura toujours depuis ce temps-là auprès du prince, et il fit tant par ses complaisances et ses petits services, que les jeux de l'enfance devinrent des liaisons plus sérieuses dans la suite, jusqu'à rendre ce favori nécessaire à son maître. Pour la fille, quand elle fut en âge, sa mère trouva le moyen de la faire entrer dans le sérail, au nombre des femmes du roi dont elle devint la favorite, mais dans sa faveur, oubliant les sages conseils de sa mère et les bontés du roi, elle prit pour le plus jeune des princes frères de Sa Majesté une malheureuse inclination, qui a été la première source des divisions de la famille royale et des désordres du royaume. Leur intrigue demeura secrète assez longtemps et fut découverte un jour que le roi avait appelé les frères au Conseil ; le jeune prince se rendit sans la salle du Conseil, mit bas sa casaque et ses sandales à la porte, selon la coutume du pays, pour paraître devant le roi. Pendant le Conseil, la dame vint prendre les habits du prince et les emporta chez elle pour l'obliger à les y venir chercher. Le prince, qui n'était peut-être pas si entêté qu'elle, ne s'avisa point de cette galanterie et fit grand bruit. Le roi en colère fit chercher les habits ; la dame éperdue s'enfuit de sa chambre, et n'eut pas la précaution de les cacher, elle fut par-là reconnue coupable et jetée aux tigres. La disgrâce de la sœur ne diminua rien de la faveur du frère. Pitracha fut se jeter aux pieds du roi, dit qu'il ne méritait plus l'honneur de paraître devant sa Majesté, et qu'il lui demandait la liberté de se retirer de la cour pour aller cacher sa confusion dans une solitude parmi les talapoins. Le roi lui répondit qu'il savait distinguer les innocents et les coupables, et qu'il ne lui imputait rien du crime de sa soeur. Mais ce n'est point par la fuite, ajouta-t-il, c'est par une juste vengeance qu'il faut réparer cet affront ; je veux que vous me vengiez et que vous vous vengiez vous-même, en faisant battre à coups de rotin le prince qui nous a outragés. Pitracha reçut cet ordre avec joie, et l'exécuta avec tant d'excès que tout le corps enfla à ce jeune prince, qui en est demeuré paralytique et muet le reste de sa vie, et c'est là où lui et Pitracha prirent l'un pour l'autre une haine qui n'a pu s'éteindre que dans le sang de ce malheureux prince. L'autre frère du roi était tout contrefait de sa naissance, et ne pouvait se soutenir sur ses pieds. Sa mauvaise humeur et ses emportements lui avaient attiré de pareilles disgrâces qu'à son cadet, et l'un et l'autre, comme j'ai déjà remarqué, avait achevé de se perdre dans la conspiration des Macassars de 1686 dans laquelle ils se trouvèrent enveloppés. (Histoire de la révolution de Siam, 1692, I, p. 37 et suiv.) ⇑
4 - La princesse Sudawadhi (สุดาวดี) Krom luang (princesse de 3ème rang) Yothathep (กรมหลวงโยธาเทพ) 1656-1735, fille unique du roi Naraï et de la Princesse Suriyong Ratsami (สุริยงรัศมี), une de ses concubines, a été fréquemment évoquée dans les relations occidentales, et a intrigué, voire fasciné tous les étrangers. Auréolée d'un grand mystère, cette princesse qu'aucun occidental ne vit jamais fut l'objet de toutes les rumeurs et de tous les fantasmes.
En 1688, la princesse Yothathep était brouillée avec son père et avait quitté la cour de Lopburi pour se retirer à Ayutthaya, refusant même d'y reparaître pour recevoir les présents que lui envoyait la Dauphine de France. Céberet, l'un des envoyés français, écrit : nous avions déjà fait des instances pour obtenir audience de la princesse-reine, et même M. Constance nous l'avait fait presque espérer, nous ayant fait dire par le père Tachard que la princesse était brouillée avec le roi, pourquoi elle était restée à Siam, mais que si elle se raccommodait, nous pourrions la voir. En attendant le dîner, nous fîmes de nouvelles instances auprès de M. Constance pour l'audience de la dite princesse et pour lui présenter les présents de Mme la dauphine. Il nous dit qu'elle était à Siam, malade d'une espèce d'asthme et d'une vieille entorse au pied dont on ne l'a jamais su guérir, et qu'il craignait qu'elle nous enverrait de ses principaux officiers pour recevoir les présents. Il nous a exagéré ensuite le courage de cette princesse, aux libéralités de laquelle le roi, son père ne peut suffire. Le roi lui a fait sa maison comme les reines de Siam ont accoutumé de l'avoir, et c'est une marque, dit le sieur Constance, qu'il ne la veut pas marier. (Michel Jacq-Hergoualc'h, Étude historique et critique du Journal du voyage de Siam de Claude Céberet, 1992, p. 106).
Les raisons de cette brouille sont peu claires. S'agissait-il de questions d'intérêt, ou du refus de la princesse d'épouser Phra Pi, le favori, malgré la volonté de son père ? Si les causes de ces relations conflictuelles entre le père et la fille restent mystérieuses, il ne fait pas de doute en revanche que la princesse Yothathep détestait cordialement Phaulkon. Déjà, en 1685, l'abbé de Choisy écrivait : Il [Phaulkon] a pourtant souvent des affaires à démêler avec elle. Il prit l'année passée deux mille hommes dans les terres de son apanage pour les faire marcher à Cambodge. Elle gronda fort, et fut longtemps sans vouloir écouter les raisons que Mme Constance lui disait pour excuser son mari. (Journal du 30 octobre 1685).
 L'illustre princesse reine de Siam. ⇑
L'illustre princesse reine de Siam. ⇑
5 - Mom Pi (หม่อมปีย์) ou Phra Pi (พระปีย์), parfois appelé Prapié, Monpy, Monpi, etc. dans les relations. D'origine incertaine, peut-être fils d'un courtisan, les sources thaïes évoquent un dignitaire subalterne de Phitsanulok, ce jeune garçon fut emmené très jeune au palais pour y exercer les fonctions de page et fut élevé par une sœur du roi Naraï. Tous les observateurs s'accordent à reconnaître la tendresse quasi paternelle que le roi lui prodiguait et les privilèges exceptionnels dont il jouissait. Le père de Bèze en dresse un portrait de parfait courtisan : Il n’avait pas l’esprit fort vif et fort brillant mais il compensait cela par son bon air, ses manières aisées et engageantes et surtout par sa complaisance à l’égard du roi et son application à étudier et à prévenir tout ce qu’il pouvoit souhaiter. Il entra par là si avant dans ses bonnes grâces que le roi ne pouvait plus être un moment sans lui. (Mémoires du père de Bèze sur la vie de Constance Phaulkon, J. Drans et H. Bernard, Tokyo, 1947, p. 74). ⇑
6 - Le père Le Blanc démentira formellement cet ascendance royale : Il était d'une naissance à servir sur un balon plutôt qu'à monter sur un trône. (op. cit., I, p. 38). ⇑
7 - Les mots sombaye, ou zombaye, fréquemment employés dans les relations françaises et qui désignent une prosternation, sont des transpositions du portugais sumbra çumbaya, sumbaïa sumba, etc. L'origine en reste obscure. Il pourrait s'agir d'une déformation du mot malais sěmbah, une salutation, une respectueuse adresse, l'acte de salutation ou d'hommage consistant à élever les mains au visage, (Dictionnaire anglais-malais de R. J. Wilkinson, Singapour, 1901) ou de son dérivé sěmbah-yang (vénération de dieu, prière, rituel). Le dictionnaire Hobson-Jobson de Yule et Burnell cite les mots Somba, et Sombay, du malais présent, cadeau. Peut-être est-ce le même mot que le Sěmbah de Wilkinson, les cadeaux, les présents étant habituellement offerts en Asie aux personnes à qui l'on souhaite rendre hommage. Rebecca D. Catz, dans les annotations de son édition des Voyages de Mendes Pinto (University of Chicago Press, 1989), mentionne le mot zumbaia, du malais sembahyang : un acte de profond respect envers un roi ou une personne d'un très haut rang, et indique que le mot est toujours en usage en portugais moderne, mais avec un sens péjoratif. ⇑
8 - Bruant était parti pour Mergui avec trois compagnies de quarante hommes chacune, commandées par les officiers Halgoy, Hiton et de Launay. L'expédition Céberet - La Loubère avait embarqué 636 hommes de troupe, soldats et officiers. Si l'on ajoute aux 120 hommes de Mergui les 200 évoqués par Desfarges, c'est donc environ la moitié des forces qui a péri dans le voyage, victime des maladies et surtout du scorbut. ⇑
9 - Ces deux navires, partis le 1er mars 1688 et qu'on crut quelque temps perdus, étaient le Siam et le Louvo, commandés par M. de Sainte-Marie, nom de guerre du lieutenant de Larre ou Delars, et Suhart. Selon le père Le Blanc, ils avaient été envoyés par Phaulkon pour aller croiser sur un corsaire dans le golfe de Siam, avec un ordre secret qu'ils avaient de M. Constance d'interrompre leur course aux premiers bruits de guerre et de troubles qui pourraient arriver dans le royaume, et d'aller se mettre sous le canon de Bangkok, où il recevraient les ordres de M. Desfarges pour le service des deux rois. (Op. cit., I, p. 32). Le major Beauchamp donne une autre version de la mission qui leur était confiée, tout aussi vraisemblable que celle du père Le Blanc : M. Desfarges vit l'ordre que ces deux officiers lui montrèrent qui était d'aller après ces forbans, et un autre ordre que mon dit sieur Constance avait donné pour aller brûler les vaisseaux anglais qui seraient en rade de la ville de Madras, côte de Coromandel. Les sieurs de Sainte-Marie et Suhart écrivirent à M. de Constance que cela ne se pouvait, la saison étant contraire. M. Constance leur écrivit de sortir et qu'ils tinssent la mer et d'aller où ils voudraient et de ne revenir que dans quatre mois (A.N. Col. C1/25 f° 73v°). Desfarges, pour se justifier, accusa plus tard Sainte-Marie de lui avoir dissimulé ce second ordre mais il est vraisemblable, comme le laisse entendre François Martin, que le général et tous les Français étaient parfaitement informés de la mission des deux officiers et que d’ailleurs les personnes qui n’entraient point dans les sentiments de M. Constance étaient surpris de la facilité de M. Desfarges à permettre l’embarquement des troupes du roi pour faire la guerre aux Anglais. (Mémoires de François Martin, 1934, III, p. 17). L'expédition de Sainte-Marie et Suhart dura plus longtemps que prévue, puisque selon un abrégé de ce qui s’est passé à Bangkok pendant le siège en 1688 (Archives Nationales, Col. C1/24 f° 140r°-171v°), les deux navires ne furent de retour que le 5 septembre. ⇑
10 - On ignore la date de naissance de Desfarges, et même son prénom, dont on ne connaît que l'initiale N. Nous reproduisons l'article que Pinard lui consacra dans sa Chronologie historique-militaire (VI, 1763, p. 455), et qui révèle une carrière bien remplie. En considérant ses états de service, on peut estimer qu'il a entre 50 et 60 ans :
Desfarges (N.) : Capitaine au régiment d'infanterie française du cardinal Mazarin le 3 mars 1661, il servit aux sièges de Bergues, de Furnes, de Courtray et d'Oudenarde en 1667, à la conquête de la Franche-Comté en 1668, et devint lieutenant-colonel de son régiment (alors la Reine) par commission du 14 novembre 1670. Il servit en cette qualité à tous les sièges de 1672, à celui de Mastrick en 1673, au combat de Seneff en 1674, aux sièges de Dinant, de Huy et de Limbourg en 1675, de Condé, d'Aire et de Bouchain en 1676, à la bataille de Cassel et à la prise de Saint-Omer en 1677, au siège d'Ypres, à la bataille de Saint-Denys en 1678. Lieutenant de roi à Brisach, par commission du 10 janvier 1683, il se démit de la lieutenance-colonelle du Régiment de la Reine.
Choisi au mois de Janvier 1687 pour commander les six cents hommes que le roi envoyait à Siam, on le créa maréchal de camp par brevet du 16 du même mois. Il était destiné au gouvernement de la place que le roi de Siam devait donner au roi avec quinze mille livres d'appointements : on lui donna en même temps quatre mille écus pour son équipage. Il emmena avec lui le sieur de Bruant, major du régiment de Feuquières, qui devant commander en qualité de colonel. Je n'ai rien pu trouver sur le sieur Desfarges depuis cette époque : je ne sais s'il est mort dans ce pays-là. On sait que Desfarges mourut de maladie à bord de l'Oriflamme en 1690, quelque part entre le Brésil et les Caraïbes, lors du voyage de retour. ⇑
11 - Vollant des Verquains, pour sa part (op.cit. p. 24), évoque quatre-vingts hommes de troupe et dix officiers, tous gens intrépides et hardis à tout entreprendre. ⇑
12 - Louis Laneau (1637-1696) et Artus de Lionne (1655-1713). Voir sur ce site la page consacrée aux missionnaires. On trouvera une biographie détaillée de l'évêque de Métellopolis et de l'abbé de Lionne sur le site des Missions-Etrangères de Paris. ⇑
13 - Le sieur Véret, personnage faisandé, principalement préoccupé de son enrichissement personnel, était arrivé au Siam le 23 septembre 1685 avec l'ambassade du chevalier de Chaumont. Il avait été nommé par la Compagnie des Indes orientales pour remplacer à la tête du comptoir Deslandes-Boureau qui était parti pour Surate. François Martin écrit dans ses Mémoires de mars 1686 : Le sieur Véret ne renvoyait rien en France pour retour du capital dont il était chargé ; il s'excusait à la Compagnie sur ce qu'il n'avait point trouvé de marchandise à acheter ; il nous écrivit une lettre de compliment. ⇑
14 - Desfarges glisse rapidement sur cet épisode capital et passe sous silence les avis des missionnaires et de Véret, qui l'incitaient à rebrousser chemin, et ceux des jésuites, qui le pressaient de se rendre à Louvo. Pas un mot non plus sur les témoignages des officiers, dont Danglas et Dacieu, qui affirmaient que tout était tranquille dans la ville. La décision de retourner à Bangkok était lourde de conséquence et marque, pour beaucoup d'historiens, le tournant de la révolution de Siam. Il est possible qu'il eût suffit à Desfarges, à la tête d'une petite unité, de se saisir de Phetracha et de le mettre hors d'état d'agir pour éliminer toute opposition sérieuse aux Français. C'est également l'analyse de François Martin, qui écrit dans ses Mémoires : Cette conduite de M. Desfarges dont on a écrit si diversement en France est assez embarrassante à déterminer les esprits, si ce retour à Bangkok a été fait à propos ou s'il aurait été plus avantageux de continuer le voyage de Louvo. Les personnes qui le dissuadèrent de passer plus avant, j'entends parler de Messieurs de la Mission, sont d'un mérite distingué, d'une vertu et d'une probité connues, instruits des manières de Siamois par un séjour de plusieurs années dans le pays, qui savaient parfaitement la langue, qui y avaient acquis des amis et qui pouvaient avoir des avis secrets. On n'a point douté aussi qu'ils ne fussent très persuadés eux-mêmes de ce qu'ils avaient rapporté à M. Desfarges. Cependant le voyage des deux capitaines à la cour, d'autres particularités reconnues depuis, le rapport des gens du pays (car il y en a eu pour et contre) ont fait douter de cette assemblée de troupes sur la route de Siam à Louvo. Il est sûr, si cet avis s'était trouvé faux, que l'arrivée à la cour de M. Desfarges avec les gens qu'il y menait était le gain de partie : Phetracha était perdu ; en l'arrêtant, c'était le plus sûr de s'en défaire sur-le-champ. L'auteur mort, le parti était absolument dissipé, il n'aurait pas été difficile de faire approuver le coup au roi par les témoignages des mandarins de son parti qu'on aurait pris et de qui l'on aurait tiré le secret du dessein des conjurés, entièrement opposé aux intentions de ce prince sur son successeur. (François Martin, Mémoires, III, p. 12).
On peut penser que le sieur Véret, sans en mesurer vraiment les conséquences, avait tout intérêt à la disparition de Phaulkon, qu'il détestait et qu'il soupçonnait être informé de ses multiples malversations au détriment de la Compagnie française. L'attitude des évêques, en revanche, est plus difficile à expliquer. Dans une lettre du 11 janvier 1692 adressée à l'abbé de Lionne, M. de Brisacier, supérieur des Missions-Étrangères écrivait : Il y a toujours une chose qui me fait beaucoup souffrir, et dont je vous supplie de faire le sacrifice avec moi : c'est que le P. Verjus publie partout à ceux qui veulent l'entendre, même à nos meilleurs amis (témoin Mgr de Laon qui me le disait chez nous il y a aujourd'hui huit jours), que c'est vous qui, par le conseil que vous avez donné à M. Desfarges, avez été cause de la mort de M. Constance, du malheur des Français et du renversement des affaires de la religion à Siam. (cité dans l'Histoire de la Mission de Siam d'Adrien Launay, I, p. 208).
Les attaques dont il était la cible incitèrent l'abbé de Lionne à rédiger un long plaidoyer dans lequel il s'efforçait de justifier son attitude : Mémoire sur une affaire sur laquelle on m'a demandé quelques éclaircissements.
Toutefois, l'honnêteté oblige à admettre que les témoignages contradictoires ne permettent pas de juger en toute connaissance de cause la décision de Desfarges de retourner à Bangkok. Entre les témoins qui n'ont rien vu d'alarmant et ceux qui évoquent des forces siamoises allant de 3 000 à 15 000, voire 30 000 hommes, il est difficile aujourd'hui de se prononcer sur le bien-fondé de la décision du général. Pour notre part, nous serions enclins à penser qu'un coup de force de Desfarges contre Phetracha, même s'il avait réussi, n'aurait fait que différer un mouvement de libération nationale qui paraissait inéluctable. Il est difficile d'imaginer que 80 hommes de troupe - c'était alors les seules ressources de Desfarges - aient pu bouleverser le destin d'une nation. ⇑
15 - C'est beaucoup dire. Même s'ils étaient populaires, et tout particulièrement Chaofa Noï, le cadet, les deux demi-frères du roi étaient tenus en disgrâce et consignés dans le palais d'Ayutthaya. ⇑
16 - D'après tous les témoignages, l'exécution de Phra Pi eut lieu le 20 mai, deux jours après l'arrestation de Phaulkon. ⇑
17 - Les deux autres étaient Beauchamp, major de Bangkok, et M. de Fretteville. ⇑
18 - Thale Chubson (ทะเลชุบศร), une île au milieu d'un ancien lac à trois kilomètres de Lopburi où le roi Naraï avait fait construire une résidence, le pavillon Kraisorn-Sriharaj (ตำหนักไกรสรสีหราช). On peut penser que la fraîcheur de l'eau rendait cette retraite agréable pendant les mois chauds. Elle était également connue sous le nom de pratinang yen (พระตี่นั่งเย็น), la Résidence fraîche. Elle servait au roi Naraï pour les réceptions et pour séjourner lors de ses parties de chasse ou de ses promenades en forêt. C'est là que fut exécuté Phaulkon. ⇑
19 - Les bras-peints (ken laï : แขนลาย), ainsi appelés parce leurs bras scarifiés avaient été recouverts de poudre à canon, ce qui, en cicatrisant, leur donnait une couleur bleue mate, sont ainsi décrit par La Loubère : Ils sont les exécuteurs de la justice du prince, comme les officiers et les soldats des cohortes prétoriennes étaient les exécuteurs de la justice des empereurs romains. Mais en même temps, ils ne laissent pas de veiller à la sûreté de la personne du prince, car il y a dans le palais de quoi les armer aux besoin. Ils rament le balon du corps, et le roi de Siam n'a point d'autre garde à pied. Leur emploi est héréditaire comme tous les autres du royaume, et l'ancienne loi porte qu'ils ne doivent être que six cents, mais cela se doit sans doute entendre qu'il n'y en doit avoir que six cents pour le palais, car il en faut bien davantage dans toute l'étendue de l'État parce que le roi en donne, comme j'ai dit ailleurs, à un fort grand nombre d'officiers. Ces bras-peints donneront toute la mesure de leur cruauté lors du coup d'État de 1688. ⇑
20 - Desfarges omet de mentionner qu'il se trouvait alors à Louvo (il n'évoque ce voyage que plus loin) et que son attitude servile envers le nouveau pouvoir et son peu d'empressement à défendre Phaulkon pesèrent lourd dans la décision de Petratcha d'éliminer Phaulkon. Vollant des Verquains écrit : Après avoir promis et fait ce qu'on voulait, le général des Français fut régalé de quelques présents et reçut des marques de faveur non commune, sur ce qu'on le trouva de si bonne composition et qu'on se flatta de retirer par douceur la forteresse d'entre ses mains. Cependant ce n'était aucunement ses intentions, et néanmoins il laissait ses enfants et ses amis exposés au ressentiment des barbares qui ne pouvait pas manquer d'éclater et de causer des effets bien funestes, quand ils sauraient qu'il les avait trompés ; pour lors ils n'en eurent aucune défiance, au contraire Phetracha voyant les Français si traitables, ne balança plus s'il se déferait de M. Constance, ne le voulant pas garder dans un lieu où il s'attendait qu'ils dussent venir. (Op. cit. pp. 74-75). ⇑
21 - Il s'agissait de Kosapan. Voir sur ce site la page qui lui est consacrée : Kosapan. ⇑
22 - Le roi Naraï envisageait-il de confier une charge officielle au marquis Desfarges, fils aîné du général ? On trouve dans le Journal de Robert Challe une très curieuse – et tout à fait invraisemblable — affirmation : Richesses, cause que la princesse de Siam a été abandonnée, quoique fille unique et héritière du royaume, qu'elle destinait au marquis Desfarges en l'épousant. (Journal d'un voyage fait aux Indes orientales, 1721, III, p. 327). ⇑
23 - Ce Monsieur de Vertesalle est ainsi décrit par François Martin : M. de Vertesalle savait bien la guerre, il était fort attaché à en faire observer tous les règlements, mais entêté dans ses sentiments et qui ne revenait pas aisément ; il dépensait à sa table les appointements qu'il avait du roi où les officiers étaient bien reçus et il en était aimé. Il est le seul des officiers qui n'a pas quitté Bangkok où il resta toujours dans l'exercice de sa charge. Il n'était pas aimé de M. Constance qui crut qu'il y avait de la fierté ou du mépris de sa part de ce qu'il n'était pas monté à Siam pour le saluer, quoique ce ne fût qu'une application à remplir les devoirs de sa charge. Il avait eu du bruit aussi avec des officiers de marine et l'on dit qu'on avait écrit en France contre lui. (Mémoires de François Martin, II, p. 520). ⇑
24 - Peuple montagnard originaire de Chine, qui réside principalement dans le sud de la Chine, dans le nord de la Thaïlande, au Laos et en Birmanie. ⇑

21 février 2019
