

Quatrième partie.
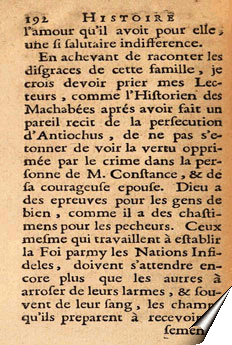
En achevant de raconter les disgrâces de cette famille, je crois devoir prier mes lecteurs, comme l'historien des Macchabées après avoir fait un pareil récit de la persécution d'Antiochus, de ne pas s'étonner de voir la vertu opprimée par le crime dans la personne de M. Constance et de sa courageuse épouse. Dieu a des épreuves pour les gens de bien, comme il a des châtiments pour les pêcheurs. Ceux même qui travaillent à établir la foi parmi les nations infidèles doivent s'attendre encore plus que les autres à arroser de leurs larmes et souvent de leur sang les champs qu'ils préparent à recevoir la semence évangélique ; et loin de désespérer par-là d'en recueillir les fruits, on en doit tirer bon augure.
Si ceux qui pleurent en semant se réjouissent dans la récolte par l'abondance de la moisson, que ne doit-on point se promettre du sang de M. Constance et des pleurs de sa famille pour la conversion des Siamois ?
L'incident que la fuite de Mme Constance avait fait naître à la capitulation de Bangkok ayant cessé par son retour, on mit enfin la dernière main à cette affaire dont les deux partis commençaient à désirer la conclusion. Outre l'article dont j'ai déjà parlé concernant les trois frégates que les Siamois devaient fournir et les otages que les Français étaient obligés de laisser pour assurer le retour de ces bâtiments, il fut dit que ceux-ci sortiraient de la place avec armes et bagages, mais qu'ils laisseraient en leur entier les ouvrages qu'ils y avaient faits, avec les canons et les armes qui étaient au roi de Siam.
Ce traité conclu, on commençait de part et d'autre à l'exécuter et on se séparait avec une espèce de renouvellement d'amitié qui semblait promettre quelque suite, lorsque sous je ne sais quel prétexte qui n'est pas venu à ma connaissance, les Siamois retinrent des canons qui appartenaient aux Français. Malheureusement pour ces derniers, les choses se trouvèrent tellement disposées par l'embarras de l'embarquement qu'ils n'étaient plus en mesure de repousser cette insulte. Ainsi remettant leur vengeance à un temps plus propre à la prendre sûrement et avec honneur, ils se retirèrent enfin, laissant à Siam pour otages des frégates qu'ils emmenaient, M. l'évêque de Métellopolis et quelques-uns autres de la nation, selon qu'on était convenu (1). Deux jésuites demeurèrent aussi pour la consolation des chrétiens, et en particulier pour tâcher de rendre service à Mme Constance. Les autres jugèrent à propos de partir avec les troupes, aussi bien que M. de Rosalie, et la plupart de ses ecclésiastiques.
Toutes choses étant prêtes, on leva l'ancre le soir du vingt-deuxième de novembre et on prit la route de Pondichéry où, après plus d'un mois de navigation, on arriva au commencement de février de l'année 1689, chacun ayant grand besoin de repos.
Ce fut là que se rassemblèrent tous les Français qui avaient occupé les deux forteresses de Siam. Ceux de Mergui n'étaient pas en si grand nombre que ceux de Bangkok, mais ils n'avaient pas fait paraître moins de valeur. M. du Bruant, qui les commandait, s'était signalé en son particulier par les preuves qu'il en avait données en des aventures fort extraordinaires et qui méritent d'être sues du public. Il avait pris possession de la place vers la fin du mois de mars de l'année 1688, avec tous les agréments qu'il pouvait souhaiter. On lui avait fourni abondamment des vivres, des instruments, des travailleurs, et s'étant appliqué tout d'abord à se fortifier, il avait déjà fort avancé ses travaux lorsqu'il s'aperçut que peu à peu ses travailleurs désertaient et que les mandarins de la province commençaient à n'avoir plus pour lui la déférence qu'ils avaient eue, en un mot qu'il y avait quelque changement dans la disposition des esprits, dont la cause lui était inconnue.
Il eut un différend avec le gouverneur de Tenasserim, sous la juridiction duquel est Mergui, qui augmenta ses défiances. Les Siamois avaient fait à Mergui un petit fort en forme d'étoile, commandé par une hauteur. On avait fortifié la hauteur ; et parce que la garde de ces deux forts était difficile à une garnison qui ne passait pas cent vingt hommes, la cour avait ordonné qu'on démolirait le fort d'en bas dès que celui d'en haut serait en état de défense. M. du Bruant voulut exécuter cet ordre, mais le mandarin s'y opposa, et sur cela, M. du Bruant ayant dépêché un courrier pour aller se plaindre au ministre de la résistance de ce gouverneur, le courrier fut arrêté en chemin et contraint de s'en revenir. Presque en même temps, une mandarine avertit un officier français nommé Beauregard que l'on en voulait à la nation, et ce même officier reconnut que le gouverneur de Tenasserim lui avait voulu dresser des embûches.
Jusque-là M. du Bruant était demeuré sans beaucoup de mouvement, selon les instructions de M. Constance, qui prévoyant bien que le roi mourant sans fils, sa succession causerait des troubles, avait exhorté cet officier à s'attacher toujours à la famille royale, et en cas qu'elle se divisât, à attendre la décision des affaires pour prendre sûrement son parti : ajoutant par une grandeur d'âme et un désintéressement admirable, que s'il apprenait qu'on l'eût disgracié, ou arrêté, ou fait mourir, sans s'amuser à le vouloir venger inutilement, il fît uniquement ce qu'il croirait de meilleur et de plus avantageux pour le service des deux rois (2).
Suivant de si sages conseils, M. du Bruant était attentif aux nouvelles différentes qu'on faisait courir et à démêler quelque vérité parmi un chaos de faussetés qui se débitaient dans tout le pays. Mais les avis que lui donna Beauregard, joints au procédé que les Siamois tenaient depuis quelque temps avec lui, l'ayant convaincu, que quelque raison qu'on en eût, on avait de mauvais desseins contre les Français, il fit appareiller un petit vaisseau anglais appartenant à un particulier et une frégate du roi du Siam, et les fit tenir sous le canon du fort (3).
Ce fut sur ces entrefaites qu'on lui apporta le billet que l'usurpateur avait obligé M. Desfarges à lui écrire de Louvo pour le faire sortir de la place. M. du Bruant jugea d'abord que ce billet était supposé ou qu'il avait été écrit par contrainte. Car outre qu'il n'était point signé, à quoi les Siamois n'avaient pas pris garde, il était obscur, peu suivi, et tel enfin, que cet habile officier jugea incontinent qu'il était pas de la prudence d'y déférer.
Ce refus fut le signal de la guerre, qui ne fut pas plutôt déclarée qu'une multitude innombrable de barbares assiégèrent la place de toutes parts et y donnèrent de grands assauts. Ils furent si vigoureusement repoussés que, peu à peu, ils perdirent courage, et n'osant plus approcher de près, ils dressèrent une batterie de canon sur une pagode de talapoins voisine du fort et le battirent d'abord avec assez de succès. Mais les assiégés en ayant élevé une autre sur le bastion le plus proche de la colline, celle des assiégeants fut bientôt démontée. On leur tua même leur canonnier, qui était Portugais, et on les mit tellement en désordre qu'ils ne pensèrent plus à prendre la place autrement que par famine.
Ils n'y auraient pas sitôt réussi, car on avait encore des vivres, si le puits de la forteresse ne se fut éboulé inopinément, de sorte qu'on ne pouvait plus avoir d'eau que ce qu'on en allait chercher hors de la place, avec beaucoup de peine et encore plus de danger.
Le gouverneur vit bien alors qu'il fallait céder à la nécessité et se détermina à sortir, mais il ne voulut point devoir sa sortie à une composition mal sûre avec des barbares sans foi. Il résolut de sortir en homme qui voulait être maître de sa destinée et ne devoir son salut qu'à sa valeur. Ayant pris cette résolution, il chargea ses soldats de ce qu'il voulut faire emporter, et sortant avec eux en bon ordre le 24 de juin, il épouvanta si fort les Siamois qui crurent qu'on les allait attaquer qu'ils s'enfuirent tous et laissèrent aux nôtres le passage libre jusqu'à la mer.
On se serait embarqué paisiblement, si en descendant au rivage, quelques soldats qui marchaient les derniers, ayant glissé par la raideur et par l'humidité du talus, ne fussent tombés sur ceux qui étaient devant eux et ne leur eussent causé par-là une terreur panique qui leur fit rompre leurs rangs et courir en désordre vers le vaisseau. Les Siamois, qui s'en aperçurent, vinrent fondre sur eux en grand nombre, et causèrent de la confusion dans l'embarquement. Il y eut des gens tués, d'autres noyés, entre lesquels fut le capitaine Hiton avec une partie de sa compagnie. M. de Bruant et ses officiers, qui avaient courageusement soutenu les derniers efforts des infidèles pendant que leurs gens s'embarquaient, entrèrent les derniers dans les vaisseaux, et après avoir essuyé quelques volées de canon qu'on leur tira du fort qu'ils venaient d'abandonner, mirent à la voile malgré les galères siamoises qui sortirent du port pour les suivre, mais n'osèrent les approcher.
Les Français et les Anglais étaient dispersés de telle manière dans les deux vaisseaux qu'il y avait dans l'un et dans l'autre des soldats des deux nations. M. du Bruant les sépara dans une île où l'on descendit : et ayant partagé les provisions, chacun se rangea sous sa bannière, ayant pourtant arrêté entre eux qu'ils s'assisteraient mutuellement. Les Anglais ne tinrent pas parole, mais ils en furent punis sur-le-champ. Car deux vaisseaux siamois ayant paru et les ayant assurés de loin qu'ils ne leur en voulaient pas, les engagèrent à se rendre à eux, et pour récompense de leur crédulité, les mirent aux fers. C'était la plupart des Hollandais et des Portugais que le gouverneur de Tenasserim envoyait à la suite de nos Français, mais qui perdirent l'envie de les attaquer quand ils les virent résolus à se défendre.
La frégate ayant échappé ce péril tomba bientôt dans un plus grand, car une tempête l'ayant mise hors d'état de se gouverner, des courants et un grand vent l'emportèrent vers une île où le pilote, quoique habile, ne se trouvant maître de rien que de choisir où échouer, demanda à M. du Bruant s'il aimait mieux que ce fût sur le sable ou sur une roche qu'on échouât. Ni sur l'un, ni sur l'autre, répondit-il ; mais il faut trouver quelque moyen de se relever et de porter au large. Le pilote ayant répliqué que cela ne se pouvait, l'étonnement et la frayeur commençaient à saisir les plus hardis, lorsqu'un protestant anglais, qu'on avait gardé dans le vaisseau je ne sais par quel motif, prit la parole et dit aux Français que s'étant souvent trouvé en de semblables dangers, en faisant voyager sur mer avec des personnes de leur religion, il avait remarqué que leur coutume en ces rencontres était de faire des vœux à la vierge Marie, et qu'ils en obtenaient de grands secours. Cet avis donné par un protestant surprit tout le monde et fut pris pour un bon augure. Incontinent tous les assistants se mirent à genoux, et le père d'Espagnac, missionnaire jésuite qu'on avait donné à M. du Bruant, ayant prononcé le vœu tout haut, il n'eut pas plutôt achevé que le vent changea et rejeta en mer le vaisseau qui allait échouer contre les terres.
Cette aventure fut suivie d'une autre sur les côtes de Martaban, où M. du Bruant eut la douleur de se voir enlever son missionnaire par les barbares de ce pays. Comme on manquait de vivres, ce père et un officier, nommé Beauregard, dont nous avons déjà parlé, s'offrirent d'en aller demander à la ville la plus prochaine. On le leur permit. Ils y furent bien reçus, mais on leur répondit qu'il fallait aller à Siriam (4) trouver le roi de Pégou à qui appartient Martaban pour obtenir ce qu'on demandait ; qu'il l'accorderait volontiers, mais qu'en attendant, c'était la coutume du pays que les vaisseaux étrangers missent à terre leurs munitions et leur canon. Beauregard ne se perdit point. Il feignit d'accepter ces conditions et demanda seulement permission d'en avertir son commandant. Mais quand il eut la plume à la main, au lieu de lui écrire conformément aux intentions des barbares, il l'avertit des mauvais desseins qu'ils avaient sur son vaisseau. Ce fut avec beaucoup de douleur que M. du Bruant se vit obligé, pour sauver les troupes du roi, de laisser entre les mains des infidèles deux personnes qui lui étaient si chères, mais la nécessité l'y obligea et les embuscades que commençaient à lui dresser ces perfides Indiens à l'embouchure d'une rivière dans laquelle il était entré lui firent voir que s'il eût demeuré plus longtemps, il n'en fût jamais sorti. On a eu nouvelle que le jésuite et l'officier ont été faits esclaves. Il y a lieu d'espérer de l'habilité et du zèle de ce missionnaire, qu'il saura user de ses chaînes pour mettre ceux qui les lui font porter dans la liberté des enfants de Dieu.
La saison des ouragans approchant, M. du Bruant se retira dans une île, où manquant de vivres et ne trouvant à manger que quelques tortues et de gros serpents, il se voyait enfin réduit à une grande extrémité, lorsque sur la fin de septembre on aperçut d'assez loin un navire qui venait aborder l'île. On s'en défia, on en eut peur : mais on eut une grande joie quand le chevalier du Halgoy l'étant aller reconnaître, on apprit que c'est un vaisseau français nommé la Notre-Dame de Lorette, appartenant à la Compagnie des Indes. On tira de grands secours de cette rencontre, car du Bruant ayant cru, dans les circonstances où il se trouvait, devoir arrêter ce bâtiment pour le service du roi, il en partagea les provisions ; après quoi ils prirent ensemble la route de Bengale. Ils ne furent pas traités des flots plus favorablement qu'ils l'avaient été jusque-là, et ils avancèrent si peu, qu'ayant entièrement consumé leurs vivres, ils furent encore une fois obligés de s'abandonner à la discrétion des infidèles dans la rivière d'Aracan où ils résolurent de relâcher.
Le souvenir de ce qui était arrivé à Beauregard n'empêcha pas le chevalier du Halgoy de s'exposer pour sauver les autres et d'aller à la capitale du pays demander les choses dont on avait besoin. On n'est pas toujours malheureux. Le roi d'Aracan avait un premier ministre nommé de Le Du, Français de nation, qui étant ravi de trouver dans un pays si éloigné une occasion si singulière de servir son roi et sa patrie, donna avec abondance et gratuitement tout ce qui était nécessaire pour mettre les vaisseaux et les hommes en état de continuer leur voyage.
La fortune semblait avoir changé pour nos voyageurs depuis cette heureuse rencontre, car la mer et les vents leur étant devenus favorables, ils étaient entrés heureusement dans la rivière de Bengale et croyaient être en assurance à la rade de Balassor, lorsque quatorze vaisseaux anglais qui faisaient depuis quelque temps la guerre aux habitants de ce pays, reconnurent la frégate du roi de Siam et prétendirent qu'étant en guerre avec ce prince ils avaient droit de se saisir de ces deux bâtiments, qu'ils supposèrent être tous deux à lui. M. du Bruant eut beau se défendre par de bonnes raisons, le commandant anglais en avait une meilleure, qui était quatorze vaisseaux contre deux et une armée entière contre les restes de trois compagnies presque détruites par un long siège, un long voyage et mille autres sortes de dangers. Ainsi il fut obligé de céder à la force, se contenter de faire des protestations et prendre par Madras, avec ses gens, le chemin de Pondichéry, où il arriva vers le quinzième janvier de l'année 1689.
Nos Français se retrouvant tous ensemble délibérèrent sur ce qu'ils avaient à faire dans la conjoncture présente et convinrent particulièrement de deux choses : la première, qu'on se mettrait en état de tirer raison des Siamois quand on aurait des forces suffisantes pour le faire : la seconde, qu'on avertirait le roi de ce qui venait de se passer à Siam. C'est pour exécuter la première qu'ils se sont allés saisir de l'île de Jonsalam (5), peu éloignée du continent de Siam et appartenant à cet état : et ce fut pour exécuter la seconde que partirent les deux vaisseaux qui furent surpris l'année dernière en passant au cap de Bonne-Espérance, par le moyen desquels, comme j'ai déjà dit, on apprit sur la fin de l'automne tout ce que je viens de raconter.
Cette nouvelle affligea ceux qui s'intéressaient à cette affaire, mais elle ne rebuta personne. Messieurs de la Compagnie des Indes, à qui la prise de ces deux vaisseaux a causé une grosse perte, en armèrent d'autres pour la réparer. Les trois mandarins nouvellement baptisés, à qui le changement arrivé chez eux devait encore donner plus d'inquiétude dans cette conjoncture que dans un autre temps, sentirent renouveler les désirs ardents qu'ils témoignaient tous les jours depuis leur baptême, d'y être utiles à la cause de Dieu. Le père Tachard, dont la maxime est que dans les entreprises apostoliques la contradiction est un gage du succès, ne changea rien dans les mesures qu'il avait prises pour un troisième voyage. Le roi surtout, qui avait sujet de craindre que les espérances qu'il avait conçues d'un projet si grand et si avancé pour l'établissement de la religion dans les Indes ne fussent ruinées par cet accident, fit paraître en cette occasion cette grandeur d'âme toujours supérieure aux affaires et aux évènements dont il ne se dément jamais, et malgré la guerre qu'il a sur les bras contre toutes les puissances de l'Europe, donna ses soins et ses vaisseaux aux missionnaires et aux négociants pour aller réparer les pertes de la religion et du commerce en Asie. Ainsi contre ce qu'on devait attendre dans une conjoncture pareille à celle où se trouvent aujourd'hui les affaires de la monarchie, on a composé une escadre qu'on a fait partir au commencement de mars de cette année 1690, en état de peu craindre sur la route et de se faire respecter au terme.

NOTES
1 - Ce n'est pas tout à fait ainsi que les choses se passèrent. Il était convenu que Louis Laneau, évêque de Métellopolis et Véret, le directeur du comptoir de la Compagnie, resteraient otages au Siam en attendant le retour du Siam et du Louvo, les deux frégates prêtées par les Siamois pour l'embarquement des troupes. Par ailleurs, et afin de garantir la sécurité de la garnison française au moment de son départ, deux otages devaient être désignés de part et d'autre, qui devaient être libérés dès que les navires seraient en sûreté en mer. Les Français avaient désigné à cet effet le fils Desfarges et le major Beauchamp. Dans la confusion du départ, Véret, Beauchamp et le fils Desfarges s'embarquèrent subrepticement à bord de l'Oriflamme, ce qui provoqua la fureur des Siamois, dont le malheureux Louis Laneau fit les frais : Une troupe de Siamois se ruèrent sur lui, le dépouillèrent d'abord de tout ce qu'il avait de tant soit peu considérable, lui arrachèrent sa croix pectorale et son anneau pastoral, lui tirèrent même jusqu'à son chapeau. (...) Ce ne fut pas assez pour eux de dépouiller ainsi mon dit Seigneur, ils le chargèrent encore de coups de poing et de bâton, le renversèrent par terre, le traînèrent dans la boue, lui mirent la corde au col, et bien lié et garrotté le jetèrent comme à la voierie dans des broussailles, exposé à une infinité de moustiques et de maringoins, et bien davantage encore à la barbarie de canailles qui ne cessaient de passer, aller et venir, et chacun s'efforçait comme à l'envi de le maltraiter, affronter, invectiver et railler. Il fut ainsi exposé, en attendant que les cangues, ceps, alzèmes (bois que l'on met au col, aux jambes, et aux mains) fussent achevés ; alors on les lui mit sur son pauvre corps déjà bien affaibli ; on ne manqua pas aussi d'y ajouter les fers aux pieds et les chaînes au col ; c'étaient donc les cinq instruments de gehenne qu'on appelle ici en termes vulgaires les cinq prisons. (Journal de la Mission de Siam, Launay, I, p.221). ⇑
2 - Ce récit suit très fidèlement l'Histoire de la Révolution de Siam du père Leblanc, publiée en 1692. ⇑
3 - La frégate était le Mergui. Aucune relation ne donne le nom du navire anglais. ⇑
4 - Syriam, ou Siriangh, ancien nom de la ville de Thanlyin dans la région de Yangon en Birmanie. ⇑
5 - Aujourd'hui l'île de Phuket (ภูเก็ต), au sud de la Thaïlande. ⇑

12 mars 2019
