


Première partie.

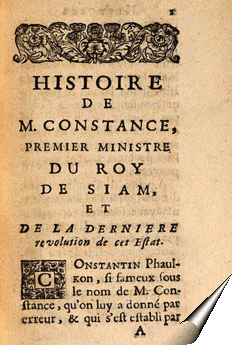
ONSTANTIN Phaulkon, si fameux sous le nom de M. Constance qu'on lui a donné par erreur (1) et qui s'est établi par l'usage, était vénitien d'origine, mais né en Grèce d'un mariage que contracta le fils d'un gouverneur de Céphalonie avec une fille de cette île, d'une bonne et ancienne famille. Ses parents furent peu heureux ou peu habiles dans leurs affaires : ils les firent mal et leur noblesse leur devint à charge par leur pauvreté (2).
À peine M. Constance avait dix ans qu'il s'aperçut de sa mauvaise fortune et qu'il la sentit vivement. Il ne s'arrêta pas à la déplorer, mais par un courant au-dessus de son âge, il prit dès lors résolution de travailler à la rendre meilleure, et pour n'y point perdre de temps, il fit dessein de sortir de son pays où il prévoyait bien que difficilement il trouverait occasion de s'avancer. Comme le commerce attire à Céphalonie beaucoup de négociants anglais, le jeune Constance se joignit à un capitaine de cette nation et passa avec lui en Angleterre. Il s'y fit connaître, mais il n'y fit que cela, et ne voyant pas même de jour à y faire beaucoup davantage, il s'embarqua pour aller aux Indes dans les vaisseaux de la Compagnie anglaise, au service de laquelle il s'engagea.
Sa probité retarda son avancement. Il eut des occasions de s'enrichir dont son équité naturelle ne put s'accommoder, parce qu'il ne les crut pas légitimes, et il aima mieux être plus tard établi que de l'être de bonne heure sur un fond injuste.
Il arriva au royaume de Siam avec ces nobles sentiments et on vit bien qu'il ne s'en était pas démenti, par le peu de bien qu'il y acquit dans un assez long espace de temps. Il s'en trouva néanmoins, après quelques années de service, autant qu'il lui en fallait pour négocier de son chef. Ainsi, las d'être subalterne, il acheta un vaisseau, et toujours plein de ce courage qui ne l'abandonna jamais, il se mit en mer pour aller trafiquer dans les royaumes circonvoisins.
Deux naufrages qu'il fit coup sur coup à l'embouchure de la rivière de Siam auraient fait perdre cœur à tout autre, et un troisième qu'il fit ensuite sur la côte de Malabar aurait jeté dans le désespoir un esprit moins ferme que le sien. Il y pensa perdre la vie et il n'y conserva que deux mille écus de son bien.
Ayant été jeté sur le rivage avec ce débris de sa fortune, il se trouva si fatigué qu'il se coucha pour prendre du repos. Il a raconté plusieurs fois lui-même qu'en ce moment il avait vu, soit en songe, soit autrement, car il n'a jamais bien pu démêler s'il était éveillé ou endormi, une personne d'une figure extraordinaire et d'un air plein de majesté, qui le regardant en souriant, lui avait ordonné de retourner d'où il était venu. Ces paroles qu'il entendit, ou qu'il s'imagina entendre, lui roulèrent longtemps dans l'esprit, et comme il s'était couché aux approches de la nuit, il la passa tout entière à réfléchir sur ce qui lui venait d'arriver.
Il continuait sa rêverie le matin en se promenant sur le bord de la mer lorsqu'il aperçut de loin un homme qui venait à lui à grands pas. Il n'eut pas de peine à reconnaître que c'était un voyageur échappé d'un naufrage aussi bien que lui ; son visage pâle et son vêtement encore tout dégouttant d'eau en étaient des marques trop visibles pour lui permettre d'en douter. La ressemblance de leur aventure leur donna à tous deux de l'impatience de s'aborder et de se connaître. La différence des langues y devait être un obstacle, mais aux premières paroles de l'inconnu, M. Constance l'entendant parler siamois lui répondit en la même langue. Ainsi ils eurent dans leur malheur la consolation d'en pouvoir parler, et ils y trouvèrent dans la suite l'un et l'autre quelque chose de plus.
L'inconnu était un ambassadeur que le roi de Siam avait envoyé en Perse, et qui en s'en retournant dans son pays, avait fait naufrage au même lieu où avait échoué M. Constance. Si M. Constance eût été de ceux que les malheurs d'autrui consolent, il avait la consolation de voir un homme plus malheureux que lui, car l'ambassadeur n'avait sauvé que lui-même de tout ce qu'il avait dans son vaisseau. Parmi les sentiments de pitié qu'un état si triste inspira à M. Constance, il eut quelque joie de pouvoir, même dans son malheur, secourir un homme malheureux. Il ne lui laissa pas demander le plaisir qu'il pouvait faire : il lui offrit d'abord de le ramener à Siam, et l'ambassadeur ayant accepté son offre, des deux mille écus qui lui étaient restés, il acheta une barque, des vivres, des habits, pour lui et pour son compagnon.
Leur navigation fut heureuse lors qu'ils n'eurent plus rien à perdre. Ils arrivèrent à Siam sans mauvaise rencontre et ils eurent le plaisir d'y raconter leurs aventures, l'ambassadeur à ses parents, et M. Constance à ses amis (3).
Le Siamois ne fut pas ingrat des secours qu'il avait reçus du Grec. Il n'eut pas plutôt rendu compte de la négociation au barcalon (4), qu'il lui parla de son bienfaiteur et lui raconta en détail les obligations qu'il lui avait. Il en dit tant de bien que ce ministre, qui était lui-même un homme d'esprit et qui aimait les honnêtes gens, eut la curiosité de le connaître. Il ne l'eut pas plutôt vu qu'il en fut charmé et qu'il prit résolution de s'en servir. Ensuite l'expérience qu'il fit de son habileté en plusieurs affaires, et la probité qu'il trouva en lui, le lui firent regarder comme un homme que le roi devait s'attacher.
Le feu roi de Siam, de l'aveu de tous ceux qui ont voyagé dans les Indes, était un des plus éclairés princes de l'Orient, qui se connaissait le mieux en habiles gens et qui en faisait le plus de cas. Le bien que son premier ministre, à qui il déférait beaucoup, lui avait dit de M. Constance, l'avait favorablement prévenu pour lui ; mais quelques occasions qu'il eût d'éprouver lui-même ce qu'il valait et qu'il était capable de faire augmentèrent beaucoup l'estime qu'il en avait déjà conçue.
On dit que sa faveur commença par l'adresse qu'il eut à supplanter les Maures dans la commission qui semblait leur être affectée de préparer les choses nécessaires pour rendre les ambassades magnifiques, de quoi le roi se piquait fort. Les sommes immenses que ces infidèles tiraient de l'épargne pour cette dépense ayant un jour étonné ce prince, M. Constance se chargea de la commission et il y réussit si bien, qu'à beaucoup moins de frais, il fit les choses avec une toute autre magnificence. On ajoute que les Maures ayant présenté un mémoire par lequel ils prétendaient que le roi leur était redevable d'une grosse somme pour des avances qu'ils avaient faites, M. Constance, qui examina leurs comptes, fit voir au roi que c'était eux au contraire qui lui étaient redevables de plus de soixante mille écus, et les en fit convenir eux-mêmes. Le roi de Siam était de ceux qui épargnent pour dépenser à propos. Il sut si bon gré à M. Constance de la judicieuse économie, qu'il se servit depuis de lui dans les affaires les plus importantes (5).
Son crédit devint si grand que les plus considérables mandarins s'empressaient de lui faire leur cour. Sa prospérité néanmoins fut interrompue par une violente maladie qu'on croyait le devoir emporter. On la cacha quelque temps au roi, apparemment pour ne le pas affliger, mais il témoigna du chagrin de la discrétion qu'on avait eue là-dessus et donna à ses médecins des ordres si précis pour travailler à la guérison du malade qu'il fut bientôt hors de danger.
Il guérit de deux maladies en même temps. Il était né de parents catholiques, mais l'éducation qu'il avait reçue parmi les Anglais, auxquels il s'était donné à dix ans, l'avait insensiblement engagé à suivre la religion anglicane. Il y avait vécu jusqu'alors et le capitaine de la faiturieFaiturie, ou factorie : bureau où les facteurs, les commissionnaires, faisaient commerce pour le compte d'une Compagnie. L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert précise également : On appelle ainsi dans les Indes orientales et autres pays de l'Asie où trafiquent les Européens, les endroits où ils entretiennent des facteurs ou commis, soit pour l'achat des marchandises d'Asie, soit pour la vente ou l'échange de celles qu'on y porte d'Europe. La factorie tient le milieu entre la loge et le comptoir ; elle est moins importante que celui-ci et plus considérable que l'autre. anglaise, qui avait aperçu en lui quelque penchant à retourner à la foi de ses pères, n'avait rien omis pour le retenir dans l'erreur. Heureusement pour l'en retirer, le père Antoine Thomas, jésuite flamand, passant par Siam pour aller dans les missions portugaises du Japon ou de la Chine (6), eut quelques conversations avec lui dans lesquelles ayant adroitement fait tourner le discours sur la controverse, M. Constance y prit tant de plaisir qu'il invita lui-même le père à le venir voir plus souvent afin qu'ils pussent avoir ensemble de plus amples conférences. Les premières qu'ils eurent, furent sur la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie, de laquelle deux ou trois entretiens convainquirent aisément un homme qui cherchait de bonne foi la vérité. Ils se disposaient à conférer sur l'intercession des Saints, sur les Indulgences et le Purgatoire, lorsque M. Constance fut obligé de suivre le Roi à LouvoLopburi (ลพบุรี) à environ 70 km d'Ayutthaya, où le roi Naraï avait un palais dans lequel il passait la plus grande partie de l'année.. Ce voyage n'interrompit point ses conférences avec le père Thomas : comme ils le firent dans un même vaisseau, ils eurent tout le temps de disputer, et le père eut l'avantage que le gouverneur de Macao, qui se trouvait alors à Siam et que M. Constance menait à Louvo, fut témoin de leurs entretiens.
Quelque occupé que fût M. Constance auprès du roi et du premier ministre, il ne laissa pas, quand il fut à la Cour, de ménager du temps pour traiter de religion avec son docteur. Ils parlèrent du Pape, du chef de l'Église anglicane et de l'origine de cette dernière puissance, dont le père lui fit voir si manifestement l'abus qu'il en demeura persuadé.
Il en était là quand il tomba malade, et il n'avait pas si bien pris son parti qu'il n'eût peut-être encore différé quelque temps à se déclarer, si la crainte de mourir hors de l'Église n'eût hâté sa détermination. S'étant donc enfin résolu, il fit venir le père pendant la nuit et après lui avoir raconté l'occasion de sa chute dans l'hérésie, il lui exposa la situation présente de son cœur et de son esprit. Comme rien ne pressait encore, quoique le mal parût assez dangereux, on ne conclut rien ce jour-là ; mais le lendemain, quoiqu'il y eût une diminution fort sensible, le malade déclara au père qu'il voulait retourner à l'Église, le priant de lui vouloir servir de guide et de directeur dans cette grande action et l'assurant qu'il trouverait en lui une docilité parfaite pour tout ce qu'il lui prescrirait.
Le péril étant diminué, le père ne se pressa pas de faire abjuration à son pénitent. Il eut seulement soin de l'entretenir durant le reste de sa maladie dans la ferveur de ses bons desseins, et attendit pour faire le reste qu'il fût entièrement guéri.
Le père Thomas voulant procéder sûrement dans une affaire de cette importance et rendre son ouvrage solide, engagea M. Constance à une espèce de retraite durant laquelle il lui fit lire et méditer un peu à loisir les Exercices de saint Ignace, expliqués par le père Salazar dans un petit livre espagnol plein d'onction et de bonnes instructions. Il lui enseigna aussi durant tout ce temps-là à faire une confession générale et lui fit promettre de se marier et de prendre une femme catholique dès qu'il aurait abjuré l'erreur, jugeant que c'était un point capital pour la solide conversion d'un homme qui était dans les désordres ordinaires aux gens de son âge, lors qu'ils ne sont pas pénétrés de la crainte des jugements de Dieu, que la seule vraie foi peut donner.
Les choses étant ainsi disposées, M. Constance fit son abjuration le second jour de mai de l'année 1682 dans l'église des jésuites portugais établis à Siam au quartier de leur nation (7). Le gouverneur de Macao y assista avec peu de personnes, car M. Constance ne jugea pas à propos de rendre si tôt cette action publique, et c'est pour cela qu'elle se fit la nuit.
On ne peut dire la consolation qu'il sentit durant la cérémonie, en pensant qu'il était enfin retourné au sein de l'Église après un si long égarement. La reconnaissance qu'il en conçut fut si vive qu'il disait aux assistants en les embrassant que puisque Dieu lui avait fait cette grâce qu'il avait si peu méritée, il tâcherait dorénavant de se rendre utile à la religion dans le royaume de Siam et d'y procurer aux autres le même bonheur qu'il venait d'y recevoir. Quelques jours après il fit sa communion, dans laquelle sa ferveur ayant encore pris un nouvel accroissement. Il s'adressa au père et lui dit ces propres mots : Je proteste devant Notre Seigneur Jésus-Christ, que je reconnais ici présent, que j'emploierai dorénavant tous mes soins à réparer ce que j'ai passé de ma vie dans l'erreur et à amplifier l'Église catholique. Je prie celui qui m'en inspire le désir de m'en donner la grâce. Il me comble de tant de bénédictions qu'à peine me reconnais-je moi-même par le changement extraordinaire qui se vient de faire en moi. Je ne veux plus vivre que pour son service, que pour me consacrer tout entier à sa gloire et pour faire servir ce qu'il m'a donné d'autorité dans ce royaume à l'exécution de ses desseins.
Quelques jours après cette action, il se maria à une jeune Japonaise, considérable par la noblesse de sa famille et encore plus par le sang des martyrs dont elle avait l'honneur d'être issue et dont elle imite si bien les vertus. Aussi a-t-il toujours vécu depuis avec cette illustre compagne dans une concorde et dans une paix, qui peut servir de modèle à ceux que le sacrement a unis du plus étroit de tous les liens (8). Le roi et tous les grands de la Cour lui en firent leurs conjouissances qu'ils accompagnèrent de beaux présents, et les catholiques en témoignèrent d'autant plus de joie que l'on avait déjà appris son changement de religion, qu'on ne put tenir plus longtemps secret. Les hérétiques eurent beaucoup de chagrin qu'un tel homme leur fût échappé, mais ils n'osèrent le témoigner, ils furent obligés par politique de faire paraître sur leur visage des sentiments qu'ils n'avaient pas dans le cœur.
Le cours des prospérités de M. Constance fut si prompt que le barcalon étant venu à mourir, le roi voulut lui en donner la charge, qui est la première de l'État. Il s'en excusa prudemment pour ne pas s'attirer dans ce commencement de sa fortune la jalousie des mandarins ; mais s'il n'accepta pas la charge, il en fit presque toutes les fonctions. Car tout ce qu'il y avait d'affaires de conséquence passait par ses mains, et le roi s'en reposait si absolument sur lui qu'il était devenu le canal de toutes les requêtes du peuple et de toutes les grâces du prince.
S'il sut se servir de sa faveur en habile homme pour établir ses affaires particulières, il en usa en homme fidèle pour la gloire de son maître et pour le bien de l'État, mais encore plus en bon chrétien pour l'avancement de la religion. Jusque-là il n'avait pensé qu'à bien conduire le commerce, qui occupe les rois des Indes beaucoup plus que la politique et les affaires publiques. Il y avait si bien réussi qu'il avait rendu le roi de Siam un des plus riches monarques de l'Asie ; mais il crut qu'après l'avoir enrichi, il devait travailler à rendre son nom célèbre et à faire connaître aux nations étrangères les grandes qualités de ce prince, et comme sa principale vue était toujours l'établissement de la religion chrétienne à Siam, il résolut d'engager son maître à prendre des liaisons d'amitié avec les rois d'Europe les plus capables de contribuer à ce dessein.
Le nom de notre grand roi, la réputation de sa sagesse et de ses conquêtes, avaient été portés jusque dans cette extrémité du monde. M. Constance, qui en avait encore de meilleures informations que les autres, crut ne pouvoir rien faire de mieux pour la gloire de son maître que de lui acquérir l'amitié d'un monarque si fameux : et comme il était très instruit de ce qui se passait en Europe, il jugea fort sainement que parmi les princes chrétiens, il n'y avait que celui-là qui fût d'humeur et en état de beaucoup entreprendre pour la religion, sans intérêt.
Le roi de Siam, à qui il communiqua les vues qu'il avait là-dessus, les approuva et entra dans ce dessein, non seulement avec plaisir pour l'intérêt de sa propre gloire, mais encore, ce qui est admirable dans un roi païen, avec une espèce de zèle que son ministre lui avait inspiré pour l'établissement de l'Évangile dans ses États. Cela fit croire à quelques-uns qu'il n'était pas éloigné du royaume de Dieu, mais l'expérience a fait voir en lui la vérité de ce terrible mot de saint Paul, que ce royaume n'est pas donné ni à celui qui court, ni à celui qui veut, mais à celui à qui Dieu fait miséricorde (9).
Les avances que fit ce monarque pour rechercher l'alliance du roi donnèrent lieu à Sa Majesté d'espérer qu'en l'envoyant assurer de son amitié, elle pourrait non seulement le rendre encore plus favorable au christianisme, mais le porter même à se faire chrétien : et ce fut pour cela qu'elle lui dépêcha M. le chevalier de Chaumont, en qualité d'ambassadeur, en l'année 1685.
Ce fut en cette occasion que M. Constance espérant plus que jamais de pouvoir, sous la protection et avec le secours du plus puissant roi de la chrétienté, introduire parmi les Siamois la religion chrétienne dont toutes les autres nations avaient depuis longtemps le libre exercice dans le royaume de Siam, fit voir la vivacité de son zèle pour une si sainte entreprise. Les paroles qu'il porta à son maître, pour seconder celles que l'ambassadeur de France lui portait de la part du roi pour l'engager à se faire instruire, en sont des témoignages d'autant plus incontestables que dans le fond, ce prince infidèle n'ayant jamais donné aucune marque qu'il eût envie d'embrasser la religion chrétienne, c'était un pas délicat à son ministre que de se joindre ainsi à un roi étranger pour lui en faire l'ouverture, et M. Constance le voyait assez. Le discours qu'il lui fit là-dessus, et que l'on peut voir tout entier dans le premier voyage du père Tachard, montre combien il se ménagea peu et qu'il savait bien oublier qu'il était ministre du roi de Siam quand il s'agissait de montrer qu'il était chrétien. La réponse de ce prince fit voir qu'il ne pensait pas à se convertir, mais elle fut assez modérée pour ne pas ôter l'espérance de sa conversion et comme d'ailleurs, quelque peu de penchant qu'il eût à embrasser la foi, il témoignait un grand désir qu'elle s'établît dans ses États, la jugeant bonne et avantageuse à ses peuples. M. Constance voulant profiter d'une si favorable disposition pour l'accomplissement de ce grand ouvrage, prit pour le faire réussir toutes les mesures que pouvait prendre dans les conjonctures présentes un esprit éclairé et prévoyant. Il y avait longtemps qu'il avait pensé à faire venir à Siam des jésuites qui, à l'exemple de ceux de la Chine, introduisissent l'évangile à la Cour par la science des mathématiques, particulièrement de l'astronomie ; et comme il avait appris qu'au royaume de Maduré (10), quelques missionnaires de cette Compagnie ayant eu le courage de se réduire à mener la vie austère des brahmines, qui sont les prêtres du pays, avaient fait de grandes conversions, il résolut d'en mettre quelques-uns parmi les talapoins de Siam, dont la vie paraît fort sainte à ces peuples et guère moins austère que celle des brahmines des Indes. Pour excuser ces deux desseins, il avait demandé au général des jésuites douze missionnaires de son ordre : mais ces douze missionnaires ne venaient point et il n'en apprenait point de nouvelles. Heureusement, pour lui fournir une ressource à ce qui lui manquait de ce côté-là, on avait eu en France la même vue pour soutenir les missions de la Chine auxquelles le père Ferdinand Verbiest, président des mathématiques à Pékin (11), avait invité par des lettres touchantes les jésuites de toutes les nations. Un sage ministre (12), qui était l'un des hommes du monde qui jugeait le mieux de la solidité d'un projet, était entré dans celui-là et avait proposé au roi d'envoyer à la Chine douze jésuites de ses sujets en qualité de ses mathématiciens, qui travailleraient à étendre le christianisme en ce vaste et florissant empire, en même temps qu'ils y feraient, pour la perfection des sciences, des observations utiles à toutes les nations du monde. Cependant comme plusieurs incidents avaient fait alors différer l'exécution de ce dessein, on se contenta de prendre l'occasion de l'ambassade de M. le chevalier de Chaumont pour en faire passer six à Siam, d'où ensuite il leur était facile de continuer leur chemin à la Chine. M. Constance ne les eut pas plutôt vus, qu'ayant appris le dessein de leur voyage, il résolut de tourner désormais ses sollicitations vers la France pour en obtenir ce qu'il ne croyait plus devoir attendre de l'Italie. Pour les rendre plus efficaces, il engagea le roi son maître à les appuyer auprès du roi : et ce fut particulièrement pour cela que le Père Tachard, l'un des six qu'avait emmenés M. de Chaumont, et en qui M. Constance avait pris dès lors une confiance particulière, fut prié de retourner en Europe.
Pendant que le zèle éclairé de M. Constance lui faisait prendre ces moyens d'établir la religion à Siam, sa politique non moins clairvoyante lui en faisait prendre d'autres pour la gloire et pour la sûreté du roi son maître. Ce sage ministre n'ignorait pas que le prince ne pouvait ainsi favoriser la religion chrétienne qu'il ne s'attirât, et à sa famille, deux sortes d'ennemis dangereux ; les talapoins avec ceux des Siamois qui auraient du zèle pour leurs pagodes ou qui voudraient paraître en avoir ; et les mahométans, qui s'efforçaient de lui faire embrasser l'Alcoran, qu'un ambassadeur de Perse actuellement à Siam lui était venu apporter de la part du SophiSophi, ou Sofi, s. ?. (Hist. mod.) c'est un titre ou une qualité qu'on donne au roi de Perse, qui signifie prudent, sage, ou philosophe. (Encyclopédie de Diderot et d'Alembert).. Il voyait bien contre cela qu'il était assez difficile que le roi de Siam se servît des Français sans donner de la jalousie à d'autres nations européennes qui environnent cet état, et qui pourraient s'en ressentir quand elles en trouveraient occasion.
Pour obvier à tout cela, il fit un plan d'une étroite alliance entre le roi et le roi de Siam, dans lequel, outre l'avantage de la religion, l'un et l'autre monarque y trouvait de sien, le roi pour la sûreté du commerce de ses sujets, le roi de Siam pour celle de ses États et plus encore pour la conservation de la Couronne dans sa famille.
Ce fut pour proposer ce plan au roi que M. Constance ménagea l'ambassade des trois mandarins qui arrivèrent en France avec M. de Chaumont en l'année 1686. L'approbation que Sa Majesté donna au projet de ce ministre et ce qu'elle fit de son côté pour en moyenner l'exécution, marque comme elle l'estimait solide. Le principal article du traité était que le roi enverrait au roi de Siam des troupes françaises, non seulement pour apprendre notre discipline aux siennes, mais pour être à sa disposition selon le besoin qu'il en aurait pour la sûreté de sa personne ou pour celle de son État : moyennant quoi le roi de Siam donnerait aux français la garde de deux places (13), où ils seraient commandés par leurs chefs sous l'autorité de ce monarque.
Après que ce traité fut conclu, que les troupes furent assemblées et les douze missionnaires choisis (14), tout étant prêt pour le retour des ambassadeurs du roi du Siam, on fit le voyage de 1687, que le père Tachard a donné au public avec la même abondance de marques curieuses que le premier.
Dès la route on s'aperçut bien de ce qu'avait prévu M. Constance, je veux dire de la jalousie des autres nations contre les Français, à l'occasion de la nouvelle alliance. Le chagrin que les Hollandais en avaient conçu contre le roi de Siam et son ministre paraissait par mille faux bruits qu'ils affectaient de répandre contre eux.
Ce qu'on apprit, en arrivant au terme, de la désobéissance de deux compagnies portugaises qui avaient refusé de faire l'exercice sous le chevalier de Forbin et de la révolte des mahométans, en furent de nouveaux témoignages qui firent juger aux gens sensés que M. Constance avait agi en homme prudent et politique quand il avait appelé au service de son roi des troupes de la nation et de la religion qu'il avait préférées aux autres. Le châtiment exemplaire que ce ministre fit de ces Portugais mutins montra son autorité ; et la défaite des mahométans fit également admirer sa valeur et sa bonne conduite. Quoique cet évènement ait été décrit dans les relations de l'année passée, je ne puis me dispenser de lui donner place dans une histoire dont il fait une partie si considérable. Voici en peu de mots comme il se passa.
Les mahométans s'étaient longtemps flattés de faire recevoir l'Alcoran au roi de Siam et à ses peuples. Ils perdirent cette espérance quand ils virent ce prince si étroitement allié avec les chrétiens, et craignirent quelque chose de pis. La différence qu'on avait faite de l'ambassadeur de France et de celui de Perse dans les honneurs de l'audience, où ce dernier avait prétendu être traité comme le premier, avait tellement augmenté cette appréhension dans ces infidèles qu'ils se résolurent de prévenir le malheur qui les menaçait par une conjuration contre le roi. Les auteurs de ce mauvais dessein furent deux princes de ChampaÉtat de culture hindouiste et de langue malayo-polynésienne situé dans la zone centrale du Viêt Nam moderne entre les IIe et XVIIe siècles. (Wikipédia)., et un prince de Macassar, tous trois réfugiés à Siam, où le roi leur donnait un asile contre des ennemis puissants qu'ils avaient dans leur pays. Un capitaine malais les seconda par des prophéties qu'il fit courir parmi les zélés de sa secte, dont il eut le crédit d'assembler en peu de temps un assez grand nombre pour exécuter la conspiration, si elle n'eut été découverte. Elle le fut par les princes de Champa, qui ayant un troisième frère au service du roi, et actuellement à Louvo où se trouvait alors la Cour, lui firent tomber en main une lettre d'avis, mais si mal à propos et d'une manière si bizarre que ne sachant ce que c'était et soupçonnant néanmoins quelque chose, il la porta toute cachetée à M. Constance.
L'activité du ministre le fit bientôt voir à Siam, après qu'il eut lu cette lettre et pris les ordres du roi son maître. Il trouva en arrivant que le gouverneur, qui avait aussi été averti de la conspiration par un des complices, avait pris de si bonnes précautions que les conjurés qui s'étaient déjà assemblés, voyant leur trame découverte, s'étaient retirés chacun chez eux. M. Constance profita de leur consternation pour faire publier une amnistie en faveur de ceux qui avoueraient leur crime et en demanderaient pardon. Tout le monde le fit, hormis le prince de Macassar et ceux de la nation, qui ayant opiniâtrement refusé d'implorer la clémence du roi, éprouveront enfin sa justice.
Les Macassars sont les plus braves et les plus déterminés soldats de l'Orient. Quand ils sont pressés, ils prennent un certain opium qui leur cause une espèce d'ivresse, ou pour mieux dire de fureur, qui leur ôte la vue du péril et les fait combattre en désespérés (15).
M. Constance prit ses mesures pour attaquer prudemment des gens dont il attendait tant de résistance ; mais il paya de sa personne dans cette occasion avec toute la résolution qu'on pouvait attendre d'un vaillant homme, car il poussa vivement cette troupe de furieux, toujours à la tête des plus hardis et courant toujours du côté où le péril était plus grand, de sorte que cinq ou six des siens furent tués près de sa personne. Le prince macassar qu'il cherchait, l'ayant aperçu, s'avança vers lui et se mit en posture de le darder, mais le ministre de son côté s'étant mis en état de parer le coup, le prince, qui ne voulut rien perdre lança son javelot contre un capitaine anglais. Le capitaine l'esquiva, mais le prince ne fut pas si heureux à éviter un coup de mousquet qui lui fut tiré par un français et dont il mourut sur la place. Ce fut la fin de ce combat où le ministre remporta une victoire qui rendit le roi son maître plus absolu sur ses peuples et plus redoutable à ses ennemis que jamais.
Tout Siam retentissait encore des louanges que cette action de vigueur avait attirées à M. Constance quand nos vaisseaux y arrivèrent. MM. de La Loubère, de Céberet, envoyés extraordinaires du roi pour l'exécution du traité, eurent avec la cour de Siam des contestations sur le cérémonial qui les brouillèrent d'abord avec M. Constance et causèrent dans la suite entre ces ministres d'assez grandes aigreurs sur d'autres sujets (16). L'essentiel du service n'en souffrit pas : M. Constance allant toujours à son but qui était l'alliance des deux rois pour l'établissement de la religion. Ainsi on donna aux troupes françaises la garde de Bangkok et ensuite celle de Mergui, les deux postes du royaume les plus sûrs et les plus avantageux pour le commerce.
M. Constance était prévenu d'une si haute estime et d'un si tendre respect pour notre grand roi, et le roi de Siam son maître était entré de telle manière dans ses sentiments là-dessus que ce prince, ne trouvant pas les Français assez proches de sa personne, résolut de demander au roi, outre les troupes déjà débarquées, une compagnie de deux cents gardes du corps ; et comme il y avait encore bien des choses à concerter entre les deux monarques pour l'établissement de la religion non seulement à Siam, mais en beaucoup d'autres lieux où M. Constance la voulait répandre, il fut résolu que le père Tachard retournerait en France accompagné de trois mandarins pour présenter à Sa Majesté la lettre de leur roi et que de là, il irait à Rome solliciter auprès du Pape des affaires importantes à la tranquillité et à l'augmentation de la chrétienté des Indes. Le père Tachard ayant reçu du roi et de son ministre les ordres et les instructions nécessaires, laissa ses confrères entre les mains de M. Constance et partit de Siam en compagnie des envoyés extraordinaires du roi au commencement de l'année 1688. Il arriva heureusement à Brest au mois de juillet de la même année.
Jamais négociation ne réussit plus à souhait que celle-là. Tout occupé qu'était le roi à repousser les armes de presque toute l'Europe, que le parti protestant venait de liguer contre lui pour lui ôter le moyen de maintenir un roi catholique sur le trône d'Angleterre (17), il ne laissa pas d'ordonner qu'on équipât des vaisseaux pour porter au roi de Siam la compagnie de gardes qu'il demandait. M. Constance avait reçu mille marques d'estime, de considération et d'approbation de la part de Sa Majesté, à qui ce ministre avait rendu un compte de sa conduite si exact, si raisonnable et si sincère que ce prince clairvoyant était demeuré plus que jamais persuadé et de son habileté et de sa droiture. M. le marquis de Seignelay avait marqué par son empressement à contenter le roi de Siam par les avantages qu'il avait procurés à son ministre, par les bontés qu'il avait témoignées au père Tachard en particulier, combien il avait cette affaire à cœur. Ce même père n'avait pas été moins heureux à Rome où entre autres grâces qu'il avait demandées au Pape, il en avait obtenu une considérable pour l'Église du Tonkin, dont M. Constance avait pris soin de faire passer les députés en Europe pour s'aller jeter eux-mêmes aux pieds du pontife et lui présenter leur requête.
Le père Tachard était revenu en France plein d'une sensible consolation qui ne fut pas peu augmentée par le baptême des trois mandarins qui avaient accompagné la lettre de leur roi. Ils avaient été précédés par cinq autres moins âgés qu'eux, étudiants à Paris au Collège des Jésuites, et ceux-ci par deux jeunes princes macassars, fils de l'auteur de la révolte dont nous venons de parler, que M. Constance avait envoyés au roi après la défaite de leur père et que Sa Majesté et Monseigneur avaient bien voulu tenir sur les fonds de baptême avec Madame la Dauphine et Madame (18).
Ces heureux commencements faisaient entreprendre avec joie à ce missionnaire un troisième voyage aux Indes. Il était sur le point de se rembarquer avec de nouvelles troupes que le roi envoyait au roi de Siam, de nouveaux missionnaires, de nouvelles assurances de l'amitié sincère de Sa Majesté pour ce prince et de sa protection pour son ministre, lorsque le bruit d'une révolution arrivée subitement en ce royaume, qui avait couru quelques semaines auparavant et qui n'avait pas été cru, devint constant par la nouvelle qu'on en apporta de Hollande qui nous apprit que deux vaisseaux Français, ignorant l'état de l'Europe, étaient aller mouiller au cap de Bonne-Espérance, qu'ils y avaient été pris et amenés en Zélande avec plusieurs prisonnier, par les lettres et par les relations desquels voici ce que nous avons su (19).
Un mandarin nommé Pitracha, de l'ordre de ceux qu'on appelle OprasOk-phra (ออกพระ), titre d'un dignitaire de 3ème rang dans la hiérarchie siamoise., voyant que le roi de Siam n'avait qu'une fille, crut que sans grande difficulté il pouvait usurper la couronne sur les deux frères de ce prince, qui en étaient tous deux fort haïs (20). Pitracha était un faux dévot dans sa religion, qui après s'être retiré parmi les talapoins s'était laissé rappeler à la Cour, où sous un extérieur modéré, il couvait une grande ambition.
Le prétexte de la religion et de la liberté publique qui est de si grand secours aux factieux ne manqua pas à celui-ci. Il trouva des talapoins zélés pour leurs pagodes qui étaient menacées, et des mandarins à qui l'établissement des Français à Siam donnait de l'ombrage ; et comme il est fort populaire, il engagea dans sa révolte autant de petit peuple qu'il put et les choses se tournèrent de sorte qu'il y trouva grande facilité. Comme M. Constance était un grand obstacle à ses desseins, ce fut la première victime qu'il résolut de s'immoler. Ainsi, il eut un soin particulier de pratiquer ses ennemis, parmi lesquels s'est fait remarquer Visouta Sunton (21), si connu en France, pour y avoir été chef de l'ambassade de 1686. Bien des gens s'aperçurent à Paris que ce mandarin craignait ce ministre, et l'on a su depuis qu'il le haïssait d'une haine héréditaire que le dernier barcalon son frère avait inspirée à sa famille. Monpit, favori et fils adoptif du roi (22), fut attiré dans cette conspiration par l'espérance qu'on lui donna de lui faire épouser la princesse et de le mettre sur le trône.
Pendant que tout cela se tramait, M. Constance n'ignorait pas les mauvaises intentions de ses ennemis, mais il ne les craignait pas beaucoup, persuadé que les Français, nonobstant leur petit nombre, étaient capables de tenir dans le devoir toute la nation siamoise. Ainsi il marchait son chemin et prenait des mesures pour assurer le succès de ses entreprises. Car d'un côté il donnait ses ordres pour faire fournir à M. du Bruant de quoi fortifier Mergui et de l'autre il procurait à M. Vollant (23) tout ce qui était nécessaire pour mettre en défense Bangkok. Il venait de fonder un collège aux missionnaires français de la Propagande, il avait fait passer à la Chine les jésuites qui y étaient destinés, et en attendant qu'il en vînt d'autres pour d'autres royaumes où il en voulait envoyer, il faisait bâtir les maisons de ceux qui devaient demeurer dans les villes de Siam et de Louvo. Le roi avait bien la bonté d'aller quelquefois visiter l'église et l'observatoire qu'il leur faisait préparer et de presser les ouvriers, dans l'impatience où il était de voir l'ouvrage bientôt achevé.
Durant ce temps-là ces pères s'occupaient à apprivoiser les talapoins et à s'apprivoiser à eux, à apprendre la langue du pays et à se disposer tout de bon aux fonctions apostoliques, le roi les favorisant toujours et les entretenant toujours avec une familiarité que les rois des Indes n'ont avec personne, surtout avec les étrangers.

NOTES
1 - Le vrai nom de Phaulkon était Constantin Geraki (Hierachy en ancien grec). Le père de Bèze explique ainsi son patronyme : Il servit en 1672 dans la flotte du prince Robert contre les Hollandais et passa ensuite aux Indes avec un autre maître qui changea son nom grec en français et le nomma Faucon, ce que signifie le mot hiérachy. Les Portugais, d'ailleurs, qui n'appellent ordinairement les personnes que par leur nom de baptême, je ne sais par quelle raison, le nommèrent Constans au lieu de Constantin ; ainsi il fut connu sous le nom de Constans Phaucon. (Drans et Bernard, Mémoire du père de Bèze sur la vie de Constance Phaulkon, Tokyo, 1947, pp. 4-5). ⇑
2 - Le père d'Orléans reprend la légende tissée par le père Tachard pour doter Phaulkon d'un passé présentable. Le favori grec était en réalité fils d'un cabaretier de Céphalonie, et n'avait bien entendu pas une goutte de sang bleu dans les veines. ⇑
3 - Cette rencontre entre rêve et réalité de deux naufragés sur une plage possède incontestablement une grande force poétique. C'est ainsi qu'elle est relatée dans le récit du père Tachard. Elle est tout de même hautement fantaisiste et prête à sourire. ⇑
4 - Ce barcalon, sorte de premier ministre, était le Phra Khlang Kosathibodi (พระคลังโกษาธิบดี), frère de lait du roi Naraï et frère de Kosapan (โกษาปาน), futur ambassadeur siamois en France. Kosathibodi mourut en 1683, non sans être tombé en disgrâce et avoir reçu des coups de rotin sur l'ordre de Naraï. Selon La Loubère (Du Royaume de Siam, I, 1691, pp. 286-287), la disgrâce du barcalon aurait été due à une liaison sentimentale qu'il entretenait avec l'épouse du roi. ⇑
5 - Épisode confirmé par l'abbé de Choisy : Il a beaucoup d'esprit, et est fort habile dans le commerce. Il a découvert les friponneries des mahométans, qui étaient les maîtres des affaires avant qu'il s'en mêlât. C'est par-là qu'il s'est élevé. (Journal du 29 septembre 1685). ⇑
6 - Antoine Thomas, (1644-1709), jésuite flamand, fut un remarquable mathématicien, astronome et cartographe. Il s'embarqua pour l'Extrême-Orient en 1680 et atteignit Goa, avant d'essayer en vain de gagner le Japon, alors fermé aux étrangers. Il se trouva au Siam en 1681 et c'est vers cette époque qu'il convertit Phaulkon. On le retrouve à Pékin en 1686 où il occupe les fonctions de collaborateur et secrétaire de Ferdinand Verbiest, président du Tribunal des mathématiques à la cour de l'empereur Khang Xi. Il succède à son compatriote à la mort de ce dernier en 1688, puis laisse la place à Claudio Filippo Grimaldi en 1694. Il continuera son oeuvre apostolique en Chine, réalisant de nombreuses cartes géographiques jusqu'à sa mort à Pékin en 1719. ⇑
7 - Les jésuites portugais s'étaient établis au Siam dès 1606 et édifièrent l'église São Paulo. Elle fut entièrement détruite par les Birmans lors de la mise à sac d'Ayutthaya en 1767. ⇑
8 - Rien n'est moins sûr. Il semble au contraire que le couple vivait dans la tension et la mésentente. Il y avait certainement incompatibilité d'humeur entre l'impulsif Phaulkon et la bouillante Marie Guyomar. ⇑
9 - Saint Paul (Rm 9, 16) : Il n'est pas question de l'homme qui veut et qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. que saint Augustin commente ainsi : Dieu prévoit en effet quels sont ceux qui croiraient à ses miracles s'ils en étaient témoins ; il vient en aide aux uns parce qu'il le veut ; il ne vient pas en aide aux autres parce que dans sa prédestination, cachée mais juste, il en a jugé autrement. Croyons donc sans hésiter à sa miséricorde envers ceux qu'il sauve, et à sa justice envers ceux qu'il punit. (Thomas d'Aquin, Somme théologique, 3ème partie, article 1, question 5). Nous sommes là au centre de la querelle qui oppose jansénistes et jésuites sur la question de la grâce. ⇑
10 - Ou Madura, ou encore Maduraï. Ville du sud de l'Inde. ⇑
11 - Ferdinand Verbiest (1623-1688) missionnaire jésuite flamand. Il fut appelé en Chine par l'empereur K'ang-Xi qui le nomma président du Bureau des mathématiques.
 Le père Ferdinand Verbiest. ⇑
Le père Ferdinand Verbiest. ⇑
12 - Jean-Baptiste Antoine Colbert, marquis de Seignelay, (1651-1690), fils du grand Colbert, qui succéda à son père au poste de Secrétaire d'État de la marine, de 1683 à sa mort. ⇑
13 - Bangkok et Mergui. ⇑
14 - Il y avait en réalité 14 jésuites : Claude de Bèze (?-1695), Jean Venant Bouchet (1655-1732), Charles de la Breuille (1653-1693), Jean Colusson (?-1722), Patrice Comilh (1658-1721), Charles Dolu (1655-1740), Jacques Duchatz (1652-1693), Pierre d'Espagnac (1650-1689), Marcel Leblanc (1653-1693), Jean Richaud (1633-1693), Louis Rochette (1646-1687) qui mourut pendant le voyage, Abraham le Royer (1646-1715), Pierre de Saint-Martin (?-1689) et François Thionville (1650-1691). ⇑
15 - Le chevalier de Forbin, qui eut à les combattre, s'étonnait aussi de la férocité de ces guerriers : J'étais si frappé de tout ce que j'avais vu faire à ces hommes qui me paraissaient si différents de tous les autres, que je souhaitai d'apprendre d'où pouvait venir à ces peuples tant de courage, ou pour mieux dire tant de férocité. Des Portugais qui demeuraient dans les Indes depuis l'enfance et que je questionnai sur ce point, me dirent ces peuples étaient habitants de l'île de Calebos, ou Macassar ; qu'ils étaient mahométans schismatiques et très superstitieux ; que leurs prêtres leur donnaient des lettres écrites en caractères magiques qu'ils leur attachaient eux-mêmes au bras, en les assurant que tant qu'ils les porteraient sur eux, ils seraient invulnérables ; qu'un point particulier de leur créance ne contribuait pas peu à les rendre cruels et intrépides. Ce point consiste à être fortement persuadés que tous ceux qu'ils pourront tuer sur la terre, hors les mahométans, seront tout autant d'esclaves qui les serviront dans l'autre monde. Enfin, ils ajoutèrent qu'on leur imprimait si fortement dès l'enfance ce qu'on appelle le point d'honneur, qui se réduit parmi eux à ne se rendre jamais, qu'il était encore hors d'exemple qu'un seul y eût contrevenu.
Pleins de ces idées, ils ne demandent ni ne donnent jamais de quartier ; dix Macassars, le kriss à la main, attaqueraient cent mille hommes. Il n'y a pas lieu d'en être surpris ; des gens imbus de tels principes ne doivent rien craindre, et ce sont des hommes bien dangereux. Ces insulaires sont d'une taille médiocre, basanés, agiles et très vigoureux. Leur habillement consiste en une culotte fort étroite, et comme à l'anglaise, une chemisette de coton blanche ou grise, un bonnet d'étoffe bordé d'une bande de toile large d'environ trois doigts ; ils vont les jambes nues, les pieds dans des babouches, et se ceignent les reins d'une écharpe dans laquelle ils passent leur arme diabolique. Tels étaient ceux à qui j'avais affaire et qui me tuèrent misérablement tant de monde. (Mémoires du comte de Forbin, I, 1730, p. 178 et suiv.)
 Macassar - La Galerie agréable du monde, 1729). ⇑
Macassar - La Galerie agréable du monde, 1729). ⇑
16 - L'affaire s'engageait mal, car d'emblée le père Tachard multiplia les cachotteries et les mystères, ainsi que l'expliquera l'abbé de Lionne : Étant arrivé à Batavia, le père Tachard qui avait jusqu'alors été dans le vaisseau où étaient les ambassadeurs, passa sur un autre vaisseau qui partit aussitôt, afin de pouvoir arriver à Siam avant les autres. Étant donc descendu le premier à terre, il alla trouver M. Constance ; je ne sais pas ce qu'ils se dirent, mais je sais seulement qu'à notre arrivée à la rade, le père Tachard nous étant venu voir dans notre vaisseau, me dit comme en secret qu'on donnerait Bangkok aux Français, c'est-à-dire qu'on les mettrait dans cette place à certaines conditions que résolurent le père Tachard et M. Constance. Ces conditions, ou ne plurent pas aux envoyés du roi, ou ne furent pas exécutées, ce qui fit que les envoyés se brouillèrent avec M. Constance et avec le père Tachard. Mais comme ce sont choses qui se passaient entre ces messieurs, dont je n'ai pris aucune connaissance, je ne me hasarderai pas à en parler.
Ce que je puis dire seulement, parce que cela est de notoriété publique, est que le père Tachard eut toujours la principale part à tout ; c'était le favori et le serviteur de M. Constance, car sa qualité de supérieur des pères jésuites français dans les Indes ne l'empêcha pas de faire la fonction de secrétaire de M. Constance dans des actes même bien particuliers, et hors de la route commune. (Lettre de M. de Lionne à M. Martineau, Archives des Missions Étrangères, citée dans Launay, I, 1920, p. 199).
Dans sa relation publiée par Michel Jacq-Hergoualc'h aux édition l'Harmattan, Claude Céberet explique qu'avant de permettre aux troupes françaises d'investir les places de Bangkok et de Mergui, ainsi qu'il était convenu, Phaulkon demandait, par une lettre écrite en portugais, l'exécution d'un énigmatique instrument authentique, dont la nature et l'objet échappaient complètement aux ambassadeurs. Tachard expliqua qu'il s'agissait par exemple que le général Desfarges, commandant des troupes, prêtât serment d'obéissance, non seulement au roi de Siam, mais également à Phaulkon, ce qui était inadmissible, comme le note Céberet : « Pour le dernier, lui dîmes-nous, cela ne se peut ; nous vous donnerons par écrit la forme du serment que le roi permet que M. Desfarges fasse au roi de Siam. » Et en effet nous lui donnâmes, mais qu'il ne pouvait faire serment à un particulier quelque grand qu'il fût. » (Étude historique et critique du Journal du voyage de Siam de Claude Céberet, 1998, pp. 58-59). ⇑
17 - Jacques II, cousin de Louis XIV, accéda au trône d'Angleterre en 1685, à la mort de son frère Charles. Très impopulaire en raison de sa conversion au catholicisme et de sa politique pro-française, il dut faire face aux révoltes d'Argyll et de Monmouth, toute deux écrasées. En 1688, Guillaume III d'Orange débarqua en Angleterre avec le soutien des nobles protestants du royaume et s'empara de la couronne. Jacques II prit la fuite, et finit par se réfugier en France, où Louis XIV lui fit une pension et l'invita à résider au château de Saint-Germain-en-Laye. C'est là qu'il mourut en 1701.
 Portrait de Jacques II vers 1686, par Nicolas de Largilliere. ⇑
Portrait de Jacques II vers 1686, par Nicolas de Largilliere. ⇑
18 - Dans son Journal du mercredi 4 février 1688, le marquis de Dangeau note : Le roi a nommé le marquis de la Salle pour tenir en son nom, sur les fonts de baptême, l'un des princes macassar, et Monseigneur a nommé ?. de Matignon pour tenir l'autre aussi en son nom : ces deux princes sont fils du prince des Macassars qui se révolta l'année passée contre le roi de Siam, et qui fut tué avec tous ses gens. (Journal de Dangeau, 1854, II, pp. 103-104).
Le Mercure Galant de mars 1688 se fit l'écho de cette cérémonie : Je vous ai appris il y a quelques mois l'arrivée de deux princes de Macassar en France, et je vous fis un détail de ce qui avait obligé le roi de Siam, chez qui ils étaient, à les envoyer en cette cour. L'aîné, qui est âgé de quinze ans, s'appelle Daën Bourou, et l'autre, qui n'en a que treize, s'appelle Daën Troulolo. Ils sont mahométans et fils de Daën Maallé, frère du feu roi de Macassar. Ce prince dès son plus jeune âge eut part au gouvernement de l'État, et soit que son humeur guerrière et entreprenante fît appréhender au roi son frère qu'il ne cherchât à le mettre hors du trône, soit qu'il prêtât trop facilement l'oreille aux rapports de ceux que des intérêts particuliers portaient à vouloir sa perte, il commença à le regarder comme ennemi, et prit le dessein de s'en défaire. Ce complot ne put être si secret que Daen Maalé n'en fût averti. La conspiration étant sur le point d'être exécutée, ce malheureux prince fut obligé d'user d'adresse et de diligence pour sauver sa vie. Comme la ville de Macassar n'est pas fort éloignée de la mer, il fit équiper une grande chaloupe et sortit le soir du palais chargé d'or, et de ce qu'il trouva de plus précieux. Il était seulement accompagné de deux de ses plus fidèles serviteurs, dont l'un portait son sabre et l'autre son bouclier. Il s'embarqua la nuit, et se rendit en peu d'heures à l'île de Java auprès d'un petit prince souverain, son allié. Il en fut reçu très favorablement, y demeura environ trois ans, et même s'y maria. Il prit pour femme Anec Sapiha, fille d'un des principaux seigneurs de l'île, qui était mahométan comme lui, et c'est d'elle qu'il a eu les deux jeunes princes dont je vous ai parlé. La nouvelle de sa fuite hors de son pays étant venue jusqu'au roi de Siam, parce que les canots de ce prince allaient trafiquer souvent à Java, il n'eut pas été plutôt informé de la valeur et des autres grandes qualités de Daën Maallé, qu'il voulut l'attirer dans ses États. Il lui envoya un de ses meilleurs canots, et lui écrivit d'une manière fort obligeante, que ce prince accepte l'offre qui lui était faite. Il arriva en quinze ou vingt jour à Siam, où le roi le reçut avec toute l'amitié et toute l'estime qu'il pouvait attendre. Il lui donna le titre de Doia Pacdy, ou Grand trésorier de la couronne, et une pension considérable avec un village et ses dépendances. Il y a vécu environ vingt ans avec honneur, aimé du roi, et fort estimé du peuple. Mais ayant enfin oublié ce qu'il devait à son bienfaiteur, le zèle de la religion mahométane le fit conspirer contre le roi de Siam, et il fut tué dans cette conspiration dont je vous ai donné le détail dans ma lettre d'octobre dernier. Daën Bourou et Daën Troulolo, ses fils, étant arrivés en France, Sa Majesté qui connaît le talent et le zèle qu'ont les jésuites pour l'instruction de la jeunesse, tant pour ce qui regarde le culte de Dieu que pour les Lettres, les mit pensionnaires chez eux, afin qu'ils eussent soin de leur éducation, et ils y ont si bien réussi, surtout à l'égard de la religion catholique, que leur en ayant enseigné les vérités, ils les ont mis en état de recevoir le baptême. La cérémonie s'en fit le 7 de ce mois dans l'église de leur maison professe, par Mgr l'évêque du Mans, premier aumônier de Monsieur, en présence de M. Hameau, curé de Saint-Paul, qui était en surplis en étole. Un fort grand nombre de jeunes gens de la première qualité, dont le Collège de Louis le Grand est rempli, et qui y sont en pension, les accompagnèrent. Le roi fut parrain de l'ainé de ces deux frères, et Madame la Dauphine en fut la marraine. Il fut nommé Louis par M. le marquis de la Salle pour le roi, et par Mme la marquise de Bellefond pour Mme la Dauphine ; et le cadet fut nommé Louis Dauphin par M. le comte de Matignon, au nom de Mgr le Dauphin, et par Mme la comtesse de Maré, au nom de Madame. (Mercure Galant, Mars 1688, pp. 239 et suiv.)
S'il faut en croire André-François Deslandes-Boureau, auteur d'une Histoire de M. Constance (Amsterdam, Paris, 1756) rédigée à partir des mémoires de François Martin et notes de son père, André Deslandes, directeur du comptoir de la Compagnie des Indes à Ayutthaya, le sort de ces deux princes exotiques ne fut guère brillant : Les jésuites, qui ne font jamais rien sans quelque motif d'intérêt, prirent soin des deux jeunes princes macassars dont le père avait été tué, et après les avoir les avoir baptisés [inexact, ils ne furent baptisés que plus tard en France], il les conduisit en France. Louis XIV les vit, et comme il aimait les choses d'éclat, il ordonna qu'ils fussent employés dans la marine. Le sort de l'aîné fut bien triste : il se tua lui-même à coups de couteau. Pour le second que j'ai connu à Brest, il avait la couleur, l'air et les manières d'un nègre grossier. Jamais les jésuites n'ont fait une plus mauvaise emplette que d'avoir amené en France ces princes macassars. Ils déshonoraient l'humanité. Je dirai en passant qu'on a souvent été trompé à Paris et à la cour par ces prétendus princes d'Asie et d'Afrique. On aurait dû rougir seulement de les présenter, à moins que ce ne fût comme des animaux extraordinaires. (Histoire de M. Constance, 1756, pp. 29-30). ⇑
19 - Ayant dû quitter le royaume « la pète au cul », selon l'élégante formule de Véret, les rescapés de la révolution de Siam n'étaient pas au bout de leurs épreuves. Réfugiés à Pondichéry, le comptoir français dirigé par François Martin, il fut décidé qu'une partie retournerait au Siam pour occuper l'île de Joncelung (Phuket) sous la direction de Desfarges tandis qu'une autre regagnerait la France pour apporter à Louis XIV les nouvelles de la révolution qui venait de ruiner tant de belles espérances. Parmi eux se trouvaient les officiers Beauchamp, Sainte-Marie, Saint-Vandrille, Delast, Vollant des Verquains et les jésuites Le Blanc et Coluson. Sur le chemin du retour, les deux navires, la Normande et le Coche, voulurent faire escale au cap de Bonne-Espérance, sous contrôle hollandais. Il se souvenaient d'y avoir été très bien accueillis sur la route de l'aller, trois ans auparavant, par le gouverneur Simon van der Stel, et ignoraient que la France était à nouveau en guerre avec les Provinces-Unies depuis quelques mois. Les passagers des deux navires furent faits prisonniers et séjournèrent quatre mois dans les geôles de la Compagnie hollandaise avant d'être envoyés en captivité à Middelbourg, en Hollande, puis renvoyés en France quelques semaines plus tard à l'occasion d'échanges de prisonniers. C'est pendant ce séjour dans les prisons bataves que plusieurs d'entre eux, disposant de nombreuses heures de loisir, se consacrèrent à l'écriture de relations et de mémoires. ⇑
20 - Cette affirmation est loin d'être confirmée par les témoignages. Il est vrai que le frère aîné du roi, Chao Fa Apai thot (เจ้าฟ้าอภัยทศ) n'était pas gâté par la nature et n'avait rien qui puisse le rendre aimable : ... mal fait de corps, il avait les jambes de travers dont à peine pouvait-il se servir et était d'ailleurs d'un naturel fort emporté et fort adonné au vin (Drans et Bernard, Mémoires du père de Bèze, Tokyo, 1947, p. 67). Accusé – à tort ou à raison – d'avoir conspiré, il fut assigné à résidence dans le palais dont il ne pouvait sortir. En revanche, toujours selon de Bèze, le frère cadet Chao Fa Noi (เจ้าฟ้าน้อย) partait avec de meilleures chances : le peuple, qui l'aimait tendrement, à cause de ses belles qualités, le regardait avec joie comme le successeur de la couronne et il avait en effet tout ce qui peut rendre un prince aimable : il était bien fait de sa personne et assez blanc, ce que les Siamois estiment beaucoup ; il était affable et populaire, l'esprit agréable et les manières fort engageantes, ce qui le rendait les délices de la cour et du peuple. Le roi Naraï songea à en faire son héritier au préjudice de l'aîné et, afin de rendre son choix plus solide, il songea à lui faire épouser la princesse son unique fille. (op. cit. p. 69). Laquelle princesse Yothathep, follement éprise de son oncle, ne demandait pas mieux. Las pour le petit prince, une liaison qu'il eut avec une des principales concubines de son père entraîna sa disgrâce. La concubine fut condamnée à être dévorée par le tigre, qui est un des exécuteurs ordinaires des Siamois. Le prince fut également condamné à mort, puis gracié, il dut néanmoins subir une sévère correction qui lui laissa une grande faiblesse des jambes avec une espèce de paralysie sur la langue qui l'empêchait de parler ; quelques-uns, cependant, ont prétendu qu'il contrefaisait le muet pour ne pas donner d'ombrage au roi à qui l'attachement que les grands du royaume et sa fille même conservaient encore pour ce prince, était suspect. (Drans et Bernard, op. cit. p. 73). ⇑
21 - Ok Phra Visut Sunthon (ออกพระวิสุทธิสุนทร) dit Kosapan (โกษาปาน). Voir sur ce site la page qui lui est consacrée. ⇑
22 - Phra Pi (พระปีย์), appelé également Prapié, Monpy, Monpi, etc. Fils d'un courtisan, ce jeune garçon fut emmené très jeune au palais pour y exercer les fonctions de page, et fut élevé par une sœur du roi Naraï. Toutes les relations s'accordent à reconnaître la tendresse quasi paternelle que le roi lui prodiguait, et les privilèges exceptionnels dont il jouissait. Lors de la révolution de Siam en 1688, Phra Pi fut arrêté dans la chambre même du roi Naraï et décapité. Selon certains témoignages, sa tête aurait été attachée pendant plusieurs jours au cou de Phaulkon soumis à la torture. ⇑
23 - Jean du Bruant était le commandant désigné pour investir la place de Mergui. Vollant des Verquains, ingénieur, écrivit une Histoire de la révolution de Siam reproduite sur ce site. ⇑

12 mars 2019
