

1ère partie.
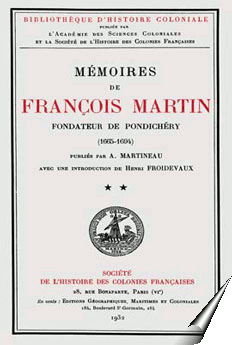
| La succession éventuelle du roi – Visées de Phetracha. – Contre-attaque de Constance. – Fausse manœuvre de Desfarges. |
Avant de passer à la continuation de cette relation, je rapporterai ce que j’ai appris des révolutions de Siam ; ce sont des faits connus et publics. Je n’entrerai point dans ce qu’il y peut avoir eu de particulier ou de partialité. Outre que les rapports sont souvent suspects par les intérêts différents des partis ; je ne suis pas en droit aussi de connaître ce qu’il y a eu d’opposé dans la conduite des personnes qui ont été de divers sentiment, je suis même persuadé que chacun a cru agir de bonne foi.
Après le départ du Siam, les envoyés et les navires du roi mirent à la voile. M. du Bruant passa à Mergui avec un détachement de troupes. On reconnut peu de temps après par certains bruits sourds, qui sont ordinairement les avant-coureurs des grandes actions, qu’il se brassait quelque chose dans le royaume, mais qu’on ne pouvait pas découvrir.
Phra Phetracha, un des premiers seigneurs de la cour, homme d’esprit et entreprenant, voyant le roi presque toujours malade, dans un âge avancé et avec toutes les apparences qu’il ne vivrait pas encore longtemps, chercha les voies de faire son parti. Le roi avait deux frères, l’un peu capable du gouvernement et l’autre entrepris de tous ses membres.
Phetracha prévit bien qu’il aurait les Français à dos dans l’entreprise qu’il méditait et qu’ils se déclareraient pour le successeur que le roi nommerait. Ce prince élevait auprès de lui un jeune homme nommé Phra Pi, fils d’un mandarin, comme un fils adoptif ; le bruit courait même qu’il le ferait succéder en le mariant avec sa fille, n’ayant point d’autres enfants. Phetracha attira à son parti le premier des trois ambassadeurs qui avait été en France ; il était mal satisfait de M. Constance ; il y joignit d’autres mandarins qui entrèrent aussi dans le complot, portés par la haine de voir un étranger à la tête des affaires, les Français dans les principaux postes et peut-être aussi par les avantages que Phetracha leur promettait. Il y fit entrer aussi les principaux talapoins – ce sont les ministres de la religion – en leur faisant appréhender l’établissement de la religion chrétienne, si les Français subsistaient. Phetracha commença à faire des levées de gens dans les provinces éloignées et à gagner aussi les officiers siamois qui étaient de ces côtés.
Il n’était pas aisé, malgré toutes les précautions qu’il prit de cacher son dessein, que ces mouvements ne fissent du bruit. M. Constance avait encore des amis, il en eut avis et connut bien qu’il n’y avait que Phetracha qui en pouvait être l’auteur. Il en communiqua avec M. Desfarges qui ne quittait point la Cour qui était pour lors à Louvo. L'on trouva à propos que ce général descendît à Bangkok pour reconnaître les lieux, ce qu’on avait avancé aux fortifications et pour mettre les choses en état avant son départ. M. Constance lui demanda s’il pouvait lui promettre de retourner à la Cour avec un détachement de 80 ou 100 hommes choisis lorsqu’il lui écrirait ; il ajouta même qu’il lui déclarât nettement s’il y trouvait de la difficulté, afin qu’il pût prendre son parti d’ailleurs, si ce secours lui manquait. M. Desfarges, qui avait des ordres du roi de suivre les sentiments du ministre, s’engagea et promit de retourner à la Cour avec le détachement aux premiers ordres qu’il recevrait. Il partit ensuite pour Bangkok.
M. Constance, averti encore plus particulièrement des mouvements dans les provinces de la levée de troupes et qu’il n’y avait point de temps à perdre pour faire le coup qu’il avait résolu de se défaire de Phetracha, écrivit à M. Desfarges de monter à la Cour avec le détachement dont ils étaient convenus. Ce général partit aussitôt avec 80 et tant d’hommes, officiers et soldats, gens choisis et capables d’un coup de main. À son arrivée à Siam, il fut à la loge de la Compagnie. Il déclara son dessein au sieur Véret qui en était le chef. Le sieur Véret, surpris du voyage de M. Desfarges, lui représenta que le bruit était répandu dans la ville de la mort du roi et que le pays était rempli de troupes, qu’il trouverait 12 à 15 000 hommes sur la route de Siam à Louvo qui l’attendaient, qu’il y périrait assurément et qu’il se croyait obligé de lui donner cet avis. Je rapporte l’essentiel de ce qui fut représenté et ce qui est de fait.
M. Desfarges, surpris aussi de son côté de ce changement de scène, ne balançait point pourtant à continuer le voyage ; il s’y était engagé. Le sieur Véret, le voyant dans cette résolution, lui proposa d’aller chez Messieurs de la Mission ; ils y furent, on lui dit les mêmes choses, et sa perte, et celle de ses gens sûre, s’il passait plus avant, et par suite aussi celle des Français restés dans Bangkok et dans les autres endroits du royaume, ce qui le détermina à demeurer à Siam. Il prit pourtant le parti d’envoyer à Louvo, afin d’être informé de l’état des lieux. Le sieur Beauchamp, capitaine dans les troupes et major de Bangkok et le sieur d’Assieux, aussi capitaine dans le même corps, y furent en différents temps ; leur rapport fut qu’ils n’avaient point trouvé d’empêchement dans les chemins et à la Cour la même tranquillité qu’autrefois (1), le roi en vie mais toujours indisposé. Ils avaient parlé à M. Constance, aux révérends pères jésuites qui étaient à Louvo, qui les avaient assurés qu’il n’y avait aucun changement. M. Desfarges était si fortement persuadé de cette assemblée de troupes par les assurances qu’on lui avait données et de ce qu’on lui ajoutait ensuite, que le passage des deux officiers sans trouver des obstacles était une adresse des conjurés pour l’engager dans la suite du voyage et le faire donner dans les embuscades qu’on lui dresserait, qu’il résolut de retourner à Bangkok, où il se retira avec ses gens.
Cette conduite de M. Desfarges dont on a écrit si diversement en France est assez embarrassante à déterminer les esprits, si ce retour à Bangkok a été fait à propos ou s’il aurait été plus avantageux de continuer le voyage de Louvo. Les personnes qui le dissuadèrent de passer plus avant, j’entends parler de Messieurs de la Mission, sont d’un mérite distingué, d’une vertu et d’une probité connues, instruits des manières de Siamois par un séjour de plusieurs années dans le pays, qui savaient parfaitement la langue, qui y avaient acquis des amis et qui pouvaient avoir des avis secrets. On n’a point douté aussi qu’ils ne fussent très persuadés eux-mêmes de ce qu’ils avaient rapporté à M. Desfarges. Cependant le voyage des deux capitaines à la cour, d’autres particularités reconnues depuis, le rapport des gens du pays (car il y en a eu pour et contre) ont fait douter de cette assemblée de troupes sur la route de Siam à Louvo. Il est sûr, si cet avis s’était trouvé faux, que l’arrivée à la Cour de M. Desfarges avec les gens qu’il y menait était le gain de partie : Phetracha était perdu. En l’arrêtant, c’était le plus sûr moyen de s’en défaire sur-le-champ. L’auteur mort, le parti était absolument dissipé, il n’aurait pas été difficile de faire approuver le coup au roi par les témoignages des mandarins de son parti qu’on aurait pris et de qui l’on aurait tiré le secret du dessein des conjurés, entièrement opposé aux intentions de ce prince sur son successeur.
| Soulèvement contre le roi. – Arrestation de Constance. |
Le retour de M. Desfarges à Bangkok fut le commencement des révolutions de siam. On a rapporté que M. Constance avait différé de donner avis au roi des desseins de Phetracha, qu’il attendait d’avoir mis les choses en état de s’y opposer avant que de s’en ouvrir à ce prince. Il le connaissait violent et prompt de son naturel, qu’il éclaterait d’abord et que cela pourrait rompre toutes ses mesures ; cependant, voyant le péril proche, il le découvrit. Il en arriva ce qu’il avait prévu ; le roi s’emporta d’abord et donna des ordres sur-le-champ d’arrêter Phetracha. L’avis que ce révolté en eut lui fit comprendre qu’il n’avait plus rien à ménager. Sa résolution prise, il se rendit maître du palais. Cette action d’un soulèvement public contre son prince éclata dans Louvo et y mit tout en confusion.
À la nouvelle que M. Constance en eut et voyant sa perte assurée, il crut aussi qu’il n’avait plus rien à ménager. On a rapporté pourtant qu’en assemblant les officiers, les gens qui étaient proche de lui et les amis qu’il avait encore à la cour, il aurait pu soutenir et mettre en état de se retirer ou mourir glorieusement. Le jugement lui manqua dans l’action la plus importante de sa vie. On peut dire aussi que le retour de M. Desfarges à Bangkok, dont il se crut abandonné, y contribua beaucoup. Il sortit de son logis, suivi de quelques gardes anglais et de quelques officiers français dont deux fils de M. Desfarges étaient du nombre (2). Les révérends pères jésuites s’opposèrent autant qu’ils purent à sa résolution ; leurs raisons n’y purent rien. Comme il ne doutait pas que Phetracha n’eût formé des desseins sur ce qui restait de vie au roi, il dit hautement qu’il voulait mourir à la défense d’un prince à qui il avait tant d’obligations, et parti de là, mais en homme qui voulait se perdre, il entra dans le palais dont on ferma la porte après à une partie des gens qui le suivaient. Il y trouva Phetracha, les mandarins de son parti et les gens de la faction en armes. Il en fut arrêté et désarmé ainsi que les officiers qui étaient entrés avec lui. Il eut un moment d’entretien avec ce soulevé, on le fit monter ensuite sur une plate-forme du palais, apparemment pour faire voir au peuple qu’il était arrêté et renfermé ensuite. Les Français ne l’ont point vu depuis. Les officiers furent retenus sous bonne garde, mais sans être maltraités.
| Voyage de Desfarges à Louvo et retour à Bangkok. |
Phetracha, maître du palais, du roi et de M. Constance continua par les même voies d’achever son crime. Le plus important était de faire sortir les Français de Bangkok. Il écrivit à M. Desfarges de monter à Louvo où le roi le mandait de venir. On a dit (mais je ne le rapporte pas pour sûr) que l’on marquait dans la lettre que ce prince avait résolu de le mettre à la place de M. Constance, qu’il avait fait arrêter pour avoir malversé dans sa charge (3). Des personnes qui étaient à la Cour écrivirent à M. Desfarges de ne point s’engager dans ce voyage. On lui donnait avis de l’état des choses et des desseins de Phetracha. Comme tous les esprits ne sont pas des mêmes sentiments, il y en eut qui persuadèrent ce général d’aller à la cour. Je n’ai pas su les raisons qu’ils rapportèrent ; elles étaient fortes apparemment, puisqu’il y déféra. Après avoir laissé ses ordres à M. de Vertesalles pour la conservation du poste de Bangkok, il fut à Louvo. Phetracha le reçut fièrement et en homme qui avait l’autorité en main. Il parla avec indignation de la conduite de M. Constance, de la dissipation des trésors du roi et y mêlait les Français par occasion. Il se modéra pourtant dans la suite par les assurances qu’il donna qu’on aurait toujours la même considération pour eux, mais que comme ils étaient venus à Siam pour contribuer à la défense du royaume, sur l’avis qu’on avait eu de la marche d’un corps de Laotiens, les anciens ennemis des Siamois, et de leur entrée dans le pays, qu’il [Desfarges] écrivît au commandant qu’il avait laissé à Bangkok de monter à la Cour avec la garnison, afin d’aller à la rencontre des ennemis avec les troupes du pays qui étaient assemblées au rendez-vous.
M. Desfarges, surpris de cette proposition, toujours ferme, répondit à Phetracha que tous les ordres qu’il écrirait au commandant qu’il avait laissé à Bangkok ne serviraient de rien, qu’il ne quitterait pas le poste et que, si l’on en voulait tirer la garnison, qu’il était absolument nécessaire qu’il y retournât. Phetracha rebuta d’abord cette réponse. On contesta de part et d’autre. M. Desfarges se tint toujours à son point. Il dit enfin au révolté que laissant à Louvo ce qu’il avait de plus cher au monde pour gage de sa parole, parlant de ses deux fils, il ne devait pas douter de son retour. Phetracha, ou par la pensée qu’il eut que M. Desfarge accomplirait sa promesse, ou que les choses n’étaient peut-être pas dans l’état qu’il était nécessaire pour éclater, permit au général de descendre à Bangkok. Ce fut dans ce voyage que la lettre dont j’ai parlé à l’article de Mergui fut écrite à M. de Bruant.
Il y eut des personnes qui ont trouvé à reprendre à la conduite de M. Desfarges de ce qu’il n’avait pas dit un mot en faveur de M. Constance ; d’autres ont cru qu’ayant fait réflexion à son arrivée à la Cour qu’il s’était engagé trop légèrement dans ce voyage, son but ne fut qu’à tâcher de s’en tirer et d’éviter d’irriter Phetracha par une intercession en faveur d’un homme qu’il voulait perdre. Il était persuadé aussi qu’elle ne servirait de rien. Enfin il arriva heureusement à Bangkok. Pendant son absence, M. de Vertesalles avait occupé la garnison aux travaux que l’ingénieur avait trouvés à propos de faire, à monter du canon et à le placer dans les lieux les plus nécessaires. On continua le travail après le retour de M. Desfarges et, comme il n’était pas résolu de monter à Louvo, on se disposa à se défendre des attaques des Siamois. M. l’abbé de Lionne passa aussi à Bangkok avec quelques missionnaires. Le sieur Véret quitta la loge et prit le même parti.
| Mort du roi et de Constance. – Massacre de la famille royale. |
Phetracha avait déjà poussé ses affaires bien avant, mais ce n’était rien faire pendant qu’il y aurait des personnes en droit de lui disputer la couronne. Il commença la tragédie par la mort de Phra Pi. Ce jeune homme ne quittait pas la chambre du roi, le seul asile où il croyait être en sûreté. Il en fut tiré pourtant, ou par adresse, ou par force, et massacré ensuite. Les deux frères du roi qui étaient dans le palais de Siam en furent tirés par les mêmes voies, menés à Louvo et renfermés dans des sacs de drap écarlate et assommés avec des bâtons de bois de santal. On n’a pas su le temps de la mort de M. Constance (4). On ne doute pas que Phetracha ne lui fît souffrir tous les tourments qui sont en usage dans le pays. On a rapporté qu’il fut conduit hors de la ville à l’entrée de la nuit, coupé en pièces à coups de sabre. Le roi mourut aussi dans le même temps. On a des informations sûres que les Hollandais étaient fort intrigués dans ces révolutions, particulièrement un certain Daniel, de leur loge, natif de Sedan, chirurgien de profession, hérétique opiniâtre et ennemi déclaré de la religion catholique et des Français. On assure encore que l’on a des témoignages par les mêmes informations qu’on mêla du poison dans un breuvage qu’on donna au roi, qui avança beaucoup sa mort (5). Je ne dis rien du nombre des mandarins et des autres personnes qui furent arrêtés dans ces mouvements de révolution et dans la suite : c’est une des maximes ordinaires des tyrans de se défaire des gens qui ne sont point de leur faction ou qui pourraient s’opposer à leurs desseins.
| Mme Constance prisonnière. – Phetracha proclamé roi. |
Mme Phaulkon fut prise aussi. L’on enleva tout ce qu’il y avait dans la maison. Elle fut exposée ensuite à la question pour l’obliger à découvrir où étaient les effets de son mari. Elle souffrit les tourments avec une fermeté qui donna de l’étonnement ; sa plus grande peine après fut de résister aux poursuites brutales du fils de Phetracha. On la fit passer à Siam, son appartement dans une écurie d’où l’on la tirait pour aller travailler au palais à des confitures. Mgr l’évêque de Metellopolis fut aussi arrêté avec plusieurs missionnaires et maltraités ; tout ce qu’il y avait dans leurs maisons fut enlevé. Les révérends pères jésuites furent exemptés de ces persécutions. On ne toucha point à leurs personnes ni à ce qui leur appartenait. Le roi, un peu avant sa mort, appréhendant qu’ils ne fussent dans la nécessité, leur envoya à chacun un cati – c’est 150 écus (6). Phetracha, après avoir achevé la tragédie de Louvo, vint à Siam y tenir sa Cour et donner les ordres à l’attaque de Bangkok. Je n’ai pas appris le temps auquel il prit le titre de roi ni celui de son mariage avec la fille du défunt.
| Armements siamois contre les Anglais - projet d’attaque de Madras. |
Mme Phaulkon fut prise aussi. L’on enleva tout ce qu’il y avait dans la maison. Je ne m’arrêterai pas au récit des attaques de Bangkok, outre que je n’en ai pas le détail. On est assez accoutumé en France aux actions de vigueur ; je ne puis pourtant éviter d’en rapporter une qui a fait de l’éclat.
Quelques temps devant les révolutions, M. Constance avait fait armer deux vaisseaux du roi de Siam commandés par deux officiers français. On y embarqua un détachement de troupes sous un capitaine que l’on tira du corps. Le bruit commun était que ces bâtiments allaient en couse contre des corsaires qui roulaient dans ces mers. On a su depuis, même par les instructions des officiers, que leurs ordres étaient de prendre les vaisseaux anglais qu’ils rencontreraient retournant des Manilles ou qui seraient partis de madras pour le voyage de ces îles, mais il y avait encore quelque chose de plus fort ; les officiers étaient chargés par leurs ordres de passer le détroit de Malacca et de venir devant Madras brûler tous les navires qu’ils trouveraient à la rade. J’ai remarqué dans un article de cette relation les avis que les Anglais eurent d’une partie de ce dessein. Il fallut que la passion de haine ou de vengeance poussât bien loin un homme pour engager des gens d’honneur et officiers du roi à une entreprise de même où leur perte était sûre. Les personnes qui n’entraient point dans les sentiments de M. Constance étaient de la facilité de M. Desfarges à permettre l’embarquement des troupes du roi pour faire la guerre aux Anglais, mais soit que les officiers qui étaient sur ces vaisseaux prévissent le peu d’apparence à réussir dans leurs ordres ou que les bâtiments mal équipés ne fussent pas en état de passer le détroit de Malacca, ils restèrent quelques mois à battre la mer sans rien rencontrer et peut-être qu’ils le souhaitaient de même (7).
| Attaque d’un vaisseau français par les Siamois - courageuse défense et mort du commandant Saint-Cry. |
Ce fut dans ces temps-là que les révolutions arrivèrent. Comme les troupes étaient nécessaires pour la défense de Bangkok, mais encore qu’il fallait des vaisseaux pour être maîtres de la rivière et de la mer, et afin aussi d’envoyer donner des avis de l’état des choses dans les comptoirs de la Compagnie afin d’en tirer les nécessités dont on aurait besoin pour la conservation de la place, on résolut de faire partir une petite barque que le sieur Véret avait faite apprêter pour un second voyage qu’il s’attendait à faire à l’île de Bornéo, ce bâtiment pour aller à la rencontre de deux vaisseaux qui étaient en mer ainsi que pour attendre les navires qui viendraient de France et informer les officiers des changements arrivés au royaume de Siam. Le sieur de Saint-Cry, enseigne de marine, eut ordre de commander ce petit bâtiment. On lui donna quelques Français avec lui. Il n’était pas beaucoup éloigné de Bangkok qu’il fut attaqué par plusieurs barques de Siamois. Après une vigoureuse défense de loin, le sieur de Saint-Cry les voyant venir à l’abordage et n’étant pas en état de leur résister par leur grand nombre, fit jeter plusieurs grenades sur le pont, de la poudre épandue partout et des traînées pour y mettre le feu. Il se retira ensuite dans la chambre du Conseil avec ses gens. Les Siamois ayant abordé se jetèrent en foule sur le pont. Le feu mis aux traînées, la poudre et les grenades firent leur effet, plusieurs des ennemis brûlés et blessés. Ceux qui échappèrent au feu se retirèrent dans leurs barques ou se jetèrent dans la rivière.
Le pont nettoyé et les bâtiments éloignés, le sieur de Saint-Cry continua sa route. Les Siamois, apparemment hors d’eux-mêmes de voir une petite barque résister si longtemps, se déterminèrent à venir une deuxième fois à l’abordage. Le sieur de Saint-Cry, connaissant par là qu’il n’y avait plus d’apparence de s’en tirer, résolut de faire sauter le bâtiment. Il disposa tout pour l’exécution. Les ennemis se jetèrent encore en foule sur le pont et le feu mis aux poudres les enleva avec la barque et ce qui était proche du bord. Le commandant y périt. J’ai entendu dire qu’il ne se sauva qu’un jeune garçon français de treize à quatorze ans qui tomba entre les mains des marchands et qui en souffrit beaucoup pendant qu’il y resta. La perte des Siamois fut considérable ; on dit même que, reconnaissant par cette action l’intrépidité et la résolution de Français de n’avoir aucun égard à eux-mêmes lorsqu’il s’agissait de la perte de leurs ennemis, ils furent plus réservés dans les attaques.
| Arrivée de deux navires français à Bangkok - leur désarmement par les Siamois. |
Cependant les deux vaisseaux retournèrent à la rade de la rivière de Siam. On ne rend peut-être pas assez de justice en France aux nations des Indes pour leur effort et pour leur bon sens ; il y a même des historiens, en parlant de quelques-unes de ces nations, qui les traitent de barbares et de sauvages ; il est vrai que ce premier nom convient bien à quelques-uns par leur perfidie et leur cruauté, mais il est sûr qu’ils sont aussi intelligents pour ce qui touche leurs traités, leurs intérêts et leur politique pour leur gouvernement et qu’ils ne le cèdent pas aux nations de l’Europe. Les Siamois avaient prévu au retour des deux navires. Ils tenaient des bateaux prêts au bas de la rivière, des mandarins et des rafraîchissements dessus. À l’arrivée des vaisseaux, ils furent à bord, ils dirent des merveilles de la santé du roi, de celle de M. Constance et du bon état des Français dans Bangkok (on commençait à traiter dans ce temps-là, ce que je rapporterai dans la suite.) Les officiers des navires crurent aisément ce qu’on leur rapportait. Le capitaine qui commandait le détachement des soldats s’embarqua avec des mandarins et fut conduit à Bangkok où il apprit les changements qui étaient arrivés. Il y eut ensuite des ordres ou mal donnés ou mal entendus qui firent débarquer tous les Français qui étaient sur les navires, que l’on fit descendre à Bangkok et les bâtiments restèrent au pouvoir des Siamois. M. Desfarges soutenait avoir donné des ordres contraires, mais le mal était sans remède.
| Le sort des Français restés à Louvo comme otages. |
Les deux fils de M. Desfarges et les autres officiers que ce général avait laissés à Louvo au voyage qu’il y fit étaient toujours restés. Ils furent tenus de court dans les commencements des révolutions et menacés, mais ensuite avec toute liberté. Ils avaient même la permission d’aller à la chasse. Un jour qu’ils étaient montés à cheval pour ce divertissement, ils résolurent de pousser jusqu’à Siam où ils croyaient trouver de la facilité à se rendre maître d’un bateau pour passer à Bangkok. Ils étaient déjà à mi-chemin de Louvo à Siam lorsque leur intention fut reconnue par les Siamois. Ils s’assemblèrent en troupe pour s’opposer à leur retraite. Leur nombre augmentant toujours à mesure que les officiers avançaient et enfermés à la fin de tous côtés, ils virent qu’il n’y avait pas d’apparence de passer plus avant. Ils étaient tous bien armés et quelques-uns d’entre eux poussaient les autres à passer de force ou à mourir généreusement. Les plus prudents crurent qu’il valait mieux céder. On en vint aux pourparlers, les officiers consentirent à retourner à Louvo, mais la méchante conduite qu’ils eurent fut de rendre leurs armes que les Siamois leur demandèrent. On se saisit d’eux ensuite, on en attacha quelques-uns à la queue des chevaux et des gens derrière avec des rotins qui les forcèrent de courir pour égaler la course de ces animaux. Un ingénieur mourut dans cette espèce de supplice (8). Les autres arrivèrent à Louvo en l’état qu’il est facile de s’imaginer par le traitement qu’ils avaient souffert et renfermés sous bonne garde.
| Phetracha négocie l’évacuation de Bangkok par les Français – Arrivée tardive d’un vaisseau de secours français. |
Phetracha ne voyant pas d’apparence de forcer les Français dans Bangkok et appréhendant l’arrivée des vaisseaux avec des forces qui leur donneraient des moyens de pousser jusqu’à Siam, crut que les voies d’accommodement lui réussiraient mieux. Le premier ambassadeur qui avait été en France et élevé depuis les révolutions à la charge de barcalon ou de premier ministre, s’entremit pour ce traité. On communiqua de part et d’autre, on convint enfin, - ce que je le rapporterai plus au long par la suite, - que les Siamois fourniraient des vaisseaéux et des vivres pour le passage des Français de Bangkok à Pondichéry. C’était tout ce que Phetracha demandait de voir les Français hors de ses États. Il y eut surséance d’armes ; on avait la liberté d’aller à Siam comme en pleine paix. Ce fut dans ce temps-là que le sieur de la Touche, qui avait été arrêté à Mergui, fut amené à Siam. Il y porta les nouvelles de la retraite de M. de Bruant sur la frégate qu’il avait enlevée dans le port. Le barcalon se plaignit ; il demanda une lettre à M. Desfarges pour le commandant des troupes qui s’étaient retirées à Mergui (et que l’on écrivait être resté entre les îles) pour faire rendre ce bâtiment. La lettre fut écrite ; le sieur de la Touche en fut le porteur, il repassa à Mergui où il n’y avait plus de nouvelles de M. de Bruant, mais où il trouva le navire le Coche où il s’embarqua.

NOTES :
1 - Ce n'est pas tout à fait ce que disait Beauchamp (Manuscrit anonyme Ms Fr 8210 Bibliothèque nationale, f° 526r°) : Comme nous fûmes arrivés au port, me trouvant obligé de me retirer un peu à l'écart, j'aperçus derrière des haies quantité d'hommes qui défilaient. Cela me fit soupçonner quelque chose, c'est pourquoi, voulant reconnaître davantage, je descendis plus de cent pas, comme en me promenant le long de la rivière. En regardant à droite et à gauche, j'aperçus dans le fond des balons grand nombre de sabres et de boucliers que l'on y avait mis, ce qui me fit croire qu'on avait quelque mauvaise intention. Je les fis apercevoir à M. l'abbé de Lionne qui me dit qu'assurément ces gens-là avaient formé quelque dessein. En effet, tout le long de la route, on ne voyait que balons qui venaient de tous côtés au barcalon, à qui il donnait ses ordres, et que monde sur les bords de la rivière qui s'embarquaient dans des balons. ⇑
2 - Il n'y avait que le chevalier Desfarges, fils cadet du général. L'aîné, le marquis, était à Bangkok. Les autres officiers présents lors de l'arrestation de Phaulkon étaient Beauchamp et le chevalier de Fretteville. ⇑
3 - Desfarges indique que c'est à son fils cadet, le chevalier Desfarges, et non à lui, qu'on avait envisagé de confier les charge de Phaulkon (Relation des révolutions arrivées à Siam pp. pp.24-25) : Le premier ambassadeur ajouta de plus dans une autre visite qu'il fit à M. l'abbé de Lionne que le roi avait fait arrêter le sieur Constance pour quelque crime, et aussi parce qu'il ne contentait pas les étrangers et qu'il avait dessein de mettre mon fils aîné en sa place, que c'était pour cela qu'il était besoin que je demeurasse quelque temps avec lui à Louvo, pour le styler dans les affaires ; et que c'était une des principales raison pourquoi on me faisait monter. ⇑
4 - Phaulkon fut exécuté le 5 juin 1688. ⇑
5 - Le roi Naraï mourut le 10 ou le 11 juillet 1688. Son empoisonnement est une hypothèse qu'on ne peut écarter. Les Archives Nationales conservent une déclaration du français Jean Rival, ancien gouverneur de Phuket, (AN Cl 25, f° 58r°-59r°) et datée du 25 novembre 1691 qui révèle qu'une conjuration s'était nouée entre Phetracha, le capitaine de la loge hollandaise, le médecin de la VOC Daniel Brouchebourde et quelques mandarins pour faire mourir le roi : Ok Pra Phetracha demanda au capitaine hollandais : comment pouvons-nous entreprendre cette affaire ? Le capitaine hollandais fit répondre à Daniel qui lui servait d'interprète : il faut que vous fassiez donner du poison lent au roi, et Daniel le préparera, et Ok Meun Sri Meun Chaya, qui est auprès du roi, le donnera au roi, et quand le roi se trouvera un peu atteint, il faut que Ok Meun Sri Meun Chaya vous donne le cachet du roi, et surtout, si Ok Pra Vitticamheng apportait des médecines pour les donner au roi, il faut que Ok Meun Sri Meun Chaya ne les donne pas au roi, sinon celles que Daniel lui donnera, et tant qu'il pourra empêcher Ok Pra Vitticamheng d'approcher du roi. Même si ces rumeurs et ces affirmations restent sujettes à caution, la brusque dégradation de l'état de santé du roi Naraï et les précautions prises par Phetracha pour empêcher quiconque d'approcher le monarque dans ses derniers jours pourraient accréditer cette thèse. ⇑
6 - Le cati, ou catti, mot probablement d'origine malayo-javanaise était le terme employé dans les relations occidentales pour évoquer l'unité de poids siamoise chang (ชั่ง). Aujourd'hui, en Thaïlande, le chang est fixé officiellement à 600 g. On peut penser qu'il était légèrement supérieur au XVIIe siècle. Le cati d'argent valait 50 livres, donc effectivement 150 écus. ⇑
7 - Ces deux navires, partis le 1er mars 1688 et qu'on crut quelque temps perdus, étaient le Siam et le Louvo, commandés par M. de Sainte-Marie, nom de guerre du lieutenant de Larre ou Delars, et Suhart. Selon le père Le Blanc, ils avaient été envoyés par Phaulkon pour aller croiser sur un corsaire dans le golfe de Siam, avec un ordre secret qu'ils avaient de M. Constance d'interrompre leur course aux premiers bruits de guerre et de troubles qui pourraient arriver dans le royaume, et d'aller se mettre sous le canon de Bangkok, où il recevraient les ordres de M. Desfarges pour le service des deux rois. (Op. cit., I, p. 32). Le major Beauchamp donne une autre version de la mission qui leur était confiée, tout aussi vraisemblable que celle du père Le Blanc : M. Desfarges vit l'ordre que ces deux officiers lui montrèrent qui était d'aller après ces forbans, et un autre ordre que mon dit sieur Constance avait donné pour aller brûler les vaisseaux anglais qui seraient en rade de la ville de Madras, côte de Coromandel. Les sieurs de Sainte-Marie et Suhart écrivirent à M. de Constance que cela ne se pouvait, la saison étant contraire. M. Constance leur écrivit de sortir et qu'ils tinssent la mer et d'aller où ils voudraient et de ne revenir que dans quatre mois (A.N. Col. C1/25 f° 73v°). Desfarges, pour se justifier, accusa plus tard Sainte-Marie de lui avoir dissimulé ce second ordre mais il est vraisemblable, comme le laisse entendre François Martin, que le général et tous les Français étaient parfaitement informés de la mission des deux officiers. L'expédition de Sainte-Marie et Suhart dura plus longtemps que prévue, puisque selon un abrégé de ce qui s’est passé à Bangkok pendant le siège en 1688 (Archives Nationales, Col. C1/24 f° 140r°-171v°), les deux navires ne furent de retour que le 5 septembre. ⇑
8 - Il s'agissait de l'ingénieur Bressy, ou Brécy. ⇑

23 février 2019
