

5ème partie.
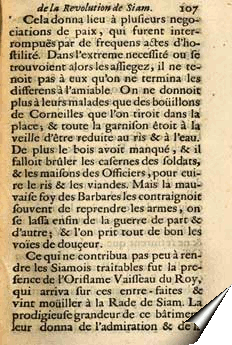
Cela donna lieu à plusieurs négociations de paix qui furent interrompues par de fréquents actes d'hostilité. Dans l'extrême nécessité où se trouvaient alors les assiégés, il ne tenait pas à eux qu'on ne terminât les différends à l'amiable. On ne donnait plus à leurs malades que des bouillons de corneilles que l'on tirait dans la place et toute la garnison était à la veille d'être réduite au riz et à l'eau. De plus, le bois avait manqué et il fallait brûler les casernes des soldats et les maisons des officiers pour cuire le riz et les viandes. Mais la mauvaise foi des barbares les contraignait souvent de reprendre les armes ; on se lassa enfin de la guerre de part et d'autre et l'on prit tout de bon les voies de douceur.
Ce qui ne contribua pas peu à rendre les Siamois traitables fut la présence de l'Oriflamme (1), vaisseau du roi, qui arriva sur ces entrefaites et vint mouiller à la rade de Siam. La prodigieuse grandeur de ce bâtiment leur donna de l'admiration et de la crainte, qui augmenta quand ils connurent ce qu'il portait.
C'était de nouvelles troupes de marine avec quelques officiers qui, ne sachant pas le changement qui était survenu, et ne le pouvant pas reconnaître à la contenance des Siamois qui affectèrent de les régaler de toute sorte de rafraîchissements accompagnés de mille feintes caresses, débarquèrent à l'embouchure de la rivière et demandèrent d'être conduits à Bangkok. Le nombre des soldats et la manière dont ils les virent équipés étonna tellement ces lâches ennemis que, craignant de n'en pas être les maîtres, quelque escorte qu'on leur donna, ils les firent remonter dans le vaisseau et ne retinrent que quelques-uns des officiers, à qui on fit entendre qu'on les allait mener à Bangkok, en attendant que l'on reçût des ordres pour le débarquement général. Il crurent effectivement y aller ; mais leurs guides évitèrent de passer devant cette place en pratiquant des canaux détournés et les rendirent à la ville capitale.
Ce fut là où, malgré les précautions qu'avait prises le barcalon, le hasard leur donna moyen d'apprendre la situation des affaires par un officier de Bangkok, qui vint heureusement dans le divanLieu où on rend la justice, où on tient le Conseil dans les pays orientaux (Furetière). de ce ministre où on les avait introduits, et qui de son côté fit savoir à la garnison la nouvelle de leur arrivée. Le sieur Véret en fut le porteur, la facilité qu'il avait d'obtenir des tarrasTra (ตรา) : document officiel, permis, autorisation. ou passeports pour donner ordre aux affaires de sa direction lui donnant lieu d'aller et de venir souvent, et sous ce prétexte d'être aussi l'instrument des négociations entre le général français et le barcalon, qui après avoir demeuré longtemps dans le fort des Siamois à Bangkok pour traiter plus facilement avec les assiégés, était retourné à Siam depuis quelques jours pour d'autres affaires.
Les éclaircissements qu'on se donna de part et d'autres servirent merveilleusement à la sûreté du vaisseau français, lequel autrement eût été très difficilement garanti de surprises. Mais les assiégés n'en tirèrent aucun secours. La grosseur du bâtiment empêchait qu'il ne pût entrer dans le fleuve, et les barricades qui en fermaient le passage, soutenues du canon dont on avait fait plusieurs batteries de distance en distance sur les bords, ne permettaient pas aux chaloupes de s'y exposer.
Ainsi on ne songea plus qu'à convenir de part et d'autre des articles du traité, qui était à peine ébauché après tant de démarches qu'on avait faites depuis le commencement du mois d'août. Les difficultés que les Siamois formaient sur chaque point firent naître des contestations qui reculèrent encore la conclusion jusque vers la fin de septembre, où le projet ayant été dressé au gré des deux nations, il fut arrêté pour dernière résolution.
1. Que le roi de Siam prêterait aux Français deux vaisseaux bien équipés et capables de porter tout leur monde et leur bagage, pour se retirer hors de ses États en tel lieu que bon leur semblerait, et que ces bâtiments seraient amenés devant la forteresse et visités par des charpentiers.
2. Que M. l'évêque de Métellopolis, avec les missionnaires et le sieur Véret, demeureraient cautions pour le retour de ces vaisseaux et pour l'argent que M. Constance avait déclaré être à lui dans le commerce de la Compagnie Royale des Indes.
3. Que la garnison sortirait, armes et bagages, tambour battant et selon la coutume observée en Europe, et emporterait avec elle toute autre chose qui se trouverait appartenir au roi de France, savoir artillerie, poudres, grenades et semblables munitions de guerre apportées à Siam dans les vaisseaux de Sa Majesté très chrétienne, et qu'il serait fourni par les Siamois des vivres et autres nécessité pour la subsistance des troupes française, autant qu'il en faudrait pour une année entière à condition d'en payer le prix.
4. Que la mission serait continuée sans rien perdre de ses avantages, et que le christianisme serait en pleine liberté, sans qu'il fût fait à personne aucun empêchement dans l'exercice de sa religion.
5. Que les révérends pères jésuites auraient le choix de sortir ou de demeurer dans le royaume, et jouiraient des privilèges, prérogatives et autres biens que la libéralité du feu roi leur avait accordés.
6. Que le bureau de la Compagnie Royale des Indes subsisterait toujours dans ses anciens privilèges, sans inquiéter en aucune manière ceux qui seraient établis pour diriger le commerce.
7. Que pour sûreté des conventions et garanties de la parole qu'on se donnait mutuellement, il serait livré des otages, savoir du côté des Siamois des personnes d'autorité et de distinction dans le royaume et reconnus tels par M. l'évêque de Métellopolis, et de la part des Français : le major de Bangkok, le chevalier Desfarges et le sieur Véret.
8. Que les otages des Siamois seraient mis dans le vaisseau que M. Desfarges monterait ; que ceux qu'il leur donnerait le suivraient dans un balon à la portée du pistolet, et que l'échange en serait fait à la dernière tabanque, c'est-à-dire au dernier bureau proche la mer.
9. Qu'à toutes ces conditions M. Desfarges s'obligeait de remettre la forteresse de Bangkok entre les mains du roi de Siam en l'état qu'elle était alors, avec tout ce qui serait reconnu appartenir à Sa Majesté siamoise (2).
L'accord étant ainsi disposé fut bientôt ratifié entre M. Desfarges et le barcalon, qui était le mandarin que nous avons vu en France chef de la première ambassade (3). Il avait acquis la confiance du nouveau roi par les services importants qu'il lui avait rendus dans tout le cours de son entreprise, et pour reconnaissance, il avait été élevé à cette première dignité.
Ce ministre qui agissait selon les intentions de son maître, dont la plus forte envie était de voir s'éloigner promptement les Français de ses États, donna ordre que tout se fît en diligence. On amena le bazar, c'est-à-dire le marché, où chacun se fournit de ce qu'il avait besoin, et peu de jours après on vit arriver au pied de la forteresse les deux vaisseaux avec tous leurs agrès, selon le premier article de la convention.
On n'était plus occupé que des soins du départ, lorsqu'un officier de la garnison revenant de la ville capitale apporta la nouvelle que Mme Constance était devant Bangkok où elle se venait réfugier parmi les Français et chercher un asile pour elle et pour son fils sous l'auguste protection de Sa Majesté très chrétienne. C'était le sieur De Larre, ou de Sainte-Marie, qui étant allé à Siam se pourvoir de quelques pièces nécessaires à l'appareil de l'un des vaisseaux dont il avait été fait commandant, avait cru qu'il était de son devoir de visiter Mme Constance avant de partir, et qu'il ne s'en pouvait dispenser honnêtement. Il y était porté par toutes les raisons que pût avoir un homme qui ne veut pas être soupçonné d'ingratitude, il avait des obligations très particulières au feu ministre époux de la dame et en avait reçu des marques d'une bienveillance extraordinaire, pour ne point faire un plus long détail des bienfaits et des commissions considérables dont il en avait été honoré (4).
Sainte-Marie trouva cette illustre affligée dans le dernier accablement et apprit par un récit bien touchant tout ce que la destinée avait de plus déplorable. Ce n'était plus la chute de la Maison, ni la mort de son mari, ni la perte de ses biens et de sa liberté, ni l'avarice insatiable de ses persécuteurs, mais l'amour brutal du bourreau de son époux était le sujet de ses peines, la fortune lui étant si contraire, qu'après l'avoir dépouillée de toutes choses au monde et ne lui avoir laissé pour consolation que sa seule vertu, elle allait jusqu'à ce point de dureté que de l'attaquer dans ce qu'elle préférait à tous les avantages de la vie.
C'était Soyatan (5) qui en était épris comme de mille autres femmes qu'il tenait enfermées sous bonne garde. Et la veuve de M. Constance, qu'il avait fait mourir et dont il avait ouï les dernières paroles qui l'auraient dû toucher de compassion pour elle, cette veuve qui, toute désolée qu'elle était, meurtrie de mille coups et réduite au plus vil état que puisse être la dernière des malheureuses, enflammait encore la passion de ce jeune emporté, qui, fier du rang où il venait de monter, ne prétendait pas soupirer inutilement.
Il fit savoir à Mme Constance qu'elle pouvait mériter sa protection en agréant l'affection qu'il avait pour elle et qu'il lui voulait faire l'honneur de la mettre au nombre de ses femmes. La vertueuse femme s'en excusa sur sa religion qui ne lui permettait pas un mariage de la sorte, mais une excuse si raisonnable, au lieu de faire cesser les poursuites du prince, le fit seulement changer de manière d'agir. Sa passion se changea en fureur, et Mme Constance fut enlevée par son ordre, et ensuite livrée à une espèce de justice criminelle dont le magistrat, trop fidèle ministre des volontés de ce cruel persécuteur, essaya de tirer d'elle à force de tourments une déclaration favorable à son amour, lui supposant faussement des crimes où il n'y avait aucune apparence de mal.
Rien n'ayant pu ébranler sa constance, elle eut le loisir de respirer pendant quelques jours que le tyran fit bâtir un appartement dans son palais pour la renfermer. Elle fut avertie de s'y préparer, et lorsque l'officier la vint saluer, c'était pour le lendemain qu'elle devait y être mise.
En racontant ses infortunes, Mme Constance versa tant de larmes que Sainte-Marie en fut ému. Il lui fit offre de ses services avec assez de franchise pour porter cette dame à lui demander son assistance pour l'exécution du dessein qu'elle avait conçu de se sauver à Bangkok sous le pavillon de France, où elle avait sujet de croire qu'elle serait en sûreté. Mais la difficulté était d'y arriver.
Sur l'avis qu'elle avait eu que les Français avaient terminé leur capitulation et que tout se disposait pour leur sortie, elle avait aussi préparé les choses nécessaires pour sa fuite, laquelle ne pouvait plus être différée, lorsqu'elle en parla au cavalier. Il reçut avec joie cette occasion de lui marquer son zèle et l'assura que si l'entreprise était heureuse pour elle, elle serait bien glorieuse pour lui.
Mme Constance lui témoigna qu'elle se serait bien donnée garde de songer à se retirer dans Bangkok, si on ne lui eût appris avant que toutes choses étaient réglées entre les deux nations et que sa présence ne pouvait apporter aucun retardement au départ des Français ; que ce n'était qu'en cette vue qu'elle prenait le parti que feu M. Constance lui avait plusieurs fois conseillé de prendre s'il arrivait du changement et qu'elle eût besoin de protection ; que la confiance qu'elle avait eue aux deux lettres que feu son époux avait reçues du roi de France, par où Sa Majesté l'assurait, et toute sa famille, de sa protection royale, l'avait obligée de remercier le capitaine de la faiturie hollandaise, qui depuis peu de jours lui avait fait proposer de la conduire à l'insu des Siamois dans un vaisseau de sa compagnie jusqu'à Batavia, n'ayant autre intérêt à sa personne que de la tirer de ses malheurs.
La dame ayant trop de bonnes raisons pour demander un asile aux Français, et l'officier trop de générosité pour ne point seconder un si juste dessein, prit toutes les mesures qui pouvaient favoriser l'évasion. Les moments étaient courts, et pour n'en point perdre, Sainte-Marie s'en alla en diligence mettre ordre aux choses qui avaient fait le sujet de son voyage, et la nuit étant survenue, il prit ses armes et se rendit sur les dix à onze heures au lieu où il devait prendre Mme Constance, qui se trouva prête avec son fils et une suivante. On sortit promptement sans bruit, et l'on gagna un rivage écarté où la petite troupe s'embarqua dans un balon que la dame avait fait apprêter. Sa résolution fut telle qu'étant entrée dedans, elle s'adressa à son conducteur et le pria que si on l'arrêtait, il lui fendît la tête de son épée plutôt que de souffrir qu'elle fût encore un coup la proie de ces barbares. Le ciel ne permit pas qu'il eût lieu de lui désobéir. Ils évitèrent tous les hasards qu'on pouvait appréhender par le chemin, et les rameurs ayant fait leur devoir avec une ardeur incroyable, ils arrivèrent le lendemain quatrième octobre à trois heures après midi devant Bangkok.
Après s'être réjouis ensemble de se trouver heureusement au port, Sainte-Marie, pour mettre en assurance le dépôt qui était à sa conduite, fit entrer Mme Constance dans l'un des vaisseaux qui étaient à l'ancre, et lui, ayant mis pied à terre, s'en alla avertir M. Desfarges de sa venue, afin qu'il ordonnât de lui préparer un logement. Il ne doutait pas que ce qu'il avait fait ne plût beaucoup à ce général, qui s'était déclaré en plusieurs occasions sensible au malheur de cette famille autant qu'on le pouvait être et qui avait dit plus d'une fois qu'il risquerait volontiers quelque chose pour délivrer une femme de ce mérite de l'oppression ou elle était.
Des officiers de la garnison qu'il rencontra en chemin et à qui il parla de son action rendirent les louanges dues à son courage, et furent fâchés de ce que ne lui cédant point en cela, ils étaient obligés de lui céder en bonne fortune (6).
Mais ce fut une chose bien étonnante pour tous, et particulièrement pour celui à qui l'honneur rendait témoignage au-dedans du mérite de son action, de voir que M. Desfarges en désapprouva la conduite et sembla en regretter le succès. Au lieu d'en recevoir les applaudissements dont Sainte-Marie s'était flatté, il fallut s'excuser de ce qu'il avait fait une démarche sans ordre, mais il le fit avec autant de retenue et de modération qu'il en parût moins sur le visage et dans les paroles du général, qui lui demanda d'un ton ému d'où il avait eu charge d'amener Mme Constance et pourquoi il avait osé le faire sans son congé. Sainte-Marie répondit qu'il avait été le compagnon de sa fuite, mais qu'il ne la lui avait pas suggérée, et que c'était assez pour n'en pas être garant ; qu'au surplus il avait toujours été persuadé qu'il y allait de son honneur, et que c'était l'obliger que de lui présenter une occasion de faire connaître les bonnes intentions qu'il témoignait avoir pour cette dame, et de la dédommager en quelque manière du tort que l'on avait fait à son mari.
Il ajouta au récit de toutes les particularités de l'entreprise, les causes qui en avaient précipité l'exécution, et rien ne fut jugé digne du moindre reproche. Mais M. Desfarges, prévenu de son opinion, continua toujours de blâmer Sainte-Marie et sa hardiesse, et le menaça de le punir, protestant qu'il ne voulait point voir Mme Constance ni savoir où elle était. Peu s'en fallut qu'il ne défendît même de la recevoir dans la place, et s'il en accorda la permission, ce fut aux instantes prières de tous les officiers de la garnison, qui s'intéressèrent pour cela, et à condition qu'elle n'y viendrait qu'à nuit fermée.
Les principaux allèrent au-devant d'elle lui aider à descendre du grand vaisseau où elle était demeurée depuis son arrivée et la conduisirent dans un appartement que M. de Vertesalle, commandant des troupes, lui fit préparer, où lui apprenant la disposition du gouverneur, ils tâcha d'essuyer les larmes qui coulèrent en plus grande abondance que jamais quand elle entendit une si étrange nouvelle. Les officiers lui promirent qu'elle trouverait toujours en eux de zélés défenseurs qui prendraient ses intérêts aux dépens de leurs vies, puisque l'honneur des Français et la gloire de leurs chefs dépendaient désormais de sa conservation.
M. Desfarges était agité de bien d'autres considérations, soit qu'il craignît que les Siamois, pour ravoir cette femme, voulussent rompre le traité de paix qu'il venait de faire avec eux, ou que quelque contestation sur son sujet arrêtât par de grandes longueurs sa sortie, qu'il souhaitait plus que toutes choses, ayant donné la main à bien des choses qu'un autre aurait cru devoir soutenir pour la réputation des armes du roi. Il députa le sieur Véret vers le barcalon, qui pour lors était dans le fort à l'opposite du sien, pour lui donner avis de l'arrivée de Mme Constance dans sa place, le priant de lui indiquer les moyens de la pouvoir garder. Le barcalon lui répondit que si M. le général était d'humeur d'en faire une honnêteté au roi, il ne doutait pas que Sa Majesté ne lui accordât la permission d'emmener cette dame avec lui, toutefois à condition de rendre les pierreries, qu'on savait de sa propre confession avoir été apportées dans Bangkok et mises au pouvoir des Français.
La réponse du barcalon surprit d'autant plus qu'on ne s'attendait à rien moins qu'à une pareille docilité, et l'on commençait à espérer de voir la fin des malheurs de Mme Constance, mais tout devient funeste à celui qui est plongé dans les disgrâces, jusqu'aux précautions même qu'il prend pour l'avenir, comme si la malignité du sort se répandait ainsi qu'un venin sur tout ce que l'on fait pour l'éviter ; et pour bien comprendre les véritables motifs de plusieurs mouvements qui se firent à Bangkok depuis l'arrivée de Mme Constance, il faut supposer certains faits importants au dénouement de cette dernière aventure.

NOTES :
1 - Parti de France au début de 1688, l'Oriflamme, vaisseau de 750 tonneaux commandé par M. de l'Estrille, amenait 200 hommes de troupes pour renforcer la garnison française au Siam. ⇑
2 - On pourra consulter sur ce site le texte complet de ce traité de capitulation à la page Papier de répondance. ⇑
3 - Okphra Visut Sunthorn (ออกพระวิสุทธิสุนทร) dit Kosapan (โกษาปาน), connu en France sous le nom de Ratchatut (premier ambassadeur).
 Okphra Visut Sunthorn, dit Kosapan. ⇑
Okphra Visut Sunthorn, dit Kosapan. ⇑
4 - Il y avait peu de Français qui n'aient reçu quelque faveur de Phaulkon, et Sainte-Marie ne faisait sans doute pas exception à la règle. Le père Le Blanc le confirme : Cet officier, écrit-il, qui avait obligation à feu M. Constance, en fut plus reconnaissant que plusieurs autres qui lui en avaient davantage. (Histoire de la révolution [...], 1692, II, p.55). Allusion à peine voilée à Desfarges. ⇑
5 - Fils de Phetratcha, Sorasak ou Luang Sarasak (หลวงสรศักดิ์) régna à la mort de son père sous le titre de Sanphet 8 (สรรเพชญ์ที่ ๘). Homme cruel, brutal et débauché, il reste surtout connu sous le surnom de Phra Chao Süa (พระเจ้าเสือ : le roi tigre). ⇑
6 - S'il faut en croire Beauchamp, l'esprit chevaleresque ne fut pas la seule motivation de l'action de Sainte-Marie. En effet, il s'était rendu coupable de désobéissance, ce qui avait entraîné la perte de son bateau, et il avait tout à redouter des foudres du général à son retour en France. Les jésuites lui firent miroiter qu'un acte héroïque en faveur de Mme Constance pourrait lui faire obtenir sa grâce. Et Beauchamp conclut : M. Desfarges m'ordonna de faire prendre sur le champ Sainte-Marie par quatre mousquetaires et de le faire mettre en prison, de l'interroger et de lui demander pourquoi il n'avait pas exécuté les ordres qu'il lui avait donnés pour le service du roi, et qui lui avait fait emmener Mme Constance sans l'en avertir ? Il me répondit que les pères jésuites étaient la cause de tout ; qu'ils lui avaient tant promis de choses, et l'avaient si fort pressé qu'il n'avait pu s'empêcher de leur obéir. (Relation des révolutions de la Cour de Siam, Bibliothèque Nationale, manuscrit Fr 8210, f° 552r). ⇑

18 février 2019
