
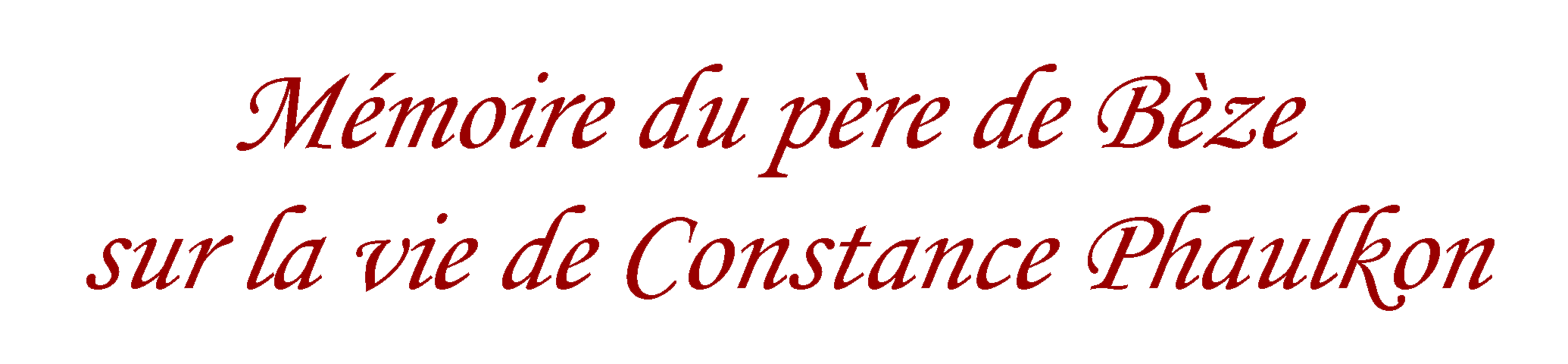
Troisième partie.
M. les vicaires, qui voulaient éviter ce coup, publièrent qu'il n'était pas envoyé de la part du roi de Portugal mais seulement du gouvernement de Macao, et M. de Métellopolis assura qu'il le savait de bonne part, et que le roi de Portugal avait trop de christianisme et de piété pour autoriser une telle démarche. L'ambassadeur fut piqué jusqu'au vif de ce reproche et demanda à M. Constance qu'on obligeât les évêques à lui en faire satisfaction. Ce ministre, qui vit que les Portugais prenaient cette affaire extrêmement à cœur et que les esprits étaient fort échauffés de part et d'autre, désespérant de pouvoir les réunir, laissa porter l'affaire devant le roi par l'ambassadeur qui, dans l'audience qu'il en eut, fit de grandes plaintes contre les évêques français et demanda justice contre eux, de la part du roi son maître, des mauvais traitements qu'ils faisaient aux Portugais, surtout à leurs religieux qu'ils empêchaient de jouir de la liberté que Sa Majesté leur avait accordée dans ses États.
Le roi de Siam ne fut pas fort édifié d'apprendre tous ces démêlés qui, depuis tant de temps, divisaient les chrétiens dans les Indes, et de voir l'animosité avec laquelle chaque parti soutenait ses intérêts. Voulant cependant les contenter les uns et les autres, il répondit à l'ambassadeur qu'il protégeait toujours les Portugais et qu'il empêchait qu'on ne les inquiétât injustement sur le fait de la religion ; qu'il ordonnerait pour cela aux vicaires apostoliques qui étaient à Siam de ne rien entreprendre contre leurs prêtres et leurs religieux sans en avoir eu auparavant son consentement.
L'ambassadeur, qui s'attendait à les faire chasser de Siam ou du moins à leur faire défendre tout acte de juridiction sur les Portugais, fut peu content de cette réponse qu'il crut avoir été ménagée par M. Constance en faveur des évêques français, afin qu'ils fussent toujours en droit, par son crédit, d'arguer sur toutes leurs démarches contre ceux de sa nation. Cela fut cause qu'il garda peu de mesures dans le reste avec ce ministre et qu'ils ne se séparèrent pas fort contents l'un de l'autre. Les Portugais de Siam qui, malgré leur pauvreté, ne laissent pas de conserver toute la fierté naturelle à leur nation, entrèrent dans les intérêts et les ressentiments de leur ambassadeur, mais ils avaient trop besoin du crédit du ministre pour oser se déclarer contre lui. Ils continuèrent à le respecter et à lui faire leur cour tant qu'il fut en faveur, mais sitôt qu'ils le virent arrêté et hors d'état de pouvoir leur nuire, ils se déclarèrent contre lui avec d'autant plus de véhémence qu'ils avaient conservé plus longtemps dans leur cœur leur ressentiment. Ils présentèrent contre lui une requête à Phetracha où le plus grand crime dont ils l'accusaient était d'avoir autorisé la tyrannie des vicaires apostoliques contre eux, et on voyait ces mêmes vicaires se plaindre en même temps et publier qu'il leur avait fait tort en cela, ne leur permettant pas d'exercer contre les Portugais la juridiction qu'ils avaient reçue du Saint Siège, tant il est vrai qu'il est bien difficile de contenter deux partis également animés et persuadés de leur bon droit, où on trouve bien peu de reconnaissance quand d'une haute fortune on vient à tomber dans le malheur.
Je ne prétends pas justifier en toutes choses la conduite de M. Constance à l'égard de l'ambassadeur de Portugal, d'autant plus que je n'étais pas, pour lors, sur les lieux. Je sais même qu'il n'est pas le seul qui s'en soit plaint et que ce pourrait être un préjugé contre ce ministre. Je dirai seulement qu'une des principales raisons qui a fait que quelques-uns de ceux qui ont eu des affaires à traiter avec lui n'en ont pas été contents, c'est parce qu'ils le connaissaient mal et avaient peu de confiance en lui. Il avait l'esprit vif et beaucoup de pénétration et savait prendre d'abord son parti, et comme d'ailleurs son pouvoir égalait ses lumières, il voyait aussitôt dans une affaire qu'on lui proposait ce qu'il pouvait accorder sans trahir les intérêts de son prince et le faisait tout d'abord. Le roi, se mettant entièrement sur lui de toutes ses affaires, il eût voulu aussi que les gens avec qui il traitait, convaincus qu'il accordait tout ce que l'honneur et la fidélité qu'il devait à son prince lui permettaient d'accorder, s'en fussent un peu rapportés à lui. Mais des ambassadeurs d'Europe, persuadés qu'ils avaient à traiter avec un homme fin et rusé, et sur qui il fallait gagner le terrain pied à pied, venaient nourris de tout ce que l'expérience et la lecture peut fournir de plus subtile politique, et étaient au désespoir de s'employer si inutilement auprès d'un homme qui, ayant pris d'abord son parti, changeait peu dans la suite. On regardait cela en lui comme une vanité insupportable et un attachement prodigieux à son propre sentiment, et on a vu être mécontents de lui après en avoir obtenu d'abord plus qu'ils n'avaient osé en espérer et qui en auraient peut-être été plus contents si, en accordant moins de choses, il l'eût fait de manière qu'ils eussent pu se flatter d'en devoir une partie à leur propre adresse. Les Européens, outre cela pleins d'estime pour leur nation et de mépris pour celles des Indes, qui ne sont pas en effet comparables aux nôtres, croyaient être en droit de prendre des airs de hauteur avec un ministre du roi de Siam. Mais lui, qui se sentait tout le pouvoir entre les mains, et toute la fierté des Européens, ne pouvait souffrir ces sortes de mépris et affectait de soutenir l'honneur de son prince et de son ministère avant d'autant plus d'affectation qu'on semblait en faire moins de cas.
Il eut encore une autre affaire à démêler avec les Anglais pendant le voyage des ambassadeurs en France, qui ne lui donna pas peu de peine. La compagnie anglaise, dont les affaires vont depuis quelques années fort en décadence dans les Indes, avait loué le comptoir qu'elle avait à Siam, n'étant plus en état de s'y tenir. Comme il y avait longtemps qu'ils faisaient commerce en ce royaume, ils eurent de grands comptes à régler avec le roi de Siam et ils se trouvèrent en différends sur plusieurs chefs dont ils ne convenaient pas, mais surtout à l'égard de quelques pierreries, et comme le roi de Siam les obligea à satisfaire à ce qu'il croyait lui être dû, les Anglais sortirent fort malcontents de lui et s'en prirent même en partie à M. Constance qui, quelque attachement qu'il eût pour les Anglais, se crut encore plus obligé de soutenir les intérêts de son prince.
Cela lui attira plusieurs insultes des Anglais, surtout d'un nommé Pats, homme fort emporté, du consentement de tous ceux qui l'ont connu, et qui chercha quelquefois l'occasion de faire périr M. Constance (1). Tout cela, cependant, ne put faire oublier à ce ministre les engagements qu'il avait eus dès sa jeunesse à cette nation et les obligations qu'il avait à quelques Anglais en particulier, c'est pourquoi il leur procura toujours tous les avantages qu'il put dans le royaume, les avançant dans le service du roi et, pour reconnaître en particulier les bienfaits qu'il avait reçus de Maître Barnabé et de Maître Ouits, il fit donner au premier le gouvernement de Mergui (2) et fit nommer le frère du second chabandard (3), c'est-à-dire receveur général de la province de Ténasserim dans laquelle il lui fit donner un pouvoir absolu.
Celui-ci en usa tyranniquement, et ne cherchant qu'à s'enrichir bientôt afin d'aller jouir en Europe des biens qu'il aurait acquis dans les Indes, il n'y a sortes de concussions qu'il ne fit dans la province. Cela souleva tout le peuple contre lui et M. Constance eut besoin de tout son crédit pour l'apaiser. Il avertit cependant M. Ouits d'apporter plus de modération dans sa conduite, mais celui-ci, qui était déjà venu à bout de ce qu'il prétendait, ayant amassé beaucoup de richesses, et qui voulait d'ailleurs s'acquérir, aux dépens de son honneur et de sa conscience, la faveur du gouverneur de Madras auprès de qui il voulait se retirer, lui promit de l'aider à se venger du tort que la Compagnie anglaise prétendait avoir reçu du roi de Siam (4), ayant engagé le gouverneur de Mergui à entrer dans le même dessein.
Le gouverneur de Madras leur envoya un vaisseau pour voir ce qu'il y aurait à faire, promettant d'en envoyer bientôt d'autres pour enlever tout ce qu'ils pourraient des magasins du roi de Siam. Le vaisseau, étant entré dans le port de Mergui, s'y saisit d'abord d'un vaisseau du roi de Siam qu'il y trouva (5). Les Siamois, surpris de cet acte d'hostilité et plus encore de ce que le gouverneur de Mergui et le chabandar de la province étaient d'intelligence avec le capitaine anglais qui venait tous les jours se divertir à terre avec eux, en avertirent d'abord la cour. On leur donna ordre d'observer les démarches de ces Anglais et de tâcher de se saisir d'eux s'ils pouvaient, pour les envoyer prisonniers à la Cour. Les Anglais, de leur côté, qui attendaient de nouveaux secours pour faire quelque meilleur coup et qui avaient sujet de se défier des Siamois, après celui qu'ils venaient de faire, prirent quelques précautions pour n'être pas surpris.
Comme ils se divertissaient ordinairement dans la maison du gouverneur de Mergui, ils la fortifièrent le mieux qu'ils purent et la percèrent en plusieurs endroits pour y placer quelques petites pièces d'artillerie. Les Siamois, n'osant pas l'attaquer en cet état, prirent la résolution de surprendre le gouverneur et le chabandar lorsqu'ils iraient reconduire le capitaine du vaisseau, qui se retirait pour l'ordinaire tous les soirs à son bord. Ils s'étaient mis pour cela en embuscade, mais un des soldats siamois, qui était du complot, s'étant enivré, alla à la maison du gouverneur et, ayant trouvé quelques Anglais qui y faisaient la garde, il en blessa un d'un coup de sabre et appela à lui ses camarades qui étaient cachés. Ceux-ci, se voyant découverts et engagés malgré eux à commencer l'attaque, allèrent en foule entourer la maison. Mais les Anglais, en ayant jeté quelques-uns par terre des coups qu'ils leur tirèrent, obligèrent bientôt les autres à s'écarter et ils n'auraient jamais approché si le feu n'eût pris par malheur à la maison qui, n'étant que de bois et étant pleine de poudre, fut bientôt hors d'état de défense.
Les Anglais prirent la résolution de se retirer dedans leur vaisseau mais, comme ils étaient à demi-ivres, ils le firent avec tant de précipitation et si peu d'ordre que cela donna cœur aux Siamois de revenir à la charge. Le capitaine du vaisseau et le chabandar se jetèrent brusquement dans le canot et se sauvèrent à bord de leur vaisseau, abandonnant le gouverneur qui fut tué sur le bord de la mer avec quelques autres Anglais. Le reste alla se cacher pour éviter la fureur des Siamois qui ne faisaient grâce à personne, mais il n'y eut point de retraite qui put les mettre à couvert de la rage de ces barbares qui, désespérés de voir que le chabandar qu'ils haïssaient particulièrement à cause de ses concussions s'était sauvé, déchargèrent leur colère sur ceux qui étaient restés et, les ayant tous découverts par l'exacte perquisition qu'ils en firent, ils les massacrèrent inhumainement, confondant avec eux quelques Portugais et Espagnols qui étaient établis à Mergui (6).
Un Hollandais qui s'y trouvait aussi pour lors fut un des principaux auteurs de cette sanglante tragédie. On n'épargna ni l'âge ni le sexe et on vit dans cette occasion de quoi sont capables des âmes basses et serviles quand elles ont la force à la main et son en état de se venger. Le bélat, ou lieutenant du roi de Ténasserim (7), se signala surtout par sa cruauté. La femme d'un marchand anglais lui avait plu, il crut avoir trouvé l'occasion d'en faire sa femme. Il l'envoya enlever, mais celle-ci, bien loin de consentir à ce qu'il souhaitait d'elle, ne voulant pas seulement le regarder et lui demandant pour toute grâce qu'il la fît mourir avec son mari, ce brutal l'envoya chercher et lui ayant fait couper le nez, les lèvres et les oreilles, il le lui présenta en cet état, lui demandant si elle l'aimait mieux que lui, ce montre d'homme. Cette femme ne le méconnut pas dans ce pitoyable état et, l'embrassant tout ensanglanté qu'il était, elle persista à vouloir mourir avec lui. Le Siamois, désespéré de se voir méprisé, fit pendre leur fils par les mains et le fit percer d'un coup de pique qui ne le tua pas sur le champ, et le laissa languir six heures durant et fit massacrer ensuite le père et la mère en sa présence. Ce fut ainsi que ces pauvres Anglais qui s'étaient venus établir à Mergui dans l'espérance d'y faire quelque chose sous le gouvernement de ceux de leur nation furent faits responsables de leur mauvaise conduite et la payèrent bien cher.
Les Siamois, cependant, étant revenus quelques jours après de leur emportement, commencèrent à en craindre les suites et, prévoyant bien que la cour ne leur pardonnerait pas de tels excès, ils songèrent à se dispenser d'en rendre compte et à se mettre en état de défense si on voulait les en punir. Le roi de Siam, qui ne voulait pas laisser une telle cruauté impunie, mais qui, d'ailleurs, appréhendait un soulèvement d'autant plus dangereux que la province, étant séparée du royaume par des forêts désertes, il n'est pas facile d'y faire passer une armée, il résolut de les avoir par adresse et se servit pour cela d'un mandarin fort adroit qu'il envoya sans aucune suite, faisant cependant filer secrètement quelques troupes par plusieurs endroits pour lui servir au besoin.
Celui-ci, suivant ses instructions, sembla fort approuver ce qu'on avait fait aux Anglais et dit qu'il venait de la part du roi pour reconnaître et récompenser tous ceux qui dans cette occasion, s'étaient comportés en bons sujets, vengeant les affronts que les Anglais avaient faits à Sa Majesté. Ce discours ôta aux Siamois toute la défiance qu'ils avaient eue et, bien loin de cacher leur cruauté, ils commencèrent à en faire trophées. Le mandarin connut par là les plus coupables. Il leur dit ensuite que le roi, ayant eu avis que les Anglais pensaient à se venger et à surprendre Mergui, Sa Majesté lui avait ordonné de faire une nouvelle levée de soldats pour fortifier la garnison. Le gouverneur et les officiers de la province, ne se défiant de rien, y consentirent fort volontiers et celui-ci, ayant sous ce prétexte ramassé les soldats qu'on avait fait filer après lui, les introduisit dans la ville et, le jour auquel il devait, de la part du roi, récompenser tous ceux qui s'étaient signalés dans cette occasion étant venu et les ayant tous assemblés dans la salle du conseil, il la fit environner par ses gens et les arrêta tous prisonniers avec le Hollandais qui avait été, comme j'ai dit, un des principaux boutefeux. On les conduisit à Louvo où on les condamna à mort, pendant que nous y étions, l'Oya ou gouverneur de la province, le bélat ou lieutenant et la plupart des autres (8). On envoya M. de Beauregard pour être gouverneur de la place (9) avec plein pouvoir de traiter de paix avec les Anglais s'ils voulaient entendre à quelque accord, car M. Constance cherchait toujours à les ménager.
Le nouveau gouverneur qui, tout jeune qu'il était, avait déjà donné à Bangkok où M. de Chaumont l'avait laissé au service du roi de Siam, des marques de sa conduite, se comporta fort sagement suivant les intentions de M. Constance, dans une affaire qui arriva peu de temps après qu'il eût pris possession de son gouvernement. Un vaisseau anglais qui venait de Madras à Mergui pour secourir les Anglais dont ils ne savaient pas la déroute, rencontra en son chemin un vaisseau du roi de Siam. Il voulut d'abord s'en saisir, mais le vaisseau siamois, qui était commandé par un brave soldat français qui avait autrefois servi sous M. de la Haye, dans les Indes, et était resté depuis au service du roi de Siam, le défendait si vigoureusement qu'ayant mis le vaisseau anglais presque hors de combat, deux officiers qui le commandaient nommés Hills et Hodgès (10) firent amener le pavillon et envoyèrent un officier à son bord pour lui faire des excuses de ce que, n'ayant pas connu d'abord le pavillon du roi de Siam, il avait attaqué son vaisseau, le prenant pour un vaisseau des Mores contre qui ils avaient guerre ; qu'ils n'auraient eu garde d'insulter un vaisseau du roi de Siam s'ils l'avaient connu puisqu'ils étaient envoyés de la part du gouverneur de Madras pour aller traiter des différends qu'il avait avec cette cour et qu'ils le priaient de leur envoyer un pilote qui conduisît leur vaisseau dans le port de Mergui dont ils ne savaient pas l'entrée.
Le capitaine français (11) retint leur chaloupe et leur ordonna de le suivre, leur disant qu'il allait lui-même à Mergui et qu'il les y conduirait. Les Anglais n'osèrent pas désobéir parce qu'ils n'étaient pas en état de se défendre ni ne pouvaient pas s'enfuir, outre qu'ils auraient abandonné l'équipage de leur chaloupe et leur officier. Ils résolurent de soutenir leur démarche et de voir comme elle leur réussirait. M. de Beauregard, à qui on les mena d'abord, ayant connu que ce n'était qu'une défaite parce qu'ils n'avaient pas de pouvoir de traiter d'affaires, ne voulut pas cependant le publier pour ne pas les perdre. Il se contenta d'en avertir M. Constance qui, voulant faire voir qu'il cherchait véritablement à faire plaisir aux Anglais malgré leur peu de ménagement, fit expédier un sauf-conduit aux deux officiers anglais pour venir à Louvo où il les reçut comme députés pour traiter de paix. Nous les trouvâmes en y arrivant. Eux, charmés des bons traitements que leur fit M. Constance et auxquels ils n'avaient pas sujet de s'attendre, lui promirent d'employer tous leurs soins auprès du gouverneur de Madras pour le porter à faire un bon accommodement. M. Hill retourna à Madras pour y prendre des pouvoirs du gouverneur et M. Hodges demeura à Louvo. Il y était encore lorsque Phetracha s'y souleva. Il fut même mis en prison avec les autres Européens et je le trouvai par hasard dans un petit trou où on l'avait enfermé et où on l'avait laissé deux jours sans lui rien donner. Je lui portai à manger et j'obtins même de son garde, en lui donnant un tical (40 sols), qu'il le menât au barcalon à qui, ayant fait voir son sauf-conduit, il fut tiré de sa prison et on lui donna même de quoi subsister honnêtement. Il eut de la reconnaissance de la charité que je lui avait faite et il nous envoya du peu qu'on lui avait donné, 20 écus pour faire des aumônes aux autres prisonniers. Voilà quel fut le démêlé qu'eut M. Constance avec les Anglais.
J'aurais parlé de la révolte des Macassars à Siam, qui arriva presque en même temps (12), si on l'avait vu par une relation fort exacte qui en a été faite (13) combien M. Constance fit paraître en cette occasion et de prudence pour ramener la plus grande partie des conjurés à leur devoir et d'intrépidité pour vaincre les plus obstinés et les punir comme ils le méritaient. Je ne dois pas cependant oublier de dire que Phetracha sut parfaitement bien se servir de cette conjoncture pour achever de perdre les princes dans l'esprit du roi, leur frère, et les éloigner de la couronne où son ambition démesurée le faisait aspirer. Il ne sera pas hors de propos de faire connaître de quelle manière il conduisait depuis longtemps son dessein et en quel état était la famille royale lorsque nous arrivâmes dans le royaume.
Le roi avait deux frères beaucoup moins âgés que lui que les lois du royaume appelaient à la couronne (14). L'aîné des deux était mal fait de corps, il avait les jambes de travers dont à peine pouvait-il se servir et était d'ailleurs d'un naturel fort emporté et fort adonné au vin. Le roi n'avait pas laissé, malgré tous ses défauts, de l'élever auprès de lui avec beaucoup de bonté, et il était arrivé à ce prince d'en abuser assez souvent pendant qu'il était jeune. Mais enfin il poussa à bout la patience du roi par ses emportements et un jour, entre autres, qu'il était à la chasse avec lui, ayant voulu pousser l'éléphant sur lequel il était monté contre un éléphant sauvage qui voulait forcer les lignes, Sa Majesté, craignant qu'il ne lui arrivât quelque accident, surtout à cause de sa faiblesse, l'empêcha de s'avancer. Il crut que c'était un affront qu'on lui faisait et un reproche de son peu de courage, ce qui fit que, se laissant aller à ses emportements ordinaires, il s'oublia du respect qu'il devait à Sa Majesté. Le roi dissimula encore et, quelque temps après, un éléphant en chaleur s'étant échappé des écuries et courant furieux par la ville où il renversait ce qui se trouvait devant lui, le roi, qui en fut averti, dit au prince que c'était là une belle occasion de faire voir le courage qu'il avait à combattre les éléphants. Celui-ci, piqué de ces paroles, s'en fit donner un d'abord et alla chercher l'éléphant échappé, mais cela lui réussit mal : il fut renversé par terre et en grand danger de perdre la vie. Son éléphant prit la fuite devant l'autre et il ne remporta que de la confusion de cette rencontre. Il s'en prit encore au roi et se laissa aller à des paroles si peu respectueuses qu'enfin Sa Majesté, qui avait eu encore plusieurs autres sujets de mécontentement de lui, lui donna d'abord son palais de Siam pour prison, lui permettant cependant de sortir dans la ville lorsqu'il en serait dehors. Il lui accorda même volontiers la permission de se faire instruire dans la religion chrétienne qu'il demandait, croyant que cela pourrait changer sa mauvaise humeur, et M. de Métellopolis eut pour cela plusieurs entretiens avec lui qui semblait l'avoir disposé à embrasser notre sainte foi, mais soit que son naturel impétueux ne lui permit pas de se tenir en repos, soit que ses ennemis voulussent le perdre entièrement dans l'esprit du roi, on l'accusa d'avoir voulu conspirer avec les Malais contre sa personne, ce qui le fit entièrement renfermer dans le palais. Il y conservait toujours un crucifix qu'il avait reçu de M. de Métellopolis et un de ses esclaves assura qu'il se prosternait quelquefois devant avec beaucoup de respect.
La disgrâce de ce prince augmenta l'amitié que le roi avait pour son cadet et tout le peuple, qui l'aimait tendrement à cause de ses belles qualités, le regardait avec joie comme le successeur de la couronne, et il avait en effet tout ce qui peut rendre un prince aimable : il était bien fait de sa personne et assez blanc, ce que les Siamois estiment beaucoup. Il était affable et populaire, l'esprit agréable et les manières fort engageantes, ce qui le rendait les délices de la cour et du peuple. Le roi, qui l'avait élevé avec beaucoup d'amitié comme s'il eût été son fils, songea à en faire son héritier au préjudice de l'aîné et, afin de rendre son choix plus solide, il songea à lui faire épouser la princesse son unique fille. Les choses même étaient déjà fort avancées pour le mariage qui se faisait avec la satisfaction universelle de tout le royaume et surtout de la princesse qui le souhaitait passionnément, lorsque le prince, par sa faute, tomba dans la disgrâce du roi et vit toutes ses espérances renversées.
Il avait eu le malheur de plaire à une des principales concubines du roi, sœur de Phetracha (15), qui était devenue passionnée de ce jeune prince. Cette malheureuse créature, dont les infâmes débauches étaient connues de tout le monde, excepté du roi, était rentrée si avant dans l'esprit et les bonnes grâces de Sa Majesté qu'elle avait un pouvoir presque absolu dans le palais. Comme cependant la vigilance avec laquelle les femmes y sont gardées ne l'y permettait pas d'y satisfaire sa brutale passion, elle eut bien assez de crédit auprès du roi pour obtenir d'en sortir quelquefois afin de s'aller faire panser par un chirurgien hollandais nommé Daniel (16), d'un mal qu'elle s'était fait elle-même à la jambe. Le chirurgien, d'intelligence avec elle, faisait durer le mal et le faisait passer pour fort dangereux auprès du roi qui ne se défiait de rien et n'avait d'autre inquiétude que celle que lui donnait la feinte maladie d'une personne qu'il aimait tendrement. Elle, cependant, jouissait de la liberté qu'elle s'était procurée et, pour éviter les yeux trop vigilants des Siamois, elle allait ordinairement dans le camp des Portugais dont quelques-uns étaient fort dans ses bonnes grâces.
Mais elle garda si peu de mesures que la chose devint enfin publique et la populace alla même jusqu'à chanter publiquement ses débauches, par une liberté qui est peu ordinaire aux Siamois. Le roi ne put pas ignorer entièrement ce qui se passait. Il en sut quelque chose, mais cette femme fut la première à se récrier contre la médisance et à en demander justice au roi. Elle sut même si bien ménager son esprit qu'elle le convainquit de son innocence et l'obligea à punir rigoureusement ceux qui oseraient parler mal d'elle ou chanter les chansons qu'on avait faites contre son honneur. Sa Majesté, cependant, ne voulant pas être tout à fait la dupe de cela, voulut que, pour éviter les bruits, elle ne sortît plus du palais et s'y fît panser par les eunuques. Elle n'y demeura pas longtemps en repos et, n'y voyant que le jeune prince sur qui elle pût jeter les yeux, nul autre homme ne pouvant entrer dans l'appartement des femmes, elle entreprit de le corrompre. Comme elle ne manquait ni d'esprit ni d'adresse et qu'elle avait outre cela du crédit, elle trouva moyen de lui parler et de lui plaire et enfin de l'engager.
Leur liaison demeura quelque temps assez secrète et peut-être que le roi n'en aurait rien su si cette malheureuse ne s'était trahie elle-même par son imprudence. Un jour, passant vers l'antichambre de l'appartement du roi, elle y vit le justaucorps du prince qui l'y avait laissé, suivant la coutume, pour entrer dans la chambre du roi, n'étant pas permis d'y entrer autrement que le corps nu depuis la ceinture jusqu'à la tête. Comme elle reconnut les habits du prince, elle les fit prendre par son esclave, ne doutant pas qu'il ne connût aussitôt qui les avait enlevés et qu'il ne vînt les chercher chez elle, mais le prince ne s'en défia nullement et, ne voyant pas ses habits, il les demanda à l'eunuque de la porte. Celui-là, qui ne les avait pas vu prendre, les chercha inutilement. Le roi, qui en fut averti aussitôt, entra en grosse colère de voir qu'on eût osé voler dans l'intérieur du palais et à sa porte les vêtements de son frère, et comme ce ne pouvait être que quelqu'un de l'appartement des femmes, il ordonna que sans différer on y fît une exacte visite. Ceux qui étaient chargés de la faire, étant entrés d'abord chez la sœur de Phetracha, y virent les habits du prince qu'elle n'avait pas eu la précaution de cacher. Le roi en fut aussitôt averti et les esclaves de cette concubine, voyant que ce contretemps allait découvrir tout le mystère d'iniquité, furent les premières à aller accuser leur maîtresse pour sauver leur vie. Le roi ressentit vivement l'affront qu'on avait fait à son honneur et l'ingratitude de deux personnes qu'il avait comblées de tant de grâces.
Il ne voulut pas cependant suivre les mouvements de sa passion ni se faire justice lui-même. Il en remit le soin à son Conseil qu'il établit juge des deux coupables. Phetracha, qui y avait obtenu une des principales places par le crédit de sa sœur, ne se récusa pas en cette occasion ni ne demanda pas sa grâce, mais il fut au contraire le premier, pour soutenir sa fortune, à condamner celle à qui il avait la principale obligation, et à demander sa mort.
Le Conseil la condamna à être dévorée par le tigre, qui est un des exécuteurs ordinaires des Siamois. Le prince fut aussi condamné à mourir, mais d'un autre genre de mort, comme il se pratique à l'égard des princes du sang, c'est-à-dire à être étouffé entre deux pièces de bois de santal pour ne pas répandre le sang royal, car ce serait un grand crime chez les Siamois qu'il en tombât une goutte à terre. Le roi fit exécuter la sentence à l'égard de sa concubine, mais il modéra celle du prince parce qu'une de ses sœurs, qu'il avait tendrement aimée, l'avait conjuré en mourant de servir de père aux jeunes princes, leurs frères, qu'elle avait élevés avec beaucoup d'affection et que, s'il leur arrivait de faire quelque faute à son égard, il ne suivît pas les premiers mouvements de sa colère qui était quelquefois violente, et qu'il ne se laissât jamais aller à leur ôter la vie, mais qu'il se contentât de les châtier en père pour les remettre dans leur devoir.
Le roi, qui ne pouvait rien refuser à une sœur si tendrement chérie et qui était prêt d'expirer, lui engagea sa parole de ne les faire jamais mourir. Il s'en ressouvint en cette occasion et voulut la garder. Comme il était cependant outré de l'affront que lui avait fait le jeune prince, il voulut qu'il en fût châtié rigoureusement par le rotin auquel il le condamna et, comme il avait vu Phetracha un des plus ardents à solliciter la mort du prince pour venger, disait-il, l'honneur de Sa Majesté, il le chargea avec Phra Pi (17) d'exécuter la sentence. Ils s'en acquittèrent avec tant de cruauté et donnèrent tant de coups à ce malheureux prince qu'ils le laissèrent comme mort sur la place. Il en revint cependant, mais tout le corps lui enfla extraordinairement et il lui resta depuis une grande faiblesse des jambes avec une espèce de paralysie sur la langue qui l'empêchait de parler. Quelques-uns, cependant, ont prétendu qu'il contrefaisait le muet pour ne pas donner d'ombrage au roi à qui l'attachement que les grands du royaume et sa fille même conservaient encore pour ce prince, était suspect. Mais j'ai de la peine à croire qu'il eût pu soutenir cette dissimulation cinq ans durant sans se trahir lui-même et qu'il eût pu être si maître de sa langue qu'il ne lui eût pas échappé une parole si la maladie ne l'avait aidé à la retenir ; il y aurait peu d'exemple de cette retenue.
Quoi qu'il en soit, le roi, voulant rompre cet attachement qu'on avait pour lui et tourner les esprits d'un autre côté, il résolut de marier sa fille avec Phra Pi, qu'il avait adopté, et de le choisir pour son successeur. Ce jeune mandarin, qui en ce temps-là, n'avait pas plus de 15 à 16 ans, était d'une naissance assez basse et d'un village qui est au-dessus de Louveau. Il avait été apporté au palais avec quelques autres enfants, n'étant encore qu'à la mamelle, pour y être élevé, car le roi de Siam avait cette coutume de prendre de petits enfants et de les faire élever auprès de lui afin que, ne connaissant pas leurs parents, ils lui fussent plus attachés. Il ne voulait pas, cependant, que leur inclination parût forcée en cela, et lorsque ceux qu'on apportaient pleuraient et semblaient marquer du déplaisir d'avoir quitté leur mère, quoiqu'ils ne fussent pas encore en âge de la reconnaître, il les leur renvoyait aussitôt et ne retenait que ceux qui paraissaient être contents du changement de leur fortune.
Phra Pi, n'étant encore qu'à la mamelle, comme j'ai dit, se signala en cela car ayant été présenté au roi, il sembla le reconnaître par ses caresses pleines de tendresse et de respect. Cela plut si fort à Sa Majesté qu'il donna le soin de son éducation à une de ses sœurs et voulut qu'on l'élevât auprès de la princesse sa fille. Phra Pi profita si bien de cet avantage et du soin qu'on eut de le former, qu'il ne retint rien de la bassesse de son extraction, mais il prit tout l'air et les manières d'un homme de naissance et devint un parfait courtisan. Il n'avait pas l'esprit fort vif et fort billant mais il récompensait cela par son bon air, ses manières aisées et engageantes et surtout par sa complaisance à l'égard du roi et son application à étudier et à prévenir tout ce qu'il pouvait souhaiter. Il entra par là si avant dans ses bonnes grâces que le roi ne pouvait plus être un moment sans lui. Au palais, à la chasse, dans les voyages, on voyait toujours Phra Pi proche de Sa Majesté, étudiant son visage pour prévenir ses ordres, aussi le roi disait ordinairement que Phra Pi lui épargnait bien des paroles.
Son amitié pour le jeune favori alla jusqu'à l'adopter pour son fils et, les deux princes étant, comme j'ai marqué, tombés dans la disgrâce, il songea tout de bon à en faire son successeur et à lui faire épouser sa fille. Mais cette princesse, à qui il fit connaître sa volonté, ne voulut jamais y consentir, soit par fierté, comme elle affectait de le faire paraître, ne pouvant s'abaisser à épouser un homme de si basse naissance, soit, comme tout le monde le croyait, parce qu'elle était engagée d'inclination et même par les liens du mariage au prince son oncle ; car c'était un bruit constant que, malgré la défense du roi et l'infidélité de ce prince qui s'était trouvé dans d'autres engagements, elle n'avait pas laissé, depuis sa disgrâce, de consommer avec lui le mariage que Sa Majesté avait d'abord projeté. Mais l'affaire était si secrète que le roi lui-même et M. Constance, comme je lui ai ouï dire, n'en ont jamais pu savoir la vérité.
Sa Majesté fut extrêmement choquée de la résistance invincible qu'il trouva dans sa fille à consentir d'épouser Phra Pi, et quelques mécontentements qu'il en eut encore depuis par l'indépendance avec laquelle elle voulut conduire les affaires et gouverner quelques pays dont Sa Majesté lui avait donné le soin, l'obligèrent à s'éloigner de sa personne et l'envoyer demeurer à Siam. Cet exil lui fut agréable par la liberté qu'il lui procurait à voir le prince qui y était aussi exilé. Aussi ne voulut-elle pas en sortir lorsque le roi la rappela à Louvo pour y recevoir les présents dont Mme la Dauphine l'avait honorée et elle affecta, en cette occasion, une fierté qui aurait obligé son père à rompre entièrement s'il n'avait eu une extrême tendresse pour elle.
Voilà l'état où étaient les choses lorsque arriva la conspiration des Macassars. Phetracha, dont l'ambition avait déjà conçu de grandes espérances par la disgrâce des deux princes, celle de la princesse et le mépris que celle-ci avait fait paraître pour Phra Pi, ce qui l'excluait de la couronne, crut que cette occasion lui était encore favorable pour avancer ses desseins. Il fit accuser les princes d'être entrés dans cette conspiration qui n'avait eu pour but, à ce qu'il disait, que de se défaire de Sa Majesté, pour élever à sa place un des princes et la princesse.
Le roi, qui était susceptible de toutes les mauvaises impressions qu'on lui pouvait donner contre ses frères, n'eut pas de peine à recevoir celle-là. Le peu de reconnaissance qu'il avait remarqué en eux et les mauvais traitements qu'il avait été obligé de leur faire lui faisaient aisément croire qu'ils ne cherchaient que l'occasion de le perdre. Ainsi il n'eut pas de peine à les condamner au rotin sur l'accusation de quelques témoins qu'on produisit.
Phetracha, qui voulait tirer un double avantage de cette perfidie, engagea Phra Pi à se charger d'exécuter le châtiment. Pour faire sa cour au roi, ce jeune mandarin, qu'il flattait de faire monter sur le trône par son crédit, suivait aveuglément tous ses conseils et ne croyait pas avoir un meilleur ami au monde que Phetracha. Mais celui-ci ne cherchait qu'à le perdre et à se défaire d'un concurrent qui aurait pu lui disputer la couronne par le grand crédit qu'il avait auprès du roi et le prodigieux nombre d'esclaves et d'autres personnes qui dépendaient de lui. Il savait que le peuple, qui aimait les princes et surtout le plus jeune, avait beaucoup de compassion de leur malheur, soit qu'on en ait naturellement pour les malheureux, soit qu'il fût persuadé que les peines qu'on leur faisait excédaient leurs fautes. Ainsi il ne doutait pas que Phra Pi ne se dût rendre odieux en les battant et que tout le monde ne conçut une extrême aversion pour lui, persuadé qu'il était lui-même l'auteur de cette fausse accusation pour se venger contre le jeune prince des dédains de la princesse et s'élever sur le trône par la perte des deux frères du roi.
Il ne fut pas trompé dans ses espérances. Phra Pi, qui s'était déjà attiré la haine de quelques mandarins dont il avait enlevé les filles, acheva de se perdre dans l'esprit de la plupart des autres par cette démarche. Le roi lui-même s'en aperçut et, quelque inclination qu'il conservât toujours pour ce favori, il se désista cependant entièrement du dessein qu'il avait eu de le faire son successeur, prévoyant bien que le peu d'inclination et d'estime que les grands et le peuple avaient pour lui mettraient une opposition invincible à ce projet, outre qu'aimant tendrement sa fille malgré sa fierté, il ne voulait pas lui ôter la couronne, quoiqu'elle refusât de la partager avec Phra Pi.
Il s'en découvrit un jour à M. Constance, de qui j'ai su cela, et lui ajouta que, ne pouvant se résoudre, après tout, à ne rien faire pour Phra Pi qu'il avait adopté, et à le laisser abandonné au ressentiment des princes, il était résolu de lui donner la province de PorceloukPhitsanulok (พิษณุโลก) dans le nord de la Thaïlande. en souveraineté et, afin qu'il fût plus en état de s'y maintenir, de lui faire un don de tous les éléphants de guerre qu'il aurait pris pendant son règne. C'était là les vues du roi, mais elles étaient fort secrètes, et Phra Pi lui-même n'en sachant rien se laissait toujours flatter de l'espérance de la couronne par Phetracha qui se servait de la crédulité de ce jeune mandarin pour couvrir son ambition et conduire plus sûrement ses desseins, comme on verra dans la suite.
Il y réussissait avec d'autant plus de succès qu'on croyait qu'il agissait sans aucun intérêt particulier, affectant un grand dégoût des choses de ce monde et un extrême désir de la retraite. Le roi lui-même croyait lui être fort obligé de ce qu'il ne se faisait pas talapoin et de ce que, par complaisance seulement pour Sa Majesté, comme il disait, il restait encore à la cour. Il l'avait déjà été autrefois et n'avait paru quitter cet état qu'avec peine, ce qui rendait l'empressement qu'il témoignait d'y rentrer moins suspect.
Il ne sera peut-être pas hors de propos de dire à quelle occasion cela se fit, d'autant plus que c'est un des principaux moyens dont il se servit pour avancer ses ambitieux desseins. C'est la coutume, dans le royaume de Siam, que quand la reine ou quelque autre prince chéri particulièrement du roi meurt, les plus zélés courtisans se fassent raser et aillent se confiner dans une talaponière pour y procurer, à ce qu'ils disent, par leurs prières et leurs pénitences, des mérites pour le défunt. Ils croient que ces mérites lui servent à le tirer des enfers si ces crimes lui en ont attiré la peine ou, s'il a à passer dans un autre corps, à lui en obtenir un plus parfait et un état de vie plus relevé, ou enfin, s'il est à la fin de ses métempsycoses et de ses transmigrations, à le faire parvenir au Nieurepan (18), c'est-à-dire au parfait repos du corps et de l'esprit en quoi les Siamois font consister le souverain bonheur. La reine qui était sœur et femme du roi étant morte, ceux qui voulurent faire la cour au roi prirent le pagne jaune qui est l'habit des talapoins. Phra Pi fut un des premiers. Quelques autres l'imitèrent et surtout Phetracha, mais le moindre de ses soins, dans sa retraite, fut d'acquérir des mérites à la reine. Il pensa bien plus à s'y faire des créatures et à gagner l'esprit des talapoins dont il connaissait le crédit auprès du peuple. Il fit de grandes liaisons avec les plus considérables d'entre eux et surtout avec le sancratSangkha rat (สังฆราช), chef de la communauté religieuse. ou supérieur de tous les talapoins de Louvo.
Cependant le roi, qui aimait beaucoup Phra Pi et qui avait de la peine à se passer de lui, ne le laissa pas longtemps parmi les talapoins. Il l'envoya chercher peu de temps après et l'obligea de quitter son pagne jaune. Phetracha eût bien voulu aussi qu'on l'eût rappelé mais, comme on ne pensa pas à lui, il n'osa pas sortir de la talapoinière, non seulement parce que la bienséance et la politique veulent que dans ces occasions on attende l'ordre du roi, mais encore parce qu'ayant témoigné aux talapoins une passion extrême pour leur état de vie et un désir ardent d'y passer le reste de ses jours, il voulait leur faire croire que, s'il l'abandonnait, ce n'était que malgré lui et par un ordre absolu du roi auquel il ne pouvait résister.
Il demeura ainsi une année sans que cet ordre vînt. Comme il commençait cependant à s'ennuyer d'une vie si tranquille et qu'il appréhendait qu'on ne l'eût oublié à la cour, il jugea à propos d'y faire agir afin qu'on le rappelât. En effet, pendant que le sancrat disait des merveilles au roi de la ferveur que ce nouveau talapoin faisait paraître à s'acquitter de tous les devoirs de la religion, un de ses amis représenta à Sa Majesté qu'il y avait déjà assez longtemps que son Conseil était privé d'un homme si capable d'y remplir la place que Sa Majesté lui avait donnée ; qu'il était à craindre qu'il ne prît enfin tant de goût pour la retraite qu'il n'en voulût plus sortir ; que ce serait une perte pour l'État ; qu'il était capable d'y rendre de bons services. Ce discours réveilla l'amitié que le roi avait eue pour ce mandarin. Il l'envoya chercher aussitôt et lui ordonna de changer son pagne jaune pour un rouge qu'il lui avait fait préparer. Phetracha joua parfaitement bien son personnage dans cette occasion car, voyant le roi résolu à le retirer des talapoins, il fit beaucoup d'instances pour y demeurer, témoignant qu'on lui faisait violence et que, si on lui eût permis de suivre son inclination, il aurait préféré le repos de la solitude à toutes les grandeurs et l'éclat de la cour. Il affecta toujours depuis de soupirer après cette chère retraite, témoignant beaucoup d'indifférence pour les honneurs et les emplois. Il refusa même, sous ce prétexte, la charge de barcalon que Sa Majesté voulut lui donner quelque temps après, mais, en effet, parce qu'il voyait bien qu'il n'en aurait que le nom ; que M. Constance avait refusé lui-même par modestie et que ce ministre, à qui Sa Majesté confiant toutes les affaires, ferait toujours fonction de cette charge.
Il portait ordinairement un simple pagne ocre rayée de noir ou de blanc pour s'approcher le plus qu'il pouvait de la couleur de celles des talapoins et il disait souvent au roi que la considération seule de Sa Majesté le retenait à la Cour, mais que, si le ciel voulait qu'il eût le malheur de lui survivre, il ne resterait dans le monde que pour faire rendre à son corps les honneurs qui lui étaient dus et s'opposer, au péril de sa vie, aux desseins des princes et des autres ennemis de Sa Majesté qui s'attendaient à se venger après sa mort sur son corps du mal qu'ils prétendaient avoir reçu d'elle pendant sa vie. Il faisait encore ces contes à Sa Majesté et à M. Constance en ma présence quinze jours avant qu'il se révoltât et dans un temps où nous savions bien qu'il prenait ses mesures pour s'élever sur le trône par la perte du roi même et de ses frères. Voilà l'état où se trouvait la Cour à Louvo quand nous y arrivâmes : le roi n'avait, de toute sa maison royale, qu'une sœur (19) auprès de lui qui s'était toujours conservée dans son amitié. Phra Pi et M. Constance étaient les plus avant dans les bonnes grâces de Sa Majesté, avec cette différence que M. Constance avait l'entière disposition des affaires où l'autre avait peu de part, parce que le roi ne l'en jugeait pas capable, et Phetracha était regardé du roi comme un homme fort désintéressé et qui n'avait d'attachement que pour sa personne, ainsi il était assez bien à la Cour.

NOTES
1 - Samuel Potts, un vaurien ivrogne et malhonnête, lourdement endetté (Maurice Collis, Siamese White, n.p.), qui succéda à Burnaby à la tête du comptoir anglais d'Ayutthaya, avait accusé Phaulkon d'avoir incendié le comptoir de la compagnie anglaise dans la nuit du 6 décembre 1682 pour faire disparaître des reconnaissances de dettes. Selon Maurice Collis, c'est Potts lui-même qui mit le feu, peut-être parce qu'il était ivre, mais peut-être plutôt parce qu'il voulait détruire les preuves de ses malversations. Quoi qu'il en soit, les rapports étaient exécrables entre les deux hommes, et Potts fut même mis quelque temps au pilori, accusé d'avoir rôdé autour de la maison de Phaulkon pour le molester, et peut-être même l'assassiner. ⇑
2 - Maître Barnabé : Richard Burnaby, l'ancien chef du comptoir anglais, reçu le titre de Phra Marit (พระมะริด), gouverneur de Mergui. ⇑
3 - Shabunder, du persan Shāhbandar, littéralement Roi du port C'était le titre d'un gouverneur portuaire avec autorité sur les commerçants étrangers et les capitaines de vaisseaux. Le shabunder était également souvent chef de la douane. (Yule, Hobson Jobson, p. 816). Le frère de maître Ouits (George White) était Samuel White. Mergui était donc alors gouverné par deux Anglais, sur terre comme sur mer. ⇑
4 - Le 28 avril 1687, L'East India Company adressa au roi de Siam une réclamation détaillée de 65 000 livres pour dommages subis par les sujets britanniques du fait de la guerre entre Siam et Golconde et en remboursement des avances faites à l'ambassadeur de Perse. La demande était accompagnée d'une lettre très amicale à Phra Naraï, couplée cependant avec la menace de s'emparer de ses navires et de ses sujets et du blocus du port de Mergui en représailles jusqu'à ce que pleine satisfaction soit obtenue. ⇑
5 - Il y avait deux frégates anglaises, le Curtana et le James. Antony Weltden, le capitaine du Curtana débarqua et une proclamation du roi James II fut lue, ordonnant à tous les Anglais de Mergui enrôlés dans le service du royaume de s'en aller. Les Anglais de Mergui, qui étaient au moins cinquante, se préparèrent à obéir, et une trêve de soixante jours fut proclamée pour permettre à la proclamation du roi d'Angleterre d'arriver à Ayutthaya. Après la proclamation de cette trêve, les Siamois entreprirent logiquement des travaux pour défendre le port. En réponse, le capitaine Weltden s'empara d'un navire siamois, le Resolution. ⇑
6 - Dans la nuit du 14 juillet 1687, le gouverneur siamois de Mergui, exaspéré par les manœuvres de Weltden et craignant que tous les Anglais ne fassent cause commune avec leurs compatriotes, ouvrit le feu sur le James et parvint à le couler. Cette même nuit, des expéditions furent menées pour tuer tous les Anglais de Mergui. Weltden, qui était à terre, s'en tira de justesse mais fut laissé pour mort. White parvint à s'enfuir mais Burnaby fut massacré avec une cinquantaine d'autres Anglais. ⇑
7 - Ok Phra Palat (ออกพระปลัด). Selon La Loubère, ce titre désigne effectivement un second, un lieutenant. ⇑
8 - Mais le roi Naraï n'était peut-être pas si irrité que l'affirme le père de Bèze. Le 11 août 1687, il lança une déclaration de guerre contre l'East India Company, dans laquelle il accusait White et Burnaby d'avoir perfidement assisté Weltden et rejetait sur ce dernier la seule responsabilité du massacre de Mergui, expliquant soigneusement qu'il ne se considérait toutefois pas en guerre avec le gouvernement anglais. De fait, beaucoup d'Anglais, sans lien avec la Compagnie anglaise, sont restés au Siam après le massacre et ne semblent pas avoir été maltraités. (Wood, op. cit., p. 209). ⇑
9 - Beauregard, fils d'un commissaire du roi à Brest, était venu au Siam avec l'ambassade de Chaumont et y était resté avec le chevalier de Forbin, qui l'avait fait major de toutes les troupes siamoises. Voir sur ce site la page qui lui est consacrée : Beauregard. ⇑
10 - Ce navire s'appelait The Pearl (La Perle) et son capitaine se nommait James Perriman. Hill et Hodges étaient deux envoyés de la compagnie anglaise chargés de prendre la direction administrative de Mergui lorsque les Anglais s'en seraient rendus maître. Bien évidemment, ils ignoraient le massacre qui avait eu lieu deux mois plus tôt. ⇑
11 - Nous n'avons pas trouvé mention de ce brave soldat français qui avait autrefois servi sous M. de la Haye [l'amiral Jacob Blanquet de la Haye, qui fut notamment à l'origine de l'une des prises de possession solennelles de l'île de La Réunion, le 5 mai 1671]. Selon Maurice Collis (Siamese White, n.p) le navire était le Dorothy, commandé par le capitaine anglais Cropley au service du roi de Siam. ⇑
12 - La révolte des Macassars eut lieu en septembre 1686, soit environ un an avant les événements relatés par le père de Bèze. ⇑
13 - Voir sur ce site la page des mémoires de Forbin qui se rapporte à la révolte des Macassars. ⇑
14 - Selon Gervaise (Histoire naturelle et politique du royaume de Siam, 1688, p.246) Le roi Naraï avait cinq demi-frères, mais seuls deux vivaient encore à l'époque où écrivait le père de Bèze. Il s'agissait de Chao Fa Apai thot (เจ้าฟ้าอภัยทศ), plutôt disgracié par la nature, et de Chao Fa Noi (เจ้าฟ้าน้อย). Tous deux furent exécutés après la prise de pouvoir par Phetracha. ⇑
15 - Tao Sri Chulalak (ท้าวศรีจุฬาลักษณ์). ⇑
16 - Ce Daniel Brouchebourde, natif de Sedan, chirugien de profession, hérétique opiniâtre et ennemi déclaré de la religion catholique et des Français (Mémoires de François Martin, III, p. 15) était au service de la compagnie hollandaise. Selon certaines rumeurs, il aurait administré du poison au roi Naraï pour hâter sa mort. ⇑
17 - Mom Pi (หม่อมปีย์) ou Phra Pi (พระปีย์), parfois appelé Prapié, Monpy, Monpi, etc. dans les relations françaises. Fils d'un courtisan, ce jeune garçon fut emmené très jeune au palais pour y exercer les fonctions de page et fut élevé par une sœur du roi Naraï. Toutes les relations s'accordent à reconnaître la tendresse quasi paternelle que le roi lui prodiguait et les privilèges exceptionnels dont il jouissait. ⇑
18 - Le Nireuphan ou niphan (นิพพาน) est la traduction siamoise du mot sanscrit nirvana, qui signifie littéralement soufflé, éteint comme une bougie. Mgr Pallegoix (Description du royaume thai ou Siam, I, 1854, p. 457) décrit ainsi cet état : Le niphan est l'extinction de la forme du corps, du goût et des autres sens, de l'expérience des choses, de notre constitution selon le mérite ou le démérite de l'âme ou de l'esprit. Toutes ces choses sont entièrement anéanties, et il n'y aura pas de nouvelle naissance ; la fin de l'existence, la fin des maladies et de toute tristesse, cet anéantissement, selon les bouddhistes, est la souveraine et parfaite béatitude.
 Bouddha dans l'état de nirvana. Peinture murale au Wat Tha Thanon à Uttaradit. ⇑
Bouddha dans l'état de nirvana. Peinture murale au Wat Tha Thanon à Uttaradit. ⇑
19 - Il est bien difficile de s'y retrouver et de démêler l'écheveau de ces familles royales, parmi les mariages consanguins, les bâtards nés des innombrables concubines et l'inflation des titres de noblesse ronflants qui se perpétuent de règne en règne. Selon Wood (A History of Siam, p. 216), la sœur du roi Naraï était la princesse Krom Luang Yothathip (กรมหลวงโยธาทิพ). ⇑

12 mars 2019
