

4ème partie.
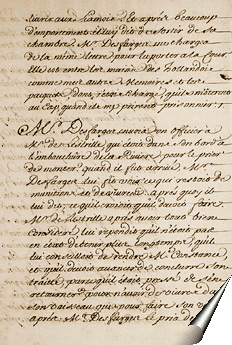
M. Desfarges envoya un officier à M. de l'Estrille qui était dans son bord, à l'embouchure de la rivière, pour le prier de monter. Quand il fut arrivé, M. Desfarges lui fit voir ce qui lui restait de munitions et de vivres, après quoi il lui dit ce qu'il croyait qu'il devait faire. M. de l'Estrille, après avoir tout bien considéré, lui répondit qu'il n'était pas en état de tenir plus longtemps, qu'il lui conseillait de rendre Mme Constance, et qu'il devait avancer de conclure son traité parce qu'il était pressé de s'en retourner, pour n'avoir de vivres dans son vaisseau que pour faire son voyage. Après, M. Desfarges le pria de visiter [555r°] les deux vaisseaux que le barcalon lui avait envoyés pour voir s'ils étaient en état, ce qu'il fit ; il dit qu'ils n'étaient pas des meilleurs, mais qu'on pourrait s'en servir, et surtout qu'on se dépêchât, puis s'en retourna à son bord.
Le jour d'après, il arriva une lettre de la mère de Mme Constance à M. Desfarges qui lui marquait qu'elle s'étonnait que sa fille eût oublié ce qu'elle devait à Dieu, à sa religion et à une mère qui l'avait toujours si tendrement aimée ; qu'elle ne considérait pas que sa retraite dans Bangkok faisait le mauvais traitement de tous les chrétiens et la dureté de sa prison ; qu'elle doutât que son éloignement du royaume causerait sa mort, celle de tous ses parents, et l'extinction générale et pour toujours du christianisme dans Siam ; que si elle était véritablement chrétienne, elle devait songer au salut de ses frères, à la vie de sa mère et à la gloire de Dieu ; que son retour ferait cet effet ; [555v°] qu'elle n'eût rien à craindre, qu'elle l'assurait de sa liberté et qu'elle était persuadée que M. le général avait le cœur trop grand pour la vouloir emmener ; qu'elle espérait qu'il aurait égard à la prière d'une mère captive et à tous les chrétiens dans les fers qui ne pouvaient espérer de vie que par le retour de sa fille.
Cette bonne mère, pour marquer la liberté avec laquelle elle écrivait cette lettre, la fit signer par le père de la Breuille et des jésuites portugais. MM. de Métellopolis et de Lionne, à l'occasion de cette lettre, allèrent voir Mme Constance pour lui dire qu'elle devait se résoudre à s'en retourner pour le salut des chrétiens et de sa propre mère ; que Phetracha, qui était sur le trône, avait promis à M. le général qu'elle aurait toute liberté, qu'elle pourrait se remarier à qui elle jugerait à propos en cas qu'elle en eût le désir, et qu'on ne lui ferait jamais aucun mauvais traitement ; et afin que ces promesse eussent tout leur effet, que [556r°] M. Desfarges en avait fait un traité particulier avec lui, que j'apportai aussi en France, avec la lettre de la mère. Mme Constance dit à MM. de Métellopolis et de Lionne qu'elle n'avait aucune répugnance à demeurer, pourvu qu'on lui tînt parole, les remercia de leurs soins, et les conjura de prier Dieu pour elle (1). Ces messieurs, après avoir pris le consentement de Mme Constance, vinrent à M. Desfarges, qui conclut son traité pour elle avec Phetracha aux conditions ci-dessus.
Le chevalier de Fretteville, qui avait été chargé des diamants dont j'ai parlé, alla voir Mme Constance, à qui il rendit ce qu'il lui avait pu sauver. Deux jours après, comme il sortait d'un des vaisseaux où tous les officiers allaient et venaient se promener et qu'il fut sur la planche d'où je ne faisais que de sortir, le vaisseau venant à éviter par un coup de marée laissa la planche de son côté qui tomba dans l'eau, le chevalier de Fretteville avec elle, que l'on ne revit plus au [556v°] moment qu'il fut dans l'eau (2). C'était un saint garçon qui communiait fort souvent, qui avait fait ses dévotions ce jour-là, qui avait résolu de venir par terre en France et de se faire capucin en arrivant.
M. Desfarges ayant fait avertir le second ambassadeur de tenir le balon prêt pour monter, Mme Constance me dit de lui aller faire compliment de sa part et de ne la pas abandonner jusqu'à son embarquement. J'allai avec M. Ferreux, missionnaire, dans le donjon où l'on l'avait fait venir pour être plus commodément et en plus grande sûreté que dans la maison de M. de Vertesalle, où elle fut d'abord (3). Je la trouvai seule avec son fils et sa servante. Je lui fis le compliment de M. le général et lui dis de sa part qu'il la priait de vouloir se mettre en état de partir, que j'aurais l'honneur de l'accompagner jusqu'où son balon. Elle me témoigna en présence de M. Ferreux, d'un air qui ne nous parut aucunement triste, et qu'on peut même dire [557r°] gai, qu'elle voulait bien s'en retourner, pourvu que Phetracha lui tînt les paroles qu'il donnait, et me pria de lui faire venir un jésuite. J'en allai avertir M. Desfarges, qui me dit qu'il le voulait bien. Je lui amenai le père Le Royer et le père Saint-Martin. Il est vrai qu'aussitôt qu'elle les eût aperçus, elle se mit à pleurer. Et le père Saint-Martin, en se tournant de mon côté : — Vous me disiez que Mme Constance n'était pas fâchée de s'en retourner, et vous voyez tout le contraire. Je leur répondis que c'était leur présence qui causait ses larmes, et qu'ils n'avaient qu'à demander à M. Ferreux si je ne disais pas vrai. Il m'ajouta qu'on lui avait rendu des pierreries qui ne serviraient qu'à la faire maltraiter si on les lui trouvait, et qu'il aurait mieux valu ne les lui pas rendre. Je répondis que je n'y pouvais que faire, qu'il pouvait s'en charger et lui faire encore ce plaisir.
Elle sortit, moi étant avec elle, et les deux pères jésuites qui l'accompagnèrent jusqu'à la porte du fort, où tous les officiers de la garnison et beaucoup de soldats [557v°] s'étaient rendus pour la voir. Comme elle y fut, les deux pères jésuites, en regardant tout le monde, se mirent à dire tout haut : — Vous voyez, Messieurs, comme l'on chasse Madame Constance pour la livrer entre les mains de ses ennemis, malgré l'assurance qu'elle a par écrit de la protection du roi. Ces paroles me surprirent et tous les officiers qui étaient présents. Les pères la quittèrent là, et moi je continuai à la mener jusqu'au bord de la rivière, où le second ambassadeur la reçut et la fit monter dans son ballon.
Je rendis compte à M. Desfarges de ce que je venais de faire, et lui rapportant ce que les pères avaient dit à la porte de la forteresse, il me répondit pour toutes choses que c'étaient de cruelles gens. Le lendemain, le père Le Blanc, me trouvant dans la place, me pria de dire à M. Desfarges de ne point écrire contre eux, qu'on oubliât ce qui s'était passé de part et d'autre, et que c'était un malheur qui était arrivé dans le royaume dont ils n'étaient pas la cause. Je le dis à [558r°] M. Desfarges, qui me répondit qu'il ne pourrait pas s'empêcher de rendre compte de tout ce qui s'était passé, et qu'il n'était point fâché contre les jésuites, qu'ils pouvaient écrire tout ce qu'ils voudraient, qu'il s'en mettait fort peu en peine. Le père Le Blanc alla le même jour chez M. Desfarges, à qui il répéta ce qu'il m'avait fait dire. M. Desfarges lui dit comme à moi qu'ils pouvaient écrire ce qu'ils voudraient, qu'il les priait seulement de ne dire que la vérité ; que pour lui il dirait simplement les choses comme elles s'étaient passées, sans se mettre en peine d'en pénétrer l'origine, ni de marquer ce qu'on en croyait à Siam. D'abord que la nouvelle fut arrivée à la Cour de la sortie de Mme Constance, Phetracha fit élargir tous les chrétiens et fit sortir de prison Véret et toute sa Maison. On commença à envoyer des vivres que Véret avait achetés et qu'on retenait, et peu après on apporta à M. Desfarges le traité qu'on avait fait exprès pour Mme Constance, signé et ratifié par Phetracha.
[558v°] Comme tous les vivres furent venus et mis dans les vaisseaux, on songea de part et d'autre à exécuter le traité qui portait que tous les Européens qui voudraient sortir du royaume de Siam le pourraient faire, non seulement Français, mais aussi Anglais, Portugais et toutes autres nations ; que tous les missionnaires, tous les jésuites et tous les autres chrétiens qui voudraient demeurer dans le royaume y seraient libres comme auparavant ; que pour la sûreté de notre sortie de la rivière, il serait donné des otages, de leur part deux des plus qualifiés du royaume, et de la nôtre le chevalier Desfarges et moi (4) ; que le chevalier Desfarges et moi serions dans un balon à côté du vaisseau de M. le général, et les deux Siamois dans son bord ; que nous sortirions du fort tambour battant, enseignes déployées, armes et bagages, mèche allumée.
M. Desfarges, ne pouvant embarquer tous les canons de sa place dans ses vaisseaux, qui [559r°] auraient été trop chargés pour sortir de la rivière, me donna ordre d'en faire mettre vingt-huit dans des mirous, qui sont des bateaux du pays qui vont terre à terre, que je fis escorter chacun par quatre soldats et par un officier qui étaient Delas et Chamoreau (5), et à Dalvimar, major des troupes (6), d'obliger tous les soldats à prendre chacun ses habits et son équipage et de les porter avec eux, ce qu'il ne fit pas, mais souffrit que la plus grande partie missent leurs sacs dans un mirou. Cela ne fut pas plutôt fait, que M. Desfarges fit battre la générale, l'assemblée et la troupe. Ce fut dans ce temps que Vollant me dit, par admiration de ce que M. Desfarges faisait : — Dieu, Monsieur, nous devait un tel homme pour nous tirer d'ici (7). Et un moment après fit battre aux champs et défiler ses troupes devant lui et devant la plupart des grands du royaume qui s'étaient rendus à Bangkok. Il en sortit 200 soldats, sans comprendre les officiers. On les fit embarquer dans les deux vaisseaux, [559v°] après quoi, prenant congé d'eux, tous lui dirent que si le roi son maître savait comme quoi il s'était tiré de trois affaires, il ne pouvait trop le récompenser, quand il le mettrait auprès du soleil. — C'est, Seigneur Général, pour n'avoir pas monté avec vos troupes jusqu'à Louvo, d'y être monté et d'en être revenu, et de sortir de cette place comme vous faites. De quoi les remerciant tous par une révérence, il les quitta et s'embarqua. M. Desfarges dit à M. de Vertesalle de faire lever l'ancre et de partir, et lui aussitôt fit lever la sienne et le suivit. Ce fut sur les cinq heures du soir, le 2 novembre 1688. Il avait fait partir les mirous deux heures devant, parce qu'ils ne vont qu'avec des perches, toujours proches les rivages et moins vite qu'un vaisseau.
Aussitôt que je vis tout parti, je m'embarquai avec le second ambassadeur dans son balon, qui me dit, environ sur [560r°] les sept heures du soir, de sortir de son balon, que je serais plus à mon aise seul avec mon valet dans un autre qui parut se rencontrer par hasard. Mon valet, qui était derrière moi qui tenait mon fusil, s'aperçut que du balon du second ambassadeur on jetait des cordes dans celui où on nous avait fait entrer, qu'après il se retira et s'en alla d'un autre côté, me laissant à la discrétion des gens à qui il m'avait donnés qui me menèrent dans un recoin de la rivière, où nous fûmes plus de deux heures sans bouger. Ce retardement me fit soupçonner qu'on m'avait mis dans ce balon pour me jouer un mauvais tour. C'est pourquoi feignant que les maringouinsLes moustiques. (ce sont des mouches que nous appelons cousins) m'y tourmentaient trop, je dis que je voulais qu'on me menât à côté des vaisseaux, autrement que je ferais main basse sur eux, comme je criais PayePaï (ไป) : Allez ! ! à haute voix, c'est-à-dire : Marche !
M. de Métellopolis qui était avec le chevalier Desfarges et Véret, passant par hasard, [560v°] reconnurent que c'était moi qui faisais ce bruit, me vinrent joindre, et un moment après le second ambassadeur qui me dit qu'il fallait que nous allassions devant à la TabanqueLa Tabangue, ou la Tabanque était une sorte d'octroi, de poste douanier sur la route d'Ayutthaya. , et que nous y trouverions toutes de sortes de rafraîchissements. Je lui répondis, pour avoir un moyen de donner avis à M. Desfarges de ceci, que j'enrageais de faim, que je voulais manger et qu'il fallait que j'envoyasse quérir de quoi au vaisseau. Il me dit que j'y pouvais envoyer mon valet, ce que je fis, le chargeant de dire à M. Desfarges que les Siamois ne tenaient pas le traité qu'ils avaient fait avec lui, qui était que les otages allassent à côté du vaisseau, et que je croyais qu'ils voulaient nous jouer un méchant tour dans la rivière. M. Desfarges me manda par mon même valet qu'il était bien fâché de ne nous pouvoir pas secourir, que j'étais bon et sage, que je m'en tirasse comme je pourrais. Il accompagnait ce compliment de deux bouteilles de vin et d'un morceau de viande.
, et que nous y trouverions toutes de sortes de rafraîchissements. Je lui répondis, pour avoir un moyen de donner avis à M. Desfarges de ceci, que j'enrageais de faim, que je voulais manger et qu'il fallait que j'envoyasse quérir de quoi au vaisseau. Il me dit que j'y pouvais envoyer mon valet, ce que je fis, le chargeant de dire à M. Desfarges que les Siamois ne tenaient pas le traité qu'ils avaient fait avec lui, qui était que les otages allassent à côté du vaisseau, et que je croyais qu'ils voulaient nous jouer un méchant tour dans la rivière. M. Desfarges me manda par mon même valet qu'il était bien fâché de ne nous pouvoir pas secourir, que j'étais bon et sage, que je m'en tirasse comme je pourrais. Il accompagnait ce compliment de deux bouteilles de vin et d'un morceau de viande.
Je songeai que [561r°] pour venir à bout de mon viel ambassadeur, il fallait que je tâchasse de l'enivrer. Je le priai de boire et de manger. Il le fit volontiers, et comme je dis à Véret que c'était peu pour mon dessein que mes deux bouteilles, il me dit qu'il avait de l'eau-de-vie. Je le priai de nous en faire apporter. Cela se fit assez bien. Cependant il nous pressait toujours de partir. Je dis que je ne le pouvais faire, que je voulais observer le traité et obéir à l'ordre de mon général, ajoutant que si nous envoyions le chevalier, j'étais sûr qu'il le voudrait bien. Il me dit que je pouvais y envoyer mon valet : — Vous vous moquez, lui répondis-je ; savez-vous bien qu'on n'en agit pas ainsi avec un général, et que s'il fallait tuer mon valet, ou lui envoyer, j'aimerais mieux mille fois le tuer.
Cependant, je lui présentais de moment à autre de l'eau-de-vie, et lui à proportion qu'il s'échauffait, m'embrassant, il me disait qu'il était Français et mon ami, ce qui fit dire à M. de Métellopolis que j'en savais bien long. Comme il vit que je [561v°] persistais toujours et que je lui dis que s'il prétendait ne pas suivre le traité, je prendrais des mesures qui lui seraient peut-être plus fâcheuses qu'à moi, il consulta fort longtemps avec les mandarins qu'il avait avec lui, et après plusieurs dites et redites, il y consentit. Je dis au chevalier Desfarges qu'il ne revînt point, et que je ferais de mon mieux pour le reste. Véret qui était dans un autre balon où il ne se croyait pas trop sûr, me témoigna beaucoup d'envie de passer dans le mien. Je lui dis qu'il le pouvait faire. En attendant nous buvions toujours de l'eau-de-vie, l'ambassadeur et moi, et comme nous commencions à nous échauffer à force de boire et de nous embrasser, le gouverneur de la province de Bangkok nous vint joindre avec des oranges et beaucoup de rafraîchissements qu'il me présenta avec toutes les démonstrations d'une cordiale amitié.
Le vieil ambassadeur à qui le temps durait de nous voir en repos, me dit [562r°] que M. le chevalier tardait bien à revenir. Je lui dis que je lui avais dit de ne pas retourner et de nous attendre, et que nous pourrions le joindre quand il voudrait, ce qui fit qu'il ordonna de partir et me pria de crier qu'on envoyât le chevalier Desfarges. Je lui dis que cela ne se faisait point, surtout pendant la nuit, que ce serait donner l'alarme et mettre le désordre partout. Ainsi nous arrivâmes proche le vaisseau, où aussitôt que je fus contre, je criai qu'on me jetât des cordes, ce qu'on fit. Je liai mon balon par les deux extrémités et dis à mon valet qui était dans le milieu de bien tenir une troisième, mais craignant qu'il ne l'abandonnât s'il venait à s'endormir, je lui fis attacher à sa cuisse et s'asseoir dessus.
Aussitôt, M. Desfarges nous voyant comme en sûreté contre lui, pour ne paraître rien faire contre le traité, fit descendre son fils le chevalier dans mon balon et dit par plusieurs fois à l'évêque de monter, qui lui répondit qu'il était incommodé, qu'il ne le pouvait faire. [562v°] L'ambassadeur, voyant le chevalier descendu, me pressa toujours de prendre les devants, m'assurant que nous trouverions toutes choses pour nous divertir. Je lui dis qu'il ne se mît en peine de rien, qu'aussitôt que le jour serait venu nous partirions. Comme il vit qu'il n'y avait pas moyen de me résoudre, il nous quitta pour aller donner quelque ordre, et deux heures après nous revint joindre. Aussitôt il passa dans notre balon. En m'embrassant plus tendrement que jamais, il me dit que le jour commençait à venir, et si nous ne voulions pas prendre les devants. Je l'assurai que ce serait dans peu et que je le régalerais d'une bonne fricassée de poulet. Et il est vrai que dans ce moment on vit paraître de tous côtés une infinité de balons remplis de monde, tous le sabre nu à la main, criant à tue-tête, passant et repassant devant nous. [Ils] coupèrent les cordes du balon de M. de Métellopolis qui était attaché au nôtre, qu'ils emmenèrent.
Aussitôt nous criâmes : [563r°] — Aux armes ! Je pris le vieil ambassadeur au milieu du corps, disant à mon valet de bien tenir la corde sur laquelle il était assis et qu'il avait entourée à sa cuisse, sans quoi notre balon était enlevé comme celui de M. l'évêque, parce qu'en passant les Siamois avaient coupé avec leurs sabres les cordes qui les tenaient par les extrémités. Aussitôt, tous les soldats du vaisseau parurent sous les armes, et M. Desfarges nous fit monter dans le vaisseau avec le second ambassadeur que je ne quittai point qu'il n'y fût entré. Nous étions pour lors près de sortir de la rivière, c'est-à-dire à dix lieues de Bangkok. Un quart d'heure après cette perfidie, nous apprîmes par un sergent à qui on avait coupé le bras pour un coup de mousquet qu'il avait reçu dans la place, qu'il avait vu faire échouer les mirous où étaient les canons sur les sept heures du soir, à trois lieues de Bangkok.
M. Desfarges, enragé d'apprendre [563v°] cette nouvelle, voulut faire une descente pour brûler la Tabanque et son village. On lui dit qu'il ne fallait pas, parce que nos vaisseaux n'étant gouvernés que par des Mores, il ne manqueraient de se jeter dans l'eau et de nous laisser aussitôt qu'ils entendraient tirer le canon, ce qui nous aurait fait périr, ou au moins nous aurait livrés entre les mains des Siamois. Cela lui fit changer de résolution et lui fit continuer sa route. Nous vîmes, comme on nous avait dit, la rivière fermée par deux lignes de grands arbres plantés proches les uns des autres, et à plusieurs rangs, chacune terminée par un fort bien garni de canon, l'un si près de l'autre qu'ils ne laissaient d'espace que pour y passer un vaisseau. Cet ouvrage, un des plus beaux que j'aie jamais vus, était si solide, que les marées les plus fortes et les plus grands coups de mer n'y faisaient rien, et ce à cause du jour qu'il y avait entre les arbres qui donnaient de l'échappée à l'eau. Il avait été construit au commencement du siège pour empêcher que rien n'entrât dans la rivière pour nous donner [564r°] quelques secours. Nous passâmes cette espèce de digue et nous fûmes mouiller proche de M. de l'Estrille.
Quelques deux heures après, M. de Métellopolis écrivit à M. Desfarges par le père Thionville qui était dans le mirou où étaient les malades, où il mandait de renvoyer les otages, et qu'on lui renverrait les canons et tout ce qui nous appartenait. Il fit réponse qu'on commençât par lui donner satisfaction, et que de son côté il ne manquerait en rien, qu'il devait savoir que jamais il n'avait manqué de leur tenir sa parole et d'agir avec eux de bonne foi. M. l'évêque, à qui cette réponse ne plaisait pas, récrivit à M. Desfarges en des termes un peu trop forts, lui disant, entre autres choses, que quand les Siamois lui manqueraient, il avait dans le vaisseau de M. de l'Estrille des effets pour plus que son canon ne valait. M. Desfarges demanda au père Thionville si la lettre que M. l'évêque lui écrivait n'était pas forcée. Il lui dit que non, [564v°] et qu'il croyait seulement que les Siamois renverraient tout après qu'ils auraient leurs otages. Puis il récrivit à M. l'évêque, lui marquant qu'à sa considération, il voulait bien commencer par envoyer un des otages, et qu'aussitôt qu'on lui aurait renvoyé un mirou, il enverrait le second.
On tomba d'accord que cela serait ainsi, et M. Desfarges fit partir un des otages qu'ils nommèrent, qu'ils n'eurent pas plutôt repris qu'ils se moquèrent de M. l'évêque et de nous. M. Desfarges, qui voulait marquer aux Siamois que malgré leur manquement de parole, il ne voulait rien faire qui fût contre le traité, dit à Véret qu'il fallait qu'il retournât à Siam, apportant pour raison que son retour, qui marquerait la bonne foi des Français, pourrait porter les Siamois à nous renvoyer nos canons pour ravoir leur second otage, ou au moins les empêcher de maltraiter M. l'évêque qui restait dans le royaume avec ses missionnaires, et les obligeât à souffrir les chrétiens dans la liberté de leur [565r°] religion. Véret lui dit que s'il demeurait, la Compagnie était perdue, et que quelque chose qui arrivât, il aimait mieux mourir que de retourner. M. Desfarges lui dit qu'il ne l'emmènerait point qu'il ne lui donnât un billet écrit de sa main, qui marquerait en termes exprès que s'il restait à Siam, le commerce serait perdu. Il lui promit de le faire quand il voudrait.
Deux heures après, qui était le 6 novembre, on leva l'ancre, et l'on fit voile pour Pondichéry. On avait pris M. Cornuel, capitaine en second de l'Oriflamme, pour le mettre sur un des vaisseaux où était M. de Vertesalle, après avoir distribué à chacun des passagers, qui étaient M. l'abbé de Lionne et cinq missionnaires, des pères jésuites et des officiers anglais. Comme nous fûmes dans le détroit de Malacca, M. Desfarges et M. de Lionne crurent qu'il serait bon de prendre la déposition du second otage et du second ambassadeur, pour savoir au vrai ce qui avait donné lieu à tout le désordre. On me dit de m'en [565v°] aller avec M. Ferreux, missionnaire, et M. de la Salle, commissaire des troupes, dans le bord de M. de Vertesalle, où ils étaient, pour prendre leurs dépositions. M. de Vertesalle les fit venir dans une chambre où nous étions. On commença par le second ambassadeur à qui je dis (après lui avoir fait jurer qu'il dirait la vérité sur tout ce qu'on lui allait demander) que s'il nous mentait en la moindre chose, on le ferait mourir à son arrivée en France.
Il nous dit, suivant les interrogations qu'on lui faisait, qu'on avait fait mourir M. Constance pour avoir malversé dans ses charges, pour avoir été convaincu de dissipation des finances et pour avoir voulu livrer le royaume de Siam aux Français ; que Phetracha lui avait dit, dès l'arrivée des Français à Bangkok, que s'il ne nous livrait au roi, il ne mourrait jamais d'autre main que de la sienne, et que sur ce qu'il n'avait pu nous livrer, on l'avait fait mourir ; qu'il y avait longtemps qu'il n'était plus bien dans l'esprit du roi ; que Phetracha faisait [566r°] tout dans le royaume dès notre arrivée, que c'était lui qui nous envoyait les travailleurs que nous demandions à M. Constance et que nous pensions qu'il nous donnait ; qu'il savait les méchantes intentions que la Cour avait pour nous ; que Phetracha avait fait poster 8 000 hommes entre Siam et Louvo, dans des pagodes, pour enlever M. le général avec ses troupes qui devaient monter, qu'il croyait que ce n'était pas pour nous tuer, mais seulement pour nous séparer ; que dans le temps que cela se serait fait, les travailleurs de Bangkok, qui étaient tous à Phetracha, devaient introduire dans la place 6 000 hommes qui étaient dans un bois proche et s'en saisir ; que le grand barcalon, ambassadeur, ne nous avait point favorisés, quoique très content des honneurs qu'on lui avait faits en France, à cause qu'arrivant à Siam, le père Tachard, jésuite, sur un ordre particulier qu'il disait avoir, avertit le roi de leur retour, qui était un honneur qu'on lui avait ravi dont il avait été sensiblement touché, ce qui n'a pas peu contribué aux maux que [366v°] nous avions soufferts ; qu'on avait fait mourir Mon Pi pour avoir levé des troupes de son chef dans le royaume ; que les frères du roi avaient été mis à mort pour faire régner Phetracha ; qu'il croyait que le roi était participant de tout, parce que tous les grands de l'État et les officiers de sa maison étaient dans son parti, et qu'on disait que Phetracha, qui s'était fait couronner roi, épouserait la princesse reine.
Il dit beaucoup d'autres choses dont je ne puis bien me souvenir. Après qu'on eut reçu la déposition du vieil ambassadeur, on fit venir le second otage qui nous dit qu'il ne savait rien du tout de ce qui s'était passé, parce qu'en revenant du pays de Cambodge, où il était allé faire la guerre, Phetracha l'avait fait mettre en prison à Louvo, d'où il ne le fit sortir qu'au commencement de la guerre contre nous pour aller à la Tabanque en qualité de gouverneur, avec ordre de construire des forts tout le long de la rivière, que nous avions vus en descendant ; qu'il pouvait seulement nous assurer que [367r°] les Hollandais avaient donné quarante pièces de canon, des boulets et d'autres munitions qui étaient venus de Batavia, et que lui-même les avait fait mettre dans les forts.
Nous mouillâmes à Malacca, où nous demeurâmes huit jours pour y prendre des vivres qui commençaient à nous manquer. De là nous allâmes à Pondichéry, où nous arrivâmes le 9 février 1689. Nous y trouvâmes M. Du Bruant avec dix ou douze hommes, qui étaient tout ce qui lui restait de ses troupes. M. Desfarges, à sa descente, fit assembler les principaux officiers chez M. Martin, directeur de la Compagnie française, pour leur dire que son dessein était d'aller à Mergui pour le reprendre. M. Du Bruant dit qu'il n'y fallait pas songer, parce qu'on ne pouvait pas le garder quand on l'aurait repris. Il fut arrêté qu'au lieu de Mergui on irait prendre Jonselan (8), île qui n'est pas beaucoup éloignée de Malacca appartenant au roi de Siam. Elle produit de l'étain, [567v°] et l'on pêche aussi des perles dans sa rivière ; elle serait de grande utilité, n'y ayant point d'endroits qui convienne mieux à la Compagnie pour y avoir des bois propres à faire des vaisseaux et de fort bonnes rades. Aussitôt qu'on eut conclu d'y aller, le sieur Martin donna ordre de faire chercher des vivres et tout ce qui serait nécessaire pour cette expédition. M. de l'Estrille y devait accompagner M. Desfarges, et l'on résolut que le 15 mars l'on partirait. M. Desfarges fit la revue de ses troupes, qui se trouvèrent monter au nombre de 330 hommes et de 40 officiers. Il me dit ensuite qu'il m'avait choisi pour porter les paquets du roi, et que si la Cour approuvait ce dessein et qu'elle jugeât à props de faire un établissement dans cette île, de la prier de me faire voir les troupes qu'on voudrait y envoyer, parce que celles qu'on avait données à M. de l'Estrille ne valaient rien, et qu'il en écrirait à M. de Seignelay.
[568r°] Comme j'attendais mes dépêches, des officiers de M. Du bruant me dirent qu'ils avaient soutenu à Mergui deux assauts de loin (ce sont leurs propres termes) et que M. Du Bruant ayant vu qu'il s'assemblait beaucoup de troupes pour venir à la charge, avait pris le temps que les Siamois mangeaient leur riz pour sortir de sa place, laissant l'argent qui y était pour le paiement des troupes à la discrétion de ses valets et de ses soldats, qui en prirent ce qu'ils purent ; ajoutant que ce fut en petite quantité, et par la précipitation où chacun était de s'enfuir. En effet, elle fut si grande que Hiton, capitaine, se noya avec la moitié de sa compagnie en s'embarquant. Ce qui fit que ceux qui demeurèrent derrière, qui étaient Chambiche, commissaire, qui voulait sauver le reste de l'argent, le chirurgien major et d'autres officiers et soldats, furent tués par les Siamois, qui s'aperçurent de ce désordre, dont la cause ne venait pas de leur part (9) ; qu'ils avaient été assiégés le ... de mai (10) [568v°] et en étaient sortis le 24 de juin suivant. Ils me dirent encore que le sieur Du Bruant fut assez malheureux pour être rencontré en allant à Pondichéry par sept ou huit vaisseaux anglais qui le prirent pour Sainte-Marie, qui commandait un des vaisseaux du roi de Siam, qui était allé avec Suhart par ordre de M. Constance pour brûler les vaisseaux qui étaient dans le rade de Madras, dont le gouverneur de la place avait été averti par le secrétaire de M. Constance ; que comme M. Du Bruant vit qu'on se méprenait, il dit à l'amiral qu'il pouvait s'informer de lui à un homme qu'il lui nomma, qui était à Madras, qu'il l'avait connu à Siam lorsque nous y étions et que l'on y avait envoyé pour négocier la paix ; qu'il l'était venu voir à Mergui en s'en retournant à Madras. L'amiral, pour en savoir la vérité, l'envoya à Madras, retenant avec lui les vingt hommes que M. Du Bruant avait, lui disant qu'il n'était [569r°] pas prudent de lui confier un vaisseau avec tant de monde ; où étant arrivé, il fut reconnu pour n'être pas Sainte-Marie et ramené à Pondichéry, où l'on n'avait encore aucune nouvelle de son monde quand j'en suis parti.
Le 17 février, ayant pris les ordres de M. Desfarges, je m'embarquai dans la Normande, commandée par M. de Courcelles, avec Vollant et Sainte-Marie, et le 27 avril nous arrivâmes au cap de Bonne-Espérance, où nous fûmes pris par les Hollandais et le Coche qui venait après nous, où étaient les pères Le Blanc et Collusson, le cinquième en suivant.
C'est là que l'on m'ôta généralement tout ce que j'avais à la réserve de 120 pistoles que je trouvai le moyen de sauver. M. de Courcelles, qui avait ordre de M. Desfarges de mettre Sainte-Marie en prison à son arrivée en France, jusqu'à ce que la Cour en fût informée, et qu'il l'avait renvoyé pour avoir enlevé [569v°] Mme Constance, pour dire lui-même pourquoi il l'avait fait, et ceux qui lui avaient fait faire ; pour s'être laissé prendre avec son vaisseau à l'embouchure de la rivière, et pour lui avoir celé un ordre que M. Constance lui avait donné contre la nation, fut prié par le gouverneur, un jour qu'il lui donnait avec moi à souper, de lui dire qui était Sainte-Marie. Il lui répondit que c'était un prisonnier que M. Desfarges lui avait donné pour mener en France. Le gouverneur répliqua qu'il le retenait à la prière que lui en avaient faite les pères jésuites, et sur ce qu'ils l'avaient assuré que c'était un fort galant homme et un très bon officier. Quelques jours devant, j'avais donné au père Le Blanc 80 pistoles pour distribuer, ce disait-il, à ceux qui en avaient besoin, et j'appris que c'était pour donner à Sainte-Marie.
Le 1er juillet nous partîmes du Cap pour Middelbourg où nous arrivâmes le 1er novembre, [570r°] et où j'ai demeuré prisonnier.
Et j'assure au péril de ma tête que tout ce que j'ai dit dans cette relation est véritable.
Fin de la relation de Beauchamp.

NOTES :
1 - Aucune relation ne confirme cette version. La relation manuscrite anonyme BN Ms 6105, probablement de Vollant des Verquains, prétend même que la mère de Mme Constance avait été contrainte d'écrire cette lettre, et donne des détails sur le départ de la veuve de Phaulkon qui contredisent formellement Beauchamp (f° 65v° et suiv.) : Le sieur Véret qui fut à Siam en ce temps-là se fit arrêter avec les autres, afin d'obliger la mère de Mme de Constance d'écrire à M. Desfarges pour le supplier d'avoir pitié de sa vieillesse, et de ne la point laisser souffrir davantage, aussi bien que toute sa famille, en lui renvoyant incessamment sa fille.
Cette ruse d'emprisonner le christianisme et la famille de Mme de Constance ne se put faire avec tant de circonspection que le père de la Breuille, jésuite destiné pour rester à Siam, et qui était du nombre des prisonniers, ne s'en aperçut, qui en donna avis à son supérieur, qui pourtant était à Bangkok, l'assurant que c'était un jeu fait à la main, pour avoir quelques raisons extérieures de rendre Mme de Constance, mais M. Desfarges, qui n'attendait qu'une pareille lettre à celle qu'il reçut de la mère de cette dame, afin d'avoir quelque chose à produire à la Cour qui justifiât sa conduite, fit aussitôt un petit traité particulier pour elle avec le barcalon, savoir qu'elle aurait dorénavant toutes libertés dans sa religion, comme aussi celle de se remarier toutes et quantes fois qu'elle le voudrait, et enfin qu'elle ne serait plus inquiétée par la suite au sujet des effets de feu son mari ; ce qu'ayant été signé de part et d'autre, il lui envoya dire par le major qu'il fallait qu'elle se disposât à sortir incessamment de la place, au refus de quoi il y avait quatre sergents de détachés pour l'emporter par les bras et par les jambes. Cette dame, outrée de douleur et de désespoir de se voir ainsi vendue et pillée, dit qu'elle n'en avait jamais moins attendu de M. le général, puisqu'il avait si lâchement abandonné son mari, et que le détachement des quatre sergents était inutile, et comme elle était à la porte du petit fort carré pour sortir, elle appela le commissaire et protesta devant lui et devant tous les officier qui y étaient présents que s'étant venue réfugier sous le pavillon du roi en vertu des honneurs que son mari en avait reçus, et des deux lettres qu'elle produisait pour lors publiquement, M. Desfarges, malgré deux conseils de guerre la rendait à ses ennemis de sa pleine autorité, contre laquelle elle protestait en présence de tous ceux qui l'entendaient comme contraire aux intentions du roi, de quoi elle le priait d'informer Sa Majesté. Sa protestation faite, elle s'achemina vers le bord de la rivière, où le second ambassadeur en France l'attendait avec plusieurs balons, et étant embarquée; elle fut menée comme en triomphe jusqu'à Siam, où elle fut gardée dans son balon au milieu de la rivière, entourée de plusieurs autres armés de soldats, sans qu'il lui fût permis d'aller à terre. ⇑
2 - L'Abrégé de ce qui s'est passé à Bangkok pendant le siège de 1688 (Archives Nationales, Col. C1/24, f° 153r°) indique que cet événement s'est passé le 3 octobre 1688, entre quatre et cinq heures du soir. ⇑
3 - Vertesalle avait eu un comportement des plus galants envers Mme Constance dès qu'elle fut arrivée à Bangkok : Avec la permission de M. le général, il fut prendre Mme Constance dans le vaisseau où elle était et la mena dans sa maison qu'il lui céda pour elle et ses gens d'une manière fort obligeante, allant coucher avec les siens au bivouac. (Le Blanc, Histoire de la révolution du royaume de Siam, II, pp. 65-66). ⇑
4 - Voir page précédente note 9. ⇑
5 - Beauchamp orthographie Chammorot. Ce M. de Chammoreau était sans doute le même qui était venu une première fois au Siam sur l'Oiseau en qualité d'enseigne avec le chevalier de Chaumont et dont l'ambassadeur disait (Relation du voyage de Siam, 1686, p. 217) : M. de Chammoreau, qui est un homme qui sait beaucoup de son métier : par la grande application qu'il y donne, il est capable d'être plus qu'enseigne. Il semble qu'il n'ait pas progressé dans la hiérarchie, puisque c'est encore avec le grade d'enseigne qu'il s'est embarqué sur le Gaillard avec l'ambassade Céberet-La Loubère. (Tachard, Second voyage 1689, p. 12). Il obtiendra enfin le grade de capitaine de frégate et commandera le Lion l'un des navires de l'escadre Duquesne-Guiton sur lequel il entreprendra son troisième voyage au Siam en février 1690. Robert Challe écrivait de lui dans son Journal : je n'ai eu aucune relation avec lui. Tout ce que j'en sais, c'est qu'il est comme M. de Quistillic capitaine de frégate, et qu'il paraît vif, ardent et résolu ; du reste très bien fait de sa personne. Il était enseigne sur l'Oiseau avec M. de Vaudricourt, lorsque M. le chevalier de Chaumont alla ambassadeur à Siam et que M. l'abbé de Choisy l'accompagnait. (Journal d'un voyage fait aux Indes Orientales, 1721, I, pp. 10-11) ⇑
6 - On trouve mention du sieur d'Alvimar, capitaine et major de la 1ère compagnie dans la Liste des Officiers choisis par le Roy pour commander les Compagnies d'Infanterie que Sa Majesté envoye a siam datée de Versailles, le 14 février 1687 et conservée aux Archives Nationales de Paris sous la référence Col. C1/27 f° 46r° et suiv. En sa qualité de major, il était logiquement désigné pour être commandant de Bangkok. Desfarges, qui le détestait, le démit de cette fonction au profit de Beauchamp. On trouve dans un rapport rédigé au Siam le 27 décembre 1687 et transmis en France par l’ambassade La Loubère (A.N. C1/23, f° 220r°) : le sieur d’Alvimar est homme d’honneur, mais l’emploi de capitaine et major ne lui convient point. Lorsqu’il [Desfarges] fut à la Cour de Siam, il fut obligé de donner le commandement de la place sous le sieur de Verdesalle au sieur de Beauchamp, major de la place, qui est un très bon officier. On lit un peu plus loin dans le même document : le sieur d’Alvimar se plaint que M. Desfarges a donné au sieur de Beauchamp le commandement de Bangkok à son préjudice. La phrase suivante, bien que rayée d’une croix, demeure lisible : Il [d’Alvimar] dit que ledit sieur Desfarges le méprise à cause qu’il a été à madame la marquise, et que lorsque M. Constance lui demande qui il est, ledit sieur Desfarges ne répond qu’en riant et secouant la tête d’une manière fort méprisable (A.N. C1/23 f° 221r°). Cette allusion à madame la marquise désigne peut-être Mme de Maintenon, épouse secrète de Louis XIV. Il semble que la très influente marquise ait pris sous sa protection nombre d'obscurs courtisans dont elle favorisait la carrière et qu'elle faisait élever à des grades parfois sans grand rapport avec leurs compétences. Robert Challe évoque les bâtards du cotillon, expliquant que c'est ainsi que les marins baptisent les officiers que produit la faveur de Mme de Maintenon. (Journal d'un voyage fait aux Indes orientales, 1721, I, p. 317). ⇑
7 - On peut douter de la sincérité de ces propos, s'ils sont authentiques. Dans la relation anonyme BN Ms. Fr. 8210, sans doute de la main de Vollant, l'ingénieur se montre très critique envers Desfarges, qu'il ne porte manifestement pas dans son cœur. ⇑
8 - L'île de Joncelang, aujourd'hui Phuket (ภูเก็ต), au sud de la Thaïlande. Dans ses Mémoires, François Martin explique qu'il avait formellement déconseillé cette expédition. Il évoque un Conseil qui se serait tenu le 6 février (la date du 9 février indiquée par Beauchamp pour l'arrivée à Pondichéry est donc sans doute fausse) et nous renseigne davantage sur la teneur des discussions : M. Desfarges fit assembler le Conseil le 6 [février 1689]. Les personnes qui le composèrent furent le général, M. de Bruant, M. de Vertesalles, M. de l'Estrille, capitaine du navire l'Oriflamme, M. de la Salle, commissaire général. [Beauchamp, qui n'est pas mentionné, n'y participa donc sans doute pas]. Je fus de l'assemblée ainsi que le sieur J.B. Martin, second du comptoir. Le sieur Véret [ancien directeur du comptoir de Siam] y entra aussi avec le sieur de la Mare, ingénieur. Le point était sur ce qu'on ferait des vaisseaux et des troupes ; on parla d'abord d'aller à l'île de Joncelang ; le sieur Véret en avait entretenu M. Desfarges qui donnait fort dans ses sentiments. Les officiers n'avaient point de connaissance de cette île, ils suivirent les intentions du général qui marquait y être porté. Le sieur de la Mare, qui n'en savait que par un rapport confus, et qu'on avait fait entrer dans l'assemblée (quoiqu'il ne fût pas d'un caractère à y avoir voix), mais pour pousser au voyage, exagéra extraordinairement la fertilité, l'abondance et la richesse de Joncelang. J'étais informé du contraire, ainsi que le sieur J.B. Martin, par quatre ou cinq voyages qu'on y avait faits de Pondichéry pour les intérêts de la Compagnie ; je pris la parole sur cette exagération opposée entièrement à la vérité. Je fis aussi appeler le sieur Germain qui avait eu l'emploi de capitaine sur les vaisseaux que nous avions envoyés à cette île, qui contredit hautement l'ingénieur ; cependant il soutint toujours sa thèse, appuyé du sieur Véret. Je n'ai jamais pu comprendre les raisons qui portèrent ces deux hommes à un voyage si mal dirigé. (Mémoires de François Martin, 1931, III, p. 28). ⇑
9 - Le père Le Blanc rapporte cette sortie précipitée de Mergui (op. cit., II, pp. 297-298) : La frayeur de nos soldats leur donna de la hardiesse. Ils vinrent fondre sur eux avec des sagaies et des sabres. Les capitaines du Halgoy et de Launay soutinrent leurs efforts pour donner aux nôtres le temps de s'embarquer, par les ordres de M. du Bruant qui fit partout le devoir de commandant et de soldat. Nous perdîmes là le commissaire Chambiche et quelques soldats qui demeurèrent dans la vase, parce qu'ils étaient trop chargés d'argent. Le sieur Hiton, brave officier, fut noyé, et avec lui une partie de sa compagnie dans une chaloupe qui coula bas ; le reste s'embarqua heureusement. Comme on n'avait pas pu enclouer le canon du fort de l'Étoile, les ennemis s'en servirent pour tirer sur les deux vaisseaux, où ils tuèrent encore dix ou douze hommes. ⇑
10 - Beauchamp n'indique pas de date. Le siège de Mergui commença à la fin du mois de mai ou dans les premiers jours de juin. ⇑

21 février 2019
