

1ère partie.
[506r°] Monseigneur (1),
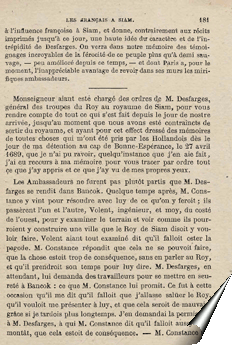
ayant été chargé des ordres de M. Desfarges, général des troupes du roi au royaume de Siam, pour vous rendre compte de tout ce qui s'est fait depuis le jour de notre arrivée jusqu'au moment que nous avons été contraints de sortir du royaume, et ayant pour cet effet dressé des mémoires de toutes choses qui m'ont été pris par les Hollandais dès le jour de ma détention au cap de Bonne-Espérance, le 27 avril 1689 (2), que je n'ai pu ravoir, quelque instance que j'en aie faite, j'ai eu recours à ma mémoire pour vous tracer par ordre tout ce que j'ai appris et ce que j'ai vu de mes propres yeux.
Les ambassadeurs ne furent pas plutôt partis (3) que M. Desfarges se rendit dans Bangkok. Quelque temps après, M. Constance y vint pour résoudre avec lui de ce qu'on y ferait ; ils passèrent l'un et l'autre, Vollant, ingénieur (4), et moi, du côté de l'ouest, pour y examiner le terrain et voir comme ils [506v°] pourraient y construire une ville que le roi de Siam disait y vouloir faire. Vollant ayant tout examiné dit qu'il fallait ôter la pagode. M. Constance répondit que cela ne se pouvait faire, que la chose était trop de conséquence, sans en parler au roi, et qu'il prendrait son temps pour lui dire. M. Desfarges, en attendant, lui demanda des travailleurs pour se mettre en sûreté à Bangkok, ce que M. Constance lui promit. Ce fut à cette occasion qu'il me dit qu'il fallait que j'allasse saluer le roi, qu'il voulait me présenter à lui, et que cela serait de mauvaise grâce si je tardais plus longtemps. J'en demandai la permission à M. Desfarges, à qui M. Constance dit qu'il fallait aussi qu'il montât, que cela était de conséquence.
M. Constance me présenta au roi dans le temps qu'il allait à la chasse de l'éléphant. Ce prince me fit beaucoup de caresses. Après l'avoir salué, je m'en revins à Bangkok avec M. Desfarges, qui ne trouvant pas les travailleurs qu'il [507r°] avait demandés, me renvoya à M. Constance pour le prier de me donner des ouvriers, comme il lui avait promis ; ce qu'il ne fit, après beaucoup d'instances, qu'au bout de huit jours seulement et en fort petite quantité, et les uns après les autres, chacun quittant les travaux et ne revenant que quand la fantaisie leur prenait, ce qui obligea M. Desfarges de me renvoyer à M. Constance par plus de dix fois consécutives pour remédier à ce désordre et pour avoir des ouvriers pour construire des affûts pour nos canons ; ce qu'il fit enfin avec beaucoup de peine, et après m'avoir dit à toutes les fois que nous étions en sûreté de quelque manière que nous fussions.
Ce fut dans ce même temps qu'il envoya cent vaches à Bangkok (5), qu'il fit garder par des Siamois, me disant d'y avoir l'œil, et que pour me récompenser de mes soins, il voulait bien que je prisse quelques veaux et du lait quand j'en aurais besoin. Il me donna aussi du linge de table en petite quantité pour [507v°] distribuer aux officiers, et de la porcelaine pour eux et pour les soldats. M. Desfarges lui donna à dîner ce jour-là avec toute la magnificence et la pompe qu'il lui fut possible. M. Constance prit plaisir d'y faire boire à la santé de quantité de rois et de princes, commençant par celle du roi de France, et à toutes voulut que l'on fît des décharges de toute l'artillerie, et si proches les unes des autres qu'il y eut une pièce de canon qui en creva, pour des desseins apparemment autres que ceux qui paraissaient, comme de ce qu'il dit à M. Desfarges qu'il serait bon que ses officiers n'allassent pas à la chasse à cause des tigres, pour lui cacher des troupes qu'on avait fait mettre dans des bois près de Bangkok, que des officiers découvrirent quelques jours après son départ en chassant et n'osèrent le dire à M. Desfarges que dans le temps du siège, à cause qu'ils y étaient allés sans permission.
[508r°] Pendant ce temps-là, M. de Bruant sollicitait son départ pour Mergui. Il ne le put obtenir qu'un mois après celui des vaisseaux du roi (6). Quelques quinze jours avant le départ de M. Bruant, M. Constance demanda à M. Desfarges des soldats et des officiers pour mettre sur des vaisseaux siamois qu'on voulait envoyer contre des forbans ou pirates qui volaient les vaisseaux qui venaient de la Chine, lui assurant que ce serait un fort grand service qu'il rendrait au roi. M. Desfarges lui donna 34 hommes, un capitaine de la place nommé La Roche du Vigeay, un lieutenant et deux enseignes, le tout commandé par les sieurs de Sainte-Marie (7) et Suhart, qui montèrent chacun un vaisseau du roi de Siam. Sainte-Marie, à la sollicitation de tous les officiers de marine, avait été fait enseigne et demandé à M. Desfarges par M. Constance à la prière du père Tachard, jésuite, qui le protégeait. Ledit Sainte-Marie avait reçu deux ordres de M. Constance : l'un pour aller [508v°] contre les forbans, et l'autre pour aller brûler les vaisseaux de Madras, portant de plus de ne pas saluer les vaisseaux français s'ils en trouvaient, et que si c'était un amiral, de l'aller voir et de lui faire compliment. Il montra le premier à M. Desfarges et lui cela le second, que Des Rivières, capitaine d'infanterie a vu, et que Sainte-Marie lui a montré à son retour (8).
En même temps, le père de Bèze (9), jésuite, arriva à Bangkok avec un ordre du roi à M. Desfarges de me faire monter avec cent Siamois et quatre officiers (10). Aussitôt je partis. Je rencontrai, à quatre lieues de Bangkok, Sainte-Marie et Suhart qui descendaient (11). J'entrai dans le bord de Sainte-Marie qui me dit qu'il était bien en peine, ne comprenant pas d'où vient que M. Constance le faisait partir dans un temps que les saisons étaient contraires. Je le quittai ensuite et me rendis à Louvo où je ne trouvai pas M. Constance, qui était à [509r°] Thale Chubson (12) avec le roi. Le père de Béze, qui était avec moi, alla lui demander où il voulait que je misse les troupes. Il lui dit que je les menasse à Thale Chubson. Au bout de trois jours que j'y fus, M. Constance m'ordonna de me tenir prêt avec vingt hommes et un lieutenant pour aller avec lui visiter les mines. Quand nous y fûmes arrivés, nous y trouvâmes Véret, directeur de la Compagnie, qui y était depuis un mois pour voir combien chaque mine pouvait apporter de profit. Il me dit de poster sur le soir des sentinelles à toutes les avenues que je jugerais à propos. Comme cela me parut extraordinaire, j'entrai dans quelque soupçon, ce qui fut cause que le lendemain matin j'allai trouver M. Constance à qui je dis que, s'il y avait quelque chose à craindre dans le royaume, je le priais de se confier en moi. Il me répondit que mon soupçon était juste et qu'il croyait que les Siamois voulaient remuer. Nous achevâmes de visiter les mines, et puis nous nous [509v°] en retournâmes à Thale Chubson.
M. Constance, à notre arrivée, trouva des lettres de M. Desfarges par lesquelles il lui donnait avis qu'il avait fait arrêter un Grec et un Portugais qui avaient débauché cinquante soldats, tous les mieux faits, qu'il en avait été averti par l'un d'eux sur le point de s'embarquer, que tout le reste l'avait avoué, et eux-mêmes : que c'était le Grec qui les avait sollicités à le faire, leur disant que c'était pour aller au Moghol, et que le Portugais lui avait fourni la barque. M. Constance lui répondit que si la chose était telle, il fallait les faire pendre. On exécuta le Grec, qui ne croyait jamais mourir, disant toujours que M. Constance le tirerait de cette affaire (13). M. Constance trouva aussi des lettres de Sainte-Marie qui lui marquaient qu'il ne pouvait sortir de la rivière, à cause de la saison. Comme il vit qu'il lui en venait souvent portant la même chose, il écrivit à Sainte-Marie et à Suhart de sortir à quelque prix que ce fût et [510r°] de s'en aller où ils pourraient, de ne revenir que leurs ordres ne fussent finis qui étaient de six mois, et de venir mouiller entre les deux forteresses.
Le père de Bèze, par ordre de M. Constance, me dit que le roi de Siam voulait me faire colonel de ses gardes. Je lui répondis que j'étais fort obligé à Sa Majesté, qu'elle me faisait bien de l'honneur, mais que le roi mon maître m'avait donné un emploi dont j'étais content, que je ne pouvais quitter sans un ordre particulier de mon général. Le père de Bèze me réitéra ces mêmes offres et me conseillait avec tous ses amis de l'accepter, et qu'il se chargeait de l'événement. Je le refusai autant de fois qu'il m'en parla. Cependant M. Constance, qui voulait le faire, me pria un matin de m'aller promener avec lui. Je le fis ; il me mena dans un endroit où toutes les troupes étaient en bataille, entre Thale Chubson et Louvo, et me conduisant à la tête, il me fit recevoir colonel malgré moi. Je lui dis que je ne [510v°] pouvais pas recevoir cet honneur, et que je le priais de permettre de m'en retourner. M. Constance me dit qu'il répondait de tout, qu'il se chargeait d'en écrire au roi et que le roi de Siam lui-même me demanderait.
Je donnai avis à M. Desfarges de cette aventure, lui disant que je voulais m'en retourner, mais que je ne l'avais pas voulu faire sans avoir ses ordres. M. Desfarges me manda de rester, que j'étais nécessaire à la Cour pour le bien de la place afin de presser M. Constance d'envoyer tout ce qu'il y faudrait. Le roi, deux jours après, m'envoya des mandarins pour me dire si je voulais aller voir prendre un éléphant. Je partis avec les officiers que j'avais auprès de moi. Aussitôt que le roi sut que j'étais arrivé, il m'envoya M. Constance qui me dit de le suivre et que le roi me voulait parler. Je saluai Sa Majesté, qui me demanda le temps que je servais, dans quel régiment, si j'avais été blessé, dans quelle occasion, [511r°] où et combien de fois, si je me plaisais à Siam et ce que j'en pensais ? Comme je lui eus répondu à tout, il me dit que j'eusse bien soin de son régiment, et que j'apprisse à ses soldats à faire exactement l'exercice à la mode de France.
M. Constance m'envoya après à Bangkok pour porter des étoffes bleues pour faire de habits à une compagnie de cadets que le roi avait demandée pour sa garde, dont il avait nommé pour capitaine le fils aîné de M. Desfarges (14). C'est cette compagnie que M. Desfarges retenait le plus qu'il pouvait à Bangkok, et qu'il avait résolu de ne pas envoyer que Sainte-Marie et Suhart ne fussent de retour, afin de tirer de M. Constance une partie des choses dont on avait besoin, qu'il ne donnait qu'à force et dans l'espérance d'avoir de nous des services et de nous disperser. Quelque temps après qu'il eut envoyé ses étoffes pour faire des habits, il envoya des chevaux à qui on fit faire des écuries, et [511v°] tous les jours l'exercice (15).
Le roi s'en retourna, de Thale Chubson à Louvo au commencement d'avril, se sentant incommodé. M. Constance écrivit à M. Desfarges pour lui ordonner de la part du roi de monter, ce qu'il fit. Il trouva chez M. Constance les pères Le Blanc et de Bèze. Il lui dit que le roi voulait faire un de ses frères roi ; que Phetracha l'ayant appris, avait résolu avec Mon Pi, fils adoptif de Sa Majesté (16), de piller le palais, ne pouvant plus, si cela arrivait, demeurer dans le royaume, ayant donné, par ordre du roi, des coups de rotin à celui qu'on voulait mettre sur le trône (17). M. Desfarges dit à M. Constance que cette affaire méritait qu'on y fît réflexion ; que s'il jugeait à propos, il me la communiquerait. Il dit qu'il le voulait bien. Aussitôt il me vint trouver avec les père Le Blanc et de Bèze, qui me raconta ce que M. Constance leur venait de dire (18). Je répondis qu'il ne [512r°] fallait pas tant façonner ; que si M. Constance voulait me donner un ordre du roi d'arrêter Phetracha, je le livrerais à Sa Majesté ; que je répondais du succès de cette entreprise sur ma tête ; qu'il pouvait en assurer M. Constance, et qu'il devait me connaître pour être capable de faire ce que je promettais.
M. Desfarges et les pères jugèrent que cet expédient était le meilleur que l'on pouvait prendre et le seul nécessaire pour le temps. Aussi M. Desfarges l'alla-t-il dire aussitôt à M. Constance, qui rejeta fort loin la proposition et comme une chose à quoi il ne fallait pas penser. Le lendemain, je fus trouver moi-même M. Constance à qui je dis la même chose, le priant de m'employer à tout ce qu'il me croyait utile pour le salut de l'État. Il me fit la même réponse qu'il avait faite à M. Desfarges. Ce même jour-là, son fils le cadet mourut (19). M. Desfarges était sur le point de descendre, mais M. Constance lui dit qu'il ne pouvait partir sans voir le roi. Il le mena à l'audience, [512v°] et aussitôt après il s'en alla à Bangkok ; et comme M. Desfarges fut près de partir, M. Constance lui dit qu'il ne manquât pas de monter aussitôt qu'il serait arrivé, afin qu'il allât avec lui offrir ses services au frère du roi, qui était dans le palais de Siam, et qu'il allait incessamment faire faire des casernes de bambou pour loger ses soldats. Il est à remarquer que c'était dans un lieu fort écarté et qu'un seul homme aurait suffi pour y faire périr tous les soldats en y mettant le feu.
Quelques jours après, le père Duchatz (20), montant à Louvo, rencontra presque par tous les chemins des troupes en très grande quantité, ce qui était fort extraordinaire. Il crut qu'il serait bon d'en avertir M. Constance, aussi ne fut-il pas plutôt monté qu'il le vint trouver pour lui en rendre compte. J'étais dans sa chambre lorsqu'il arriva, et à peine eut-il fait le récit de ce qu'il venait de voir que M. Constance lui [513r°] dit en colère qu'il était un fou, un visionnaire, qu'il avait peur, et mille autres paroles aussi outrageantes.
M. Desfarges étant arrivé dans sa place, dit à M. de Vertesalle (21), qui commandait en son absence, qu'il allait monter avec 84 hommes, et lui donna tous les ordres nécessaires pour continuer les travaux. Comme il fut arrivé avec ses troupes devant la ville de Siam, tout le peuple s'écria que les Français allaient piller le palais (croyant que le roi était mort), ce qui fit que M. Desfarges s'arrêta et alla trouver Véret, directeur de la Compagnie, pour s'informer de lui ce que signifiait ce tumulte. Véret lui dit que M. Constance était un traître et un fourbe qui voulait tromper les Français et faire d'eux comme il avait fait quelque temps avant notre arrivée, des Anglais à Mergui (22). M. Desfarges n'ajoutant pas une extrême foi à ce que lui disait Véret, passa de l'autre côté de la rivière pour [513v°] voir M. l'évêque de Métellopolis et M. l'abbé de Lionne et savoir d'eux la vérité, qui lui dirent qu'il se donnât bien de garde de monter à Louvo, que tout était perdu s'il y montait, qu'ils savaient, il y avait longtemps, que M. Constance n'était plus bien dans l'esprit du roi et qu'il y avait un de leurs missionnaires, nommé M. Paumard, médecin du roi, qui ne partait point de la Cour et qui couchait dans une salle proche le roi, qui leur donnait des avis secrets de ce qui s'y faisait (23).
Nonobstant cela, M. Desfarges voulut persister à monter, mais les évêques le conjurèrent de n'en rien faire, lui assurant que s'il le faisait, tous les chrétiens étaient perdus et qu'il allait compromettre la gloire du roi (24). Quand il vit que ces messieurs s'opposaient si vivement à son dessein et qu'ils parlaient comme gens fort assurés, il demanda du papier pour écrire. Il manda à M. Constance, par un officier de ses troupes [514r°] appelé Le Roy, qu'il était arrivé à Siam avec 84 hommes, que le peuple criait partout que les Français allaient piller le palais, qu'il ne savait ce que cela voulait dire et qu'il le priait d'y descendre pour résoudre ce qu'il y aurait à faire. L'officier arriva sur les dix heures du soir à Louvo, donna sa lettre à M. Constance, qui après l'avoir lue, lui dit de s'en retourner, de dire à M. Desfarges de monter, qu'il n'y avait rien à craindre, et que le roi n'était point mort.
M. Desfarges ayant communiqué cette lettre aux évêques, ils le conjurèrent par les mêmes raisons qu'ils lui avaient déjà dites, de ne pas monter, ce qui l'obligea de réécrire une seconde lettre à M. Constance, qu'il envoya par le sieur Dacieux (25), capitaine, où il le priait de venir lui-même à Siam, qu'ils iraient ensemble offrir leurs services au frère du roi, qui était dans le palais ; cependant qu'il allait se retirer à la Tabanque (26) attendre ses ordres, et que s'il ne venait pas, il s'en retournerait avec ses troupes à Bangkok. Dacieux arriva à [514v°] quatre heures après minuit à Louvo, me vint trouver pour aller avec lui chez M. Constance, qui fit réponse qu'il ne pouvait pas descendre, qu'il n'y avait rien à craindre, et qu'il fallait que M. Desfarges montât. Ce fut sur ces difficultés de venir que M. Desfarges crut que ce que les évêques lui avaient dit de M. Constance était véritable, joint à ce qu'il n'avait pu envoyer le corps de son fils de Louvo à Siam pour l'enterrer, où les évêques, les prêtres et les moines s'étaient rendus par son ordre pour le recevoir et l'inhumer avec toute la pompe et l'honneur qui étaient dus au fils du premier ministre du royaume ; ce qui l'obligea de s'en retourner avec ses troupes dans sa place, où il ne fut pas plutôt arrivé qu'il fit continuer les ouvrages et distribua des officiers dans tous les travaux pour les presser et la mettre en état de se défendre, si on venait pour l'attaquer.
M. Desfarges fut fort surpris [515r°] d'apprendre à son retour que Vollant, ingénieur, s'amusait à faire des maisons de plaisance ; qu'il débauchait sous main des ouvriers de la place ; qu'il en avait tiré jusqu'à trente en un seul jour ; qu'il avait fait démolir en partie une très belle maison que les missionnaires lui avaient prêtée pour la rendre plus spacieuse, comme aussi il en avait fait bâtir une entière à un quart de lieue de celle-là sur le bord de la rivière, à quatre pavillons, avec une grand ménagerie, ce qui fut cause que les Siamois qui travaillaient à Bangkok se plaignirent de lui à M. Desfarges sur ce qu'il leur enlevait leurs travailleurs. Ce fut sur ces plaintes et sur ce que M. Desfarges s'aperçut qu'ils n'étaient plus si assidus aux travaux, qu'il lui dit qu'il ne prétendait pas qu'il quittât les travaux du roi pour bâtir des palais ; qu'il devait se ressouvenir que, manque d'application, les fortifications qu'il conduisait de la place ne valaient rien : que le batardeau [515v°] qu'il avait fait construire pour retenir l'eau dans les fossés s'était éboulé, en un mot qu'il voulait qu'il fît ce qu'il était obligé de faire ; que ce n'était pas ainsi qu'on gagnait l'argent du roi, et que s'il continuait il en écrirait à la Cour. Vollant lui répondit brusquement qu'il s'en souciait fort peu et qu'il en écrirait aussi. M. Desfarges, indigné d'une telle réponse, le mit lui-même en prison, où il ne demeura que deux heures, parce qu'il pria le sieur de la Salle, commissaire, de dire à M. Desfarges qu'il lui demandait pardon et qu'il tâcherait de le mieux contenter à l'avenir (27).
Comme M. Constance vit que M. Desfarges s'en était retourné, sur ce que lui-même n'avait pas voulu ou n'avait pu descendre comme il avait promis pour aller tous deux offrir leurs services aux frères du roi, il m'envoya à Bangkok pour demander la compagnie de cadets à M. Desfarges. Aussitôt que je fus arrivé et que j'eus [516r°] dit ce que M. Constance m'avait ordonné, M. Desfarges se plaignit à moi de la conduite de M. Constance, disant que c'était un fourbe qui voulait nous faire périr, qu'il n'en était que trop assuré, tant par ce qu'il en avait appris des évêques et de Véret que par toutes ses démarches qui marquaient qu'il avait dessein de disperser nos troupes, et la difficulté qu'il avait d'obtenir des travailleurs et des bois pour monter l'artillerie. Cependant, comme c'était un homme sans lequel on ne pouvait rien faire, qu'il fallait le ménager afin de mettre la place en état de se défendre et de ne pas périr comme des malheureux.
Je fus surpris d'apprendre de si fâcheuses choses, et comme le soupçon fait réfléchir, je trouvai, par bien des démarches que M. Constance avait faites et qu'il m'avait fait faire, que M. Desfarges était parfaitement bien informé. Ce fut à cette occasion que je lui dis que je ne retournerais pas à Louvo, afin de contribuer de mettre plus tôt la [516v°] place en état. Cependant, M. Desfarges m'ordonna de monter et d'aller dire à M. Constance qu'il lui enverrait la compagnie des cadets dès que Sainte-Marie serait de retour, qu'il était nécessaire qu'on l'exerçât encore du temps, pour la mettre en état de donner au roi le plaisir qu'il en attendait ; que les chevaux n'avaient point de bouche (28), et que les hommes qui les devaient monter ne pouvaient pas encore les bien gouverner. M. Constance, qui ne trouva pas cette réponse à son goût et qui voulait venir à bout de son dessein, crut que le père Le Royer, supérieur des jésuites, aurait plus de pouvoir sur l'esprit de M. Desfarges. C'est pourquoi il le lui envoya avec des ordres extrêmement pressants, qui ne produisirent rien davantage, le père Le Royer lui rapportant seulement, pour raison de ce qu'il venait seul, les mêmes que je lui avais dites (29).
M. Constance, ne pouvant s'empêcher de témoigner son ressentiment, dit, avec les [517r°] démonstrations d'un homme furieux, qu'il savait que c'étaient les évêques qui étaient cause de cela, mais qu'ils s'en repentiraient, et se tournant de mon côté : — Monsieur, me dit-il, que feriez-vous, si vous étiez en ma place, à des ingrats, à des gens à qui j'ai fait bâtir des églises, que j'ai introduits dans le royaume, que j'ai protégés, à qui j'ai fait tout le bien qu'ils y ont, et qui s'opposent à mes desseins ?. Je lui répondis qu'il ne fallait pas croire aux rapports qu'il pouvait avoir des ennemis, et que peut-être ils n'avaient aucune part à ce qui lui faisait de la peine. Il me dit qu'il était sûr de ce qu'il disait et qu'ils s'en repentiraient.
Je sortis et m'en allai chez les pères jésuites, que je trouvai dans leur salle prenant du thé et qui me demandèrent pourquoi M. Desfarges n'avait pas monté à Louvo. Je leur répondis que je n'en savais pas les raisons. Ils dirent qu'ils devrait pourtant bien être monté. Le père Saint-Martin (30), confesseur de M. Constance, [517v°] dit que M. Desfarges était bon et sage, qu'il savait bien ce qu'il faisait, à quoi tous répondirent, comme en colère, méprisant la réponse du Père Saint-Martin, qu'il devrait bien monter à Louvo. Le père Saint-Martin leur répliqua avec émotion qu'il en savait plus qu'eux, puisqu'il était son confesseur. Cette chaleur de ces pères, et surtout du dernier, me fit croire que le soupçon qu'on avait de M. Constance était véritable, qu'il fallait même qu'il ne fût pas si bien dans l'esprit du roi qu'il avait été. Je voulus par moi-même en avoir quelques preuves. Je parlai pour cet effet à un valet de chambre de M. Constance, un des deux que M. le chevalier de Chaumont lui avait donnés (31), sur ce que son maître me paraissait quelquefois triste. Il me dit qu'il savait que depuis plus de deux mois M. et Mme Constance ne faisaient que pleurer. Le lendemain, étant à table avec lui, dans un moment où il était dans une profonde rêverie, je lui dis qu'il me paraissait triste, que [518r°] je le priais de m'en apprendre la cause s'il croyait que je pusse lui être utile. Il me répondit que le sujet de son chagrin était que le roi prenait trop de remèdes, que cela le rendait plus malade et qu'il se mettait en colère contre lui lorsqu'il voulait lui en parler.
M. Constance, quelques jours après, écrivit à M. l'évêque de Métellopolis (32) pour le prier de monter afin de voir ensemble le lieu qu'il croyait le plus propre pour bâtir une église ; que le roi lui en avait donné la permission, et qu'il n'y avait point de temps à perdre.
M. de Métellopolis, qui savait le contraire, comme lui-même me l'a dit par le moyen de M. de Paumard, missionnaire (33), qui était toujours auprès du roi, et le seul en qui il avait sa confiance pour ses remèdes, envoya M. Ferreux, missionnaire (34), dire à M. Constance qu'il lui était fort obligé de la bonté qu'il avait pour lui et pour tous les chrétiens du royaume, qu'il le priait de l'excuser de ce qu'il ne [518v°] se rendait pas à ses ordres, qu'il lui était survenu une incommodité qui ne lui permettait pas de sortir de sa chambre sans danger. Je me trouvai chez M. Constance lorsque M. Ferreux arriva. M. Constance voyant que M. l'évêque ne venait pas, comme il avait espéré, se mit en colère contre lui, disant mille choses offensantes, lui reprochant qu'il ne portait pas le respect qu'il devait au roi, puisqu'il avait osé excommunier un Portugais (qui était un homme d'une abominable conduite) sans en avertir Sa Majesté, qui était maître dans son royaume, et où on ne devait rien faire sans sa permission.
Il m'entretint ensuite environ un quart d'heure sur la bonne volonté que le roi avait pour moi et sur la reconnaissance qu'il aurait de tous mes soins, que dans peu il m'en donnerait quelque marque. En effet, deux jours après, le roi m'envoya mille écus par des mandarins. M. Constance, [519r°] qui ne voyait plus le roi que difficilement, quoique tous les jours il allât au palais, pour me dissuader de l'opinion qu'on avait qu'il était mort, me mena avec lui, et dans le temps que Sa Majesté passait pour aller voir ses éléphants, il me présenta à elle pour la remercier des mille écus qu'elle m'avait fait donner. Ce prince était dans une chaise que quatre hommes portaient sur leurs épaules, accompagné de Phetracha. M. Constance se servit de cette occasion pour lui parler d'une éclipse de soleil qui devait arriver dans quelques jours et pour lui demander si sa santé lui pouvait permettre de la voir, que les père jésuites lui donneraient ce plaisir (35). Il lui dit que oui et qu'il les amenât dans le temps que devait arriver l'éclipse. M. Constance conduisit les pères jésuites au palais, qui y dressèrent leurs lunettes devant le roi, qui ne fut au plus qu'une petite demi-heure avec eux, à cause que le temps ne se trouva pas aussi propre qu'on l'aurait souhaité.
[519v°] Depuis cette éclipse, M. Constance ne vit plus le roi, quoiqu'il allât tous les jours à son ordinaire au palais. C'est pourquoi cherchant tous les moyens de se rendre nécessaire, il pria M. Paumard, qui était, comme j'ai dit, le médecin du roi, d'introduire le père de Bèze, jésuite, à la Cour, en disant à Sa Majesté que c'était une personne fort habile dans la médecine qui pouvait, par le moyen de ses remèdes, contribuer au rétablissement de sa santé. M. Paumard lui dit qu'il le voulait bien et le fit comme il lui avait promis, mais le roi n'a jamais voulu voir le père De Béze, et encore moins se servir de ses remèdes (36).
M. Constance, qui commençait à tout craindre et qui voyait que, quelque chose qu'il fît, il ne pouvait parvenir à voir le roi, voyant de plus que les soldats de la garde du palais faisaient tous les soirs tous leurs efforts pour parler à ceux que j'avais amenés de [520r°] Bangkok, qui étaient dans un corps de garde proche d'eux, jugea qu'il y avait quelque chose de mauvais pour lui, ce qui l'obligea de me dire d'ordonner aux officiers français de défendre à leurs soldats de parler aux autres, et afin que cela se fît plus aisément, il distribua lui-même à tous leurs soldats de l'argent, enjoignant aux officiers d'y tenir la main. Ce qui était de particulier, c'est que dans ce temps, par toutes les villes, bourgs et villages du royaume, tous les hommes s'exerçaient avec des bâtons et des boucliers, marque que l'on tramait quelque chose dans l'État ; mais ce qui en donna une assurance entière, ce fut les troupes que Mon Pi, fils adoptif du roi et qui ne l'abandonnait jamais, fit lever à l'insu de Sa Majesté (37), de quoi elle fut avertie par Phetracha, pour lors son favori. Le roi aussitôt le dit à Mon Pi, qui se jeta à ses pieds, lui demandant pardon de sa faute, apportant pour excuse que c'était par le conseil de son père et pour se [520v°] mettre en état de résister à ses ennemis en cas qu'il arrivât faute de Sa Majesté. Le roi se contenta de cet aveu, lui pardonna et lui dit seulement de ne plus tomber dans une semblable faute. Ces troupes à l'instant se dispersèrent et ne parurent plus depuis.
Depuis ce temps jusqu'au 18 de mai, je ne bougeai de Louvo, étant toujours avec M. Constance qui affectait de ne parler que de choses qui n'avaient aucun rapport à nos affaires. Le même jour je dînai avec lui. Il me parla moins qu'il n'avait jamais fait. À la sortie de table, il s'alla coucher sur son lit et moi sur le mien, suivant la coutume du pays, où deux heures après, c'est-à-dire sur les 3 à 4 heures du soir, il m'envoya quérir. Comme j'entrais dans sa chambre, il s'en vint au-devant de moi, me disant, en présence du père de Bèze, jésuite : — Monsieur le major, il y a bien des affaires : le roi [521r°] veut faire arrêter Phetracha. Je lui dis que s'il n'était pas bien sûr de cela et qu'il y eût quelque chose à craindre, il souffrît que nous nous retirassions chez lui, que sa maison était forte, que j'y ferais venir nos Français et qu'avec sa compagnie anglaise nous nous mettrions en état de résister à nos ennemis. Il me dit que non, mais qu'il fallait (répétant qu'il fallait par trois ou quatre fois, comme un homme interdit et qui cherche une réponse à faire) que j'allasse faire prendre les armes aux Siamois que j'avais amenés de Bangkok, sans que l'on s'aperçût de rien.
Je lui dis que je les leur ferai prendre pour faire l'exercice comme à l'ordinaire. Comme je m'en allais sortir, le père de Bèze lui demanda s'il n'irait pas au palais : — Je m'en donnerai bien de garde, lui répondit-il. Aussitôt je me rendis aux troupes à qui je fis prendre les armes, et à peine les eus-je fait mettre en haie, j'aperçus M. Constance qui s'en allait seul au palais. J'allai au-devant [521v°] de lui. Je lui demandai où il allait. Il me dit : — Au palais, et venez avec moi. MM. les chevaliers Desfarges et de Fretteville qui s'en allaient à la chasse, étant l'un et l'autre bien armés, m'abordèrent en me disant où j'allais. Je leur dis : — Au palais avec M. Constance. Il l'allèrent aborder, le saluèrent et lui demandèrent s'il voulait qu'ils l'accompagnassent. Il leur dit que oui, et qu'ils laissassent leurs armes au corps de garde, ce qu'ils firent, à la réserve des pistolets de poche qu'ils ne purent pas avoir le temps de quitter.
Nous entrâmes dans le palais, et comme je fus à vingt pas en dedans, je dis à M. Constance : — Pourquoi, Monsieur, n'avez pas voulu me donner l'ordre d'arrêter Phetracha ? Il me dit : — Ne parlons point de cela. Aussitôt nous aperçûmes Phetracha à la tête de plus de 2 000 hommes (38), entouré de tous les officiers du palais, qui vint à nous, et nous ayant abordés, prit par la manche M. Constance, lui disant : — Ah ! le voici, et aussitôt [522r°] dit à un mandarin de lui couper le col. M. Constance, à demi-mort, se tourna du côté de Phetracha en posture de suppliant, à qui il parla à l'oreille. En même temps, six personnes me prirent sans beaucoup me presser, et le fils de Phetracha [toucha] le bout de mon épée (39). Aussitôt je mis les deux mains sur la garde, afin d'en être toujours maître, en regardant fixement M. Constance pour, au moindre signe qu'il m'aurait fait, la passer au travers du corps de Phetracha, croyant que c'était la volonté du roi de s'en défaire, comme il me l'avait dit. M. Constance, tournant la tête de mon côté, me dit d'une voix tremblante : — Seigneur major, rendez à Phetracha votre épée. Je la tirai, et comme je la tenais par le milieu pour la donner à Phetracha, son fils, qui était derrière moi, la prit par la garde. Je me tournai brusquement, et comme j'eus vu qui c'était je la laissai aller.
Les chevaliers Desfarges et de Fretteville, qui nous suivaient, furent [522v°] désarmés et arrêtés à quelques vingt pas avant dans le palais. Comme je fus désarmé, ils me menèrent avec les chevaliers Desfarges et De Fretteville dans une salle du palais sous la garde du second ambassadeur (40) et de cinquante Siamois, ayant tous leurs sabres nus. Phetracha prit par le bras M. Constance, lui fit quitter ses souliers et son chapeau et le promena ainsi tout autour du palais pour le montrer au peuple qui s'y était rendu en foule. Après, on l'amena dans la salle où nous étions. À peine y fut-il entré qu'il me dit en m'abordant : — Seigneur major, je suis bien fâché de vous voir ici. Je lui répondis : — Votre Excellence l'a bien voulu, car si vous m'aviez cru, ni vous ni moi n'y serions pas. Phetracha, voyant que nous nous parlions, le vint prendre et l'emmena. On le chargea de fers, on lui mit la cangue au col et on lui brûla la plante des pieds. Ensuite Phetracha s'en alla dans l'antichambre du roi, y fit [523r°] prendre Mon Pi, et là le fit couper en trois en sa présence (41). La princesse reine, la fille du roi, qui était dans le palais lorsque tout cela se faisait, disait tout haut qu'il fallait exterminer tous les chrétiens qui étaient dans le royaume. En effet, on se saisit de tous que l'on chargea de fers. M. de Métellopolis n'en fut pas même exempt. Il n'y eut que les bons pères jésuites qui eurent la liberté et la permission de voir ces pauvres captifs, qu'ils soulagèrent autant qu'ils purent.
Le lendemain de ma détention, l'on me transféra avec les chevaliers Desfarges et De Fretteville à Thale Chubson, où je trouvai les trois officiers que j'avais amenés avec moi de Bangkok (42), qui m'apprirent que leurs soldats sur les huit heures du soir les avaient abandonnés. On avait aussi mis en prison les gardes de M. Constance et leur capitaine, à qui je demandai pourquoi il n'avait pas suivi son maître. Il me répondit qu'il ne lui avait pas dit (43).
Nous demeurâmes là quatre jours sans qu'on nous [523v°] donnât quoi que ce soit à manger, au bout desquels Phetracha me fit venir avec les officiers qui étaient avec moi à Louvo, où il nous fit traiter magnifiquement. Comme je m'étais plaint qu'on nous avait pillés et qu'on m'avait pris à moi seul pour plus de cent pistoles d'argent et de nippes, Phetracha, qui ne parlait jamais que de la part du roi, nous fit apporter par dix grands mandarins, dans le lieu où nous étions, tous les plus précieux habits qui se trouvèrent chez M. Constance, avec toutes sortes d'autres belles hardes, jusqu'à des pistolets et des épées que l'on étala devant nous. Les mandarins nous dirent que, ne pouvant pas nous rendre les mêmes choses qu'on nous avait prises, le roi leur avait ordonné de nous dire que nous pourrions nous accommoder de ce qu'il nous conviendrait et de nous récompenser par cet échange de nos pertes. Je dis que nous ne le pouvions faire, que les Français comme nous ne portaient jamais les habits des autres et encore moins [524r°] d'un homme qui avait été notre ami. Ils me répondirent que si les Français n'avaient pas cette coutume, c'était celles des Indes de ne refuser rien de ce qui était donné par un roi. Je répliquai que j'estimais fort les présents des rois, mais que si j'étais assez lâche d'en prendre de semblables, je serais indigne de vivre, et que le roi mon maître, à mon arrivée, ne manquerait pas de m'en faire punir. Aussi je n'y pris rien, ni les officiers qui étaient avec moi. Ce qui fut cause qu'on remporta tout ce qu'on avait apporté.

NOTES :
1 - Le destinataire de la lettre n'est pas nommé. Monseigneur indique qu'il s'agit d'un personnage haut placé, très certainement le marquis de Seignelay, ministre de la marine. ⇑
2 - Les deux navires le Coche et la Normande étaient partis de Pondichéry le 16 février 1689, pour porter en France des nouvelles du coup d'État de Phetracha et pour rapatrier les rescapés de l'aventure. Ignorant que la guerre avait éclaté entre la France et les Provinces-Unies, les navires et leurs équipages furent capturés lors de leur escale au cap de Bonne-Espérance, la Normande, sur laquelle se trouvait Beauchamp, le 27 avril, et le Coche, qui avait rencontré des vents contraires, le 4 mai. Le 1er juillet, les prisonniers furent transférés à Middelbourg, en Hollande, où il arrivèrent à la fin octobre 1689. Ils furent ensuite renvoyés en France en ordre dispersé, à la faveur d'échanges de prisonniers, entre novembre 1689 et janvier 1690. C'est pendant leur séjour dans les geôles hollandaises que plusieurs officiers rédigèrent des lettres et des relations qui apportent de précieux témoignages sur les événements dont ils ont été témoins ou acteur. On pourra lire sur ce site celles de Vollant des Verquains du 17 novembre 1689 et de Beauchamp, toutes deux datées du 17 novembre 1689, et celle de Saint-Vandrille en date 30 décembre 1689. ⇑
3 - Céberet avait quitté Lopburi pour se rendre à Mergui dès le 13 décembre 1687, et La Loubère s'était embarqué le 3 janvier 1688 pour retourner en France où il arriva le 25 juillet. ⇑
4 - Jean Vollant des Verquains, ou des Werquains, était l'un des fils de Simon des Verquains, architecte qui collabora, sous la direction de Vauban, à l'édification de la Porte de Paris à Lille. Envoyé au Siam avec la double fonction de capitaine d'une compagnie et d'ingénieur en chef, il laissa une Histoire de la révolution de Siam arrivée en l’année 1688 publiée à Lille en 1691. On pourra consulter sur ce site la page qui lui est consacrée : Vollant des Verquains. ⇑
5 - Le père Le Blanc (op. cit., I, p. 104) et la Relation de ce qui s'est passé à Louvo, royaume de Siam (Archives Nationales, Col. C1/24, f° 144r°) indiquent 200 vaches. Vollant des Verquains, pour sa part, évoque entre 80 et 100 vaches et précise qu'on ne pouvait pas les tuer, faute de sel pour les conserver. (Histoire de la révolution de Siam, 1691, pp. 80-81). ⇑
6 - Du Bruant quitta Bangkok pour aller prendre possession de Mergui avec trois compagnies de 40 hommes chacune à la mi-février 1688. Il arriva à Mergui le 17 mars (Relation de La Touche, f° 13r°) ⇑
7 - Sainte-Marie était le nom de guerre de l'officier Delars (ou De Larre), qui s'embarqua pour le Siam afin de fuir la France où il se trouvait dans une situation délicate. Un Mémoire des choses qui ont été rapportées par François Walch, pilote sur le vaisseau la Normande venu de Zélande (BN Ms. Fr. 15476, f° 124v°) comporte cette annotation en marge : Le sieur Delars a été autrefois lieutenant de vaisseau, et qu'ayant eu de mauvaises affaires en France, il s'était embarqué sergent d'une des compagnies envoyées à Siam, où il avait été fait capitaine de vaisseau par M. Constance. L'affaire devait être particulièrement sérieuse, car Sainte-Marie, qui revenait en France sur la Normande, se mit au service des Hollandais lorsque le navire fut capturé au cap de Bonne-Espérance, ainsi que l'indique une seconde annotation sur le document précité : Le sieur Delars, que M. Desfarges envoie en France sur la Normande, est demeuré au cap de Bonne-Espérance, dans le dessein d'aller servir les Hollandais à Batavia, pour éviter les suites des mauvaises affaires qu'il avait en France avant d'aller à Siam. De fait, fin janvier ou début février 1690, deux jésuites, les pères de Bèze et Comilh, faits prisonniers à Malacca alors qu'ils tentaient de se rendre en Chine, eurent l'occasion de s'entretenir avec Sainte-Marie qui servait alors sur un navire de la Compagnie hollandaise, le Carocom (le Castricum ?). (Lettre contenant plusieurs nouvelles des Indes, Mercure Galant de janvier 1691, pp. 123-124). ⇑
8 - Dans une lettre écrite à la prison de Middelbourg le 17 novembre 1689, adressée à un destinataire inconnu, Beauchamp donne d'autres précisions : M. Desfarges vit l'ordre que ces deux officiers lui montrèrent qui était d'aller après ces forbans, et un autre ordre que mon dit sieur Constance avait donné pour aller brûler les vaisseaux anglais qui seraient en rade de la ville de Madras, côte de Coromandel. Les sieurs de Sainte-Marie et Suhart écrivirent à M. de Constance que cela ne se pouvait, la saison étant contraire. M. Constance leur écrivit de sortir et qu'ils tinssent la mer et d'aller où ils voudraient et de ne revenir que dans quatre mois (AN. Col. C1/25 f° 73v°). ⇑
9 - Claude de Bèze (?-1695) était l'un des quatorze jésuites mathématiciens que Louis XIV envoyait au roi Naraï. Ses connaissances médicales, réelles ou supposées, lui permirent d'approcher de près le roi Naraï et Phaulkon et d'avoir accès à nombre d'informations : M. Constance, m'ayant fait passer pour un habile médecin, m'introduisit auprès de ce prince qui me témoigna beaucoup de bonté et dit qu'il me voulait voir tous les jours et qu'il souhaitait pour cela que je prisse un appartement dans le palais et que je ne mangeasse pas ailleurs qu'à la table qu'il m'y ferait servir. (Drans et Bernard, Mémoires du père de Bèze sur la vie de Constance Phaulkon, 1947, p. 95). ⇑
10 - Beauchamp n'explique les raisons de cet ordre. On les trouve dans la lettre de Véret du 3 mars 1689 : Étant à Louvo où je faisais le courtisan comme les autres, il arriva du bruit une nuit qui était à la pleine lune de février [16 février], ce qui me donna beaucoup d'émotion, m'empêcha de dormir et me fit mettre mes armes en état à deux heures après minuit. Le roi était à Thale Chupson et M. Constance. Le lendemain matin, je fus voir les révérends pères qui, par bonheur, avaient eu peur aussi, ayant donc raisonné la-dessus avec eux, je leur promis d'aller dîner avec M. Constance et de m'informer de ce que cela voulait dire. Y ayant été et l'ayant demandé à M. Constance, il me dit que ce n'était que des badineries et qu'il n'y avait rien à craindre, néanmoins, je connus bien à la mine de mon homme qu'il n'était pas plus assuré que moi, quoiqu'il fît la meilleure contenance qu'il pouvait. Le peu de troupes qu'avait le roi de Siam faisait incessamment l'exercice, et continuellement on tirait du canon pour dresser grand nombre de canonniers. Ce qui me faisait encore plus de peine, c'est que nous étions assez simples pour leur enseigner nous-mêmes le métier de nous égorger avec plus de facilité. M. Constance, ne sachant plus où donner de la tête, envoya pour ce sujet le père de Bèze à Bangkok chercher trois compagnies de Siamois qui étaient commandés par des officiers français. (Robert Lingat, Une lettre de Véret sur la révolution siamoise, T'oung Pao XXXI, 1934, pp. 345-346). ⇑
11 - L'Abrégé de ce qui s'est passé à Bangkok […] (AN. Col. C1/24, f° 140r°-171v°) indique que Sainte-Marie et Suhart mirent à la voile le 1er mars 1688 et fixe le départ de Beauchamp au 23 février : Le 23, [février 1688] il partit deux compagnies siamoises pour Louvo, commandées par M. de Beauchamp, major de la place, le lieutenant de Saint-Vandrille et les enseignes Des Targes et De Lasse. (f° 151r°). Dans sa lettre du 17 novembre 1689 écrite de la prison de Middelbourg, Beauchamp écrit : M. Constance envoya un ordre à M. Desfarges de la part du roi de m'envoyer à Siam incessamment avec cent Siamois et les officiers français qui les commandaient. Suivant cet ordre, M. Desfarges me fit partir avec le père de Bèze, jésuite, qui était le porteur de l'ordre. Tout cela est arrivé dans le 15ème du mois de février. Je trouvai en y allant les sieurs Sainte-Marie et Suhart qui s'en allaient en mer (AN. C1/25 f° 73v°-74r°). ⇑
12 - Beauchamp orthographie Tripson. Thale Chubson (ทะเลชุบศร), île au milieu d'un ancien lac à trois kilomètres de Lopburi, où le roi Naraï avait fait construire une résidence, le pavillon Kraisorn-Sriharaj (ตำหนักไกรสรสีหราช). On peut penser que la fraîcheur de l'eau rendait cette retraite agréable pendant les mois chauds. Elle était également connue sous le nom de Pratinang yen (พระตี่นั่งเย็น), la Résidence fraîche. Elle servait au roi Naraï pour les réceptions et pour séjourner lors de ses parties de chasse ou de ses promenades en forêt.
 Le pavillon Kraisorn-Sriharaj.
Le pavillon Kraisorn-Sriharaj.
 Les vestiges du système d'irrigation de Thale Chubson, peut-être dû à l'ingénieur La Mare. ⇑
Les vestiges du système d'irrigation de Thale Chubson, peut-être dû à l'ingénieur La Mare. ⇑
13 - Le père Le Blanc mentionne également cette affaire (Histoire de la révolution du royaume de Siam, 1692, II, pp. 273-274) : Les Siamois n'étaient pas les seuls qui désertaient. Douze Français, soldats de la garnison, [de Mergui] s'enfuirent dans une chaloupe à l'insu des officiers. C'était un complot fait de longue main avec une troupe d'autres soldats de Bangkok. Ces Français, déjà ennuyés du séjour des Indes, voulaient passer au Moghol par l'espérance que l'inquiétude naturelle donne toujours d'être mieux ailleurs que là où l'on est. Ils s'étaient déjà assurés d'un mirou au mois d'avril, pour s'aller joindre aux déserteurs de Mergui. Un Provençal établi dans le même royaume, et qui se disait grec, les devait conduire. M. Constance le fit pendre dans Bangkok et laissa à M. le général le soin de punir ses soldats. ⇑
14 - Soixante cadets destinés à sa garde particulière avaient été demandés par le roi Naraï en vertu du traité signé par La Loubère quelques semaines auparavant. Desfarges, dont les troupes ne suffisaient plus à assurer la défense de Bangkok, négocia leur nombre à vingt-cinq et différa leur envoi, prétextant qu'ils ne savaient pas monter à cheval et qu'il était nécessaire de les entraîner avant de les présenter au roi. L’officier choisi pour les commander, avec 2 000 écus d’appointements, était un des fils de Desfarges (Drans et Bernard, 1947, p. 93). Sur un plan juridique, le général était bien fondé dans son refus d’envoyer ses soldats, puisque l’article 2 du même traité stipulait que le roi de Siam ne pourra demander au général des troupes françaises et aux commandants des places que le nombre qui lui pourrait être fourni sans trop affaiblir la garnison qui demeurera toujours aussi forte que lesdits commandants l'estimeront nécessaire pour la sûreté de la place (Reinach, Recueil des traités conclus par la France en Extrême-orient, 1902, p. 6). ⇑
15 - L'Abrégé de ce qui s'est passé à Bangkok […] indique : Les premiers jours de mars, il arriva ici vingt-six chevaux qui étaient pour monter les vingt-quatre cadets et l'officier qui les commandait pour être gardes du roi de Siam. (Op. cit. f° 151r°). ⇑
16 - Phra Pi (พระปีย์), ou Mom Pi (หม่อมปี), fils d'un hobereau de la région de Phitsanulok, recueilli très jeune en tant que page au palais et considéré comme le fils adoptif du roi Naraï. ⇑
17 - Le demi-frère cadet du roi, Chaofa Noï (เจ้าฟ้าน้อย) avait été sévèrement fouetté pour avoir entretenu une liaison avec une concubine du monarque. Le châtiment fut si sévère que tout le corps enfla à ce jeune prince, qui en est demeuré paralytique et muet le reste de sa vie. (Le Blanc, op. cit., I, p. 42). ⇑
18 - Cette réunion, dont le but était de faire monter des troupes françaises à Louvo pour se rendre maître de Phetracha et éteindre dans l'œuf la conspiration, se tint dans les premiers jours du mois de mars 1688. Le père Le Blanc la relatait ainsi : M. Constance crut qu'il était nécessaire de communiquer à M. Desfarges l'affaire dont il s'agissait, mais pour lui laisser tout le loisir de faire réflexion sur ce qu'il avait à lui proposer et une liberté entière de prendre son parti, il ne voulut pas lui en faire l'ouverture lui-même ; il lui envoya deux jésuites, dont j'étais l'un, parce qu'il savait que le général avait quelque confiance en nous. Nous ne pûmes nous dispenser de cette commission, parce que l'affaire regardait les intérêts de la religion, le service du roi et le salut de toute la nation française dans ce royaume. Nous allâmes trouver M. Desfarges en son logis, et nous nous enfermâmes dans sa chambre avec lui et le sieur de Beauchamp, major de Bangkok. (Op. cit., I, pp. 67-68). ⇑
19 - Le père de Bèze situe la mort de ce fils, prénommé Jean (João ou Juan) et âgé d'environ 4 ans, au début de janvier 1688, après le départ de La Loubère : Ce ministre perdit en ce temps le second de ses enfants qu'on nommait Signor Juan. Il apprit sa maladie dans le temps que nous retournions de l'embouchure de la rivière et cela lui fit hâter son retour. Il n'arriva quasi que pour voir expirer ce petit innocent qui semblait n'attendre que son père pour mourir entre ses bras. (Drans et Bernard, p. 91). Dans sa lettre écrite de la prison de Middelbourg le 17 novembre 1689, Beauchamp se contredit et indique que la mort de cet enfant eut lieu en mars (f° 74v°). Wikipédia, sans indiquer la source, date la mort du fils de Phaulkon le 11 mai 1688, ce qui est très improbable. ⇑
20 - Beauchamp épelle Du Chapt. Jacques Duchatz (1652-1693) était l'un des 14 jésuites mathématiciens astronomes envoyés par Louis XIV au roi de Siam. ⇑
21 - Vertesalle était le troisième officier dans la hiérarchie, après Desfarges et Du Bruant. Ce dernier étant à Mergui, c'est à Vertesalle qu'incombait de prendre le commandement de la garnison de Bangkok en l'absence de Desfarges. François Martin le présentait ainsi : M. de Vertesalle savait bien la guerre, il était fort attaché à en faire observer tous les règlements, mais entêté dans ses sentiments et qui ne revenait pas aisément ; il dépensait à sa table les appointements qu’il avait du roi ou les officiers étaient bien reçus et il en était aimé. Il est le seul des officiers qui n’a pas quitté Bankok où il resta toujours dans l’exercice de sa charge ; il n’était pas aimé de M. Constance qui crut qu’il y avait de la fierté ou du mépris de sa part de ce qu’il n’était pas monté à Siam pour le saluer, quoique ce ne fût qu’une application à remplir les devoirs de sa charge. Il avait eu du bruit aussi avec des officiers de marine et l’on dit qu'on avait écrit en France contre lui. (Mémoires de François Martin, fondateur de Pondichéry, 1932, II, p. 520). ⇑
22 - Dans la nuit du 14 juillet 1687, suite à une longue montée des tensions entre le Siam et l'East India Company, une centaine d'Anglais furent massacrés à Mergui par les Siamois. ⇑
23 - La plupart des historiens considèrent que les avis pressants de Véret et des missionnaires pour inciter Desfarges à ne pas intervenir alors qu'il en était peut-être encore temps marquèrent un tournant décisif dans le cours des événements et entraînèrent les désastres qui allaient suivre. La question était de savoir précisément si les forces siamoises étaient alors suffisamment nombreuses et organisées pour mettre en déroute les troupes de Desfarges. Entre ceux qui n'ont vu aucun signe alarmant dans des campagnes paisibles et ceux qui ont affirmé que le royaume entier était en ébullition et sous les armes, il est bien difficile de dégager la vérité. Dans une lettre du 3 mars 1689 adressée à Deslandes, Véret se montre formel : J'ai déjà dit qu'on faisait par tout le royaume des lances et de sagaies, ce que nous savions si bien que nous avions appris qu'on en faisait même dans Bangkok au lieu de travailler aux affûts de canon que nos charpentiers faisaient, le bruit courant déjà que l'on voulait massacrer tous les Français et les autres chrétiens. (Une lettre de Véret sur la révolution siamoise de 1688, op. cit., p. 349). Analyse partagée par l'abbé de Lionne : Il était encore certain que tout le royaume était en armes ; tous les jours on voyait monter à Louvo des gens armés ; tout le chemin de Siam à Louvo en était plein. Il n'y avait pas jusqu'à la plus vile populace et jusqu'aux rameurs de balon, qui ne portassent des armes, chose inouïe dans le royaume, si ce n'est dans un temps de révolte ou de trouble extraordinaire ; enfin, il était constant qu'on répandait dans le royaume des bruits désavantageux contre les Français pour les rendre plus odieux. On les accusait publiquement de vouloir envahir le royaume, ce qui se confirmait, parce que, dès que M. Desfarges avait paru près de Siam, les femmes qui tenaient le marché près de la ville et tout le peuple avaient pris l'alarme, et s'étaient enfui comme à la vue d'un ennemi déclaré ; enfin l'on avait redoublé les gardes pour empêcher, disait-on, que les Français ne pillassent le palais de Siam. (Mémoire sur une affaire sur laquelle on m'a demandé quelques éclaircissements, cité par Launay, Histoire de la Mission de Siam, I, 1920, p. 212). ⇑
24 - L'abbé de Lionne fut vivement critiqué à son retour en France, ainsi qu'en témoigne une lettre de Laurent de Brisacier, directeur du séminaire des Missions Étrangères, en date du 11 février 1692 (cité par Launay, Histoire de la Mission de Siam, I, 1920, p. 208) : Il y a une chose qui me fait beaucoup souffrir, et dont je vous supplie de faire le sacrifice avec moi : c'est que le père Verjus publie partout à ceux qui veulent l'entendre, même à nos meilleurs amis (témoin Mgr de Laon qui me le disait chez nous il y a aujourd'hui huit jours), que c'est vous qui, par le conseil que vous avez donné à M. Desfarges, avez été cause de la mort de M. Constance, du malheur des Français et du renversement des affaires de la religion à Siam. Pour se justifier, l'abbé écrira un long et peu convaincant Mémoire sur une affaire sur laquelle on m'a demandé quelques éclaircissements. ⇑
25 - On trouve plus souvent d'Assieu, ou d'Assieux. ⇑
26 - La Tabangue, ou Tabanque était une sorte d'octroi, de poste douanier sur la route d'Ayutthaya. ⇑
27 - On peut imaginer la joie féroce de Beauchamp, qui détestait Vollant des Verquains, à livrer au public ces savoureuses révélations. C'était au demeurant un juste retour des choses : Vollant, en arrivant au Siam, avait lui-même violemment (et sans doute très injustement) taxé l'ingénieur La Mare d'incompétence. ⇑
28 - Les chevaux n'étaient pas habitués au mors. ⇑
29 - L'officier La Touche écrivait dans sa relation : Sitôt que M. Constance eut appris la retraite de M. Desfarges, il en fut plus surpris qu'on ne peut se l'imaginer et se jugea dès lors abandonné par les Français en qui il avait mis toute sa confiance, ayant même méprisé toutes les autres nations en leur faveur. Ces pressentiments n'ont été que trop véritables, car du moins s'ils ne l'ont pas abandonné, ils ne l'ont aucunement secouru et ne lui ont rendu aucun service, ni à lui ni aux siens, ni pendant sa vie ni après sa mort. Cependant, dans l'extrémité où il se voyait réduit, ne se rebutant point encore, il envoya le révérend père Le Royer, supérieur de la Maison de Jésus à Siam, après M. Desfarges à Bangkok pour lui assurer derechef qu'il pouvait monter à Louvo avec toute sorte de sûreté ; que tout y était encore tranquille ; que le roi et lui l'en priaient ; qu'il ne tenait qu'à lui de les sauver d'une perte évidente ; que ce serait un honneur immortel pour lui et sa nation d'avoir retiré un prince des mains d'un scélérat, et qu'après ce service, il devait tout espérer de la reconnaissance d'un roi qui lui devrait non seulement son rétablissement mais aussi la vie. Toutes ces remontrances, quoique fort pressantes, furent inutiles, et ce bon père fut contraint de s'en retourner avec bien du chagrin annoncer ces tristes nouvelles à M. Constance, qui va ressentir en peu de temps les effets d'un pareil abandonnement. (Relation de ce qui est arrivé dans le royaume de Siam en 1688, f° 3r°-3v°). ⇑
30 - Pierre de Saint-Martin (?-1689) était l'un des quatorze jésuites mathématiciens que Louis XIV envoyait au roi Naraï. ⇑
31 - Plusieurs Français venus avec l'ambassade du chevalier de Chaumont étaient restés au Siam, soit de leur propre volonté, soit, comme le chevalier de Forbin, sur ordre de l'ambassadeur. Chaumont indique dans sa relation (1686, p. 219) : M. Constance m'ayant témoigné qu'il serait bien aise d'avoir deux de mes trompettes et mon tapissier, je les lui laissai de leur consentement : il leur a fait un bon parti. Mon maître d'hôtel me demanda d'y rester pour négocier quelque argent qu'il avait. Un de mes laquais est demeuré avec le chef de la Compagnie française, et un autre à qui la dévotion a fait prendre parti de rester au séminaire de Siam pour être missionnaire. (…) Il est bien demeuré douze ou quinze Français au service du roi et du ministre. ⇑
32 - Louis Laneau, évêque de Métellopolis (1637-1696). On pourra consulter une notice biographique de ce missionnaire sur le site des Missions Étrangères de Paris : Louis Laneau. ⇑
33 - Étienne Paumard (1640-1690), prêtre des Missions Étrangères. Ses connaissances médicales lui permirent d'approcher de près le roi Naraï et Phaulkon, et de bénéficier, après le coup d'État, d'une relative liberté. On pourra consulter une notice biographique de ce missionnaire sur le site des Missions Étrangères de Paris : Étienne Paumard. ⇑
34 - Beauchamp orthographie Ferru. Pierre Ferreux (1657-1698), missionnaire, fut ordonné prêtre à Ayutthaya en 1684. ⇑
35 - Cette éclipse de soleil totale eut lieu le 30 avril 1688. Il y avait eu une éclipse de lune partielle le 15 avril.
 L'éclipse de soleil à Siam en 1688 au mois d'avril.
L'éclipse de soleil à Siam en 1688 au mois d'avril.
Elle fut spéculée par les missionnaires jésuites et mathématiciens envoyés par le roi aux Indes orientales en 1687. Ce fut à Louvo dans le palais du roi qu'on l'observa en présence de ce prince qui était à une fenêtre d'une grande salle de son palais, assis sur un fauteuil, et les jésuites avec M. Constance qui leur servait d'interprète était assis les pieds croisés sur un grand tapis où était une rangée de mandarins prosternés la tête contre terre des deux côtés. On se servait en cette occasion de la belle machine parallactique qui est une espèce d'horloge où est attachée une lunette d'approche qui suit le mouvement du soleil. L'on voit là le mandarin Opra Pitracha qui vint voir de près cette machine. C'est celui qui s'est emparé du royaume de Siam et a chassé les Français. (Bibliothèque Nationale, Paris, Cabinet des Estampes). ⇑
36 - Dans son Mémoire sur la vie de Constance Phaulkon, le père de Bèze laisse entendre qu'il a souvent vu le roi et s'est entretenu avec lui. ⇑
37 - Vollant des Verquains confirme les menées de Phra Pi : On travaillait sous main à lever des troupes de tous côtés pour son service, à quoi son propre père s'employait avec plusieurs autres personnes, jusque-là qu'on assure qu'il avait déjà près de 14 000 hommes sur pied. (Op. cit. p. 49). L'Histoire thaïlandaise indique que le père de Phra Pi était Khun Kraisittisak (ขุนไกรสิทธิศักดิ์), un hobereau originaire de Ban Kaeng, au nord de Phitsanulok. Les khun étaient des dignitaires d'un rang assez peu élevé, il est douteux que celui-ci ait pu lever une armée de 14 000 hommes. ⇑
38 - La Relation de ce qui s'est passé à Louvo, royaume de Siam (Archives Nationales, Col. C1/24, f° 146v°) n'évoque que 150 hommes, ce qui semble plus vraisemblable. Beauchamp amplifia-t-il ce chiffre parce qu'il trouvait qu'il était peu glorieux pour un officier français de se faire arrêter par 150 Siamois ? ⇑
39 - Le fils de Phetracha, Naï Dua, devenu Luang Sorasak, (หลวงสรศักดิ์) est décrit par Wood comme un jeune homme violent et agressif. Sous l'empire de la colère, il aurait même cassé deux dents à Phaulkon d'un coup de poing. Élevé au rang de Maha Upparat (มหาอุปราช), il succèdera à son père sur le trône en 1703 pour un règne peu glorieux. ⇑
40 - Okluang Kanlaya Ratchamaïtri (ออกหลวงกัลยาราชไมตรี), qui était venu en France en qualité d'ambassadeur en second.
 Okluang Kanlaya Rachamaïtri, connu en France sous le nom de Uppathut (second ambassadeur). ⇑
Okluang Kanlaya Rachamaïtri, connu en France sous le nom de Uppathut (second ambassadeur). ⇑
41 - Beauchamp place l'assassinat de Phra Pi immédiatement après l'arrestation de Phaulkon, c'est-à-dire le 18 mai. Le père Le Blanc (op. cit. p. 156) la place le vingtième de mai, deux heures avant le jour. ⇑
42 - Selon l'Abrégé de ce qui s'est passé à Bangkok […], il s'agissait de Saint-Vandrille et des enseignes Des Targes et De Lasse. (Op. cit., f° 151r°). ⇑
43 - Selon le père Le Blanc, c'est pour protéger ses biens que le capitaine anglais de la garde de Phaulkon resta impassible pendant l'arrestation de son maître : Son capitaine des gardes préféra à son devoir une cassette d'argent qu'il aima mieux défendre que la vie de son maître. (Op. cit. pp. 148-149). ⇑

21 février 2019
