

Deuxième partie.
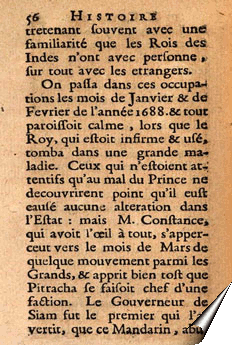
On passa dans ces occupations les mois de janvier et de février de l'année 1688 et tout paraissait calme, lorsque le roi, qui était infirme et usé, tomba dans une grande maladie. Ceux qui n'étaient attentifs qu'au mal du prince ne découvrirent point qu'il eût causé aucune altération dans l'État : mais M. Constance, qui avait l'œil à tout, s'aperçut vers le mois de mars de quelque mouvement parmi les grands et apprit bientôt que Pitracha se faisait chef d'une faction. Le gouverneur de Siam fut le premier qui l'avertit que ce mandarin, abusant des entrées qu'il avait au palais, s'était servi des sceaux ou les avait contrefaits pour demander des armes et des poudres, sous prétexte, disait-il, qu'il fallait pourvoir à la sûreté de la personne du roi. Le gouverneur de PipeliPhetchaburi (เพชรบุรี), ou Phetburi, la Cité des pierres précieuses, à environ 160 km au sud de Bangkok, à l'extrémité nord de la péninsule Malaise. ayant donné les même avis, M. Constance jugea sagement que pour couper chemin au mal, il fallait aller à la force, et prenant d'abord son parti, résolut de faire arrêter Pitracha et de lui faire son procès.
Pour exécuter ce dessein, ce ministre vit bien qu'il avait besoin du secours des armes françaises et fit prier M. Desfarges (1), qui était alors à Bangkok, de vouloir venir jusqu'à Louvo, où il avait à lui communiquer une affaire importante au service des deux rois. M. Desfarges usa d'une diligence qui marquait un grand zèle et alla le trouver sans délai.
Quand il fut arrivé, M. Constance lui envoya deux personnes de confiance (2) qui lui apprirent les secrètes menées de Pitracha contre le roi, la maison royale, la religion chrétienne et les Français, et lui représentèrent l'importance de prévenir les conjurés, de dissiper de bonne heure leur faction, de les étonner d'abord par un coup hardi qui, leur ôtant leur chef, troublerait leurs conseils et déconcerterait leurs assemblées. M. Desfarges reçut cette proposition avec applaudissement et témoigna même de la joie d'avoir trouvé cette occasion de signaler son zèle par une action si glorieuse. Après un préliminaire si heureux, ils n'eurent pas de peine à convenir, M. Constance et lui, de tout ce qu'il y avait à faire pour l'exécution de leur dessein. Ils eurent une longue conférence dans laquelle M. Desfarges s'engagea de venir à Louvo avec une partie de sa garnison et de seconder de tout son pouvoir la résolution du ministre.
Ces mesures étant prises, il s'achemina à Bangkok où il ne fut pas plutôt arrivé, qu'ayant choisi quatre-vingts de ses soldats les plus résolus et quelques-uns de ses meilleurs officiers, il se mit en chemin pour la Cour. Mais malheureusement pour M. Constance, le général passant à Siam trouva des gens qui le détournèrent de poursuivre son entreprise (3), l'assurant que le roi était mort, que le ministre était perdu et que Pitracha était le maître. Sur ces représentations, M. Desfarges retourna dans sa place et fut tellement persuadé qu'il y devait demeurer, que tout ce qu'on lui put dire depuis pour l'engager à renouer l'affaire fut inutile et sans effet. Il en envoya excuse à M. Constance, le priant de considérer que parmi les bruits qui couraient de la mort du roi de Siam, il ne pouvait prudemment tirer les troupes de sa place pour les occuper ailleurs. Il lui fit offrir en même temps une retraite pour lui et pour sa famille parmi les Français de Bangkok.
Dans l'extrémité où se trouvait ce ministre qui voyait la nue prête à crever, c'était l'unique parti qu'il avait à prendre, s'il n'eût regardé que lui-même. Mais outre le bien de la religion qu'il crut devoir préférer au sien propre, cette grande âme trouva de l'ingratitude à abandonner le roi son maître à la discrétion de ses ennemis, dans un état où il ne pouvait plus s'en défendre, et regarda comme une tache à sa gloire et à sa réputation de faire dire dans le monde qu'il avait fait donner des places aux Français, moins par un vrai zèle pour la religion que par une prévoyance de bon politique, pour s'y préparer une retraite contre la fortune et les évènements. Ces considérations l'empêchèrent d'accepter l'offre de M. Desfarges et le déterminèrent à périr plutôt qu'à s'éloigner de la cour.
Afin néanmoins de ne rien omettre de tout ce qu'il crut devoir contribuer à dissiper ou à adoucir l'orage, il s'avisa de proposer au roi de se désigner un successeur. Cette proposition est toujours difficile et délicate à faire à un roi, mais elle l'était beaucoup davantage à faire au roi de Siam qu'à un autre. Il ne pouvait choisir pour successeur qu'un de ses frères et il en était mécontent et les tenait captifs dans ses palais, sans considération et sans crédit. Cette aversion même s'était encore augmentée depuis la maladie du monarque par les défiances que Pitracha avait pris soin de lui donner de ces princes, pour avoir occasion d'assembler des troupes et de faire des provisions sous prétexte de le défendre contre leurs mauvais desseins. De plus en faisant cette proposition au roi, il lui fallait découvrir la raison qui obligeait à la lui faire et c'était à quoi le ministre ne trouvait pas de sûreté. Car il y avait bien de la différence entre le roi de Siam malade et lui-même en santé. Il n'était plus assez maître de ses troupes pour détruire les conjurés, ni de lui-même pour dissimuler la conjuration. M. Constance le voyait bien, et la connaissance qu'il en avait lui fit craindre qu'en découvrant le mal, au lieu d'en détourner les effets, il ne fit que les avancer.
Quand il faut persuader fortement ce qu'on n'ose dire qu'à demi, on a besoin d'une éloquence bien insinuante et bien déliée. Telle fut celle de M. Constance dans l'occasion dont nous parlons ; encore n'eut-elle pas tout son effet. On ne peut, Sire, dit-il au roi, cacher à votre Majesté que la longueur de sa maladie commence à faire des factieux. Il se forme des cabales dans votre Cour, capables d'y causer de grands troubles. Tandis que vous avez été en santé, vos vues, auxquelles rien n'échappe ont tout découvert et tout pénétré : et votre puissance, sous laquelle tous vos ennemis ont plié, a dissipé ce que vous n'avez pu prévenir. Un roi ne fait pas dans son lit ce qu'il fait sur son trône ou à la tête de ses troupes. Naturellement les courtisans, attentifs à leurs intérêts, pensent qu'un roi malade peut mourir, et dans cette vue chacun s'attache à celui des prétendants à la couronne dont il espère le plus de faveur. C'est ce qui arrive maintenant, Sire, parmi les grands de votre cour. Je m'en aperçois, et je trouve le mal assez pressant pour hâter le remède. Je n'en vois qu'un, et je suis sûr, que quand votre Majesté y aura pensé, elle en jugera comme moi. Vos courtisans se divisent ; déterminez-les à s'attacher tous à un seul, que vous vous attacherez à vous-même, en le nommant pour votre successeur. Comme il est de votre gloire que la couronne ne sorte pas de votre famille, vous ne sauriez choisir que l'un de vos deux frères. Le choix ne vous en est pas aisé, mais enfin il est nécessaire, et vous ne sauriez faire autrement, sans sacrifier à des ressentiments inutiles vos plus solides intérêts.
Quelque fort que fut ce discours, et avec quelque insinuation que l'eut prononcé M. Constance, il ne put obtenir du roi que la moitié de ce qu'il prétendait. Quoiqu'il pût dire de plus fort pour l'engager à faire un choix, jamais il n'en put venir à bout. Tout ce que ce prince put gagner sur soi, pour marquer quelque déférence aux sages conseils de son ministre, fut de déclarer sa fille reine, et son héritière après lui, lui laissant la liberté de choisir pour mari celui de ses oncles qu'elle jugerait le plus digne d'elle et de la couronne. M. Constance eut beau lui représenter que cela ne suffisait pas, le roi ne voulut rien faire de plus pour des frères qu'il haïssait (4). Et il fallut en demeurer là.
Les demi-remèdes augmentent souvent les maux et jamais ils ne les guérissent. Celui que le roi de Siam avait prétendu suffisant pour fixer les humeurs inquiètes qui commençaient à agiter le corps de l'État n'avait garde d'avoir d'effet, puisque bien loin de réunir les grands à la suite d'un seul prince destiné à porter la couronne, il les éloignait de tous les deux, leur faisant craindre de se méprendre et de mal deviner celui qui la porterait. Ainsi les factions continuaient toujours, et les chefs n'attendaient que le temps de se pouvoir déclarer sans péril.
Comme les conjurés néanmoins gardaient des mesures avec M. Constance et paraissaient avoir encore de grands ménagements pour lui, il ne croyait pas que les choses fussent en état d'éclater si tôt ; et peut-être en effet eussent-elles encore traîné quelque temps si un accident imprévu n'eut trompé toutes ses conjectures. Pitracha et Monpit avaient tous deux chacun leurs troupes et leurs affidés. Jusque-là ils avaient été dans une intelligence parfaite, mais un poste qu'ils voulurent tous deux faire occuper par quelques-uns de leurs gens les aigrit de telle sorte l'un contre l'autre qu'ils en vinrent à une rupture ouverte. Pitracha maltraita Monpit, et comme il était le plus fort, Monpit crut qu'il n'y avait point de meilleur moyen de se venger de lui que d'aller déclarer la conjuration au roi, espérant que son repentir et la révélation de ses complices lui en mériteraient le pardon.
Il l'obtint en effet, et le premier mouvement de la colère du roi fut contre M. Constance, qui lui avait caché le détail de la chose du monde qu'il devait le plus savoir. Il le fit appeler et lui en fit des reproches. M. Constance lui répondit que dans l'état où il était, il avait jugé à propos de lui épargner ce chagrin ; qu'il avait cru inutile de lui apprendre une chose à laquelle il n'aurait pu apporter d'autres remèdes que ceux qui avait lui-même tentés en vain. Là-dessus il lui raconta ce qui s'était passé entre lui et le général des troupes françaises, et lui dit les raisons que cet officier lui avait apportées pour se défendre de les amener à Louvo.
Le roi fut surpris à ce discours et commençait déjà à se plaindre, mais M. Constance l'interrompant : Il n'est pas temps, Sire, lui dit-il, de se plaindre, ni même de parler ; il faut au contraire agir et se taire. Voici vos ennemis divisés, profitez de leur division et faites arrêter Pitracha la première fois qu'il paraîtra dans la chambre de votre Majesté. Ce coup hardi intimidera les factieux et dissipera peut-être la faction. Aux maux pressants il faut des remèdes décisifs. Mais que votre Majesté se souvienne que pour une grande entreprise il faut un grand secret, et qu'elle se fasse la violence de cacher ses ressentiments jusqu'à ce qu'elle les puisse faire éclater sans péril et d'une manière digne d'elle.
Le monarque écouta M. Constance avec une grande attention et approuva fort son dessein. Il lui promit en même temps l'exécution et le secret, mais n'ayant pas eu la force de garder le secret, il n'eut pas le temps d'en venir à l'exécution. La raison à la vérité réprima sa colère pour quelques moments, mais la raison affaiblie par le mal ne tint pas longtemps contre l'humeur. Il s'y laissa aller, il se plaignit et mêla trop souvent à ses plaintes le nom de Pitracha et de ses amis.
Quoique ce fût la nuit, Pitracha ne laissa pas d'en être averti, et jugeant bien qu'il n'y avait plus de temps à perdre, il usa de tant de diligence pour assembler ceux de son parti que dès le lendemain matin, qui était le dix-huitième de mai, il se rendit maître sans résistance et du palais et de la personne du roi.
Ce fut là que M. Constance fit paraître son zèle sincère et la tendresse pour son maître. On l'avait averti de ce qui se passait et on lui avait conseillé de se tenir chez lui jusqu'à ce que les conjurés eussent jeté leur premier feu. Il rejeta ce conseil comme indigne de son courage et injurieux à sa fidélité.
Il avait alors auprès de lui quelques Français, deux Portugais et seize gardes anglais qu'il entretenait. Ayant ramassé cette petite troupe, il entra dans sa chapelle avec son confesseur pour se disposer à mourir : d'où passant dans la chambre de sa femme : Adieu, Madame, lui dit-il en lui tendant la main, le roi est prisonnier, je vais mourir à ses pieds. Il sortit en disant ces mots, et courant tout droit au palais, il se flattait qu'avec le petit nombre d'Européens qui le suivaient, il se ferait jour au travers des Indiens qui voudraient l'arrêter et pénètrerait jusqu'au roi. Il en serait venu à bout si ceux qui le suivaient eussent été aussi déterminés que lui. Mais à peine était-il entré dans une des premières cours du palais qu'il fut environné tout à coup d'une foule de soldats siamois. Il se mettait en devoir de s'en démêler, lorsqu'il s'aperçut que, hormis les Français, tous ceux de sa suite l'avaient déjà lâchement abandonné. La partie était trop inégale pour pouvoir tenir bien longtemps. Il fallut se rendre à la force et céder à la multitude. On le fit prisonnier, lui et les Français qui lui avaient tenu compagnie, et on les chargea tous de fers.
Pitracha s'étant assuré du monarque et de son ministre se déclara régent du royaume sous l'autorité du roi captif, auquel il voulut conserver cette ombre de la royauté pour rendre son usurpation moins odieuse. Toute la Cour l'eut bientôt reconnu, et les mandarins qu'on a vus en France en qualité d'ambassadeurs furent des plus prompts à lui rendre leurs hommages (5). Il ne prit que le nom de Grand mandarin et il commença à agir en roi. Peu de gens dans le royaume lui résistèrent. Cependant le gouverneur de la capitale ne se rendit qu'à l'extrémité. Ils eurent une grande contestation touchant un des frères du roi qui était demeuré à Siam et qu'on gardait dans le palais. Pitracha, qui suivait sa pointe (6), et qui allait toujours à son but, crut qu'il était de sa politique d'avoir ce prince en sa puissance, et plus encore de ne le pas laisser entre les mains d'un homme qui paraissait disposé à s'en servir contre lui. Dans cette vue, il résolut de le faire transférer à Louvo et il employa pour cela le nom et l'autorité du roi. Les ordres qu'il envoya ne trouvèrent pas dans le gouverneur de Siam la docilité qu'il désirait. Cet officier, qui savait bien que le roi ne faisait plus rien que ce qu'on le forçait à faire, était résolu de n'y point déférer. Pitracha sentit vivement cette résistance du gouverneur, mais il la dissimula en habile homme ; et n'étant pas encore en état d'agir partout à force ouverte, il mit heureusement l'artifice en œuvre. Comme on n'avait point encore eu le temps de démêler ceux des mandarins qui étaient sincèrement ses amis d'avec ceux que la politique et la nécessité lui attachaient, il en aposta quelques-uns, qui feignant d'être mécontents de sa conduite et du changement qu'il venait de faire dans le gouvernement de l'État, sous prétexte de faire leur cour au frère du roi et de lui offrir leur service pour conserver la couronne dans la maison royale, allaient au palais de Siam corrompre les gardes de ce prince. Ils y réussirent si bien que ces gardes infidèles, trompant la vigilance du gouverneur, enlevèrent eux-mêmes leur maître, et l'ayant conduit hors du palais par des chemins et des portes écartées, le livrèrent à une troupe de soldats qui le transportèrent à Louvo.
Cette expédition, qui rendit Pitracha maître de toute la famille royale, fit perdre cœur au peu de gens qui y étaient encore attachés. Le gouverneur de Siam même crut devoir céder au torrent et se soumettre à une puissance à laquelle il ne pouvait résister. Tout plia sous l'autorité d'un usurpateur puissant et heureux, et la plupart même baissèrent la tête avec plaisir sous ce nouveau joug : les talapoins regardant Pitracha comme le restaurateur de leur religion, les mandarins comme un homme fidèle à la patrie qui la délivrait des étrangers, et le peuple comme l'auteur d'une nouveauté, qui lui plaît toujours.
Il n'y avait plus que les Français qui paraissaient à Pitracha pouvoir faire obstacle à sa grandeur, tandis qu'ils conserveraient au légitime roi les deux plus considérables places de l'État. Pour s'ôter cette épine du pied, avant que de tenter la force, il voulut encore employer la ruse. Il manda aux évêques du séminaire des Missions-Étrangères de Siam de le venir trouver à Louvo, les assurant que le changement des affaires ne regardait point les chrétiens et encore moins les Français. M. l'abbé de Lionne, nommé évêque de Rosalie (7) y alla seul, M. l'évêque de Métellopolis s'en étant excusé sur quelque indisposition.
Quand le prélat fut arrivé à Louvo, le grand mandarin lui signifia qu'il le voulait envoyer à Bangkok pour amener à la Cour M. Desfarges, avec qui il voulait, disait-il, conférer de la part du roi d'une affaire de grande importance : ajoutant que ce général ne pouvait se dispenser de ce voyage sans donner atteinte à l'union qui était entre les deux couronnes et faire naître de fâcheux ombrages.
M. de Rosalie s'étant chargé de cette commission, trouva dans M. Desfarges une docilité que les amis de M. Constance n'y avaient pas trouvée et l'engagea à venir à la cour (8).
Les assurances que Pitracha avait données à ce prélat de ses bonnes intentions pour les Français ne lui permirent pas de douter que le voyage ne dût être heureux : mais ceux de la nation qui étaient à Louvo avaient un grand préjugé qu'il ne le serait pas, par la manière dont on avait traité quelques-uns de leurs officiers qui, durant le premier tumulte que la révolution avait excité, avaient tenté de se retirer à l'insu de l'usurpateur. Ces officiers au nombre de six, dont le chevalier Desfarges était un (9), ne trouvant plus de sûreté à la Cour, prirent résolution d'en sortir et de se retirer à Bangkok. Ils montèrent à cheval et s'armèrent, et feignant de s'aller promener, s'échappèrent aisément d'un garde que Pitracha leur avait donné pour les accompagner partout. Il est vrai que pour un dont ils s'étaient défait, ils en trouvèrent depuis Louvo jusqu'à la rivière plusieurs troupes d'espace en espace, mais qu'ils n'eurent pas de peine à forcer. Quand ils furent sur le bord du fleuve, y ayant trouvé un balon plein de talapoins, ils en chassèrent les talapoins et se saisirent du balon. Mais comme ils n'attachèrent pas leurs rameurs, ils furent tout étonnés qu'à la faveur de la nuit, ils les virent tous disparaître et se sauver à la nage chacun de son côté. Contraints de conduire leur balon eux-mêmes, ils s'en trouvèrent en peu de temps si embarrassés et si fatigués qu'ils résolurent de descendre à terre et de continuer leur voyage à pied. La chose n'était pas sans difficulté : le peuple averti par les talapoins auxquels on avait ôté le balon et par les rameurs fugitifs, s'attroupait de toutes parts sur le rivage et les suivait avec de grands cris. Ils sautèrent sur le bord nonobstant cela, et gagnèrent les plaines de Siam où, pour comble de malheur, ils s'égarèrent. La populace les suivait toujours; et quoiqu'elle n'osât les approcher, elle ne les perdait point de vue et ne laissait pas de les inquiéter. Ils s‘en seraient néanmoins démêlés, si la faim ne les eut contraints d'y avoir recours pour avoir des vivres. Ils demandèrent à leur parler ; et leur ayant été répondu qu'on ne leur parlerait point tandis qu'ils seraient armés, ils furent obligés de quitter leurs armes. Alors cette lâche canaille, au lieu de leur fournir des vivres, se jeta sur eux, les dépouilla, les mena garrottés à Siam d'où ils furent renvoyés à Louvo avec mille traitements indignes. Une troupe de trois cents mahométans, que Pitracha, averti de leur fuite, avait envoyés après eux et qu'ils rencontrèrent au retour, les traita si brutalement qu'un nommé Brécy mourut sous les coups. Les autres furent mis en prison à leur arrivée à Louvo.
De cette persécution particulière contre ces Français fugitifs, insensiblement les infidèles passèrent à une plus générale contre tous les chrétiens de Siam, surtout lorsqu'on leur eut appris que M. Desfarges était en chemin pour venir trouver Pitracha. Car depuis ce temps-là, ce tyran s'abandonnant aux défiances que donnent le crime et l'ambition, crut qu'il pouvait ne plus garder ni ménagement ni mesures avec ceux qu'il haïssait ou dont il croyait être haï. Il avait fait massacrer Monpit deux jours après qu'il se fut rendu maître du palais, l'ayant fait épier lorsqu'il sortait en cachette de la chambre du roi où il était allé chercher un asile, pour lequel Pitracha voulait paraître avoir encore quelque respect. Sa haine contre les chrétiens avait été quelque temps suspendue par un reste de considération qu'il avait encore pour les Français, mais il n'eut pas plutôt appris la déférence de leur général aux ordres qu'il lui avait envoyés, que commençant à ne plus rien craindre, il commença à n'épargner personne.
Je laisse à des relations plus amples à décrire plus en détail les tourments que l'on fit souffrir à tant de courageux chrétiens de toutes nations, de tout sexe, de tout âge, de toutes conditions : je ne parlerai que de ceux dont on exerça la vertu de M. et de Mme Constance, qui sont le sujet de ce livre et qui sont dignes d'être proposés aux plus fervents et aux plus zélés, comme des modèles accomplis d'une fermeté vraiment chrétienne dans l'adversité et dans les supplices.
Comme la prison de M. Constance était dans l'enceinte du palais, on ne sait pas tout le détail de ce qu'on lui fit endurer. Les uns disent que pour lui faire avouer les crimes dont on l'accusait, on lui avait brûlé la plante des pieds : d'autres, qu'on lui avait serré les tempes avec un cercle de fer. Quelques-uns assurent qu'on lui avait laissé la tête de Monpit pendue au cou, pour marquer qu'il était complice de sa trahison et de ses crimes. Ce qui est sûr, c'est qu'il fut gardé dans une prison faite de pieux, chargé de trois pesantes chaînes, ayant manqué de toutes les choses les plus nécessaires à la vie jusqu'à ce que Mme Constance, ayant découvert où il était, eût obtenu de les lui fournir.
Elle ne le put faire longtemps, car elle en manqua bientôt elle-même. L'usurpateur avait d'abord parut respecter sa vertu, elle en avait même obtenu des grâces. Il lui avait fait rendre son fils, que des soldats lui avaient caché, et s'était justifié auprès d'elle assez honnêtement de ce rapt. Ces égards ne furent pas de durée. Si la vertu de Mme Constance avait adouci pour quelques moments la férocité siamoise, ses richesses, qu'on croyait immenses, l'irritèrent de telle sorte que rien ne put l'apaiser.
Dès le trentième de mai, on lui vint demander les sceaux des charges de son mari. Le lendemain on lui enleva ses armes, ses papiers, ses habits. Un autre jour on mit le scellé à ses coffres et on en prit toutes les clés. On mit un corps de garde devant son logis et une sentinelle à la porte de sa chambre, comme pour la garder à vue. Rien ne l'avait altérée jusque-là, mais cette dernière insulte la consterna tellement qu'elle ne pût s'empêcher de s'en plaindre. Hé quoi, s'écria-t-elle en pleurant, qu'ai-je donc fait pour être traitée comme une criminelle ? Aussi fut-ce la seule plainte que l'adversité tira de la bouche de cette courageuse chrétienne pendant tout le cours de ses malheurs. Encore répara-t-elle bientôt cette faiblesse, pardonnable d'une femme de vingt-deux ans (10), et qui avait jusque là ignoré ce que c'était que la mauvaise fortune. Car deux jésuites, qui se trouvèrent auprès d'elle en cette occasion, lui ayant représenté doucement que les chrétiens, qui ont leurs trésors au Ciel et qui le regardent comme leur patrie, ne doivent pas s'affliger comme les païens de la perte de leurs biens et de leur liberté ; Il est vrai, leur répondit-elle en reprenant sa tranquillité, j'ai tort, mes pères : Dieu nous a tout donné, il nous ôte tout, son nom soit béni. Je ne lui demande plus rien dans la vie que la délivrance de mon mari. Affermissez-moi dans ce sentiment ; et comme vous êtes les seuls de nos amis que notre disgrâce n'a point éloignés de nous, ne m'abandonnez pas, je vous prie, dans un temps où je prévois bien que l'avarice de nos ennemis va désoler notre maison.
Les pressentiments de Mme Constance ne se trouvèrent que trop vrais. À peine deux jours s'étaient écoulés depuis qu'on avait mis le scellé, qu'un mandarin, suivi de cent hommes le vint lever de la part du nouveau maître et fit enlever tout ce qu'il trouva d'argent, de meubles, et de bijoux, dans tous les appartements de ce riche palais. Mme Constance eut la fermeté de le conduire partout elle-même et de lui mettre entre les mains tout ce qu'il eut envie d'emporter. Après quoi regardant les pères qui lui tenaient toujours compagnie, Enfin, leur dit-elle d'un air tranquille, il ne nous reste plus que Dieu, mais personne ne nous l'ôtera.
Le mandarin s'étant retiré avec sa proie et ses dépouilles, on croyait qu'elle en était quitte et qu'on ne demanderait plus rien à qui on avait tout ôté. Les deux jésuites l'avaient laissée pour retourner à leur logis, personne ne s'imaginant qu'il y eût rien de nouveau à craindre pour une personne à qui on avait pris tout son bien et qui, n'ayant point fait de crime, semblait à couvert de tout autre mal. On vit sur le soir qu'on s'était trompé. Vers les six heures, le même mandarin, accompagné de ses satellites vint lui demander ses trésors cachés. Je n'ai rien de caché, lui répondit-elle : si vous en doutez, vous pouvez chercher ; vous êtes le maître et tout est ouvert. Une réponse si raisonnable sembla avoir irrité ce barbare : Je ne chercherai point, lui répliqua-t-il ; mais sans sortir du lieu où je suis, je te ferai apporter ce que je te demande ou je te ferai mourir sous les coups. En disant ces mots, ce brutal fit signe à deux bourreaux qui s'avancèrent avec des cordes pour la lier et de grosses cannes pour la battre. Cet appareil étonna d'abord cette pauvre femme, abandonnée à la fureur de cette bête féroce. Elle fit un grand cri, et se prosternant à ses pieds, elle lui dit d'un air capable d'amollir le cœur le plus dur : Ayez pitié de moi. Mais ce cruel homme lui répondant avec sa férocité ordinaire qu'il n'en aurait aucune pitié, la fit prendre et attacher à la porte même de sa chambre où il commença à la faire frapper sur les bras, sur les mains, et sur les doigts, d'une manière impitoyable. À ce spectacle, son aïeule, ses parentes, ses femmes, son fils, poussèrent des cris dont tout autre que ce barbare eût été touché. Cette famille désolée se jeta toute ensemble à ses genoux et battant la terre du front, lui demanda miséricorde, mais ce fut inutilement. Il continua à la faire tourmenter depuis sept heures jusqu'à neuf, et n'en ayant pu rien tirer, il la fit enlever elle et sa famille, à la réserve de son aïeule, qu'un grand âge et une grande maladie ne permirent pas de transporter.
On fut quelque temps sans savoir ce que Mme Constance était devenue, mais on le découvrit enfin. Quoi qu'on eût mis aussi des gardes à la maison des pères jésuites et qu'on fût fort animé contre eux, néanmoins par une providence toute particulière d'en haut pour la consolation des chrétiens, on leur laissait assez de liberté. Ils avaient divisé la ville entre eux ; et chacun visitait tous les jours le quartier qui lui était échu, consolant les uns, soulageant les autres, et leur distribuant autant d'aumônes que leur pauvreté le permettait. Ce fut en visitant son quartier qu'un d'entre eux fut assez heureux pour découvrir Mme Constance.
Ce père passait devant les écuries du palais lorsqu'une tante de cette dame, qu'on y avait renfermée avec elle, pria les gardes de permettre qu'elle parlât à ce religieux pour lui demander quelque argent, promettant qu'ils y auraient part. On apprit par-là l'état humiliant où était cette illustre affligée, enfermée dans une écurie où, à demi-morte des tourments qu'on lui avait fait endurer, elle était couchée sur un morceau de natte, ayant son fils à ses côtés.
Le père supérieur des jésuites (11) n'en fut pas plutôt informé qu'il l'alla visiter et lui faire offre de tout ce qui dépendait de lui pour sa consolation et pour son soulagement. Il n'eut permission de la voir qu'un moment, pendant lequel il admira la force et la vivacité de sa foi. Car elle l'assura qu'elle était contente, qu'elle regardait les biens qu'on lui avait ôtés comme un poids dont on l'avait déchargée et qu'elle aurait été plus tranquille dans l'écurie où elle était qu'elle ne l'avait jamais été dans son palais, si elle eût cru pouvoir espérer que le malheur de sa famille ne passerait pas sa personne et qu'on épargnerait son époux. Depuis cette entrevue, le père lui envoya tous les jours de quoi vivre, et ce ne fut que par ce secours qu'elle subsista, elle et sa famille, à laquelle elle le distribuait avec si peu d'égard pour soi qu'elle ne s'en réservait jamais qu'un peu de riz et de poisson sec, ayant fait vœu de s‘abstenir de viande le reste de ses jours.
On en était à ce premier acte d'une tragédie si sanglante quand M. Desfarges arriva. Tout ce qu'il apprit à son arrivée lui fit comprendre que Pitracha avait trompé les évêques et que la religion et la nation n'avaient rien à attendre de lui que de funestes et de violent. L'audience qu'il lui donna sur-le-champ le confirma dans cette pensée. Cet usurpateur y parut avec un appareil affecté, environné d'une multitude extraordinaire de mandarins, assis sur un carreau de velours, ayant quatre sabres à ses côtés ; et le général ayant pris sa place, il lui parla avec une fierté qu'un aussi brave homme ne put souffrir sans se faire une grande violence. Il lui dit qu'on faisait à la cour de grandes plaintes contre les Français ; qu'on l'avait mandé pour savoir, premièrement à quel dessein ils étaient venus dans le royaume ? de plus, par quelle hardiesse ils avaient maltraité à Bangkok des sujets du roi de Siam ? enfin, pourquoi il avait amené quelque temps auparavant jusqu'à la capitale un corps considérable de troupes ; et si c'était par son ordre que les officiers français qui étaient à la cour avaient voulu s'enfuir ? Le général s'en allait répondre et avait commencé à parler, mais Pitracha, l'interrompant, lui dit qu'il n'était pas alors question de se justifier ; que la première chose que le roi voulait de lui était qu'il envoyât à Bangkok un ordre à celui qui y commandait pour en retirer la garnison, afin qu'elle vînt rendre compte de sa conduite aussi bien que lui, ajoutant que s'il se justifiait, le roi le remettrait dans la place ou l'enverrait faire la guerre aux Laos ses ennemis.
M. Desfarges avait prudemment pris ses précautions en sortant de Bangkok pour éviter qu'il fût rendu aux Siamois en son absence, même par ses ordres, si quelque violence eût pu l'obliger d'en donner. Car il avait fait jurer M. de Vertesalle, qui y était lieutenant de roi, que quelque ordre semblable qu'on lui apportât, il ne rendrait jamais la place ; et ce fut la réponse qu'il fit à la proposition du grand mandarin, disant qu'en vain il y enverrait un ordre, auquel on ne défèrerait pas ; qu'il fallait qu'il y allât lui-même, la discipline de France étant, qu'un gouverneur hors de la place n'y soit point obéi en pareil cas.
Jusque-là, Pitracha avait conduit ses affaires sans qu'on eût rien à lui reprocher du côté de la prévoyance, mais la prudence abandonna le crime en cette occasion. Sa fortune l'aveugla tellement qu'il crut que rien ne lui pouvait plus résister. Ainsi il laissa aller M. Desfarges, se tenant d'autant plus sûr de son retour, qu'ayant amené son fils aîné avec lui, on avait à Louvo ses deux enfants qu'on y retint comme en otage.
Après l'audience, on le mena dîner, mais il est aisé de juger qu'il ne fit pas un repas tranquille. Le roi, qui avait vu sa venue, lui fit dire en sous-main que ce n'était point par son ordre qu'on l'avait mandé, mais que c'était un artifice de leur ennemi commun et qu'il ne comprenait pas comment il s'était lui-même venu livrer entre ses mains. D'autres lui ayant témoigné qu'ils étaient surpris aussi de cette démarche, il répondit qu'il avait été mal informé de l'état des choses. En effet le supérieur des jésuites lui ayant répliqué que ses lettres le lui devaient avoir appris, il assura qu'il ne les avait point reçues ; et la personne qui s'en était chargée avoua d'assez bonne foi qu'elle avait cru les devoir déchirer en chemin, de peur que si elles étaient surprises, elles ne donnassent occasion à quelque incident fâcheux (12).
Pour surcroît de chagrin, les trois mandarins venus en ambassade en France vinrent proposer à ce général d'écrire au gouverneur de Mergui pour en retirer sa garnison et la conduire à un certain lieu, qui lui était marqué par la cour pour joindre celle de Bangkok, et mener toutes ces troupes ensemble combattre les ennemis du roi. M. Desfarges se défendit assez longtemps d'écrire cet ordre et demanda que si le roi n'agréait pas le service des Français, on leur permît d'acheter des vaisseaux pour s'en retourner en leur pays. On éluda cette proposition par des compliments affectés, mais enfin il fallut écrire. Le général apparemment crut le pouvoir faire sans rien risquer, le gouverneur de Mergui, qui était le brave M. du Bruant, étant trop habile homme pour déférer à un ordre de cette nature, donné en pareilles circonstances : aussi n'eut–il aucun effet.
Jusque-là, le grand mandarin n'avait osé faire mourir M. Constance que le général des Français lui avait envoyé demander comme une personne qui était sous la protection du roi son maître. Mais jugeant alors qu'il n'avait plus rien à craindre ni de lui ni de ses amis, il prit la résolution de s'en défaire. Ce fut le cinquième de juin, qui était la veille de la Pentecôte, qu'il commit cette exécution à l'Oya Soyatan son fils (13), après que sans autre forme de justice il eut fait lire dans le palais la sentence de mort portée par lui-même contre ce ministre, qu'il accusait d'avoir été d'intelligence avec Monpit. Cette sentence prononcée, on le fit monter sur un éléphant et on le mena sous bonne garde dans la forêt de Thlée Poussonne (14), comme si le tyran eût choisi l'horreur de cette solitude pour y ensevelir dans l'oubli cette action injuste et barbare.
Ceux qui le conduisirent remarquèrent que pendant tout le chemin il avait paru tranquille, qu'il avait employé ce temps en prières, prononçant souvent à haute voix les noms de Jésus et de Marie. Quand il fut arrivé au lieu du supplice, on lui fit mettre pied à terre et on lui dit qu'il fallait mourir. La vue de la mort ne l'étonna point ; il la vit de près, comme il l'avait vue de loin, et avec la même intrépidité. Il demanda seulement à Soyatan encore quelques moments pour achever sa prière, ce qu'il fit à genoux, d'un air si touchant que ces infidèles en furent attendris. Sa prière faite, il leva les mains au ciel et protestant de son innocence, assura qu'il mourait volontiers, avec le témoignage intérieur que lui rendait la conscience de n'avoir rien fait dans son ministère que pour la gloire du vrai Dieu, pour le service du roi et le bien de l'État ; qu'il pardonnait à ses ennemis comme il priait Dieu de lui pardonner. Au reste, Seigneur, ajouta-t-il en se tournant vers Soyatan, quand je serais aussi coupable que mes ennemis le publient, ma femme et mon fils sont innocents ; je vous les recommande tous deux. Je ne vous demande pour eux ni biens, ni établissements, mais la vie et la liberté. En achevant ces derniers mots, il leva doucement les yeux au ciel et fit signe par son silence qu'il était prêt à recevoir le coup. Alors un bourreau s'avança et d'un revers de sabre l'ayant fendu en deux, le fit tomber sur le visage, mourant, et poussant un profond soupir qui fut le dernier de sa vie.
Ainsi mourut dans la fleur de ses jours, à l'âge de quarante et un an, cet homme fameux qu'un génie sublime, une grande habileté dans les affaires, beaucoup de pénétration et de feu, un grand zèle pour la religion, un fort attachement au roi son maître, rendaient digne d'une vie plus longue et d'une destinée plus heureuse ; si toutefois on ne compte pas pour quelque chose de meilleur qu'une vie longue et ce que les hommes appellent une destinée heureuse, la gloire d'être mort pour avoir voulu établir la foi du vrai Dieu parmi une nation infidèle et affermir la couronne sur la tête et dans la famille de son roi. Car tels furent jusqu'à la fin les desseins de M. Constance. La providence n'a pas permis qu'il en ait eu un bon succès ; c'est un jugement qu'il faut adorer; mais s'il n'a pas eu l'honneur d'un succès heureux, on ne peut lui refuser le mérite d'un projet sage et bien concerté. Une suite d'évènements imprévus rompit ses mesures et le fit succomber sous les efforts de ses ennemis, dont il serait venu à bout si ses conseils eussent été suivis.
On ne peut nier qu'il n'ait eu des défauts. Comme il n'est point d'astre qui n'ait ses taches, il est peu de grands hommes qui n'aient leurs faiblesses. Il était colère et quelquefois emporté, il aimait la gloire jusqu'à l'ostentation, mais ces défauts étaient contrebalancés par tant de qualités éclatantes et de si solides vertus, qu'on ne peut autrement les regarder que comme des effets de la destinée de toutes les choses d'ici-bas, de n'être jamais parfaites de tout point.
Il avait une magnificence qui aurait été excessive dans un particulier, mais qui lui était convenable dans le poste qu'il occupait. Sa table, ses habits, ses meubles, ses maisons, et ses domestiques faisaient honneur au maître qu'il servait et étaient presque des biens publics pour ceux qu'il aimait ou qui en avaient besoin. Car il était très libéral, et je trouve dans un mémoire qu'un homme qui l'a fort connu m'a laissé, qu'en trois ans il lui avait vu dépenser plus de cent mille écus en présents. Il était bon ami et si généreux que quoiqu'il n'eût pas tiré le secours qu'il espérait des Français de Bangkok, il ne laissa pas de leur envoyer deux cents vaches pour munir la place qu'il prévoyait bien devoir être assiégée, et de leur donner tous les avis nécessaires pour la bien défendre.
Il avait l'esprit et le cœur véritablement chrétien, fréquentant les sacrements et s'y préparant toujours avec un extrême recueillement, prenant plaisir à orner les églises et contribuant de tout ce qu'il pouvait à la solennité du service divin ; entendant presque tous les jours la messe et souvent la parole de Dieu, faisant faire chez lui régulièrement la prière le matin et le soir, nourrissant dans sa maison plus de quatre cents pauvres, donnant à toutes les communautés régulières, à diverses missions, et en particulier une grosse somme tous les ans au séminaire de Siam auquel il avait fondé un collège qu'on avait nommé de son nom.
Sa ferveur avait redoublé quelque temps avant sa mort. Il employait le matin et le soir une heure à prier et à lire. Il ne manquait jamais à entendre la messe, et pour y assister, il faisait quelquefois une lieue pendant la plus grande chaleur du jour. Dès qu'il fut arrêté au palais, comme s'il eût perdu tout d'un coup le souvenir de toutes les choses du monde, il ne demanda que des livres et un jésuite. Le jésuite lui fut refusé, mais on lui accorda les livres. Il est à croire que le bon usage qu'il en fit ne contribua pas peu à lui procurer la sainte et précieuse mort qui couronna une vie si chrétienne.
On ne peut dire la douleur de Mme Constance à cette nouvelle. On lui avait donné une question qui lui avait brisé le corps et elle ne se pouvait soutenir. La mort de son époux lui fit oublier les plaies de son corps pour ne sentir que celle que faisait à son cœur cette dure séparation. Quoi il est mort ! s'écria-t-elle toute transportée, et hors d'elle-même, pourquoi est-il mort, et qu'avait-il fait pour être traité en criminel ? Un mandarin, parent de Pitracha, et l'un des plus grands seigneurs du royaume, se trouvant par hasard auprès d'elle quand elle prononça ces mots, lui parla à l'oreille et lui dit que le crime de son mari était sa faveur et son esprit. Les jésuites n'omirent rien pour la consoler, quoiqu'ils eussent bien de la peine à se consoler eux-mêmes, la perte leur étant commune avec elle, puisque le même coup qui lui avait ôté un bon mari leur avait ôté le meilleur de leurs amis et le plus zélé de leurs protecteurs.
Le roi et ses frères suivirent le sort du ministre. Quelques-uns disent que le roi fut empoisonné (15), d'autres, qu'il mourut de sa maladie et du chagrin de sa captivité. Quoiqu'il en soit, le grand mandarin le voyant près de la mort, ou la lui voulant avancer, crut que celle de ses frères devait précéder la sienne pour se rendre la couronne plus incontestable. Ainsi il les fit tous deux assommer avec des bâtons de santal, qui est un bois précieux, après les avoir fait enfermer dans des sacs de velours, selon l'usage de ces peuples qui croient ce genre de mort honorable et qui ne l'accordent qu'aux princes du sang.
Le roi mourut peu de jours après. Ce fut une grande perte pour le royaume. C'était un prince de bon esprit, de bon naturel, de bonnes mœurs. Aucun de ses prédécesseurs n'avait eu de meilleures vues pour la grandeur de cet État, et au défaut même des siennes, il prenait aisément celles des autres quand il les croyait habiles et affectionnées. Il aimait la gloire et n'omettait rien pour s'acquérir de la réputation, surtout chez les princes étrangers, auxquels il envoyait de fréquentes ambassades qu'il accompagnait toujours de présents dignes d'un roi riche et magnifique. Il estimait les gens de mérite et les voyait volontiers dans sa Cour. Il avait le même goût pour les beaux arts, et s'il ne fût point mort si tôt, il avait pris toutes les mesures nécessaires pour les faire passer de Paris à Siam. Il gardait avec ses sujets l'incommode gravité des rois des Indes, les tenant toujours prosternés devant lui et ne leur parlant guère que pour leur commander ; mais les respects que lui rendaient ses sujets et la soumission qu'ils avaient pour ses ordres ne l'éblouissaient pas et ne l'empêchaient pas de sentir le faible de son État. L'appui qu'il chercha dans l'alliance du roi fut un effet de cette connaissance. Avec toutes ses richesses, il savait bien qu'un peuple mou et sans discipline était un mauvais boulevard à un royaume menacé par des ennemis redoutables, s'ils n'étaient retenus par quelque puissance amie capable de les intimider. Celle de France lui parut telle, et en effet, si sa santé lui eût permis d'attendre encore un voyage des vaisseaux du roi, il était en état de ne craindre ni les factions de ses courtisans, ni les invasions des étrangers. Il était libéral et bienfaisant, allié fidèle et bon ami. Il avait conçu pour le roi une estime et une tendresse que sa maladie et son malheur ne diminuèrent point. Il l'appelait quelquefois simplement, et sans y rien ajouter, le grand roi. Son amitié pour le monarque s'étendait sur toute la nation. Il sentit tout le mal qu'on fit aux Français dans le trouble de la révolution et leur fit même donner des avis utiles pour leur sûreté. Il aima M. Constance jusqu'à la mort, et pour avoir été malheureux, il ne l'en estima pas moins. Quand il apprit qu'on l'avait fait mourir, il fit témoigner à sa veuve la part qu'il prenait à sa douleur, marquant en effet par les louanges qu'il donna à ce fidèle ministre qu'il en regrettait beaucoup la perte. Depuis qu'il eut pris en affection les jésuites que le roi lui avait envoyés, il eut pour eux des bontés et des soins qui ne finirent qu'avec sa vie. Trois ou quatre jours avant qu'il mourût, ayant ouï dire que ces pères étaient en danger de tomber dans la nécessité à cause des aumônes qu'ils avaient faites aux chrétiens durant la persécution, il fit demander à Pitracha quelque argent pour en disposer; et l'ayant reçu, il l'envoya aux pères, disant qu'il n'était pas juste que des gens qui lui avaient été recommandés si particulièrement par le grand roi manquassent des choses nécessaires. Sa vie au reste était réglée et éloignée de l'oisiveté et de la mollesse des rois des Indes. J'en ai un journal entre les mains où l'on ne voit que des occupations louables et des plaisirs honnêtes. Enfin ce prince méritait d'être plus heureux dans les projets qu'il avait faits pour affermir l'état florissant où il avait mis les affaires de son royaume. Peut-être que son malheur a été un effet de la colère d'en haut, et que Dieu a puni par-là la rébellion à la lumière et son indifférence pour son salut.
Il laissa par sa mort Pitracha maître de sa couronne et de ses trésors. Le mariage que cet usurpateur contracta, si nous en croyons quelques lettres, avec la princesse reine unique héritière du feu roi, l'affermit encore sur le trône ; et personne ne se trouvant en état de lui disputer, il en demeura possesseur paisible.

NOTES
1 - Le général Desfarges, qui commandait les troupes françaises au Siam, demeure un personnage unanimement condamné. Matamore borné, vaniteux, intéressé, il a les idées fort courtes et alterne extrême crédulité et défiance excessive. Après avoir abandonné Phaulkon à son sort, son attitude envers Mme Constance lui attirera la réprobation et le mépris de tous. Il y a une justice, Desfarges ne revint jamais en France, il mourut de maladie en 1690 lors du voyage de retour, à bord du vaisseau l'Oriflamme. Ses fils eux-mêmes, qui héritaient du fabuleux trésor amassé par leur père au Siam, se réjouirent de sa mort ; pas très longtemps, certes, car l'Oriflamme pris dans une tempête disparut au large de la Bretagne le 27 février 1691. ⇑
2 - Les jésuites Claude de Bèze et Marcel Le Blanc. ⇑
3 - Des gens désigne Véret, le directeur du comptoir de Siam, et les prêtres des Missions Étrangères, et notamment l'abbé de Lionne qui écrira plus tard pour se justifier un long Mémoire sur une affaire sur laquelle on m'a demandé quelques éclaircissements qu'on pourra lire sur ce site. ⇑
4 - C'était sans doute moins la haine de ses frères que la crainte qu'on lui avait instillée que ses frères ne profanassent son corps après sa mort. C'est ce qu'explique le jésuite Claude de Bèze : On avait si prévenu ce prince de leur ressentiment et du dessein qu'ils avaient de maltraiter son corps après sa mort qu'il ne put se résoudre à leur mettre le pouvoir entre les mains. Tout ce que put obtenir M. Constance de lui fut qu'il laisserait, par son testament la couronne à sa fille, à condition qu'elle ne pût rien faire que par l'avis d'Oya Vitchiaigen [Phaulkon], d'Opra Pit et Opra Pitratcha, jusqu'à ce qu'elle eût fait rendre à son corps les derniers devoirs, après quoi il lui permettait de faire part de la couronne auquel elle voudrait des princes, mais cette déclaration du roi ne servit qu'à autoriser encore Pitratcha à l'aider à exécuter plus tôt son dessein si on ne le faisait connaître au roi. (Drans et Bernard, Mémoire du père de Bèze sur la vie de Constance Phaulkon, Tokyo, 1947, pp.113-114). ⇑
5 - Ces trois ambassadeurs étaient Okphra Visut Sunthon (ออกพระวิสุทธิสุนทร) dit Kosapan (โกษาปาน), Okluang Kanlaya Ratchamaïtri (ออกหลวงกัลยาราชไมตรี) et Okkhun Siwisan Wacha (ออกขุนศรีวิสารวาจา).
 Les trois ambassadeurs siamois.
Les trois ambassadeurs siamois.
 Les trois ambassadeurs siamois. ⇑
Les trois ambassadeurs siamois. ⇑
6 - Suivre sa pointe, c'est aller de l'avant dans ses opérations. (Littré). ⇑
7 - Lionne avait été nommé coadjuteur de Louis Laneau, évêque de Métellopolis, qui succédait à Ignace de Cotolendi, mort en 1682, puis élu évêque de Rosalie par le pape Innocent XI, double nomination qu'il refusa. Il ne fut officiellement sacré évêque de Rosalie qu'en 1700. ⇑
8 - Sur ce point encore mis en accusation par les jésuites, l'abbé de Lionne tâcha de s'en justifier dans une lettre adressée aux directeurs du séminaire des Missions Étrangères :
Environ le 15 de mai, Phetracha ayant arrêté Prapi dans le palais, M. Constance nous écrivit à M. de Métellopolis et à moi, comme de la part du roi, pour qu'un de nous montât à Louvo. M. de Métellopolis ayant été bien aise de se dispenser de ce voyage, j'y montai et trouvai la ville de Louvo devenue une prison pleine de chrétiens. Les officiers français qui s'étaient trouvés à Louvo à la prise de M. Constance, et que l'on avait gardés jusqu'alors très étroitement, les remettant toujours à l'arrivée de M. de Métellopolis ou de moi, eurent pour lors la liberté de venir me voir. Peu de temps après vinrent aussi les pères jésuites, au nombre de 8 ou 10, qui tous s'efforcèrent de me persuader qu'en parlant à Phetracha, je devais me plaindre de ce qu'on avait arrêté M. Constance et en faire l'affaire de la nation ; et ils prétendaient qu'en menaçant Phetracha du ressentiment des Français de Bangkok, on l'empêcherait de se porter aux dernières extrémités contre M. Constance. J'avoue que j'admirai que la préoccupation ou l'erreur où avaient été les pères jésuites par une confiance aveugle en M. Constance pût durer si longtemps.
Je leur répondis que quoique j'eusse de M. Constance des sentiments bien différents des leurs sur les services qu'on prétendait qu'il eût rendu à la religion et à la nation, Dieu était téoin que je souhaiterais extrêmement de le pouvoir soulager de l'état où il se trouvait, qui me faisait grande compassion ; mais que j'étais fort éloigné d'aller de moi-même, ou par leur conseil, faire de l'affaire de M. Constance l'affaire de tous les Français, surtout dans la conjoncture présente ; que je verrais ce qu'il me dirait, et servirais en ce que je pourrais M. Constance.
Je vis après dîner Phetracha qui était entouré des plus grands mandarins du royaume, dont une partie était prosternés, et tous se tenant d'une manière qui seule eût pu faire connaître qu'il était le maître. Il me dit que le roi souhaitait que M Desfarges montât à Louvo, qu'il voulait donner la place de M. Constance au fils de M. Desfarges ; mais que comme il était encore jeune, il était nécessaire que dans le commencement M. Desfarges le formât. Il me demanda ensuite si je croyais que M. Desfarges monterait, m'ajoutant que le roi l'avait déjà souhaité et l'avait demandé diverses fois ; que la première fois M. Desfarges avait cru que le roi était mort et était redescendu à Bangkok (ce fut alors qu'il vint au séminaire) ; que depuis, le roi continuant de le presser de monter, il avait dit qu'il était malade, et que le roi lui ayant envoyé des médecins, on avait trouvé qu'il se portait très bien et que s'il continuait à ne vouloir point monter, cela donnerait des soupçons au roi contre lui et pourrait causer des brouilleries ; il ajouta qu'il enverrait le lendemain avec moi les deux premiers ambassadeurs qui avaient été en France, pour aller inviter M. Desfarges à monter, et qu'en attendant il garderait son second fils en sa compagnie.
Sans entrer dans les vues que pouvait avoir en tout cela Phetracha, il est facile de concevoir que je ne pouvais me dispenser d'accepter la commission qu'il me donnait, qui ne m'engageait à autre chose qu'à accompagner les deux ambassadeurs qui devaient aller proposer à M. Desfarges de monter à Louvo ; et je suis bien sûr qu'il n'y avait aucun Français pour lors à Louvo qui n'eût été bien aise de les y accompagner. (Citée dans Launay, Histoire de la mission de Siam, I, 1920, pp.207-208). ⇑
9 - Ces six officiers étaient Dacieu, parti premier puis rejoint par les cinq autres : les deux fils Desfarges, Saint-Vandrille, de Fretteville et Brécy. ⇑
10 - Marie Guyomar avait épousé Phaulkon en 1682, elle avait alors 16 ans. ⇑
11 - Le père Abraham Le Royer. ⇑
12 - Si l'abbé de Lionne relate bien sa rencontre avec 8 ou 10 pères jésuites lors de son séjour à Louvo (voir note 8), il ne mentionne nulle part ces lettres que les jésuites lui auraient remises à l'intention de Desfarges, pour le dissuader de venir à Louvo, lettre qu'il aurait déchirées. On connaît cet incident par les mémoires du jésuite Claude de Bèze : Aussi ce traître [Phetracha] ne se fut pas plutôt révolté qu'il lui écrivit [à Desfarges] pour l'assurer de son amitié et de la disposition où il était de lui faire plaisir. Il écrivit encore de plus amples lettres à MM. les évêques, leur mandant qu'il souhaitait leur faire part de son autorité et qu'il les priait pour cela de venir à Louvo afin de l'aider par leurs lumières dans l'administration des affaires. Son dessein était de se rendre maître des Français, comme il le fit assez voir par la suite, mais le malheur voulut qu'ils n'en fussent pas persuadés, que, quelques choses qu'on leur ait pu dire, ils n'aient pu se convaincre que ce mandarin les trompait ; que, lorsque n'ayant plus besoin de leurs services, il les a plus maltraités que les autres. Il est vrai que M. de Metellopolis ne s'y fiait tout à fait tant et qu'il ne voulut pas même d'abord venir à Louvo sur les premières instances qu'on lui en fit. Il se contenta d'y laisser monter M. de Lionne, qui avait moins de répugnance d'y aller. Ce prélat y arriva deux jours après la révolte de Phetracha. nous crûmes qu'il était à propos de le prévenir avant qu'il eût audience et nous allâmes le trouver pour cela. Je lui racontai tout ce qui s'était passé à Louvo : M. Paumard lui confirma l'emprisonnement du roi et la rébellion de Phetracha, en ayant été averti de la part du roi même que personne ne pouvait plus voir. Un témoignage aussi désintéressé que celui de M. Paumard ne put pas encore le désabuser des impressions avantageuses qu'il avait prises pour Phetracha et il crut, ou que nous étions si durs ou que l'envie de sauver M. Constance nous faisait déguiser la vérité. Je passe plusieurs choses qui furent dites dans cet entretien et qu'on peut voir ailleurs. Il vit le Grand Mandarin, car c'est ainsi que nos Français l'appelaient par honneur depuis qu'il avait détrôné le roi, qui le reçut assez bien, à ce qu'il nous dit, mais qui lui déclara d'une manière bien fière que le roi souhaitait que M. Desfarges vînt à Louvo ; que, comme il avait beaucoup d'autorité sur son esprit, il fallait qu'il allât à Bangkok pour lui persuader d'obéir incessamment aux ordres de Sa Majesté. M. de Lionne ne s'attendait pas à être chargé de cette commission ; cependant, comme il n'était pas encore convaincu de la trahison et de la mauvaise foi de Phetracha, il paraissait assez disposé à porter M. le général à obéir aux ordres de ce mandarin. Comme nous étions persuadés que M. Desfarges ne pouvait pas faire cette démarche sans abandonner les chrétiens à la fureur de Phetracha qui ne les épargnait à Louvo que parce que les Français étaient maîtres de Bangkok, nous crûmes devoir le représenter à M. de Lionne et le conjurer de ne point engager M. Desfarges à venir se mettre entre les mains de ce traître sans s'être bien assuré de ses intentions ; que le roi nous avait fait dire que ce mandarin n'en avait point d'autre que de faire égorger tous les Français s'il pouvait s'en rendre maître et qu'il sacrifierait ensuite tous les chrétiens à la haine des talapoins ; que ce n'était pas une affaire de si petite conséquence qu'elle ne méritât bien qu'il s'informât mieux qu'il ne l'était de l'état des choses ; que, s'il ne voulait pas nous en croire ni M. Paumard, qu'il demandât à voir le roi et à savoir de lui sa volonté. M. de Lionne nous répondit qu'il ne voulait pas choquer le Grand Mandarin par une démarche semblable qui ferait voir qu'il se défiait de lui, mais que, si nous croyions qu'il ne fût pas à propos que M. Desfarges vînt à Louvo, nous lui écrivissions notre sentiment et nos raisons ; qu'il s'offrait de lui porter nos lettres. Nous écrivîmes en effet, le R.P. Supérieur et moi, et j'allai lui porter nos lettres comme il était prêt de partir. Je lui dis que, s'il avait de la peine à s'en charger, je les donnerais à M. de Beauchamp qui s'en allait avec lui : il me dit qu'il n'en avait aucune et, qu'étant envoyé de la part du Grand Mandarin, il ne craignait pas qu'on le fouillât ; cependant il changea bientôt après de sentiment car, sitôt qu'il fut sorti de Louvo, il déchira nos lettres, à ce qu'il nous dit depuis, craignant qu'elles ne lui fissent de la peine si elles venaient à être surprises. Il se rendit bientôt à Bangkok où Mun Pan l'accompagna avec ordre de faire toutes sortes de promesses à M. Desfarges pour l'engager à venir. C'était un coup de conséquence pour Phetracha car, quoiqu'il se fût rendu maître de Louvo, les autres villes ne s'étaient pas encore déclarées pour lui. (Drans et Bernard, Mémoire du père de Bèze sur la vie de Constance Phaulkon, Tokyo, 1947, pp.120 et suiv.) ⇑
13 - Ce nom de Soyatan est peut-être une déformation de Suriyenthrathibodi (สุริเยนทราธิบดี), un des titres sous lesquels régna le fils de Phetracha, dont le nom était Sorasak (สรศักดิ์). À la fin des deux volumes de son Histoire de la révolution de Siam, (Lyon, Horace Molin, 1692), le père Le Blanc insère un erratum invitant à remplacer Soiatan par Sorasak dans tout l'ouvrage. ⇑
14 - Thale Chubson (ทะเลชุบศร), une île au milieu d'un ancien lac à trois kilomètres de Lopburi, où le roi Naraï avait fait construire une résidence, le pavillon Kraisorn-Sriharaj (ตำหนักไกรสรสีหราช). On peut penser que la fraîcheur de l'eau rendait cette retraite agréable pendant les mois chauds. Elle était également connue sous le nom de Pratinang yen (พระตี่นั่งเย็น), la Résidence fraîche. Elle servait au roi Naraï pour les réceptions et pour séjourner lors de ses parties de chasse ou de ses promenades en forêt. ⇑
15 - L'empoisonnement du roi Naraï est une hypothèse qu'on ne peut écarter. Dans ses Mémoires, François Martin écrivait : On a des informations sûres que les Hollandais étaient fort intrigués dans ces révolutions, particulièrement un certain Daniel, de leur loge, natif de Sedan, chirurgien de profession, hérétique opiniâtre et ennemi déclaré de la religion catholique et des Français. On assure encore que l'on a des témoignages par les mêmes informations qu'on mêla du poison dans un breuvage qu'on donna au roi, qui avança beaucoup sa mort. (Mémoires de François Martin, III, 1934, p.15). Par ailleurs, les Archives Nationales conservent une déclaration du français Jean Rival, ancien gouverneur de Phuket, (AN Cl 25, fs.58-59) et datée du 25 novembre 1691 qui révèle qu'une conjuration s'était nouée entre Phetracha, le capitaine de la loge hollandaise, le médecin de la VOC Daniel Brouchebourde et quelques mandarins pour faire mourir le roi : Ok Pra Phetracha demanda au capitaine hollandais : comment pouvons-nous entreprendre cette affaire ? Le capitaine hollandais fit répondre à Daniel qui lui servait d'interprète : il faut que vous fassiez donner du poison lent au roi, et Daniel le préparera, et Ok Meun Sri Meun Chaya, qui est auprès du roi, le donnera au roi, et quand le roi se trouvera un peu atteint, il faut que Ok Meun Sri Meun Chaya vous donne le cachet du roi, et surtout, si Ok Pra Vitticamheng apportait des médecines pour les donner au roi, il faut que Ok Meun Sri Meun Chaya ne les donne pas au roi, sinon celles que Daniel lui donnera, et tant qu'il pourra empêcher Ok Pra Vitticamheng d'approcher du roi. Même si ces rumeurs et ces affirmations restent sujettes à caution, la brusque dégradation de l'état de santé du roi Naraï et les précautions prises par Phetracha pour empêcher quiconque d'approcher le monarque dans ses derniers jours pourraient accréditer cette thèse. ⇑

12 mars 2019
