

AVERTISSEMENT
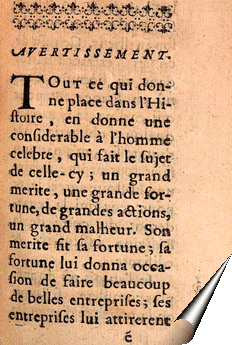
Tout ce qui donne place dans l'histoire en donne une considérable à l'homme célèbre qui fait le sujet de celle-ci : un grand mérite, une grande fortune, de grandes actions, un grand malheur. Son mérite fit sa fortune ; sa fortune lui donna occasion de faire beaucoup de belles entreprises ; ses entreprises lui attirèrent les haines et les jalousies qui furent cause de son malheur. Ce tissu de choses extraordinaires dans un homme connu en France, et pour qui même la nation a quelque obligation de s'intéresser, m'a paru un sujet tout propre à faire une histoire agréable, et pour ceux qui la regarderont du côté de la religion, instructive et édifiante.
Je l'aurais pu donner pour complète si j'avais eu la patience d'attendre des mémoires plus amples qu'un habile homme m'envoie des Indes et que je n'ai pas encore reçus. Ce qui m'empêche de différer est l'expérience qui m'apprend qu'en différant de contenter le public sur ces sortes de choses, on lui en ôte la curiosité, et que pour les lui donner plus parfaites, on lui en fait perdre le goût. Les livres, comme les fruits, ont leur saison, hors de laquelle, sans cesser d'être beaux et utiles, ils ne sont plus recherchés. Tandis qu'on parle d'une affaire, ou d'un événement dans le monde : que c'est la nouvelle du jour ; qu'on s'en entretient dans les compagnies ; tout livre qui en traite, quelque médiocre qu'il soit, est favorablement reçu. Cette première ardeur passée, le meilleur livre n'est plus lu ; et l'auteur a le chagrin de voir que pour l'avoir voulu rendre plus digne d'être mis en lumière, il l'a enseveli dans les ténèbres.
Il est encore temps de donner celui-ci. On n'a point vu de détail exact de la dernière révolution de Siam, qui fait la meilleure partie de cet ouvrage et qui est un événement des plus dignes de la curiosité publique qui soit arrivé de nos jours. On en trouvera dans le récit que j'en fais les particularités, soigneusement recueillies de diverses relations très fidèles. J'en ai lu de personnes si différentes, si hors de soupçon d'avoir écrit de concert, et je les ai trouvées à peu près si conformes les unes aux autres que je n'ai pu douter qu'elles ne fussent vraies. S'il en a paru quelques-unes qui ne tinssent pas le même langage, on découvre aisément, en les lisant, l'intérêt qu'on eu ceux qui les ont écrites de ne parler pas comme les autres. Il y a quelque temps qu'un homme sage disait de fort sens, après en avoir lu une de ce caractère, que contre l'intention de l'auteur, c'était pour lui une confirmation de celles qui disaient le contraire.
Je me flatte que dans celle-ci on trouvera tout le sens froid qu'il faut avoir pour être cru. Comme je n'ai point d'autre dessein en écrivant cette histoire que de dire ce qui s'est passé, je n'épouse les intérêts d'aucun de ceux qui ont été acteurs dans cette affaire au préjudice des autres. Ainsi, je loue toujours tellement ceux que je crois louables, que je ne blâme pas ceux-là mêmes que je ne puis m'empêcher de croire blâmables. Je raconte les faits qui ont diverses faces, simplement, et prenant toujours la précaution de laisser au lecteur la liberté entière d'en juger selon ses vues, sans le prévenir par les miennes. J'ai même pris soin de lui cacher autant qu'il m'a été possible, non seulement par discrétion, pour ne pas fâcher ceux à qui elles ne sont pas favorables, mais par un principe d'équité, pour ne pas ôter à des actions qui ont eu de mauvais succès, le mérite de la bonne intention. Je les aurais volontiers supprimées, mais outre qu'elles sont d'une notoriété si publique qu'il est impossible de les taire, elles font une si grande partie de cette histoire qu'on ne les peut dissimuler. Ceux qui savent les choses à fond verront bien que j'en passe assez pour mériter que le public loue un jour ma modération, si jamais on dit tout sur cette matière ; et si les intéressés sont équitables, j'espère qu'ils m'en sauront quelque gré. Les curieux m'en voudront du mal, mais j'aime encore mieux m'attirer les curieux que les gens charitables, vu d'ailleurs que je donne assez à la curiosité dans cette histoire, pour donner quelque chose à la charité.
Au reste, je ne me fais point une loi, comme la plupart des faiseurs de relations, de donner place dans la mienne à tous ceux qui se sont trouvés présents aux événements que je raconte. Je ne parle guère que des principaux acteurs, et je n'en parle même qu'à mesure qu'ils ont part à l'action que j'écris. Ainsi, il peut bien arriver que tel, qui ne sera point nommé dans ce livre, mérite d'être lui-même le sujet d'un plus gros volume pour d'autres actions que je n'aurai pas sues ou qui n'auront pas de liaison avec celles que je raconte.
Je me suis peu étendu sur ce que les relations imprimées ont déjà dit de M. Constance. Les deux Voyages du père Tachard ont été lus de tant de gens qu'on n'ignore rien en France de ce qui regarde ce ministre depuis le temps qu'il a commencé à avoir commerce avec nous. C'est ce qui fait que je n'ai rien écrit de cette partie de sa vie que ce qu'il était nécessaire d'en écrire pour masquer au lecteur la suite et le tissu de ses actions. J'ai pris tout ce que j'ai dit de sa naissance et du commencement de sa fortune de ce qu'en a écrit le même père, qui était son ami et qui assure avoir appris de sa propre bouche ce qu'il en raconte de plus singulier. J'ai tiré le récit que je fais de sa conversion d'une lettre originale de celui-là même dont Dieu se servit pour le convertir (1), qui reçut son abjuration, et qu'il reconnut toujours depuis pour son père spirituel, et son maître en la foi. Ayant puisé en de telles sources ce que je dis dans cette histoire, je crois qu'au défaut d'autres agréments, qu'un plus habile homme lui aurait pu donner, elle aura au moins celui de dire exactement la vérité.
Si par hasard je m'en étais écarté, soit par la faute de mes guides, soit par la mienne, je promets au lecteur de le détromper, sans craindre la honte de me dédire, dès que je m'en serai aperçu ou qu'on m'en aura averti. Je n'ai aucun sujet de me défier des mémoires que j'ai suivis, et autant qu'on peut être assuré de ces sortes de choses, je le suis de leur fidélité. Excepté ce qui est contenu dans les dix ou douze première pages de ce livre, touchant la jeunesse, l'éducation et l'avancement de M. Constance, dont il a néanmoins raconté lui-même ce qu'il y a de principal, tout le reste est de gens qui ont été témoins oculaires de ce qu'ils ont écrit et dont quelques-uns y ont beaucoup de part.
Je leur aurais au reste volontiers rendu l'honneur que mérite le soin qu'ils ont pris de nous instruire, si j'avais cru qu'ils ne l'eussent pas trouvé mauvais. Mais comme il y a des gens qui ne veulent pas être cités, et que quelques-uns de ceux dont je parle peuvent avoir des raisons particulières de ne le pas vouloir, j'ai jugé à propos de supprimer leur nom en mettant en œuvre les matières qu'ils m'ont fournies. J'en connais qui pourront un jour mettre leurs relations en lumière ; je suis obligé d'avertir le public que la lecture de celle-ci ne doit point ôter la curiosité de lire celles-là. Elles sont pleines de mille circonstances que je n'ai pas jugées de saison, mais qui sont fort bonnes à savoir, et que ceux qui aiment ces sortes de choses liront toujours avec plaisir.
Siam est aujourd'hui si connu en France que je ne crois pas qu'il soit nécessaire, quand on parle des dignités et des charges de ce royaume, d'expliquer ce que l'on entend par les mots qui les expriment. On sait ce que c'est que le barcalon, un Oya, un Opra, un talapoin, comme on sait ce que c'est que le grand Vizir, un bacha, un aga, un mufti.
Depuis l'impression de cet ouvrage, on m'a fait apercevoir que j'en avais retranché ce qui plairait le plus au grand pape à qui je le dédie, en supprimant le détail de ce que les chrétiens ont souffert dans la persécution de Siam. Pour déférer à cet avis, j'ai fini ce livre par une lettre que j'avais écrite à un de mes amis uniquement sur ce sujet, peu de temps après l'arrivée de vaisseaux (2). J'en ai seulement ôté ce que je disais de M. et de Mme Constance, pour ne pas dire deux fois la même chose.

NOTES
1 - Phaulkon était né dans une famille catholique, mais s'était converti au protestantisme lors de ses activités dans l'East India Compagny anglaise. Au Siam, deux jésuites œuvrèrent à son retour à la maison paternelle qu'il avait si malheureusement abandonnée : les pères Jean-Baptiste Maldonado et Antoine Thomas. Mais plus que les bonnes paroles des prêtres, c'est la perspective d'un mariage avec Marie Guyomar, luso-japonaise issue d'une famille profondément catholique qui entraîna la décision de Phaulkon. C'est ce relate le père de Bèze dans ses Mémoires sur la vie de Constantin Phaulkon (Drans et Bernard, p. 28-29) : Dieu se servit de la passion qu'il avait pour Mlle Guyomar afin de le tirer de cet état malheureux. L'opposition insurmontable qu'il trouva dans son père l'obligea à faire une sérieuse réflexion sur sa conduite. Il trouva que c'était pousser la reconnaissance trop loin à l'égard de son bienfaiteur que de lui sacrifier jusqu'à la religion ; qu'il avait maintenant de quoi reconnaître ses obligations, dont il l'avait prévenu, et qu'il ne devait plus trahir sa conscience par une lâche dissimulation. Il avait eu, outre cela, quelques entretiens avec le R.P. Thomas, supérieur de la maison des pères de la Compagnie à Siam, avec qui il avait fait connaissance, qui l'avaient frappé vivement et lui donnaient de terribles remords. Enfin, une lettre qu'il reçut en même temps de sa mère acheva de le déterminer. Cette vertueuse dame lui mandait que la joie qu'elle avait eue d'apprendre qu'il commençait à s'avancer dans le royaume de Siam avait été bien moindre que la douleur dont elle avait été pénétrée d'apprendre en même temps qu'il n'y vivait pas en bon catholique ; qu'elle eût bien mieux aimé le savoir pauvre et dénué de biens temporels, mais dans le chemin qui mène aux éternels, que de le voir hors de cette voie avec tous les biens du monde. Ensuite, lui en représentant la vanité et l'inconstance, elle le conjurait, par la tendresse qu'elle avait toujours eue pour lui, de songer plus sérieusement à son salut et que, s'il ne pouvait pas le faire à Siam, il vînt plutôt vivre auprès de ses parents dans la médiocre fortune que le Ciel leur avait donné. Les exhortations, dis-je, d'une mère qu'il aimait tendrement, jointe aux autres considérations, le firent enfin passer sur les obstacle qu'on mettait à sa conversion. Il alla trouver le R.P. Thomas, pénétré d'une vive douleur de ses désordres passés. Il lui en fit une confession générale et lui demanda ensuite, avec l'humilité et la soumission de l'enfant prodigue, à être reçu dans la maison paternelle qu'il avait si malheureusement abandonnée. ⇑
2 - Cette lettre est reproduite sur ce site à la page : Lettre de l'auteur de cette histoire à un jésuite de ses amis. ⇑

12 mars 2019
