

Troisième partie.
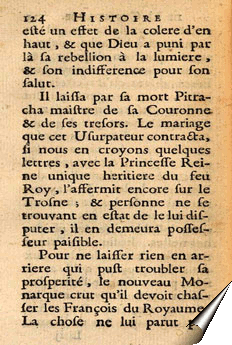
Pour ne laisser rien en arrière qui pût troubler sa prospérité, le nouveau monarque crut qu'il devait chasser les Français du royaume. La chose ne lui parut pas difficile depuis qu'il crut s'être assuré qu'ils quitteraient Bangkok et Mergui et viendraient avec leur général recevoir sa loi à Louvo. Le temps lui apprit qu'il s'était trompé. Dès que le général fut rentré dans sa place, il assembla ses officiers et ils furent tous d'avis qu'il n'en sortît plus. Le mauvais traitement qu'on avait fait aux six Français qui s'étaient voulus sauver servit de prétexte au général pour s‘excuser d'aller à la cour et d'y mener sa garnison, disant que cet exemple l'avait fait résoudre à ne point sortir de ses forts et à s'y défendre jusqu'à la mort si on l'y venait attaquer.
Il y avait heureusement dans Bangkok des vivres et des munitions de guerre autant qu'il en fallait pour soutenir un siège. Outre ce que M. Constance y en avait fait conduire, les officiers, qui avaient bien prévu que les discordes domestiques des Siamois se tourneraient en guerre contre les étrangers, s'étaient fournis de tout ce qu'ils avaient pu. Pendant le voyage de M. Desfarges, ils avaient disposé toutes choses à bien recevoir les ennemis et il trouva à son retour leurs batteries toutes dressées.
Aussi fut-ce le même jour que cette guerre commença, à l'occasion d'un bâtiment chinois qui était à l'ancre au-dessus de la place et qui voulut passer sans la saluer. Les Siamois qui le commandaient, car il était à leur service, avaient voulu profiter du trouble où ils croyaient alors les Français pour leur faire cette espèce d'insulte (1). Mais on s'aperçut de leur dessein, et on résolut de s'y opposer. Pour agir dans l'ordre, les sentinelles les avertirent de venir saluer ; ils refusèrent de le faire : on délibéra trop longtemps si on ferait tirer sur eux, M. Desfarges ne voulant pas qu'on pût dire qu'il avait commencé la guerre. On lui représenta que les Siamois l'avaient suffisamment déclarée par tout ce qui s'était passé à Louvo, et qu'il était bon même de commencer de bonne heure à faire des représailles sur eux pour tirer plus aisément de leurs mains ceux qui y étaient demeurés. Sur cette remontrance on tira, mais trop tard pour endommager le vaisseau qui, suivant le cours de la rivière, s'était déjà fort éloigné. Le bruit du canon néanmoins fit tant de peur à ceux qui étaient dedans qu'ils se jetèrent tous à l'eau et laissèrent aller leur bâtiment échouer sur le rivage à demi-lieue du fort.
Ce signal donné pour la guerre, on fit la revue de la garnison qui se trouva de deux cent cinquante Français et d'environ quarante Siamois qu'on garda pour les gros ouvrages. Ensuite, prévoyant qu'on aurait peine à conserver deux forts qu'on avait faits, on en démolit un à l'occident, pour en conserver un autre à l'opposite (2). C'était un conseil que M. Constance avait donné diverses fois, dont on vit bien la conséquence ; mais on la vit un peu trop tard, car on n'eut pas assez de temps pour faire jouer la mine et retirer tout le canon ; on éboula seulement les parapets, on retira vingt-deux pièces d'artillerie appartenant au roi de Siam et on en encloua douze. Mais comme on fit tout cela à la hâte, on ne le put si bien faire que les Siamois n'en tirassent encore beaucoup d'avantage. On s'aperçut bientôt qu'ils travaillaient à réparer le fort et à désenclouer le canon ; ainsi l'on fut obligé, pour achever ce qu'on n'avait fait qu'à demi, de les aller attaquer avant qu'ils s'y fussent logés. Le capitaine d'Acieu fut commandé pour faire cette expédition, avec La Dorbelaye, lieutenant, Du Hardil, enseigne, et vingt-deux soldats. Ces braves gens firent tout ce qu'on pouvait attendre de leur courage et de leur vigueur : mais s'étant mis dans deux chaloupes qui n'arrivèrent pas en même temps au fort, et ayant été obligés, à cause de la marée, de se jeter, en abordant, dans la vase jusqu'à la ceinture, ils ne purent forcer le grand nombre d'ennemis qu'ils trouvèrent à combattre et furent obligés de se retirer avec perte de trois ou quatre hommes. D'Acieu y reçut un coup de pique à la jambe, et La Dorbelaye y fut blessé au poignet d'un boulet de fer jeté d'en haut. Ainsi les Siamois conservèrent leur fort, qu'on ne put attaquer pendant le reste du siège autrement qu'à coups de canon, la garnison n'étant pas assez nombreuse pour exposer autant de monde qu'il en eût fallu pour le prendre autrement.
Pendant ces premières hostilités, Pitracha obligea les deux enfants de M. Desfarges à lui écrire pour lui signifier de sa part qu'il les allait faire mourir s'il ne se rendait incessamment à Louvo avec sa garnison. Le général répondit en brave homme qu'il était sensible au malheur de ses enfant autant qu'ils pouvaient l'imaginer, et que s'il n'eût fallu que sa vie pour sauver la leur, il l'aurait sacrifiée sans peine, mais que ne le pouvant faire sans manquer à son devoir, il les exhortait à suivre son exemple et à regarder comme un grand honneur de pouvoir souffrir quelque chose pour la cause de Dieu et le service du roi ; qu'au reste ils devaient s'assurer que leur mort serait bien vengée et qu'on ne répandrait pas impunément leur sang. Cette réponse donna de la crainte ou de l'admiration à Pitracha : loin de l'irriter contre les enfants du général, elle l'adoucit, et le porta à les lui renvoyer tous deux.
Cet expédient ayant manqué, l'usurpateur envoya chercher M. de Métellopolis et le chargea d'aller sommer le général de sa parole, le menaçant que si par le crédit que lui donnait son caractère il ne l'engageait à sortir de Bangkok, il ferait exposer à la bouche du canon tous les missionnaires du royaume (3). Le prélat ayant reçu ces ordres, et ne voyant point d'autre parti à prendre que celui d'obéir et de les porter, se met en chemin et arrive devant la place le deuxième de juin. Comme il y arriva dans le temps que les Français battaient le fort des ennemis avec le plus de violence, les Siamois le traitèrent mal et le voulurent obliger d'abord à se montrer aux siens du côté que le canon faisait le plus de fracas. Il leur représenta que le bruit empêcherait qu'il ne fût entendu et obtint terme jusqu'au lendemain, qu'ayant trouvé un intervalle favorable pour se faire entendre, il fit cesser les canonnades et lia une espèce de négociation où l'on commença à parler de paix.
Comme les Siamois néanmoins voulurent se servir de cette occasion pour réparer le dommage que le canon avait fait à leur fort, quoiqu'ils n'y travaillassent que la nuit, on s'en aperçut et on tira sur eux. Ils avaient désencloué leur canon et ils s'en servirent d'une manière à laquelle on ne s'attendait pas. Ils tirèrent aussi quelques bombes qui ne firent pourtant pas grand mal. On se lassa de part et d'autre et on reprit les négociations, mais ces négociations furent interrompues par de fréquents actes d'hostilité. Le détail en serait ennuyeux. Je ne puis cependant passer sous silence l'action déterminée d'un de nos Français qui les rendit extrêmement redoutables dans tout le royaume de Siam.
Un capitaine nommé Saint-Cricq (4) défendait la rivière avec une petite barque dont tout l'équipage, composé d'Indiens, était ivre, et dormait sur le pont. Il n'avait que deux personnes en état de combattre s'il était attaqué, comme il le fut en effet. Car les Siamois, s'étant aperçus du désordre de ses matelots, vinrent sur lui, et après avoir balancé quelque temps, se mirent en devoir de venir à l'abordage. Leur contenance fit peur à un de ceux qui devait défendre la barque. Il se déroba, se mit à la nage, et alla parler aux ennemis qui le prirent et le mirent aux fers, et qui ensuite, profitant de la terreur où ils s'imaginaient que cette aventure avait jeté Saint-Cricq, montèrent en foule dans la barque. Dès que Saint-Cricq s'était aperçu de leur dessein, voyant bien qu'il ne résisterait pas et ne voulant pas tomber entre les mains des barbares, il avait disposé sur son pont avec son soldat, nommé Lapierre, aussi déterminé que lui, une partie de ses poudres, ses grenades, et ses mousquets chargés ; et ayant laissé monter dans sa barque un grand nombre de ces infidèles, de la porte de sa chambre il mit le feu aux poudres, qui les firent tous sauter en l'air ou tués, ou blessés, ou fort étourdis. Ni lui ni son soldat n'eurent point de mal, mais la barque souffrit beaucoup et, ne pouvant plus être gouvernée, elle erra quelque temps et échoua. Les Siamois croyant alors que toutes les poudres étaient usées revinrent sans crainte, et montèrent en plus grande foule qu'auparavant. Ils croyaient être en sûreté et pouvoir piller à leur aise, lorsque Saint-Cricq, mettant le feu à des barils qu'il avait réservés, fit jouer une seconde fougadeOu fougasse. Espèce de mine qui n'est qu'un petit fourneau en forme de puits, large de deux à trois mètres et profond de trois à quatre, qu'on charge de barils de poudre ou de sacs à poudre, et qu'on fait jouer par le moyen d'une saucisse. La fougasse à bombes consiste dans la réunion de plusieurs bombes enterrées qui éclatent à la fois. (Littré). qui fit périr plusieurs des ennemis ; mais il y périt lui-même, n'ayant pu à temps se jeter à l'eau. Son soldat le fit et aborda le sabre à la main sur le rivage, où accablé par la multitude de ces barbares qui fondirent sur lui, après en avoir tué cinq, il tomba parmi eux percé de coups.
On ne peut dire combien cette action acquit de gloire à nos Français. Pitracha dit que c'était dommage que de si braves gens s'obstinassent à périr, et l'écrivit même à Bangkok, ajoutant qu'après tout, malgré toute leur bravoure, il n'avait qu'à se tenir en repos et à empêcher qu'il ne leur vînt des vivres pour les faire mourir de faim, de fatigues, et de maladies. On lui répondit courageusement que, quand on n'aurait plus de quoi vivre, on irait chercher la mort parmi les Siamois, mais qu'en la cherchant on la porterait à beaucoup d'autres.
Nonobstant ces actions et ces discours, qui marquent une guerre assez vive et assez animée, on renouait toujours les négociations de paix. Le mandarin chef de l'ambassade de France en 1686, que Pitracha avait fait barcalon en montant sur le trône (5), était venu à Bangkok, demeurer dans le fort des Siamois, pour traiter plus commodément et éviter les trop grandes longueurs. On était parvenu jusqu'à convenir que le roi de Siam fournirait des vaisseaux aux Français pour se retirer à Pondichéry, sur la côte de Coromandel, où la Compagnie des Indes a un comptoir, lorsque la mauvaise foi des Siamois renouvela la mésintelligence et retarda l'exécution du traité. Car au lieu de fournir des vaisseaux aux troupes françaises, comme ils l'avaient promis, ils ne leur présentèrent que de mauvaises barques, capables de les faire périr. Le général voulut acheter un bâtiment anglais qui était sûr, mais on le voulut vendre si cher qu'on perdit l'envie de l'acheter.
Ce fut dans cette conjoncture qu'arrivèrent dans la rivière, sur la fin de juillet et au commencement d'août, deux vaisseaux du feu roi de Siam commandés par deux capitaines français, Sainte-Marie et Suart. Il n'en fallait pas davantage pour mettre bientôt à la raison toute la nation siamoise, si Suart et Sainte-Marie eussent été avertis de l'état des choses. Mais comme ils le croyaient toujours tel qu'ils l'avaient laissé en partant, ils furent trompés par les Siamois qui gardaient l'embouchure du fleuve, et engagés adroitement à désarmer leurs deux vaisseaux avec lesquels ils auraient pu se rendre maître de la mer.
Suart arriva le premier et trouva la rivière fermée, mais pour lui ôter les ombrages qu'il aurait pu prendre de là, les Siamois qui gardaient l'entrée du fleuve n'eurent pas plutôt vu le vaisseau, qu'ils y allèrent ; et comme si les choses eussent toujours été au même état, ils firent des civilités à ce capitaine et lui portèrent des rafraîchissements. Ils lui dirent que M. Constance l'avait longtemps attendu à la tabanqueLa tabangue, ou la tabanque était une sorte d'octroi, de poste douanier sur la route d'Ayutthaya., mais que des affaires pressantes l'avaient obligé de retourner à la Cour ; qu'il l'y trouverait et qu'il en serait reçu d'autant plus agréablement qu'il arrivait à propos pour secourir le roi contre les peuples de Cambodge, avec lesquels il y avait quelque temps qu'il avait guerre par mer et par terre. Suart ne se défiait de rien, et depuis qu'il était parti, ne s'étant appliqué qu'à ce qu'on lui avait ordonné de faire, qui était de donner la chasse à des corsaires qui infestaient la mer, il n'avait rien appris de ce qui s'était passé dans le royaume. Ainsi il fut aisément surpris par ces artificieux barbares entre les mains desquels il laissa son vaisseau, après qu'il fut entré dans la rivière, et qu'il eut désarmé. Ils lui présentèrent un mirou (6), dans lequel il se mit lui et son équipage pour aller à Bangkok voir le général. Les Siamois qu'on lui donna pour conduire son mirou tâchèrent en arrivant près de la place de le conduire au fort dont ils étaient maîtres, mais les Français s'étant aperçus de quelque changement dans ce fort, et entrant par-là en quelque défiance, les obligèrent à les mener à l'autre ; ce que les Siamois furent contraints de faire, parce qu'ils n'étaient pas les plus forts. Si Suart fut surpris d'apprendre le changement des affaires du royaume, les officiers de la garde furent bien fâchés qu'il ne l'eût pas appris plus tôt et qu'il eût rendu son vaisseau. Leur chagrin augmenta quelques jours après, que Sainte-Marie étant arrivé et étant entré dans la rivière, malgré de fort sages précautions qu'il avait prises pour ne pas tomber dans un pareil inconvénient, y tomba néanmoins par un malentendu qui rendit sa prudence inutile.
Cette aventure différa encore la conclusion de l'accommodement, les Siamois espérant toujours que la nécessité et le manquement de vivres obligeraient enfin les Français à prendre les barques qu'ils leur offraient. On demanda à acheter les deux vaisseaux qu'on venait de rendre. La chose fut mise en négociation, mais les Siamois ne concluant rien, on se trouvait en de grandes extrémités lorsque l'Oriflamme, vaisseau français commandé par M. de l'Estrille, parut à la barre de Siam environ le quinzième d'août (7). La grosseur de ce bâtiment épouvanta fort les Siamois. Ils tâchèrent, par leurs artifices ordinaires, d'empêcher que les assiégés n'en tirassent plus d'avantage que des deux autres, et peu s'en fallut qu'ils n'y réussissent. Le vaisseau avait passé à Batavia où l'on n'avait aucune nouvelle de ce qui était arrivé à Siam. Ainsi M. de l'Estrille n'ayant pas sujet de se défier du changement, entra dans le MénamLa Mae Nam Chao Phraya (แม่น้ำเจ้าพระยา), fleuve qui arrose notamment Nakon Sawan, Ayutthaya et Bangkok. avec confiance, et alla mouiller à la barre. Les Siamois, continuant leur manège, allèrent avec empressement à son bord, lui portèrent toute sorte de rafraîchissements et eurent l'adresse de les accompagner de beaucoup de démonstrations d'amitié, qui avaient assez l'air d'être naturelles. Comme il ne vint pas en pensée d'en douter, on s'y laissa aisément surprendre et l'on commença à débarquer. On avait déjà mis à terre quelques officiers et cinquante soldats, lorsque les Siamois, qui ne se crurent pas assez forts pour arrêter un si grand nombre de Français braves et bien armés, jugèrent à propos de renvoyer les soldats dans leur vaisseau, sous prétexte que M. Constance n'avait pas encore pourvu à leur logement, et ne retinrent qu'un capitaine nommé Cornuel, un lieutenant, et assez peu d'autres officiers. Ceux-ci ne doutaient point qu'on ne les menât à Bangkok, comme ils l'avaient demandé, mais ils furent assez surpris quand, après bien des tours et des détours par des chemins qui leur étaient inconnus, ils se trouvèrent rendus à Siam. Dès qu'ils y furent arrivés, on les conduisit chez le barcalon, que ses affaires avaient appelé depuis quelques jours dans la capitale. Un officier de Bangkok, nommé Des Rivières, était actuellement chez lui où il négociait pour l'embarquement des troupes qui devaient sortir de la place. Ceux qui conduisaient Cornuel et ses compagnons en ayant été avertis, eurent soin de les tenir à l'écart jusqu'à ce que Des Rivières fût sorti, pour lui ôter la connaissance de l'arrivée du vaisseau français. Leur ruse avait assez réussi. Des Rivières était sorti de chez le barcalon et Cornuel y était entré sans qu'ils se fussent vus l'un l'autre, lorsqu'un Portugais avertit le premier qu'il était arrivé à la barre un navire de France dont les officiers entraient en ce moment chez le barcalon. À cette nouvelle, Des Rivières retourne, et entrant brusquement chez le ministre malgré les gardes qui voulurent l'arrêter, il y trouva en effet Cornuel et les officiers qui l'accompagnaient. Le barcalon fit paraître beaucoup de présence d'esprit en cette rencontre. Cette surprise ne l'embarrassa point, et se tirant en habile homme du mauvais pas où il se trouvait : Ah M. Des Rivières, s'écria-t-il, venez, vous rentrez fort à propos : j'allais envoyer après vous. Voici des messieurs qui vous diront des nouvelles de France, et vous leur en apprendrez des vôtres. Ces paroles furent suivies d'une conversation vague où tout le monde fut fort distrait. Ensuite de quoi les Français, ayant tous ensemble pris congé du barcalon, s'instruisirent mutuellement de ce qu'ils ignoraient touchant les affaires présentes, et rendirent inutiles les entreprises des Siamois contre l'Oriflamme. La présence même de ce vaisseau ne contribua pas peu à leur inspirer une docilité qu'ils n'avaient pas. Ils commencèrent à se montrer plus faciles à fournir de bons vaisseaux pour l'embarquement de la garnison, et convinrent enfin de donner trois frégates, à condition que pour en assurer le retour, M. de Métellopolis et Véret, chef de la faiturie française, que l'on avait fort employés à négocier et à conclure ce traité, demeureraient en otage.
On en était là, lorsque l'arrivée de Mme Constance à Bangkok y causa de grands mouvements. Avant que d'écrire plus en détail cette dernière de ses aventures, au moins de celles que nous savons, il faut reprendre d'un peu plus haut la suite tragique de son histoire.
Il n'est point de malheur où l'on a au moins l'avantage de ne plus rien craindre. Mme Constance croyait y être parvenue depuis qu'on eût fait mourir son mari, mais l'événement lui fit voir qu'elle n'en était pas encore là. La dureté de sa destinée fut telle que la mort de son mari lui devint un médiocre mal en comparaison de l'amour que conçut pour elle celui-là même qui en avait été le meurtrier. Soit esprit de débauche, soit vraie passion, Soyatan en devint amoureux et n'omit rien pour s'en faire aimer. Pour la moins effaroucher, il lui fit représenter d'abord, qu'étant veuve et en liberté, elle pouvait sans blesser son devoir passer à un second mariage, et qu'il ne lui serait point honteux d'être mise au nombre de ses femmes ; puis la prenant par son intérêt, il lui fit dire que c'était le moyen de mériter sa protection pour elle et pour son fils, qui sans cela demeurerait exposé aux ressentiments et à la vengeance de tous les ennemis de son père.
On ne peut dire combien ce discours fit d'horreur à Mme Constance, et combien il lui fit sentir toute la dureté de sa mauvaise fortune. Soyatan a-t-il oublié ce que je suis, répondit-elle ? Ne sait-il pas que je suis chrétienne et que ma religion me défend un mariage si monstrueux ? ignore-t-il comme j'ai vécu ? et s'il le sait, comment ose-t-il faire une telle proposition à une femme qui a aimé son mari et qui a quelque réputation d'être attachée à son devoir ? Dieu ordonnera ce qu'il lui plaira de ma destinée et de celle de mon fils, mais on ne me reprochera jamais que j'aie racheté ma vie ni la sienne par une si honteuse faiblesse.
Ce refus ne fit qu'irriter la passion du jeune prince, qui devint plus violente par la résistance. Il redoubla ses sollicitations et employa diverses personnes auprès de Mme Constance pour lui persuader de ne s'ôter pas l'unique ressource que la fortune lui présentait dans sa disgrâce. Il lui fit faire des promesses qui auraient flatté l'ambition d'une autre, et pour lui donner quelque sorte de gage de sa fidélité à les accomplir, il ordonna qu'on lui laissât plus de liberté qu'auparavant. Il voulut néanmoins qu'on l'empêchât de parler aux jésuites, parce qu'on lui avait dit que ces pères lui donnaient des conseils contraires à ses intentions. Tout cela fut également inutile pour avancer les desseins du prince. Mme Constance fut toujours ferme à rejeter ses propositions et ne montra jamais plus d'horreur pour lui que quand il témoigna plus d'empressement pour elle. Elle s'imaginait qu'enfin ses rebuts lui attireraient la haine d'un jeune homme féroce et emporté : elle se trompa encore en cela. Soyatan ne cessa point de l'aimer, mais il l'aima désormais en tyran, et résolu d'avoir par force ce qu'il ne pouvait obtenir de gré, il la fit enlever par quatre Maures et conduire dans son palais. On peut juger de l'affreux état où se trouva cette pauvre femme quand elle se vit entre les mains de ces ministres impitoyables de la violence d'un furieux. Ce fut bien pis quand elle se vit dans sa maison, sans autre défense que ses larmes et les cris lamentables qu'elle poussait. Ils lui furent de grand secours dans cette occasion. Soyatan eut peur qu'ils n'allassent jusqu'aux oreilles du roi son père, qui n'approuvait pas ses débauches et à qui une pareille action ne pouvait que causer beaucoup de chagrin. Cette considération l'obligea à la renvoyer dans le lieu d'où on l'avait enlevée, mais elle n'éteignit pas sa passion. Dès le lendemain il lui envoya un des médecins du roi pour lui déclarer que si elle persistait à s'opposer à ses volontés, il la ferait mourir, elle et son fils. Il fit ajouter des menaces contres les jésuites qui continuaient à l'exhorter à la résistance. Elle eut en effet la consolation que ces pères ne l'abandonnèrent point dans tous ses combats et que, malgré les défenses du prince, la charité qui est ingénieuse leur fit toujours trouver les moyens de lui parler pour l'affermir. Leur zèle était fortement secondé par celui de sa vertueuse aïeule qui, à l'âge de quatre-vingt huit ans, n'ayant rien perdu de l'ardeur et de la vivacité de sa foi, lui parlait continuellement des fameux martyrs du Japon dont elle avait l'honneur d'être issue. Ah ma fille, lui disait-elle, qu'il y a de gloire à être martyre. Vous avez en cela l'avantage qu'il semble que le martyr soit un bien héréditaire dans votre famille. Si vous avez tant de sujet de l'espérer, quel soin ne devrez-vous point prendre de le mériter ?
Soutenue par de si fortes exhortations, Mme Constance résistait avec une fermeté héroïque aux recherches de Soyatan, lorsque ce prince lui supposa un crime de péculatProfit personnel fait sur des deniers publics par un homme auquel l'administration ou le dépôt en est confié. (Littré). pour l'intimider. Dans un livre de comptes de M. Constance qu'un parent de sa femme tenait, on avait trouvé une somme de quinze mille livres, données sans en marquer l'emploi. Soyatan ne l'eut pas plutôt appris qu'il fit mettre en prison le comptable et citer Mme Constance devant un juge qui lui demanda ce qu'était devenu cet argent. Elle répondit simplement qu'elle n'avait eu soin durant la vie de son mari que de donner à ses commis l'argent qu'ils lui demandaient de sa part, sans s'informer à quoi on l'employait. Le juge parut content de cette réponse, et Mme Constance ne croyait pas que cette affaire dût avoir de suite ; mais lorsqu'elle y pensait le moins, ce même juge, gagné par Soyatan, la vint trouver pour lui dire en secret que si dans trois jours elle ne donnait à ce prince de meilleures espérances qu'elle n'avait fait jusque-là, il était résolu de la faire condamner à recevoir cent coups de bâton, et qu'il serait obligé malgré lui d'être le ministre de cette vengeance. Quoi, répondit Mme Constance, vous seriez homme à faire cette injustice, connaissant mon innocence comme vous la connaissez ? Ce scélérat fut sincère en cette rencontre : M'en pourrais-je défendre, Madame ? lui répliqua-t-il sans hésiter. Je serais un homme perdu si je faisais autrement. Non, il ne faut pas que vous doutiez de votre condamnation ni de votre supplice, si dans trois jours le prince n'est content. À ces paroles Mme Constance se sentit le cœur saisi et pleura amèrement, mais sa douleur ne l'abattit point assez, pour l'empêcher de dire au juge avec un courage que les pleurs n'amollissaient point que son parti était pris et qu'elle était prête à tout souffrir, pour conserver à Dieu et à son époux la fidélité qu'elle leur avait vouée.
Pendant que l'inique magistrat allait faire rapport à son maître du peu de succès de sa négociation, Mme Constance fit venir son confesseur et employa les trois jours qu'on lui avait donnés à se préparer à mourir. En effet, ce terme expiré, on la cita à comparaître et on la conduisit dans le lieu où on lui devait prononcer sa sentence. Elle n'y fut pas plutôt qu'on l'interrogea tout de nouveau sur l'emploi de l'argent dont il s'agissait : à quoi ayant répondu comme la première fois, on la condamna à la peine dont elle avait été menacée. Elle n'en put souffrir que la moitié : elle s'évanouit et fit craindre qu'elle n'expirât sous les coups. Sa famille, qu'on n'accusait point d'avoir eu part à son prétendu crime, en eut néanmoins à ses tourments : trois de ses oncles, deux de ses tantes, et l'aîné de ses frères furent cruellement battus en sa présence, et si le grand âge de son aïeule, sa faiblesse et les infirmités n'eussent donné quelque compassion, sa vertu, qui la rendait si vénérable ne l'eût pas exemptée du supplice.
Jamais personne malheureuse ne vit le jour avec tant de chagrin que Mme Constance en cette rencontre quand, étant revenue de son évanouissement, elle apprit qu'elle n'était pas délivrée de la persécution de Soyatan ; car à peine avait-elle repris ses esprits que ce barbare amant recommença ses poursuites, et témoigna depuis en toute occasion qu'il était résolu de ne les point cesser qu'il ne fût venu à bout de son dessein.
On peut juger en quelle inquiétude vivait cependant cette vertueuse personne, tous les jours à la veille d'être tout de nouveau enlevée et enfermée dans un sérail pour y être compagne de la captivité d'une troupe de femmes païennes, qui sous le faux nom d'épouses, étaient les victimes dévouées à l'incontinence de ce brutal. Mais ce fut bien pis quand, ayant été transportée de Louvo au palais de Siam, on lui montra un appartement que le prince lui faisait bâtir et qui était même déjà avancé. On ne peut exprimer la douleur que lui causa cette triste vue et l'état affreux où elle la mit.
Ce fut en ce temps-là que la garnison de Bangkok conclut la capitulation. Cette nouvelle fut à Mme Constance un nouveau coup de foudre qui l'atterra, le départ des Français la privant de tout ce qui lui restait d'amis et de consolation à Siam. Comme il arrive néanmoins que les grands courages ne font jamais de plus grands efforts que quand ils se sentent plus accablés, ce fut en cet état que Mme Constance prit une résolution où en risquant tout, elle avait sujet d'espérer que si elle réussissait, elle sauverait tout.
Sa mère était tombée malade dans la maison d'une femme de ses amies, chez qui elle s'était retirée au quartier des Japonais. Comme les Siamois n'ont rien de plus sacré que les devoirs des enfants envers leurs parents, Mme Constance obtint aisément permission d'aller soulager sa mère. Pendant qu'elle était là, le capitaine de la faiturie hollandaise lui alla faire offre de service, et lui demanda même son fils, pour le mettre sous la protection du général de Batavia. Cette honnêteté toucha Mme Constance : elle ne put s'empêcher de témoigner de la confiance à un homme qui lui témoignait de l'amitié, dans un temps où il n'en pouvait avoir d'autre motif qu'une générosité fort désintéressée. Elle lui donna son fils pour quelques jours, et le lui aurait laissé tout à fait si la religion du capitaine ne l'avait obligée de le lui redemander, aimant mieux le voir exposé aux injures et à la vengeance des ennemis de sa maison que le voir comblé des grâces d'une nation qui le pouvait rendre ennemi de l'Église.
Ce fut sur ces entrefaites qu'un officier français nommé Sainte-Marie, brave homme et déterminé soldat, étant venu chercher à Siam de quoi équiper les vaisseaux qui devaient porter à Pondichéry la garnison de Bangkok, alla voir Mme Constance et lui fit offre non seulement de son service, mais de son argent. Cette civilité fit naître à la dame un dessein hardi, dont elle n'osât encore s'expliquer, parce qu'elle en voulait demander avis à des personnes de confiance. Comme elle jugea néanmoins à l'air et aux discours de Sainte-Marie qu'il était l'homme qu'il lui fallait pour exécuter ce qu'elle méditait, elle l'engagea à la revenir voir. Pendant ce temps-là elle consulta ses amis sur la pensée qui lui était venue de se servir de Sainte-Marie pour se faire mener à Bangkok où, sous la bannière du grand roi qui l'avait tant de fois assurée de l'honneur de sa protection, elle ne doutait pas qu'elle ne trouvât un asile inaccessible à ses ennemis. Ceux à qui elle s'ouvrit là-dessus trouvèrent l'entreprise hasardeuse et de difficile exécution. Nous ne doutons pas, lui dirent-ils, que vous ne soyez en assurance dès que vous serez à Bangkok. Mais avez-vous fait réflexion aux périls qu'il vous faut essuyer avant que vous y arriviez ? Si on vous reconnaît, si on vous arrête en chemin, à quoi ne devez-vous point vous attendre ? Mme Constance répondit à ceux qui lui parlèrent ainsi qu'elle avait prévu toutes ces suites d'une fuite si périlleuse mais que celles de sa demeure à Siam avaient quelque chose de si affreux qu'il n'y avait point de périls auxquels elle ne dût s'exposer pour tâcher à les éviter. Car enfin, leur dit-elle, il ne s'agit de rien moins que de mon honneur et de la religion de mon fils. Si je demeure ici, je suis en proie à tout l'emportement d'un prince brutal et mon fils en danger d'être enfermé dans une maison de talapoins, obligé d'aller aux pagodes et élevé dans les superstitions du pays. De tous les dangers, n'est-ce pas là le plus grand ? et tous ceux que je puis courir pour l'éviter lui sont-ils comparables ?
Il n'y avait rien à répondre à ce discours, et on ne pouvait qu'approuver de si justes raisons d'une entreprise que les conjonctures rendaient nécessaire. Elle devint même pressée peu d'heures après. Soyatan n'attendait plus patiemment, et l'appartement qu'il faisait bâtir à Mme Constance étant prêt, il lui envoya une de ses parentes pour lui dire que le lendemain elle la conduirait au palais où elle aurait la satisfaction de vivre désormais avec elle et de lui tenir bonne compagnie. Elle l'entretint ensuite de la passion du prince et l'assura qu'elle était plus forte et plus allumée que jamais.
Sans l'espérance de la fuite que Mme Constance méditait, ce discours l'aurait accablée ; mais se soutenant par la pensée qu'elle allait tenter sa liberté et qu'elle y pourrait réussir, elle demanda à la personne qui lui était venu parler de la part de Soyatan encore quelques jours de délai, afin qu'elle eût la satisfaction de laisser sa mère en santé et de loisir de se remettre elle-même de quelque indisposition.
Justement dans cet intervalle Sainte-Marie la revint voir, sur le point de retourner à Bangkok. Elle le reçut comme un ange du ciel envoyé pour sa délivrance. Elle s'ouvrit à lui de son dessein, et le pria par tout ce qu'elle crut le plus capable de le toucher de l'aider à l'exécuter. Vous avez été, lui dit-elle, ami de feu M. Constance. Je vous conjure par sa mémoire de sauver l'honneur à sa femme et la religion à son fils. Vous voyez l'état où je suis, dans la nécessité de fuir ou d'être enfermée pour jamais dans un lieu plus affreux pour moi que la prison et le tombeau même. Vous m'avez offert vos services avec tant de générosité que je me suis dès lors flattée de trouver en vous mon libérateur. Menez-moi avec vous à Bangkok, c'est un asile assuré pour moi, et un brave homme comme vous peut risquer quelque chose pour m'y conduire. Il n'était pas besoin d'un discours si touchant ni des larmes dont Mme Constance l'accompagna pour engager Sainte-Marie à une action si digne d'un homme de cœur. Il lui promit toute sorte d'assistance et s'engagea à la venir prendre à l'entrée de la nuit d'un jour qu'il lui marqua.
Ce fut le troisième d'octobre qu'ayant disposé avec soin les choses nécessaires au voyage, il se vint présenter à sa porte, bien armé et bien résolu de tout risquer pour la sauver. Jamais entreprise hasardeuse ne réussit plus heureusement. Mme Constance ayant suivi Sainte-Marie avec son fils et une femme de chambre, entra à la faveur des ténèbres dans un balon qui les attendait, et le signal donné aux rameurs, on prit la route de Bangkok.
À ce départ, Mme Constance sembla oublier tous ses malheurs, dans l'espérance qu'en peu d'heures elle serait tirée des mains de Soyatan. Afin même que quoi qu'il arrivât, elle ne courût plus risque d'y retomber, elle pria son conducteur qu'en cas qu'ils fussent arrêtés, il les jetât dans la rivière elle et son fils. Sainte-Marie ne fut pas dans la peine de lui déplaire en se défendant de déférer à cette prière. Quoique Bangkok soit éloigné de près de vingt-cinq lieues de la capitale et qu'il y eût sur tout le rivage des corps de garde disposés pour empêcher que rien ne passât sans permission du barcalon, le petit balon fut si heureux qu'il arriva le lendemain à Bangkok sans mauvaise rencontre.
Il n'est pas aisé de dire lequel des deux vit le port avec plus de joie, de Mme Constance ou de son libérateur. Si le plaisir de se voir libre était grand dans celle-là, celui d'avoir délivré une personne illustre du plus affreux état qui fut jamais était extrême dans celui-ci ; et il augmenta dans l'un et dans l'autre par les applaudissements que donnèrent à une action si heureuse pour la dame et si glorieuse pour le cavalier, les officiers de la garnison qui en furent informés les premiers. Mais ils furent tous deux bien surpris quand ils apprirent que le gouverneur n'était pas du sentiment des autres, qu'il avait résolu de punir Sainte-Marie et de ne point voir Mme Constance. Ce fut pour cette pauvre femme un coup de foudre qui la frappa d'autant plus vivement qu'elle s'y était moins attendue. Quoi, dit-elle, sous la bannière de France, qui est l'asile de tous les malheureux, la veuve de M. Constance est la seule qui n'en trouve pas ! Ceux qui se rencontrèrent autour d'elle la consolèrent le mieux qu'ils purent et les officiers la rassurèrent, lui disant qu'elle n'eût point de peur, qu'elle était sous la protection du roi et qu'elle avait de bons défenseurs. La suite fit voir qu'ils parlaient de bonne foi, car après quelques négociations entre le gouverneur et le barcalon, le premier ayant jusqu'à deux fois assemblé le Conseil de guerre pour délibérer sur cette affaire, quoi qu'il pût dire pour montrer qu'il était du bien de la religion et du salut de la nation même qu'on renvoyât Mme Constance, il ne persuada que ses deux enfants, et tout le reste d'officiers d'une commune voix opiniâtra à la garder, disant qu'il leur serait honteux qu'elle eût inutilement imploré le nom et la protection du roi, qu'elle pérît sous le pavillon de France et qu'il n'y avait personne parmi eux qui ne versât volontiers son sang pour une telle cause.
La prudence d'un officier général a des maximes différentes de celles qu'inspire aux particuliers une valeur déterminée à tout risquer pour faire une belle action. Le gouverneur de Bangkok fut ferme dans son sentiment et résolut de renvoyer Mme Constance à Siam. Pour faire néanmoins la chose avec moins de violence, il tâcha de l'engager à y consentir, et lui envoya, pour lui persuader de faire ce sacrifice au bien public, une personne d'un caractère à donner beaucoup de force à l'éloquence (8).
Cette personne l'étant allé trouver dans un logis que M. de Vertesalle, qui depuis trois mois couchait au bivouac, avait eu l'honnêteté de lui céder, commença son discours par l'éloge du gouverneur et de son zèle pour la religion, puis venant à elle, lui dit qu'elle devait entrer dans ses sentiments là-dessus et préférer le repos des chrétiens de Siam au plaisir qu'elle aurait de passer en France. Mme Constance répondit à cela avec assez de tranquillité que le désir de voir la France n'était point ce qui lui avait fait quitter Siam, mais la nécessité de sauver son honneur et la religion de son fils ; que pour preuve de cela, on la conduisît à Goa ou Macao, et qu'elle ne demandait rien de plus. Celui qui lui parlait répliqua qu'elle était louable d'avoir ce soin de la conservation de son honneur et de la religion de son fils. Mais, ajouta-t-il, si les affaires s'accommodent de telle sorte que vous pussiez rester à Siam sans courir de risque, ni pour votre honneur ni pour la religion de votre fils, ne vous croiriez-vous pas obligée d'y demeurer, pour n'exposer pas la chrétienté du pays, la Compagnie française, le séminaire, la garnison de Bangkok et votre propre famille à une perte inévitable ? Mme Constance ne put souffrir la continuation de ce discours. Ne prétendez pas, reprit-elle, m'éblouir par ces grands noms. Le roi de Siam n'a pas intention de persécuter personne à mon occasion. Eh ! quels chrétiens à l'heure qu'il est pourraient craindre la persécution ? ses sujets ? je n'en connais point. Les Portugais ? ils sont devenus ses amis. Pour les Français, croyez-moi, Monsieur, ce prince ne les attaquera plus ; il craint trop leurs armes et la puissance du grand monarque qui les a envoyés. L'évasion d'une femme malheureuse ne lui fera point recommencer une guerre qu'il est fort aise de voir finie. Pour ma famille, loin de souhaiter que je demeure dans le royaume, elle a au contraire grand intérêt que j'en sorte, puisque ma liberté est l'unique ressource qui reste aujourd'hui à mes parents. D'ailleurs, je suis maîtresse de mes actions, et je ne dois sacrifier à aucun intérêt mon honneur et la religion de mon fils. Je connais mes proches : ils répandront volontiers leur sang pour cette cause. Mais enfin, de quelque manière que les affaires s'accommodent, quand les troupes seront une fois parties, quelle sûreté me donnez-vous contre les violences du jeune barbare ? Ici la personne dont nous parlons proposa à Mme Constance un expédient qu'on avait trouvé pour la délivrer de cette inquiétude, qui était de la marier à un Portugais, parce que les Siamois étant accoutumés à respecter le mariage, ce serait une digue à la passion du prince qui l'arrêterait infailliblement. Outre que pour l'en garantir davantage, on insérerait dans le traité de paix qu'elle demeurerait à Siam sous la protection du séminaire. Cette proposition fit rougir la vertueuse femme. Elle baissa les yeux toute confuse et en laissa couler des larmes qui lui ôtèrent pour quelque temps la parole. Quand elle fut revenue à soi : Est-ce donc vous, s'écria-t-elle, appelant celui qui lui parlait par son nom, qui me tenez un tel discours ? et pouvez-vous me le tenir sans en être touché aussi bien que moi ? Quoi ? à peine suis-je bien assurée que M. Constance soit mort, à peine ai-je eu le temps de le pleurer, et vous me proposez un second mariage ! En vérité croyez-vous qu'on approuvât en France que vous m'eussiez engagée à épouser un Portugais inconnu, étant veuve d'un homme que le roi avait honoré d'un collier de ses ordres (9), et de tant d'autres marques de considérations ? Vous me dites que les Siamois respectent les liens du mariage : Soyatan les a-t-il respectés dans la personne de tant de femmes chrétiennes qu'il a fait enlever à leurs maris ? Vous m'assurez de la protection du séminaire : Eh ! Le séminaire lui-même s'est-il pu garantir du pillage ? Si quelque protection était capable de m'assurer contre mes ennemis, c'était celle du grand monarque dont j'ai deux lettres qui en font foi. Puisque celle-là m'est rendue inutile, je n'en attends plus que de Dieu. Vous pouvez dire à M. le général que personne ne m'obligera jamais d'accepter le parti qu'on me propose. Je le prie d'avoir pitié de moi, mais si je ne le puis toucher, qu'il laisse entrer les Siamois pour m'égorger moi et mon fils, s'ils nous craignent encore l'un ou l'autre. Ma vie n'est pas assez heureuse pour la conserver à ce prix, mais mon honneur m'est trop cher pour l'exposer à un péril que personne ne connaît mieux que moi.
Un discours si touchant fit cesser une conversation qu'on ne pouvait plus longtemps soutenir de part ni d'autre et dont la continuation aurait été inutile, Mme Constance étant résolue de ne retourner à Siam que quand elle y serait forcée et le gouverneur s'opiniâtrant de son côté à l'y renvoyer. Ce fut le dix-neuvième du mois que se termina cette affaire. On avait transféré Mme Constance de la maison de M. de Vertesalle dans le donjon du fort, où elle attendait avec une profonde tristesse la fin tragique de son aventure. Un officier de la garnison la lui vint annoncer de la part du gouverneur (10). Elle en fut touchée, mais elle ne résista point. Elle protesta seulement contre la violence qu'on lui faisait sous la bannière de son auguste protecteur. Elle remercia les officiers de la place de la bonne volonté qu'ils lui avaient témoignée, elle se tourna vers le supérieur des jésuites qui était là pour lui dire adieu, et lui marqua en des termes touchants combien elle se sentait obligée des soins, des assiduités, de l'amitié constante des pères de cette Compagnie : Vous n'abandonnez point vos amis, vous autres, lui dit-elle, mes pères. Vous avez aimé M. Constance dans la bonne et dans la mauvaise fortune, vous avez été sensibles aux malheurs de sa famille, Dieu sera votre récompense.
Pendant qu'elle parlait ainsi, un vieux mandarin, l'un de ceux qu'on a vus ambassadeurs en France (11), se présenta pour la conduire au rivage où il lui avait amené un balon. Elle acheva ses adieux et le suivit avec son fils, la femme qu'elle avait amenée et un ecclésiastique du séminaire qu'on lui donna pour l'accompagner. On peut juger en quelle tristesse tomba cette vertueuse dame quand, s'étant enfin embarquée, elle commença à s'éloigner d'un lieu où elle s'était flattée de trouver la fin de tous ses malheurs et un asile inviolable contre les persécutions de ses ennemis. Mais quel redoublement de chagrin et quelles alarmes ne ressentit-elle point à la vue de Siam, qui était le terme de son funeste voyage ? Si elle n'y eût craint que la mort, elle y serait entrée avec moins de répugnance, mais la pensée que c'était là la demeure de Soyatan, qu'elle l'allait revoir, qu'il allait recommencer son importune persécution, qu'elle se reverrait exposée aux emportements de ce prince violent, était pour elle un supplice si cruel que tout ce qu'elle avait enduré jusque-là lui paraissait doux en comparaison. Outre ce qui concernait sa personne, ce qui regardait celle de son fils redoublait continuellement ses frayeurs, et il avait cela de commun avec elle qu'il avait rien de moins à craindre que la mort. Le danger d'être enlevé à sa mère et d'être mis dans un monastère d'idolâtres était quelque chose de bien plus fâcheux, surtout pour un enfant de cet âge.
Ce fut avec ces tristes idées que Mme Constance arriva à Siam. Elle n'y fut pas aussi malheureuse qu'elle avait appréhendé de l'être. On lui enleva à la vérité son fils et on dit qu'on le fit mourir d'une manière assez cruelle (12), mais pour elle, elle fut traitée plus favorablement qu'elle ne s'attendait. Car soit que les extrémités où elle s'était portée pour s'éloigner de Soyatan lui en eussent attiré le mépris, soit que le roi, père de ce prince, qui ne pouvait souffrir les dérèglements, lui eût fait des remontrances sur une passion qui avait déjà trop éclatée, au lieu de la loger dans l'appartement qui lui avait été préparé, on la mit dans une des cuisines du palais, où parmi les traitements indignes et les outrages qu'elle reçoit, elle rend tous les jours grâces au ciel d'avoir mis dans le cœur du prince, au lieu de l'amour qu'il avait pour elle, une si salutaire indifférence.

NOTES
1 - L'ingénieur Vollant explique qu'il ne s'agissait pas d'un simple manquement au protocole, mais surtout du refus des Chinois de vendre aux Français le sel nécessaire pour saler les vaches données plus tôt par Phaulkon : Sur l'heure même on commença de songer aux moyens de soutenir la guerre, puisqu'il fallait l'entreprendre, et de subsister dans la suite. On délibéra de tuer 80 ou 100 vaches, dont on était redevable à la prévoyance de M. Constance et de les saler, mais il se trouva qu'il manquait de sel dans les magasins. Dans l'embarras où l'on était, il passa devant Bangkok une somme chinoise, c'est un grand bâtiment à trois mats fort relevé de bord et fait à plate varangue afin d'entrer facilement dans toutes les rivières qui sont au-delà des détroits, lesquelles sont toutes barrées à leur embouchure.
Ayant eu avis que sa cargaison était de sel et de poivre, on envoya un officier avec quatre mousquetaires à bord de ce bâtiment pour y acheter ce qui était nécessaire, mais le capitaine en refusa à quelque prix que ce fût et on n'en put rien obtenir, ni par prière ni par menaces ; au contraire l'officier lui ayant dit en le quittant qu'on allait tirer sur lui avec le canon de la forteresse, il répondit fièrement qu'il en avait aussi dans sa somme, se laissant néanmoins toujours dériver par la marée. Son refus ayant été rapporté à M. Desfarges, il ordonna de lui envoyer plusieurs volées de canon qui furent sans effet, mais le Chinois ne répondit pas des siens, comme il l'avait promis. (Vollant de Verquains, Histoire de la révolution de Siam, 1691, pp.80-81). ⇑
2 - Dans son journal du 10 octobre 1685, l'abbé de Choisy évoque ces deux forteresses : Nous avons passé ce matin entre deux forts de bois qui nous ont salués, l'un de dix coups de canon, et l'autre de huit. Il n'ont ici que du canon de fonte, et la poudre est fort bonne. Le fort à main droite s'appelle Hale [Halle ?] de cristal, et celui de la gauche Halle de rubis. Sur la rive droite du fleuve, dans la province de Nonthaburi (นนทบุรี) se trouvait la forteresse de rubis (Phom thatphim : ป้อมทับทิม) et sur la rive gauche, du côté de l'ouest, la forteresse de cristal, la plus importante (Phom kheo : ป้อมแก้ว), à l'emplacement de l'actuel Wat Chalerm Phra Kyat. ⇑
3 - C'était sans doute le mode d'exécution des missionnaires. Dans son Histoire de la marine française, (Flammarion 1934) Claude Farrère évoque le père Le Vacher, missionnaire des Lazaristes exécuté à Alger le 21 juillet 1683 : Cet homme admirable, né soixante-quatre ans plus tôt, avait usé sa vie à cette tâche héroïque à la fois et désespérante, le rachat des esclaves chrétiens de la chiourme africaine. Successivement consul de France à Tunis, puis vicaire apostolique à Bizerte, enfin consul à Alger, il avait partout prodigué des trésors de charité, et s'était par surcroît prouvé diplomate habile. La populace d'Alger, exaspérée par le feu des galiotes à bombes, se jeta sur le père Le Vacher, le traîna devant le nouveau dey Mozzomorto, l'y accusa d'intelligence secrète avec les galiotes à bombes, et finalement l'attacha à la bouche d'une couleuvrine de gros calibre dont on fit partir le coup. Ainsi les sanglants lambeaux d'un martyr s'envolèrent vers nos vaisseaux. Une tradition veut que la couleuvrine qui servit d'instrument de supplice ait été conquise en 1830 par les soldats de Charles X, et rapportée en France. Ce serait elle qu'on peut encore voir, érigée en colonne triomphale, sur le terre-plein principal de l'arsenal de Brest. ⇑
4 - Toutes les occurrences de ce patronyme sont orthographiées Saint Coy. Le père d'Orléans s'en explique dans sa préface : L'imprimeur a fait peu de fautes, et c'est par celle d'un copiste qu'au lieu de Saint Cry on a nommé un brave officier français Saint Coy. Les noms propres sont assez sujets à ces sortes d'altérations. Nous avons rétabli l'orthographe des documents officiels, Saint-Cricq, mais on trouve également Saint-Cry, Saint-Criq, Saint-Christ, etc. dans d'autres relations. ⇑
5 - Kosapan (โกษาปาน), qui fit si grande impression en France, fut effectivement nommé Phra Khlang (พระคลัง) - sorte de premier ministre chargé tant des finances et des affaires intérieures et extérieures - après la révolution. Voir sur ce site la page qui lui est consacrée. ⇑
6 - Les mirous, ou dans certaines relations mirons, étaient de petits bateaux à rames réservés aux trajets côtiers. Robert Lingat (Une note de Véret sur la révolution siamoise, T'oung Pao vol. XXXI, 1934, p.360), qui note que les Anglais écrivaient meruah ou merua, suggère que ce mot pourrait avoir une étymologie siamoise, de mi rua (มีเรือ) : Il y a un bateau (ou des bateaux). ⇑
7 - Cette date indiquée dans la relation du père Le Blanc est probablement erronée. Beauchamp fixe l'arrivée du navire le 20 septembre (A.N. Col. C1/25 f° 79v°). L'auteur anonyme de la Relation de ce qui s'est passé à Louvo, royaume de Siam, avec un abrégé de ce qui s'est passé à Bangkok pendant le siège en 1688, conservée aux Archives Nationales (Col. C1/24 140r°-171v°) écrit : Voilà comme nous apprîmes au retour l'arrivée du navire l'Oriflamme à la barre et rade de Siam le 7 de septembre 1688. Dans la chronologie de son ouvrage Siam and the West (2002, p.524), Dirk van der Cruysse date l'arrivée de l'Oriflamme au 9 septembre. ⇑
8 - Magnifique exemple de l'hypocrisie perfide des jésuites envers les missionnaires. Le père d'Orléans sait parfaitement que les lecteurs reconnaîtront dans ce personnage peu glorieux Louis Laneau, l'évêque de Métellopolis, qui servit d'intermédiaire entre Desfarges et Mme Constance. Dans un Mémoire sur l'affaire de Mme Constance Phaulkon daté du 17 janvier 1691, reproduit dans l'Histoire de la mission de Siam de Launay (I, 1920, p.215), l'abbé de Lionne explicite et tente de justifier la position de Louis Laneau : M. de Métellopolis fut d'avis que l'on devait écouter les propositions des mandarins siamois déclarant à M. Desfarges que le nouveau roi s'engagerait par un traité qu'il ne serait fait à Madame Constance aucune violence, ni en sa religion, ni en son honneur, et qu'elle pourrait vivre à sa liberté soit dans le camp des Portugais, soit dans le camp qui était près de notre séminaire, où on lui bâtirait, si elle le voulait, une maison, et ou elle serait sous la protection de M. l'évêque et qu'après avoir fait ce traité, M. Desfarges renvoyât à Siam Mme Constance, et ne l'emmenât point avec lui. Ce fut là l'avis de M. de Métellopolis, qui crut qu'en cette occasion l'on se pouvait fier à la parole du roi de Siam. ⇑
9 - En 1687, La Loubère avait apporté à Phaulkon de la part de Louix XIV le brevet de l'ordre de Saint-Michel, des lettres de naturalité, le droit de porter trois fleurs de lys d'or dans ses armes, et pour son fils, le don d'une terre de trois mille livres de rente avec le titre de comte. (Lanier, Étude historique..., 1883, p.96). ⇑
10 - Il s'agissait du major de Beauchamp. ⇑
11 - Sans doute Ok Luang Kanlaya Ratchamaïtri (ออกหลวงกัลยาราชไมตรี), second ambassadeur adjoint de Kosapan.
 Ooc Loüang Calayanaraa Tchamaïtrioupathoud. ⇑
Ooc Loüang Calayanaraa Tchamaïtrioupathoud. ⇑
12 - Ceci n'est absolument pas confirmé par W.A.R. Wood, qui indique dans son History of Siam (1924, p.214) : Le fils grandit et devint capitaine dans la marine siamoise. Il mourut dans la pauvreté en 1754, laissant un fils et plusieurs filles. Le petit-fils de Phaulkon, John Phaulkon, et une de ses petites-filles, se trouvaient parmi les prisonniers faits par les Birmans lors de la prise d'Ayuthaya en 1767. Ils revinrent au Siam et vivaient encore en 1771. Il est plus que possible que des descendants de Phaulkon vivent encore au Siam aujourd'hui. Quant à Mme Constance, elle devint superintendante de la cuisine du roi T'ai Sra et mourut vers 1720. ⇑

12 mars 2019
