

3ème partie.
Le chevalier de Forbin s'installe au Siam - La misère du Siam - Histoires d'éléphants - Une révolte à Bangkok - Les ennuis de Phaulkon et son ingratitude.
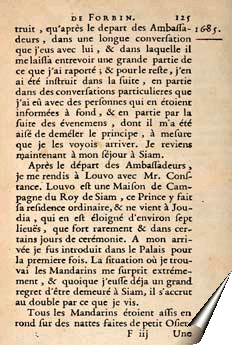
Après le départ des ambassadeurs, je me rendis à Louvo (1) avec M. Constance. Louvo est une maison de campagne du roi de Siam. Ce prince y fait sa résidence ordinaire et ne vient à Joudia, qui en est éloigné d'environ sept lieues, que fort rarement et dans certains jours de cérémonie. À mon arrivée, je fus introduit dans le palais pour la première fois. La situation où je trouvai les mandarins me surprit extrêmement et quoique j'eusse déjà un grand regret d'être demeuré à Siam, il s'accrut au double par ce que je vis.
Tous les mandarins étaient assis en rond sur des nattes faites de petit osier. Une seule lampe éclairait toute cette cour, et quand un mandarin voulait lire ou écrire quelque chose, il tirait de sa poche un bout de bougie de cire jaune, il l'allumait à cette lampe et l'appliquait ensuite sur une pièce de bois, qui, tournant de côté et d'autre sur un pivot, leur servait de chandelier.
Cette décoration si différente de celle de la cour de France, me fit demander à M. Constance si toute la grandeur de ces mandarins se manifestait dans ce que voyais. Il me répondit que oui. À cette réponse, me voyant interdit, il me tira à part, et me parlant plus ouvertement qu'il n'avait fait jusqu'alors : Ne soyez pas surpris, me dit-il, de ce que vous voyez. Ce royaume est pauvre à la vérité, mais pourtant votre fortune n'en souffrira pas, j'en fais mon affaire propre, et ensuite, achevant de s'ouvrir à moi, nous eûmes une longue conversation dans laquelle il me fit part de toutes ses vues qui revenaient à ce que j'ai rapporté il n'y a qu'un moment. Cette conduite de M. Constance ne me surprit pas moins que la misère des mandarins, car quelle apparence qu'un politique si raffiné dût s'ouvrir si facilement à un homme dont il ne venait d'empêcher le retour en France que pour n'avoir jamais osé se fier à sa discrétion ?
Je continuai ainsi pendant deux mois à aller tous les jours au palais, sans qu'il m'eût été possible de voir le roi qu'une seule fois. Dans la suite je le vis un peu plus souvent. Ce prince me demanda un jour si je n'étais pas bien aise d'être resté à sa Cour ? Je ne me crus pas obligé de dire la vérité. Je lui répondis que je m'estimais fort heureux d'être au service de Sa Majesté. Il n'y avait pourtant rien au monde de si faux, car mon regret de n'avoir pu retourner en France augmentait à tout moment, surtout lorsque je voyais la rigueur dont les moindres petites fautes étaient punies.
C'est le roi lui-même qui fait exécuter la justice. J'ai déjà dit qu'il a toujours avec lui 400 bourreaux qui composent sa garde ordinaire. Personne ne peut se soustraire à la sévérité de ses châtiments. Les fils et les frères des rois n'en sont pas plus exempts que les autres (2).
Les châtiments ordinaires sont de fendre la bouche jusqu'aux oreilles à ceux qui ne parlent pas assez, et de la coudre à ceux qui parlent trop. Pour des fautes assez légères, on coupe les cuisses à un homme, on lui brûle les bras avec un fer rouge, on lui donne des coups de sabre sur la tête, on lui arrache les dents. Il faut n'avoir presque rien fait pour n'être condamné qu'à la bastonnade, à porter la cangue (3) au cou ou à être exposé tête nue à l'ardeur du soleil. Pour ce qui est de se voir enfoncer des bouts de cannes dans les ongles, qu'on pousse jusqu'à la racine, mettre les pieds au cep (4), et plusieurs autres supplices de cette espèce, il n'y a presque personne à qui cela ne soit arrivé, au moins quelques fois dans la vie.
Surpris de voir les plus grands mandarins exposés à la rigueur de ces traitements, je demandai à M. Constance si j'avais à les craindre pour moi. Il me répondit que non, et que cette sévérité n'avait pas lieu pour les étrangers. Mais il mentait, car il avait eu lui-même la bastonnade sous le ministre précédent, comme je l'appris depuis.
Pour achever, le roi me fit donner une maison fort petite. On y mit 36 esclaves pour me servir, et deux éléphants. La nourriture de tout mon domestique ne me coûtait que cinq sous par jour, tant les hommes sont sobres dans ce pays, et les denrées à bon marché. J'avais la table chez M. Constance. Ma maison fut garnie de quelques meubles peu considérables, on y ajouta douze assiettes d'argent, deux grandes coupes de même métal, le tout fort mince, quatre douzaines de serviettes de toile de coton et deux bougies de cire jaune par jour. Ce fut là tout l'équipage de M. le Grand amiral, Général des armées du roi. Il fallut pourtant s'en contenter.
Quand le roi allait à la campagne ou à la chasse à l'éléphant, il fournissait à la nourriture de ceux qui le suivaient. On nous servait alors du riz et quelques ragoûts à la siamoise. Les naturels du pays les trouvaient bons, mais un Français peu accoutumé à ces sortes d'apprêts ne pouvait guère s'en accommoder. À la vérité, M. Constance, qui suivait presque toujours, avait soin de faire porter de quoi mieux manger, mais quand les affaires particulières le retenaient chez lui, j'avais grande peine à me contenter de la cuisine du roi.
Souvent, dans ces sortes de divertissements, le roi me faisait l'honneur de s'entretenir avec moi. Je lui répondais par l'interprète que M. Constance m'avait donné. Comme ce prince me donnait beaucoup de marques de bienveillance, je me hasardais quelquefois à des libertés qu'il me passait, mais qui auraient mal réussi à tout autre. Un jour qu'il voulait faire châtier un de ses domestiques pour avoir oublié un mouchoir, ignorant les coutumes du pays, et étant d'ailleurs bien aise d'user de ma faveur pour rendre service à ce malheureux, je m'avisai de demander grâce pour lui (5).
Le roi fut surpris de ma hardiesse et se mit en colère contre moi. M. Constance, qui en fut témoin, pâlit et appréhenda de me voir sévèrement punir. Pour moi, je ne me déconcertai point, et ayant pris la parole, je dis à ce prince que le roi de France, mon maître, était charmé qu'en lui demandant grâce pour les coupables, on lui donnât occasion de faire éclater sa modération et sa clémence, et que ses sujets, reconnaissant les grâces qu'il leur faisait, le servaient avec plus de zèle et d'affection et étaient toujours prêts à exposer leur vie pour un prince qui se rendait si aimable par sa bonté. Le roi, charmé de ma réponse, fit grâce au coupable en disant qu'il voulait imiter le roi de France. Mais il ajouta que cette conduite, qui était bonne pour les Français, naturellement généreux, serait dangereuse pour les Siamois ingrats, et qui ne pouvaient être contenus que par la sévérité des châtiments.
Cette aventure fit bruit dans le royaume et surprit les mandarins, car ils comptaient que j'aurais la bouche cousue pour avoir parlé mal à propos. Constance même m'avertit en particulier d'y prendre garde à l'avenir, et blâma fort ma vivacité, qu'il accusa d'imprudence. Mais je lui répondis que je ne pouvais m'en repentir, puisqu'elle m'avait réussi si heureusement.
En effet, bien loin de me nuire, je remarquai que depuis ce jour-là le roi prenait plus de plaisir à s'entretenir avec moi. Je l'amusais en lui faisant mille contes que j'accommodais à ma manière et dont il paraissait satisfait. Il est vrai qu'il ne me fallait pas pour cela de grands efforts, ce prince étant grossier et fort ignorant (6). Un jour qu'étant à la chasse, il donnait ses ordres pour la prise d'un petit éléphant, il me demanda ce que je pensais de tout cet appareil, qui avait en effet quelque chose de magnifique. Sire, lui répondis-je, en voyant Votre Majesté entourée de tout ce cortège, il me semble voir le roi mon maître à la tête de ses troupes, donnant ses ordres et disposant toutes choses dans un jour de combat. Cette réponse lui fit grand plaisir. Je l'avais prévu, car je savais qu'il n'aimait rien tant au monde que d'être comparé à Louis le Grand.
Et, s'il faut dire la vérité, cette comparaison, qui ne roulait que sur la grandeur et la magnificence extérieure des deux princes, n'était pas absolument sans quelque justesse, y ayant peu de spectacle au monde plus superbe que les sorties publiques du roi de Siam ; car, quoique le royaume soit pauvre et qu'on n'y voie aucun vestige de magnificence nulle part, cependant, lorsque le roi, qui passe sa vie renfermé dans l'intérieur de son palais, sans que personne y soit jamais admis, pas même ses plus intimes confidents à qui il ne parle que par une fenêtre, lors, dis-je, que ce prince se montre en public, il y paraît dans toute la pompe convenable à la majesté d'un très grand roi.
Une des sorties où il se montre avec plus d'éclat, c'est lorsqu'il va toutes les années sur la rivière commander aux eaux de se retirer. J'ai déjà dit plus d'une fois que tout le royaume est inondé six mois de l'année. Cette inondation est principalement causée, en été, par la fonte des neiges des montagnes de Tartarie (7). Mais lorsque l'hiver revient, le dégel cessant, les eaux commencent peu à peu à diminuer, et, laissant le pays à sec, les Siamois prennent ce temps pour faire leur récolte de riz, qu'ils ont plus abondamment qu'en aucun autre pays du monde.
C'est dans cette saison, et lorsqu'on commence à s'apercevoir que les eaux sont notablement diminuées, que le roi sort pour la cérémonie dont nous parlons. Il y paraît sur un grand trône tout éclatant d'or, posé sur le milieu d'un balon superbe. Dans cet état, suivi d'une foule de grands et de petits mandarins assemblés de toutes les provinces, chacun dans des balons magnifiques et accompagnés eux-mêmes d'une infinité d'autres balons, il va jusque dans un certain endroit de la rivière donner un coup de sabre dans l'eau en lui commandant de se retirer (8). Au retour de cette fête, il y a un prix considérable pour le balon qui, remontant la rivière, arrive le premier au palais. Rien n'est si agréable que ce combat et les différents tours que ces balons, qui remontent avec beaucoup de légèreté, se font entre eux pour se supplanter.

Pour revenir à notre chasse, après que l'éléphant fut pris, le roi continua à s'entretenir avec moi, et pour me faire comprendre combien ces animaux paraissent doués d'intelligence : celui que je monte actuellement, me dit ce prince, peut être cité pour exemple. Il avait, il n'y a pas longtemps, un cornac, ou palefrenier, qui le faisait jeûner en lui retranchant la moitié de ce qui était destiné pour sa nourriture. Cet animal, qui n'avait point d'autre manière de se plaindre que ses cris, en fit de si horribles qu'on les entendait de tout le palais. Ne pouvant deviner pourquoi il criait si fort, je me doutai du fait et je lui fis donner un nouveau cornac, qui, étant plus fidèle, et qui lui ayant donné sans lui faire tort toute la mesure de riz, l'éléphant la partagea en deux avec sa trompe, et n'en ayant mangé que la moitié, il se mit à crier tout de nouveau, indiquant par là à tous ceux qui accoururent au bruit, l'infidélité du premier cornac qui avoua son crime, dont je le fis sévèrement châtier.
Ce prince me raconta encore sur ce sujet plusieurs autres traits qui m'auraient paru incroyables si tout autre m'en avait fait le récit, mais voici des faits que j'ai vus moi-même. Quand les éléphants sont en rut, ils deviennent furieux, en sorte qu'on est obligé, pour les adoucir, de tenir une femelle auprès d'eux, surtout lorsqu'on va les abreuver. La femelle marche devant avec un homme dessus, qui donne d'une espèce de cor pour avertir le monde d'être sur ses gardes et de se retirer.
Un jour, un éléphant en rut qu'on menait ainsi à l'abreuvoir se sauva et fut se mettre au milieu de la rivière, hurlant et faisant fuir tout le monde. Je montai à cheval pour le suivre et pour voir ce qu'il deviendrait. Je trouvai la femme du cornac qui était accourue sur le bord de l'eau, et qui, faisant des reproches à cet animal, lui parlait à peu près dans ces termes : – Tu veux donc qu'on coupe la cuisse à mon mari ? car tu sais que c'est le châtiment ordinaire des cornacs quand ils laissent échapper leurs éléphants. Eh bien ! puisque mon mari doit mourir, tiens, voilà encore mon enfant ; viens le tuer aussi. En achevant ces mots, elle posa l'enfant à terre, et s'en alla. L'enfant se mit à pleurer. Alors l'éléphant parut se laisser attendrir ; il sortit de l'eau, prit l'enfant avec sa trompe et l'apporta dans la maison où il demeura tranquille.
Un autre jour, je vis un autre éléphant qu'on menait à l'abreuvoir. Comme il badinait par les rues avec sa trompe, il la porta auprès d'un tailleur, qui, pour l'obliger à se retirer, le piqua avec son aiguille. Au retour de la rivière, il alla badiner de nouveau auprès du tailleur, qui le piqua encore légèrement. À l'instant même, cet animal lui couvrit le corps d'une barrique d'eau bourbeuse qu'il avait apportée pour se venger. Quand le coup fut fait, l'éléphant, voyant son homme ainsi inondé, s'applaudit et parut rire à sa manière, comme pourrait faire un homme qui aurait fait quelque bon tour.
Les Siamois tirent des services considérables de ces animaux. Ils s'en servent presque comme de domestiques, surtout pour avoir soin des petits enfants : ils les prennent avec leur trompe, les couchent dans de petits branles, les bercent et les endorment, et quand la mère en a besoin, elle les demande à l'éléphant qui les va chercher et les lui apporte (9).
Le roi continuait à me donner tous les jours de nouvelles marques de bonté, en m'admettant de plus en plus dans ses entretiens particuliers. Il arriva un jour qu'en revenant de la chasse il se trouva mal. Le lendemain, sa maladie augmenta, sur quoi les médecins ayant été appelés, ils opinèrent à la saignée. Il y avait de la difficulté à ce remède, car les Siamois regardant leur roi comme une divinité, ils n'oseraient le toucher. L'affaire étant proposée au conseil, un mandarin fut d'avis qu'on perçât un grand rideau à travers lequel Sa Majesté ayant passé le bras, un chirurgien le saignerait sans savoir que ce fût le roi.
Cet avis ridicule ne me plut pas, et me servant de la liberté que j'avais de parler sans qu'on le trouvât mauvais, je dis que les rois sont comme des soleils dont la clarté, quoique obscurcie par des nuages, paraît toujours ; que quelque expédient qu'on prît, on ne saurait venir à bout de cacher la majesté du prince qui se ferait toujours assez sentir ; mais que si la saignée était absolument nécessaire, il y avait à la cour un chirurgien français dont on pouvait se servir (10) ; qu'étant d'un pays où l'on saigne sans difficulté les rois et les princes toutes les fois qu'ils en ont besoin, il n'y avait qu'à l'employer, et que j'étais assuré que Sa Majesté n'aurait pas regret à la confiance qu'elle aurait prise en lui. Le roi approuva mon avis. Il n'eut pas lieu de s'en repentir, ce prince ayant recouvré la santé.
À peu près dans ce temps-là, un accident imprévu mit au jour un trait de fourberie que M. Constance avait fait à M. de Chaumont et à sa suite. J'ai dit qu'en leur étalant les richesses de Siam, il avait eu grand soin de leur montrer les plus belles pagodes du royaume, et qu'il avait assuré qu'elles étaient toutes d'or massif. Parmi ces statues, il y en avait une de hauteur colossale, elle était de quinze à seize pieds de haut. On l'avait fait passer pour être de même métal que les autres. Le père Tachard et l'abbé de Choisy y avaient été trompés aussi bien que tous nos Français, et avaient cru ce fait si constant qu'ils l'ont rapporté dans leur relation. Par malheur la voûte de la chapelle où la statue était renfermée fondit et mit en pièces la pagode, qui n'était que de plâtre doré. L'imposture parut, mais les ambassadeurs étaient loin. Je ne pus pas gagner sur moi de ne pas faire sur ce sujet quelque raillerie à M. Constance, qui me témoigna n'y prendre pas plaisir.
Peu après nous eûmes ordre, Constance et moi, d'aller à Bangkok pour y travailler à un nouveau fort qui devait être remis aux soldats français que le roi de Siam avait demandés, et qu'il attendait au retour des ambassadeurs. Nous y traçâmes un pentagone. Comme Bangkok est la clé du royaume, le roi y entretenait dans un petit fort carré, deux compagnies de quarante hommes chacune, formées de Portugais, métis ou créoles des Indes. On donne ce nom à ceux qui sont nés dans les Indes, d'un Portugais et d'une Japonaise chrétienne (11). Ces métis, apprenant que j'arrivais en qualité de général, et que je devais les commander, se mutinèrent.
Un prêtre de leur nation fut cause de cette révolte. Après avoir dit la messe, prenant tout à coup l'air d'un homme inspiré, il se tourna vers le peuple en leur adressant la parole : Mes chers compatriotes, leur dit-il, la nation portugaise ayant toujours été dominante dans les Indes, il serait honteux pour elle qu'un Français entreprît aujourd'hui de vous commander. Marchez donc courageusement et ne souffrez pas un pareil affront. Ne craignez rien, Dieu vous bénira, comme il a toujours fait jusqu'ici ; cependant recevez sa bénédiction que je vous donne de sa part. Il n'en fallut pas davantage pour les mettre en mouvement.
Nous étions occupés, Constance et moi, à l'arrangement des travailleurs, pour commencer les fossés du fort, lorsque nous vîmes arriver le colonel portugais, qui dit à M. Constance que ses soldats s'étaient révoltés. Le ministre lui en demanda la raison. C'est, lui répliqua le colonel, parce qu'ils ne veulent pas obéir à un officier français.
À ce discours, m'avançant sur un bastion, je vis venir une troupe de soldats, le fusil sur l'épaule, qui marchaient droit vers le fort. J'en avertis M. Constance, et, l'ayant tiré à part : Cet officier, lui dis-je, est sûrement complice de la révolte, puisqu'il vient vous avertir quand les séditieux sont en marche. Ils en veulent à votre personne comme à la mienne. Je vais commencer par me saisir de celui-ci, je l'obligerai à faire retourner ses soldats, et s'il résiste, je le tuerai. Alors, mettant l'épée à la main, je sautai sur le Portugais que je désarmai comme un enfant, et, lui tenant la pointe de l'épée sur la poitrine, je le menaçai de le tuer s'il ne criait à ces séditieux de s'en retourner.
Constance paya de sa personne dans cette occasion. Il sortit du fort avec beaucoup de fermeté et sans se troubler, et allant à la rencontre des mutins qui n'étaient plus qu'à dix pas de la porte, il leur demanda d'un air de hauteur ce qu'ils prétendaient. Ils répondirent tout d'une voix qu'ils ne voulaient point du commandant français qu'on leur avait destiné. Ce ministre, qui avait pour le moins autant d'esprit que de courage, les assura que je devais, à la vérité, commander les Siamois, mais nullement les Portugais.
Cette réponse semblait les calmer lorsqu'un de la troupe, voyant d'une part ses camarades incertains de ce qu'ils avaient à faire, et de l'autre côté entendant le colonel, qui du haut du bastion leur criait de toute sa force d'obéir à M. Constance, prit la parole et mettant la main sur la garde de son épée : À quoi bon, dit-il, tant de raisonnements ? Devons-nous nous fier à ses promesses ? Constance, qui se vit au moment d'être massacré, sauta sur ce scélérat, lui ôta son épée, et, après avoir adouci ses camarades par de bonnes paroles, les renvoya chez eux.
Comme cet attentat pouvait avoir de dangereuses conséquences s'il demeurait impuni, le colonel fut arrêté, les soldats et les officiers qui étaient entrés dans la sédition le furent aussi, et, par ordre de M. Constance, j'assemblai un conseil de guerre assez mal ordonné à la vérité, mais nous étions dans un pays où l'on n'en avait jamais vu. Nous ne laissâmes pourtant pas de condamner le soldat qui avait porté la main sur la garde de son épée à avoir le poing coupé. Deux autres qui furent convaincus d'avoir été les chefs de la sédition furent condamnés à mort. Il y eut quelques officiers exilés, et le reste des soldats fut condamné aux galères. Mais, avant de les y envoyer, ils furent enchaînés deux à deux, comme nos forçats, et obligés de travailler aux fortifications. Cette exécution faite, et tous les ordres nécessaires étant donnés afin que le travail se continuât, nous repartîmes, M. Constance et moi, et nous nous rendîmes à Louvo.
À notre arrivée, M. Constance se trouva embarrassé dans une méchante affaire qui faillit à le perdre et de laquelle je puis dire avec vérité qu'il ne se serait jamais tiré sans moi. Son avidité pour le gain la lui avait attirée, voici à quelle occasion. Avant que de partir pour Bangkok, il avait voulu acheter une cargaison de bois de santal. Pour cela, il s'était adressé à un Français huguenot nommé le sieur de Rouan, qui en avait fait venir une grande quantité de l'île de Timor. Il avait fait des profits très considérables sur une partie qu'il en avait déjà vendu. Constance voulait s'accommoder du reste, mais il le voulait à bas prix. Le marchant ne voulut jamais y entendre, sur quoi n'étant pas d'accord, le ministre lui chercha noise, et usant de son autorité, le fit arrêter et mettre aux fers.
Dans ce temps-là, nous partîmes pour Bangkok. Pendant notre absence, le facteur français de la compagnie d'Orient (12), instruit de la vexation faite au sieur de Rouan et voulant avoir satisfaction de l'affront qu'il prétendait avoir été fait à la nation, s'en alla à Louvo planter le pavillon blanc devant le palais. Le roi, surpris de cette nouveauté, envoya un mandarin pour en apprendre le sujet. Le facteur répondit qu'il venait demander justice de l'injure que la nation avait reçue ; qu'on avait mis aux fers un Français, sans qu'il fût coupable d'aucun crime ; qu'il demandait qu'on lui en fît réparation, à défaut de quoi il suppliait Sa Majesté de lui permettre de sortir du royaume avec tout ce qu'il y avait de Français.
Le roi, qui ignorait la manœuvre de son ministre, envoya dire au facteur qu'il pouvait retourner chez lui et que, quand nous serions revenus, Constance et moi, il s'informerait de cette affaire et qu'il rendrait bonne justice. Ce prince, surtout depuis l'ambassade, aimait beaucoup les Français, il les protégeait volontiers et ne les voyait sortir de son royaume qu'avec regret.
À peine fûmes-nous à Louvo, que M. Constance fut averti de la démarche du facteur. Sans perdre un moment de temps, il se rendit au palais, comptant détruire d'un seul mot tout ce qui avait été dit contre lui. Mais il n'en fut pas ainsi ; le roi irrité le maltraita en paroles et le menaça de le faire châtier s'il ne se justifiait dans tout le jour.
Constance répondit brièvement que bien loin d'être capable de maltraiter la nation française, il n'y en avait point dans le royaume pour qui il eût tant d'égards ; qu'il suppliait Sa Majesté de s'en rapporter à mon témoignage ; qu'étant par ma naissance et par mes emplois mis au-dessus de ce facteur, il y avait apparence que j'aurais porté mes plaintes à Sa Majesté si on m'en avait donné occasion, mais qu'il espérait que je viendrais dans un moment rendre témoignage à son innocence et certifier à Sa Majesté l'attention qu'il avait à ne rien faire dont la nation française pût s'offenser.
M. Constance, en sortant du palais, vint me chercher, et m'abordant : Monsieur, me dit-il, il s'agit de me rendre un service essentiel. Le facteur de la compagnie de France a porté plainte contre moi au sujet de l'emprisonnement du sieur de Rouan. Vous savez aussi bien que moi que, quoiqu'il soit originairement Français, il est huguenot et que, comme tel, ayant été contraint de sortir de France, il est depuis longtemps au service des Anglais et qu'il n'appartient nullement à la Compagnie française, au service de laquelle il ne fut jamais. Nonobstant cela, le facteur le protège de tout son pouvoir, et quoiqu'il n'ignore pas que le sieur de Rouan est devenu Anglais, et par sa sortie de France et par la religion qu'il professe, il ne laisse pas de se déclarer hautement pour lui et veut l'agréger au corps de la nation à laquelle il a si solennellement renoncé. Vous sentez sans doute l'injustice de ce procédé. J'espère que vous viendrez me justifier auprès du roi et que vous me servirez dans cette occasion comme je vous servirais si vous étiez en pareil cas.
M. Constance était encore chez moi lorsque le roi m'envoya chercher. Je me rendis incessamment au palais, où tout le conseil attendait en silence l'événement de cette affaire. Il n'y avait aucun des mandarins qui ne souhaitât la perte du ministre. La plupart la regardaient comme inévitable et ils s'en tenaient d'autant plus assurés que, s'agissant d'un Français, ils ne doutaient pas que je ne dusse appuyer les plaintes que le facteur avait faites. Ils furent trompés dans leur attente, je justifiai amplement M. Constance. Après avoir loué son zèle pour le service de Sa Majesté, je représentai que le Français qu'on avait châtié ne devait point être regardé comme membre de la nation, puisque le roi mon maître l'avait banni de ses États ; que le facteur avait sans doute ignoré ce point, sans quoi il ne se serait pas intéressé si vivement pour un homme qui appartenait aux Anglais et non à la France. Je déclarai que je me chargeais de faire entendre raison au facteur. Je finis en ajoutant que je ne pouvais trop remercier Sa Majesté de la protection qu'elle voulait bien accorder à la nation, et je suppliai ce prince de la lui continuer, l'assurant que le roi mon maître lui en marquerait sa reconnaissance.
Mon témoignage justifia Constance si pleinement dans l'esprit du roi, qu'il fut apaisé sur-le-champ, et, se tournant de mon côté, il me dit gracieusement ces mots : Choca di nacna, c'est-à-dire : Je suis content et satisfait. Je courus sur-le-champ chez le ministre pour lui apprendre le détail de tout ce qui s'était passé. Il me sauta au cou, et m'embrassant mille et mille fois, m'assura qu'il n'oublierait jamais le service signalé que je venais de lui rendre.
Je lui représentai que pour finir entièrement cette affaire, il convenait de faire mettre en liberté le Français qui était aux fers et de lui faire rendre sa cargaison de bois de santal, le priant, pour l'avenir, de laisser aux Français une entière liberté de commercer dans tout le royaume ; qu'à cette condition j'adoucirais facilement le facteur de la Compagnie. Constance promit et exécuta tout ce que je lui demandais, et cette affaire finit sans qu'il lui en arrivât d'autre mal.
Il semblait qu'après un service si important, je devais trouver dans M. Constance un ami à l'épreuve de tout. Ce fut pourtant ce même service qui fut une des principales causes de tout le mal qu'il voulut me faire dans la suite.
Constance était naturellement fort jaloux et très méfiant. Il avait d'abord vu avec quelque peine les bontés du roi à mon égard, et il aurait bien souhaité que ce prince m'eût donné un peu moins de liberté de parler et de dire ce que je voulais. Cependant toute cette faveur ne l'avait encore que peu alarmé, mais lorsqu'il vit que pour le tirer lui-même d'un très mauvais pas, je n'avais eu qu'à parler, il commença à me craindre tout de bon, et considérant qu'il pourrait bien m'être un jour aussi aisé de le perdre qu'il m'avait été aisé de le protéger, il songea sérieusement à traverser un commencement de faveur qu'il croyait déjà trop avancé, mais qu'il résolut d'interrompre à quelque prix que ce fût.
Tandis qu'il délibérait sur les moyens, il eut lieu de se confirmer dans sa résolution par un nouvelle grâce dont il plut au roi de m'honorer. Ce prince lui dit de me faire savoir qu'il m'avait nommé à la dignité d'Opra sac di son craam (13), ce qui revient à peu près à la dignité de maréchal de France. Ce nom barbare veut dire une divinité qui a toutes les lumières et toute l'expérience pour la guerre. En même temps il lui marqua le jour de ma réception et lui ordonna de faire en sorte que tout fût prêt. En voici la cérémonie.
Les mandarins étant venus me prendre chez moi, me conduisirent jusque dans l'enceinte du palais. Quand nous fûmes à cent pas de la fenêtre où le roi était, je me prosternai à terre et tous les grands mandarins en firent de même. Nous marchâmes appuyés sur les coudes et sur les genoux environ une cinquantaine de pas. Deux maîtres de cérémonie marchaient devant en même posture. À une certaine distance de l'endroit d'où nous étions partis, nous fîmes tous ensemble une seconde révérence, qui se fait en se relevant sur les genoux et battant du front à terre, les mains jointes par-dessus la tête. Tout ceci se passe dans un grand silence. Enfin nous nous prosternâmes une troisième fois quand nous fûmes arrivés sous la fenêtre du roi. Ce prince alors m'envoya le bétel, en prononçant deux mots qui signifient : Je vous reçois à mon service.
Le bétel que le roi donne dans cette occasion est une grâce des plus singulières qu'il puisse faire à un sujet. Ce bétel est une espèce de fruit à peu près semblable au gland. La peau en est verte, elle est remplie de petits nerfs et d'une eau insipide. On coupe ce gland en quatre parties, et après l'avoir mêlé avec de la chaux faite de coquillages calcinés, on l'enveloppe d'une feuille qui ressemble à celle du lierre. Les Siamois mâchent le bétel avec plaisir, et trouvent qu'il est utile à la santé (14).
La cérémonie de ma réception finit à peu près comme elle avait commencé. Nous retournâmes sur nos pas en marchant toujours sur nos coudes et sur nos genoux, mais à reculons et en faisant les trois révérences, le roi se tenant toujours à sa fenêtre et nous reconduisant des yeux jusqu'au lieu d'où nous étions partis.
Lorsque nous y fûmes arrivés, un maître de cérémonie me donna la boussette avec son fourreau et une boîte peinte de rouge pour fermer le tout. Cette boussette est une façon de petit coffre d'or et d'argent fort mince, ciselé fort proprement, et sur lequel sont représentées plusieurs figures de dragons (15). Il y a dans ce coffre deux petites tasses d'or fort minces aussi, l'une pour le bétel, et l'autre qui sert à mettre les feuilles dont on l'enveloppe. Il y a encore un étui d'or pour fermer la chaux, une espèce de petite cuillère de même métal pour appliquer la chaux sur le bétel, et un petit couteau à manche d'or pour couper le gland.
Quand tout fut fait, les mandarins qui m'accompagnaient me firent un compliment fort court, selon l'usage, et une inclination de tête, tenant les mains jointes devant la poitrine, et me reconduisirent ensuite chez moi. Après la cérémonie, le roi voulant ajouter grâce sur grâce, m'envoya deux pièces d'étoffes des Indes à fleurs d'or. J'en eus amplement de quoi faire deux habits magnifiques.
Ces dernières marques de la bonté du roi à mon égard ayant, comme j'ai dit, excité encore plus violemment la jalousie de M. Constance, il ne balança plus à mettre tout en usage pour se défaire de moi. Comme il ne pouvait plus entreprendre de me discréditer auprès du roi, il résolut d'abord de m'empoisonner. J'en fus averti par un de mes amis, ce qui me détermina à manger à mon particulier.
Cette démarche qui devait le faire douter que j'avais au moins quelque connaissance de ses desseins, ne lui fit pas changer de résolution. Un jour que j'avais la fièvre, ignorant mon indisposition, il m'envoya du lait caillé qu'il savait que j'aimais beaucoup. Quand je me serais bien porté je n'aurais eu garde d'y toucher. Ayant eu l'imprudence de le laisser à mes esclaves, il y en eut quatre qui en mangèrent et qui moururent presque sur-le-champ. Je parlai de cette aventure à M. l'évêque de Métellopolis qui me dit qu'il n'y savait point de remède, mais qu'il fallait mettre ma confiance en Dieu, et cependant être toujours sur mes gardes.

NOTES
1 - Aujourd'hui Lopburi (ลพบุรี), à 66 kilomètres d'Ayutthaya. ⇑
2 - Phra Naraï avait deux demi-frères. L'aîné, Chao Fa Apai thot (เจ้าฟ้าอภัยทศ), boiteux, ivrogne et colérique, fut assigné à résidence pour avoir comploté. Le cadet, Chao Fa Noi (เจ้าฟ้าน้อย), fut condamné à mort pour avoir eu une liaison avec une concubine de son frère le roi. Gracié, il subit néanmoins une formidable correction qui le laissa à moitié paralysé. En revanche, il n'avait qu'une fille et aucun fils, du moins aucun fils officiellement déclaré. ⇑
3 - Instrument de torture portatif, d'origine chinoise, ayant la forme d'une planche ou d'une table percée de trois trous dans lesquels on introduisait la tête et les mains du supplicié. ⇑
4 - On utilisait plutôt ce mot au pluriel. Selon Littré, les ceps sont des sortes de chaîne. ⇑
5 - Plus loin dans ses mémoires, le chevalier de Forbin nous apprendra que ce domestique n'était autre que Mom Pi (หม่อมปีย์), le favori de Phra Naraï, qui fut une des premières victimes de Phetracha lors du coup d'État de 1688. ⇑
6 - Ceci contredit l'opinion de nombreux témoins. Le roi Phra Naraï était généralement décrit comme un homme instruit, ouvert et curieux. La littérature et les arts prospérèrent sous son règne, et lui-même taquinait la muse avec quelque talent, paraît-il. ⇑
7 - Il faut plutôt incriminer la saison des pluies, qui frappe la Thaïlande entre mai/juin et octobre/novembre, et provoque de très spectaculaires inondations.
 Lopburi inondé. Photo du Bangkok Post du 5 septembre 2018. ⇑
Lopburi inondé. Photo du Bangkok Post du 5 septembre 2018. ⇑
8 - Ce rituel magique sans doute d'inspiration brahmanique s'appelait laï nam (ไล่น้ำ), littéralement chasser les eaux ou encore laï rua (ไล่เรือ : chasser le bateau) parce qu'elle se terminait généralement par une régate. Comme beaucoup de spectateurs occidentaux, Forbin fait une confusion. Le roi ne coupe pas les eaux avec son sabre, mais il agite dans l'eau un éventail à long manche.
Environ deux siècle plus tard, en 1854, Mgr Pallegoix évoque lui aussi cette cérémonie dans sa Description du royaume de Siam (II, p. 56), mais à cette époque, le roi ne se déplace plus en personne pour accomplir le rituel, son prestige risquant d'être écorné si les eaux continuent à monter malgré ses injonctions, comme c'était souvent le cas. Il délègue ses pouvoirs à des bonzes : Lorsque l'inondation a atteint son plus haut point, et dès que les eaux commencent à se retirer, le roi députe plusieurs centaines de talapoins pour faire descendre les eaux du fleuve. Cette troupe de phra, montée sur de belles barques, s'en va donc signifier aux eaux l'ordre émané de sa Majesté, et, pour en presser l'exécution, tous ensemble se mettent à réciter des exorcismes pour faire descendre la rivière; ce qui n'empêche pas que, certaines fois, l'inondation augmente encore en dépit des ordres du roi et des prières des talapoins.
D'après H. G. Quaritch Wales, (Siamese State Ceremonies, their History and Function, 1931), ce rituel n'avait pas lieu tous les ans. Le dernier monarque à l'accomplir fut le roi Mongkut (Rama IV) en 1831, année où la mousson fut exceptionnellement abondante. La cérémonie fut définitivement abolie sous le règne du roi Phumiphon Adunyadet. ⇑
9 - Ces histoires, vraies ou fausses, viennent grossir le flot d'anecdotes et de légendes qui circulent depuis l'Antiquité sur ces sympathiques pachydermes. Dans son Dictionnaire des idées reçues, Flaubert note à l'article éléphants : Se distinguent par leur mémoire et adorent le soleil. Marco Polo écrivait dans son Devisement du monde : Sachez que quand le mâle veut saillir la femme, ils font une grande fosse dans la terre, et se met l'éléphante à la renverse dans cette fosse, et l'éléphant monte dessus comme le fait l'homme à la femme, cela parce que l'éléphante a la nature très près du ventre. Mais Ambroise Paré, dans son Livre des animaux, nous rassure quant à ce que la vue de cette copulation pourrait avoir de choquant, particulièrement sur des esprits sensible : Jamais le mâle et la femelle ne se connaissent ensemble qu'en secret, à cause de honte qu'ils ont. Nous voilà rassurés ! ⇑
10 - Il s'agit très certainement d'Étienne Paumard, prêtre des Missions Étrangères, qui n'était pas chirurgien, mais avait des compétences en médecine et avait déjà soigné Phaulkon en 1682. ⇑
11 - C'était là les origines de Maria Guyomar de Pinha, ou Marie Guimard, l'épouse de Phaulkon. Sur les métis portugais au Siam, on se réfèrera au mémoire de Master de sciences historiques, philologiques et religieuses de Rita Bernardes de Carvalho : La présence portugaise à Ayutthaya (Siam) aux XVIe et XVIIe siècles, p. 96 : Les liaisons des Portugais au Siam ne se vérifiaient pas seulement avec des femmes thaïes. En effet, des mariages mixtes avec des femmes mon, peguanes, japonaises, chinoises, etc. étaient communs. Nous trouvons de même une référence à une femme portugaise, mariée à un Arménien. (...) Nonobstant, nous considérons qu'étant nés de relations de Portugais avec d'autres peuples outre le Thaï, ces métisses s'intégraient encore plus facilement dans la société siamoise, puisque ces communautés asiatiques étrangères étaient elles-mêmes déjà bien intégrées socialement. ⇑
12 - Le nom n'est jamais cité, mais il s'agissait probablement de Véret, qui était arrivé avec l'ambassade de Chaumont pour prendre la direction du comptoir d'Ayutthaya. ⇑
13 - Okphra Sakdi Songkhram (ออกพระศักดิสงคราม). ⇑
14 - La mastication du bétel n'est plus guère pratiquée aujourd'hui en Thaïlande que par les personnes âgées. Voici ce qu'en écrivait Jean-Baptiste Pallegoix en 1852 : Bien des gens ne savent pas ce que c'est que l'arec et le bétel, et cependant l'usage de mâcher l'arec et le bétel est répandu dans presque la moitié du globe terrestre. Le bétel est une plante grimpante qui ressemble au poivre, aussi l'appelle-t-on piper-betel ; elle produit sans cesse de belles feuilles en forme de cœur, un peu charnues, d'une saveur piquante et aromatique. L'arec est un arbre du genre des palmiers, de la grosseur de la jambe, droit, élancé, n'ayant de feuilles qu'à son sommet qui atteint la hauteur de cinquante à soixante pieds. Il produit deux ou trois grappes énormes chargées de deux à trois cents noix, d'abord vertes, qui, en mûrissant, deviennent d'un jaune rouge ; ces noix sont pleines d'une chair acerbe et astringente. On prend donc deux feuilles de bétel, sur l'une desquelles on étend avec une spatule une légère couche de chaux vive rougie par le curcuma, on les enroule de manière à leur donner la forme d'un cigare, puis on coupe en quatre une noix d'arec, on en met un morceau dans sa bouche et on le mâche tout en mordant peu à peu le bétel que l'on tient par le bout ; on se frotte les dents avec une pincée de tabac à fumer qu'on mâche avec ; bientôt la salive devient couleur de sang, on éprouve une légère ivresse, qui repose la tête et égaie l'esprit. Quand la bouchée d'arec n'a plus de saveur, on se lave la bouche et bientôt après on recommence l'opération. L'usage du bétel noircit les dents (ce qui, du reste, est une beauté pour le pays), il corrige la mauvaise odeur de la bouche, et quand il est modéré, il contribue beaucoup à la conservation des dents, comme il les détruit s'il est excessif ou si l'on prend l'habitude de mettre trop de chaux. Les personnes habituées à cette mastication en éprouvent un tel besoin que, en les supposant à jeun, si vous leur donniez le choix entre des aliments et une bouchée de bétel, vous pouvez être assuré qu'elles choisiront de préférence l'arec et le bétel. Puisque j'ai parlé du curcuma, il faut dire ce que c'est. Le curcuma ou safran indien, est une racine bulbeuse et charnue, d'un beau jaune d'or, d'une saveur aromatique ; broyé et réduit en poudre fine, il est employé comme excellent cosmétique à oindre le corps des enfants et des femmes ; une petite quantité mise dans la chaux lui donne une belle couleur rose ; on s'en sert pour teindre en jaune, et il entre aussi dans la fameuse composition des ragoûts indiens appelée cary. (Op. cit., I, p. 124 et suiv.). ⇑
15 - La Loubère cite le krob (ครอบ) et le tiab (เตียบ) : Le krob est une boîte d'or ou d'argent pour l'arek et le bétel. Le roi les donne, mais ce n'est qu'à certains officiers considérables. Elles sont grosses et couvertes, et fort légères ; ils les ont devant eux chez le roi et dans toutes les cérémonies. Le tiab est une autre boîte pour le même usage, mais sans couvercle, et qui demeure au logis. C'est comme un grand gobelet, quelquefois de bois vernis, et plus la tige en est haute, plus il est honorable. Pour l'usage ordinaire, ils portent sur eux une bourse où ils mettent leur arek et leur bétel, leur petite tasse de chaux rouge et leur petit couteau. Les Portugais appellent une bourse bosseta, et ils ont donné ce nom au krob dont je viens de parler, et après eux nous les avons appelés bossettes. (Du royaume de Siam, 1691, II, pp. 70-71).
 Tiap, ou plutôt krop, selon la description de La Loubère.
Tiap, ou plutôt krop, selon la description de La Loubère.
 Bossette (tiap : เตียบ). Époque du roi Chulalongkorn. ⇑
Bossette (tiap : เตียบ). Époque du roi Chulalongkorn. ⇑

2 janvier 2019
