

6ème partie.
Retour en France - Pondichéry - Madras - Forbin reçu par Louis XIV - Forbin reçu par le père de La Chaize - Remarques sur la révolution de Siam.
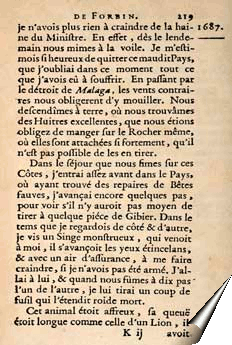
En passant par le détroit de Malacca, les vents contraires nous obligèrent d'y mouiller. Nous descendîmes à terre, où nous trouvâmes des huîtres excellentes que nous étions obligés de manger sur le rocher même, où elles sont attachées si fortement qu'il n'est pas possible de les en tirer.
Dans le séjour que nous fîmes sur ces côtes, j'entrai assez avant dans le pays, où ayant trouvé des repaires de bêtes fauves, j'avançai encore quelques pas pour voir s'il n'y aurait pas moyen de tirer à quelque pièce de gibier. Dans le temps que je regardais de côté et d'autre, je vis un singe monstrueux qui venait à moi. Il s'avançait les yeux étincelants et avec un air d'assurance à me faire craindre, si je n'avais pas été armé. J'allai à lui, et quand nous fûmes à dix pas l'un de l'autre, je lui tirai un coup de fusil qui l'étendit raide mort.
Cet animal était affreux, sa queue était longue comme celle d'un lion. Il avait plus de deux pieds et demi de hauteur, huit pieds du bout de la queue à la tête, et sa face longue et grosse était semée de bourgeons comme celle d'un ivrogne. Ceux du pays m'assurèrent que j'avais été bien heureux de le tuer, cet animal étant capable de m'étrangler si j'eusse manqué mon coup. J'allai chercher nos matelots pour l'emporter. Ils avouèrent qu'ils n'avaient jamais vu de singe si gros dans toutes les Indes.
Du détroit de Malacca, nous passâmes par les îles de Nicobar qui sont habitées par des peuples tout à fait sauvages. Ils vont entièrement nus, hommes et femmes, et ne vivent que de poisson et de quelques fruits qu'ils trouvent dans les bois, car leurs îles ne produisent ni riz, ni légume, ni d'autre sorte de grain dont ils puissent se nourrir. À 30 lieues de ces îles est celle d'Andaman, que nous aperçûmes de loin. Ceux qui l'habitent sont anthropophages, et les plus cruels qu'il y ait dans toutes les Indes.
Nous arrivâmes enfin à Pondichéry. C'est un des plus célèbres comptoirs de la Compagnie d'Orient. Il y a un directeur général et plusieurs commis. C'est un entrepôt où l'on transporte des Indes des toiles de coton, des mousselines, et des indiennes (1) de toutes les espèces. Les vaisseaux de cette compagnie viennent de France toutes les années pour acheter ces toiles, et les portent au Port-Louis (2).
M. Martin, pour lors directeur de ce comptoir (3), m'accueillit le plus gracieusement du monde, et ne cessa de me combler de politesse pendant tout le temps que je séjournai dans le pays. Il ne fut pas en mon pouvoir d'en partir aussitôt que je souhaitais. Il me fallut attendre assez longtemps les vaisseaux d'Europe, qui, cette année, arrivèrent un peu plus tard que de coutume (4). Mon occupation ordinaire pendant ce séjour, était la chasse. Il y a dans ce pays des espèces de renards qu'on nomme chiens marrons. J'en prenais presque tous les jours avec des lévriers que j'avais dressés, et qui furent d'abord faits à cette manière de chasser, qui est très amusante.
Il m'y arriva une aventure où je faillis de périr. Le commis d'un vaisseau de la Compagnie de France, arrivé depuis peu, me pria de le mener avec moi. Après avoir chassé quelques heures, mes lévriers firent lever un de ces renards, qui se voyant pressé, se sauva dans un terrier. Pour l'obliger à en sortir je me mis en devoir de l'enfumer. Je ramassai de la paille de riz, j'en remplis le trou et j'y mis le feu. Comme j'étais baissé pour souffler, il en sortit tout à coup un animal, qui, s'élançant sur moi, me renversa en me couvrant de paille, de feu et de fumée, me passa sur le visage et fut se jeter dans une rivière qui n'était qu'à deux pas. Tout cela se fit si vite que l'animal s'était plongé dans l'eau avant que je fusse en état de me relever. Le commis me dit qu'il ne doutait point que ce ne fût un crocodile ou un caïman. Quoi qu'il en soit, j'eus grand peur, et je m'estimai bien heureux d'en être quitte à si bon marché.
Les habitants de Pondichéry sont fort noirs sans être Cafres. Ils ont les traits du visage bien faits, le regard doux, les yeux vifs et fort beaux. Ils laissent croître leurs cheveux qui s'abattent jusqu'à la ceinture. Leur nation est divisée par castes ou races. Les bramines, qui sont les prêtres du pays, sont en plus grand vénération que tous les autres ; ensuite viennent les bergers. Ces peuples observent sur toute chose de ne s'allier qu'avec leurs égaux, en sorte qu'un berger ne saurait prétendre à l'alliance d'un bramine. Que s'il arrive que quelqu'un d'une caste distinguée épouse une femme qui soit d'un rang inférieur, il déchoit et n'a d'autre rang que celui de la famille à laquelle il s'est allié. Il n'en est pas de même des femmes, qui, en se mésalliant, ne perdent rien de leur condition. Parmi ces castes, la plus méprisable est celle des cordonniers, excepté celle qu'on appelle des parias qu'on regarde avec horreur parce qu'ils ne font pas difficulté de se nourrir de la chair de toute sorte d'animaux.
Ces peuples, qui sont idolâtres, ont, à une lieue de Pondichéry un fameux temple où ils se rendent toutes les années, à un certain jour marqué, pour y célébrer une fête à l'honneur de leurs principales divinités. On s'y accourt en foule de tous les environs. J'y allai par curiosité. Après mille cérémonies dont on me fit le récit, car je ne pus pas entrer dans le temple, ils sortirent le dieu et la déesse à l'honneur desquels ils étaient assemblés. Ces idoles sont de figure gigantesque et fort bien dorées. Ils les mirent sur un char à quatre roues et les placèrent en face l'une de l'autre. La déesse sur le devant du chair paraissait dans une posture lascive, et l'attitude du dieu n'était guère plus honnête.
Ce char était tiré avec des cordes par deux ou trois cents hommes. Tout le reste du peuple, qui était innombrable, se jetait ventre à terre et poussait des cris de joie dont toute la campagne retentissait. Il y en avait d'assez simples pour se jeter sous les roues du char, s'estimant heureux d'être écrasés en témoignage du respect qu'ils avaient pour leur dieu.
Cette cérémonie étant faite, je vis des hommes et des femmes qui se roulaient à terre et continuaient cet exercice en tournant tout autour du temple. Je demandai pour quel sujet ils se meurtrissaient ainsi tout le corps, car ils étaient nus, à la réserve d'un linge dont ils étaient couverts depuis la ceinture jusqu'à demi-cuisse. On me répondit que n'ayant point d'enfants, ils espéraient par cette sorte de pénitence de fléchir leurs dieux qui ne manqueraient pas de leur en donner. C'est là tout ce que je rapporterai de cette fête, n'ayant pu entrer, comme j'ai dit, dans le temple où les seuls idolâtres sont admis.
J'y retournai pourtant deux jours après, car j'étais curieux de le voir. Je me présentai à la porte avec sept autres Français qui souhaitaient aussi d'y entrer. Le chef des bramines nous en refusa l'entrée, sous prétexte qu'il ne lui était pas permis de le profaner en y introduisant des chrétiens. Sur ce refus, sans me mettre en peine de lui répondre, je m'approchai de lui, je lui arrachai un poignard qu'il avait à la ceinture, et je lui en présentai la pointe en le menaçant de le tuer. Il ne lui fallut pas dire de fuir. Alors nous entrâmes. Nous ne trouvâmes dans cet édifice, qui était fort vaste, qu'un grand nombre d'idoles de différentes grandeurs, et toutes en posture déshonnête.
Tandis que nous nous amusions à les regarder, le bramine offensé de l'affront qu'il avait reçu, alla crier l'alarme aux environs et vint à nous à la tête de plus de 300&nbs;hommes. Mais ce peuple, qui est absolument sans courage, fut si effrayé en nous voyant avec des armes à feu qu'il n'y en eut pas un seul qui eût la hardiesse d'approcher.
À peu près dans ce temps-là, un vaisseau de la Compagnie des Indes (5) étant prêt à faire voile pour Masulipatam (6), ville fameuse par son commerce, et les vaisseaux de France ne devant point encore arriver, je résolus de m'embarquer dans le dessein de passer de cette ville jusqu'à celle de Golconde (7), qui n'en est éloignée que de 30 lieues. Le grand Moghol assiégeait pour lors cette place. J'étais bien aise de voir comment ces peuples font la guerre, et la manière dont ils s'y prennent pour former des sièges et des attaques, mais il ne fut pas à mon pouvoir d'exécuter ce projet, comme on verra par ce que je vais dire.
Lorsque nous partîmes, nous étions dans la saison du vent d'ouest, c'est-à-dire dans la saison la plus favorable de l'année. La route se fit fort heureusement et en peu de jours. Nous n'étions plus qu'à huit lieues de Masulipatan lorsque nous vîmes venir du côté de terre un nuage noir et épais que nous crûmes tous être un orage. Nous serrâmes d'abord toutes les voiles, crainte d'accident. Le nuage arriva enfin à bord avec très peu de vent, mais suivi d'une prodigieuse quantité de grosses mouches semblables à celles qu'on voit en France, qui mettent des vers à la viande. Elles avaient toutes le cul violet. L'équipage fut si incommodé de ces insectes qu'il n'y eut personne qui ne fût obligé de se cacher pour quelques moments. La mer en était toute couverte, et nous en eûmes une si grande quantité dans le vaisseau, que pour le nettoyer, il fallut jeter plus de 500 boyaux d'eau.
Environ à quatre lieues de la ville, nous aperçûmes comme un brouillard qui la couvrait tout entière. À mesure que nous avancions, ce brouillard s'étendait, et peu après nous ne vîmes plus que la pointe des montagnes qui servaient à guider les pilotes. En approchant de terre, nous vîmes que ce nuage n'était autre chose qu'une multitude innombrable de mouches toutes différentes des premières. Celles-ci avaient quatre ailes et ressemblaient à celles qu'on voit le long des eaux et qui ont la queue barrée de jaune et de noir.
Plus nous avancions et plus ces insectes se multipliaient. Il y en avait une si grande quantité, que nous empêchant de voir la terre, nous fûmes obligés d'en approcher en sondant. Quand nous fûmes avancés à un certain nombre de brasses, le pilote fit démouiller l'ancre. Un commis de la Compagnie, nommé le sieur Delande (8), qui avait ordre de visiter le comptoir, s'embarqua dans la chaloupe. Nous le suivîmes, le capitaine et moi. La quantité de ces mouches était si grande que nous fûmes obligés d'embarquer une boussole pour ne pas manquer la terre qu'elles nous cachaient entièrement. Nous abordâmes enfin.
Ne trouvant personne dans le port, ceux du vaisseau qui connaissaient la ville nous servirent de guides et nous menèrent à la douane. Personne ne parut dans le bureau qui était tout ouvert. Nous entrâmes pourtant, et nous en parcourûmes toutes les pièces sans trouver qui que ce soit. Surpris de cette nouveauté, nous marchâmes du côté où était le comptoir de la Compagnie d'Orient, nous traversâmes plusieurs rues sans voir personne. Cette solitude, qui régnait par toute la ville, jointe à une puanteur insupportable, nous fit bientôt comprendre de quoi il était question.
Après avoir beaucoup marché, nous arrivâmes devant la maison de la Compagnie. Les portes en étaient ouvertes, nous y trouvâmes le directeur, mort apparemment depuis peu, car il était encore tout entier. La maison avait été pillée et tout y paraissait en désordre. Frappé d'un spectacle si affreux, je revins dans la rue, et m'adressant au sieur Deslande : — Retournons à bord, lui dis-je, retournons à bord, il n'y a rien de bon à gagner ici. Il me répondit que sa commission l'obligeait d'aller plus avant ; qu'ayant à rendre compte de son voyage, il ne pouvait retourner à bord sans avoir au moins parlé à quelqu'un qui pût l'instruire plus précisément des causes de tout ce désordre.
Nous continuâmes donc à marcher et nous nous rendîmes au comptoir des Anglais. Nous le trouvâmes fermé. Nous eûmes beau frapper, personne ne répondit. De là nous passâmes à celui des Hollandais. De 80 personnes qui le composaient, il n'en restait plus que 14. C'étaient plutôt des spectres que des hommes. Ils nous dirent que la peste avait mis la ville dans l'état où nous l'avions trouvée, que la plupart des habitants étaient morts et que le reste s'était retiré dans les campagnes ; qu'ils ne pouvaient nous donner aucun éclaircissement sur la maison des Français, dont ils n'avaient appris aucune nouvelle ; que les Anglais avaient abandonné la leur, après avoir perdu la meilleure partie de leurs gens, et que pour eux, ayant des trésors immenses dans leur maison, il leur était défendu, sous peine de la vie, d'en sortir, sans quoi ils ne seraient pas restés.
Dans la situation où était cette malheureuse ville, il n'y avait pas apparence d'y trouver un bâtiment pour me conduire à Golconde. Il fallut se passer d'en voir le siège. Nous retournâmes à bord annoncer ce que nous avions vu et ce qu'on nous avait dit. Sur-le-champ nous remîmes à la voile, et sans faire un plus long séjour, nous fîmes route pour le port de Mergui qui appartient au roi de Siam. Ce ne fut qu'avec peine que je me résolus de retourner dans un pays d'où il ne m'avait pas été facile de me tirer. Mais comme ce port est éloigné de la Cour de plus de cent lieues, et que d'ailleurs j'étais dans un vaisseau français, je crus que j'y serais en sûreté contre la mauvaise volonté de M. Constance.
Le troisième jour du départ de Masulipatam, quelques matelots de la chaloupe, qui étaient descendus à terre, tombèrent malades. La cause de leur maladie ne pouvait être incertaine. Le chirurgien, leur trouvant la fièvre, les saigna. Le lendemain, je fus moi-même attaqué de la fièvre. Je refusai de me laisser saigner. Tous les autres matelots qui étaient venus dans la chaloupe tombèrent aussi malades. Ils furent saignés comme les premiers, et les uns et les autres moururent peu de jours après. Cependant ma fiève continuait. Elle était accompagnée d'une sueur si abondante, et qui dans peu me mit si bas, que je pouvais à peine parler. La violence du mal m'avait affaibli la vue au point de ne pouvoir plus distinguer les objets qu'imparfaitement. Pour comble de malheur, les provisions commençaient à manquer et il n'y avait plus dans le vaisseau de quoi faire du bouillon, car nous n'avions pu prendre que très peu de vivres à Pondichéry où la disette, qui était fort grande, réduisait la ville à une espèce de famine.
Je ne me trouvai jamais dans une plus fâcheuse conjoncture. Ne sachant à quoi me déterminer, je m'avisai de dire à un petit esclave siamois qui n'avait jamais voulu me quitter de m'apporter un peu de vin de Perse, dont j'avais bonne provision. J'en bus environ un demi-verre et je m'endormis profondément. Quelques heures après, je m'éveillai tout en sueur. Il me parut que ma vue s'était un peu fortifiée. Je revins à mon remède, dont je doublai la dose. Je me rendormis une seconde fois et je me réveillai encore trempé de sueur, mais beaucoup plus fortifié. Comme le remède opérait, j'en pris pour la troisième fois, y ajoutant un morceau de biscuit que je mangeai après l'avoir trempé dans le vin. Je continuai de même pendant quelques jours, après lesquels ma fièvre continue se changea en tierce.
M. Deslande et le capitaine, qui furent attaqués du même mal, profitant de mon exemple, refusèrent la saignée et ne voulurent d'autre remède que le mien. Leur mal diminua peu à peu et ils échappèrent comme moi. Enfin nous arrivâmes à Mergui, où, à l'aide des rafraîchissements dont nous ne manquâmes plus, nous fûmes sur pied en peu de jours. De 17 que nous étions embarqués dans la chaloupe et qui descendîmes à terre, 14 qui avaient été saignés, moururent, sans qu'il en échappât un seul. M. Deslande, le capitaine et moi, nous ne nous en tirâmes que pour n'avoir pas voulu de la saignée, tant il est vrai qu'elle est mortelle dans ces sortes de fièvres pestilentielles.
Peu de jours après notre arrivée à Mergui, M. Céberet y arriva suivi d'un grand cortège de mandarins. Il revenait de Louvo. La Loubère et lui y avaient été envoyés de France pour traiter du commerce et pour régler toutes choses avec Constance (9), car la négociation dont le père Tachard s'était chargé avait réussi. Ce père, trompé par Constance, comme nous avons déjà dit, et comptant de bonne foi de servir et la religion et l'État, n'avait rien oublié pour porter la Cour à entrer dans les vues, et à profiter de la bonne volonté du ministre de Siam, et, sur la parole de ce jésuite, la Cour avait donné dans ce projet d'alliance et avait envoyé des troupes commandées par le chevalier Desfarges, à qui on avait remis la forteresse de Bangkok, suivant ce qui avait été convenu.
Le mandarin qui avait été envoyé ambassadeur en France était du nombre de ceux qui accompagnaient M. Céberet (10). Dès qu'il m'aperçut, il courut à moi, tout plein de la magnificence du royaume. Il me dit que j'avais grand sujet de vouloir retourner dans mon pays, qu'il y avait vu toute ma famille et un grand nombre de mes amis avec qui il avait souvent parlé de moi, et ensuite, me faisant de grands éloges de la Cour et de tout ce qui l'avait le plus frappé, il ajouta en mauvais français : — La France grand bon, Siam petit bon.
M. Céberet, qui s'était rendu par terre de Louvo à Mergui, renvoya tous les mandarins après avoir fait à chacun des présents considérables. Il s'embarqua ensuite avec nous sur le vaisseau de la Compagnie et nous fîmes route pour Pondichéry. Sur ce que nous lui demandâmes des nouvelles de sa négociation avec M. Constance, il déclara publiquement qu'il n'était point satisfait de lui, et que ce ministre avait trompé la Cour à qui il avait promis des choses frivoles et qui n'avaient pas la moindre apparence de réalité.
Nous fûmes pendant toute la route, M. Céberet et moi, dans une grande liaison. Nos entretiens ordinaires roulaient sur le royaume de Siam et sur les manières de ces peuples. Il était si frappé de les avoir vus si pauvres, et de la misère du royaume, qu'il ne comprenait pas comment on avait eu la hardiesse d'en faire des relations si magnifiques.
— Ce que vous en avez vu, lui dis-je un jour, est pourtant ce qu'il y a de plus beau. Tout ce royaume, qui est fort grand, n'est guère qu'un vaste désert. À mesure qu'on avance dans les terres, on n'y trouve plus que des forêts et des bêtes sauvages. Tout le peuple habite sur le bord de la rivière. Il s'y tient préférablement à tout autre endroit parce que les terres, qui y sont inondées six mois de l'an, y produisent presque sans culture une grande quantité de riz, qui ne peut venir et multiplier que dans l'eau. Ce riz fait toute la richesse du pays. Ainsi, en remontant depuis la barre jusqu'à Louvo, vous avez vu, et par rapport aux peuples, et par rapport à leurs villes, et par rapport aux denrées qu'ils recueillent, tout ce qui peut mériter quelque attention dans ce royaume.
Une autre fois, comme nous parlions encore de ce pays, il témoigna souhaiter quelques éclaircissemts sur la manière dont le roi se gouverne dans son palais. — Pour cet article, lui répondis-je, il n'est pas aisé de vous satisfaire. Ceux du dehors, quelque distingués qu'ils puissent être, n'entrent jamais dans cette partie du palais que le roi habite, et ceux qui y sont, une fois entrés, n'en sortent plus. Tout ce qu'on en sait de plus particulier, c'est que tout s'y traite dans un grand secret. Non seulement chacun y a son emploi marqué, mais encore chacun a son quartier séparé hors duquel il ne lui est jamais permis de sortir. Ceux qui servent dans les chambres qui sont les plus près de la porte ne savent et ne connaissent du palais que ce qui se passe en cet endroit. Les chambres attenantes ont de nouveaux officiers qui ne sont pas plus instruits que les premiers, et ainsi successivement jusqu'à l'appartement du roi, qui passe presque toute sa vie enfermé, faisant consister une partie principale de sa grandeur à ne se montrer que très rarement. Quand il a à parler à ses ministre, à ceux même qui sont le plus en faveur, il se montre par une fenêtre élevée de terre à peu près de la hauteur d'une toise, d'où il les entend, et disparaît après leur avoir brièvement expliqué ses volontés.
M. Céberet m'ayant encore questionné au sujet de M. Constance, je lui dis tout ce que j'en savais, et quoiqu'il fût entré de lui-même assez avant dans les vues de ce ministre, dont il commençait à démêler la politique, je lui fis apercevoir bien des choses qui lui étaient échappées et de la vérité desquelles il ne douta plus dès qu'il fut en état de joindre ce que je lui disais avec ce qu'il avait déjà reconnu.
Cependant nous approchions de la ville de Madraspatan (11), célèbre par son commerce. Il n'y avait pas apparence de revenir des Indes en Europe sans en rapporter quelques étoffes et autres raretés du pays. Dans la résolution où j'étais d'y employer quelque argent, je priai le capitaine du vaisseau de me mettre à terre. Les Anglais sont les maîtres de cette place. Le directeur général de leur compagnie, ennemi juré de Constance, m'ayant su logé chez les capucins français, voulut à toute force m'emmener chez lui. Il emmena aussi le supérieur de ces bons religieux (12) à qui il fit honnêteté à mon occasion. Ces pères sont établis dans le faubourg et administrent les sacrements à des Portugais ou métis qui sont catholiques romains.
Il me donna un fort grand dîner, pendant lequel on tira bon nombre de coups de canon. Nous bûmes les santés des rois d'Angleterre, de France, et des deux familles royales, les canons tirant à boulets. Constance ne fut pas épargné pendant le repas. Le directeur disait tout haut qu'il le ferait pendre s'il pouvait jamais l'attraper. Cependant nous buvions toujours, et nous continuâmes de telle sorte que nous nous enivrâmes tous, le capucin comme les autres, quoiqu'il y eût moins de sa faute, ayant été engagé à boire presque malgré qu'il en eût.
Quand j'eus fait mes emplettes, le directeur me donna un petit bâtiment pour me conduire à Pondichéry, qui n'est éloigné de Madraspatan que de 20 lieues. En arrivant, j'y trouvai un vaisseau du roi qui venait prendre M. Céberet (13). Ce bâtiment était commandé par M. Duquesne-Guitton, qui me remit un magnifique fusil et une paire de pistolets d'un ouvrage merveilleux. C'était un présent que Bontemps (14) m'envoyait comme une marque de son amitié et pour me remercier de quelques pièces assez curieuses que je lui avais envoyées par le retour des ambassadeurs.
Après que M. Céberet eut fini toutes ses affaires à Pondichéry, nous nous embarquâmes et nous fîmes route pour la France. Pendant le voyage, la conversation roula encore souvent entre lui et moi sur le royaume de Siam. Il me parla de la jalousie de M. Constance et des dangers auxquels il m'avait souvent exposé, et quoique nos Français, qu'il avait vus à Joudia et à Louvo, l'eussent instruit, et de mon aventure des Macassars et de celle du capitaine anglais, il souhaita encore que je lui en fisse le récit.
Après une navigation fort heureuse, nous mouillâmes au cap de Bonne-Espérance où nous fîmes quelques rafraîchissements. Nous mouillâmes encore à l'île Sainte-Hélène, qui appartient aux Anglais, et peu après à l'île de l'Ascension, où nous pêchâmes quantité de tortues et autres poissons. Enfin nous arrivâmes heureusement au port de Brest, où nous débarquâmes sur la fin de juillet de l'année 1688, environ trois ans et demi après en être parti avec M. de Chaumont.
Ayant débarqué tout ce que j'avais acheté de marchandises à Madraspatan, j'en fis porter les ballots chez le messager qui part toutes les semaines pour Paris. Avant que de me dessaisir de tous ces effets, j'eus la précaution de lui déclarer, et de faire spécifier sur son livre, la quantité et la qualité des marchandises, qui consistaient en des paravents, cabinets de la Chine, thé, porcelaines, plusieurs pièces d'indienne de toutes sortes et une quantité assez considérable d'étoffes d'or et d'argent. Je le chargeai de tout. Après quoi je pris la poste pour Paris où je fus me présenter à M. de Seignelay, ministre de la marine. Il me reçut fort bien et me présenta lui-même au roi qui donna ordre de me compter tous mes appointements depuis mon départ jusqu'à ce jour-là.
Ce fut à l'amitié de Bontemps que je dus une réception si favorable, car M. de Seignelay ayant trouvé fort mauvais que j'eusse déféré aux ordres de M. de Chaumont et que je ne fusse pas revenu en France, m'avait fait effacer de dessus l'état. Bontemps, qui en fut informé, en parla de lui-même au roi qui ordonna au ministre de ne rien innover sur mon sujet et de m'avancer même, dans l'occasion, préférablement à plusieurs autres.
Charmé de la manière dont j'avais été accueilli, je fus me présenter au dîner du roi. Sa Majesté me fit l'honneur de me questionner beaucoup sur le royaume de Siam. Elle me demanda d'abord si le pays était riche : — Sire, lui répondis-je, le royaume de Siam ne produit rien et ne consomme rien. — C'est beaucoup dire, en peu de mots, répliqua le roi, et continuant à m'interroger, il me demanda quel en était le gouvernement, comment le peuple vivait et d'où le roi tirait tous les présents qu'il lui avait envoyés. Je lui répondis que le peuple était fort pauvre, qu'il n'y avait parmi eux ni noblesse, ni condition, naissant tous esclaves du roi pour lequel ils sont obligés de travailler une partie de l'année, à moins qu'il ne lui plaise de les en dispenser en les élevant à la dignité de mandarin ; que cette dignité, qui les tire de la poussière, ne les met pas à couvert de la disgrâce du prince, dans laquelle ils tombent fort facilement et qui est toujours suivie de châtiments rigoureux ; que le barcalon lui-même, qui est le premier ministre et qui remplit la première dignité de l'État, y est aussi exposé que les autres ; qu'il ne se soutient dans un poste si périlleux qu'en rampant devant son maître, comme le dernier du peuple ; que s'il lui arrive de tomber en disgrâce, le traitement le plus doux qu'il puisse attendre, c'est d'être renvoyé à la charrue après avoir été très sévèrement châtié ; que le peuple ne se nourrit que de quelques fruits et de riz qui est très abondant chez eux ; que croyant tous à la métempsycose, personne n'oserait manger rien de ce qui a eu vie, de crainte de manger son père ou quelqu'un de ses parents ; que pour ce qui regardait les présents que le roi de Siam avait envoyés à Sa Majesté, M. Constance avait épuisé l'épargne et avait fait des dépenses qu'il ne lui serait pas aisé de réparer ; que le royaume de Siam, qui forme presque une péninsule, pouvait être un entrepôt fort commode pour faciliter le commerce des Indes, étant frontière de deux mers, l'une du côté de l'est qui regarde la Chine, le Japon, le Tonkin, la Conchinchine, le pays de Lahore et Cambodge, et l'autre du côté de l'ouest faisant face au royaume d'Aracan, au Gange, aux côtes de Coromandel, de Malabar, et à la ville de Surate ; que les marchandises de ces différentes maisons étaient transportées toutes les années à Siam, qui est le rendez-vous, et comme une espèce de foire où les Siamois font quelque profit en débitant leurs denrées ; que le principal revenu du roi consistait dans le commerce qu'il fait presque tout entier dans ce royaume où l'on ne trouve que du riz, de l'arec dont on compose le bétel, un peu d'étain, quelques éléphants qu'on vend, et quelques peaux de bêtes fauves dont le pays est rempli (15) ; que les Siamois allant presque tout nus, à la réserve d'une toile de coton qu'ils portent depuis la ceinture jusqu'à demi-cuisse, ils n'ont chez eux aucune sorte de manufacture, si ce n'est de quelques mousselines dont les mandarins seulement ont droit de se faire comme une espèce de chemisette qu'ils mettent dans les jours de cérémonies ; que lorsqu'un mandarin a eu l'adresse de ramasser quelque petite somme d'argent, il n'a rien de mieux à faire que de la tenir cachée, sans quoi le prince la lui ferait enlever ; que personne ne possède dans tout le royaume aucuns biens-fonds (16), qui de droit appartiennent tous au roi, ce qui fait que la plus grande partie du pays demeure en friche, personne ne voulant se donner la peine de cultiver des terres qu'on leur enlèverait dès qu'elles seraient en bon état ; qu'enfin le peuple y est si sobre qu'un particulier qui peut gagner 15 ou 20 francs par an a au-delà de tout ce qui lui est nécessaire pour son entretien.
Le roi me demanda encore quelle sorte de monnaie avait cours dans le pays. — Leur monnaie, lui répondis-je, est comme un morceau d'argent, rond comme une balle de fusil, marqué de deux lettres siamoises, qui sont le coin du prince. Cette balle, qui s'appelle tical (17), de la valeur de cinq sous. Pour la petite monnaie, ils se servent de coquilles de mer qui viennent des îles Maldives, et dont les 120 font 5 sous.
— Parlons un peu de la religion, me dit le roi. Y a-t-il beaucoup de chrétiens dans le royaume de Siam, et le roi songe-t-il véritablement à se faire chrétien lui-même ? — Sire, lui répondis-je, ce prince n'y a jamais pensé, et nul mortel ne serait assez hardi pour lui en faire la proposition. Il est vrai que dans la harangue que M. de Chaumont lui fit le jour de sa première audience, il fit mention de religion, mais M. Constance, qui faisait l'office d'interprète, omit habilement cet article. Le vicaire apostolique qui était présent et qui entend parfaitement le siamois, le remarqua fort bien (18), mais il n'osa jamais rien en dire, crainte de s'attirer sur les bras M. Constance, qui ne lui aurait pas pardonné s'il en avait ouvert la bouche.
Le roi, surpris de ce discours, m'écoutait fort attentivement. J'ajoutai que dans les audiences particulières que M. de Chaumont eut dans le cours de son ambassade, il s'épuisait toujours à parler de la religion chrétienne et que Constance, qui était toujours l'interprète, jouait en homme d'esprit deux personnages en disant au roi de Siam ce qui le flattait, et en répondant à M. de Chaumont ce qui était convenable, sans que de la part du roi et de celle de M. l'ambassadeur il y eût rien de conclu que ce qu'il plaisait à Constance de faire entendre à l'un et à l'autre ; que je tenais encore ce fait de M. le vicaire apostolique lui-même, qui avait été présent à tous leurs entretiens particuliers et qui s'en était ouvert à moi dans un grand secret. Sur cela, le roi se prenant à sourire, dit que les princes étaient bien malheureux d'être obligés de s'en rapporter à des interprètes qui souvent ne sont pas fidèles.
Enfin le roi me demanda si les missionnaires faisaient beaucoup de fruit à Siam, et en particulier s'ils avaient déjà converti beaucoup de Siamois. — Pas un seul, Sire, lui répondis-je ; mais comme la plus grande partie des peuples qui habitent ce royaume n'est qu'un amas de différentes nations et qu'il y a parmi les Siamois un grand nombre de Portugais, de Cochinchinois, de Japonais, qui sont chrétiens, ces bons missionnaires en prennent soin et leur administrent les sacrements. Ils vont d'un village à l'autre et s'introduisent dans les maisons sous prétexte de la médecine qu'ils exercent et des petits remèdes qu'ils distribuent ; mais avec tout cela leur industrie n'a encore rien produit en faveur de la religion. Le plus grand bien qu'ils fassent est de baptiser les enfants des Siamois qu'ils trouvent exposés dans les campagnes, car ces peuples, qui sont fort pauvres, n'élèvent que peu de leurs enfants et exposent tout le reste, ce qui n'est pas un crime chez eux. C'est au baptême de ces enfants que se réduit tout le fruit que les missions produisent dans ce pays.
Au sortir du dîner du roi, M. de Seignelay me fit passer dans son cabinet où il m'interrogea fort au long sur tout ce qui pouvait regarder l'intérêt du roi, et en particulier il s'informa si l'on pouvait établir un gros commerce à Siam, quelles vues pouvait avoir M. Constance en témoignant tant d'empressement pour y appeler les Français. Je le satisfis sur ce dernier article en lui apprenant dans un long détail tout ce que je savais des vues et des desseins du ministre de Siam.
Pour l'article du commerce, je lui répondis, comme j'avais fait au roi, que le royaume ne produisant rien, il ne pouvait être regardé que comme un entrepôt à faciliter le commerce de la Chine, du Japon et des autres royaumes des Indes ; que cela supposé, l'établissement qu'on avait commencé en y envoyant des troupes était absolument inutile, celui que la Compagnie y avait déjà étant plus que suffisant pour cet effet. Qu'à l'égard de la forteresse de Bangkok, elle demeurerait entre les mains des Français tandis que le roi de Siam et M. Constance vivraient, mais que l'un des deux venant à manquer, les Siamois sollicités, et par leur propre intérêt, et par les ennemis de la France, ne manqueraient pas de chasser nos troupes d'une place qui les rendait maîtres du royaume.
Deux jours après, le cardinal de Janson (19) me dit d'aller trouver le père de La Chaize (20) qui souhaitait de m'entretenir sur le nouvel établissement des Français dans le royaume de Siam. — Mon cousin, me dit le cardinal, prenez bien garde à ce que vous direz, car vous allez parler à l'homme le plus fin du royaume. — Je ne m'en embarrasse pas, lui répondis-je, je n'ai que des vérités à dire. Dès le jour même je fus introduit par un escalier dérobé, et présenté à Sa Révérence par le frère Vatblé.
Ce révérend père ne me parla presque que de religion et du dessein que le roi de Siam avait de retenir des jésuites dans ses États en leur bâtissant à Louvo un collège et un observatoire. Je lui dit que M. Constance, qui voulait avoir à toute force la protection du roi, promettait au-delà de ce qu'il pouvait tenir ; que l'observatoire et le collège se bâtiraient peut-être pendant la vie du roi de Siam, que les jésuites y seraient nourris et entretenus, mais que ce prince venant à mourir, on pouvait se préparer en France à chercher des fonds pour l'entretien des missionnaires, y ayant peu d'apparence qu'un nouveau roi voulût y contribuer.
Quand le père de La Chaize m'eut entendu parler ainsi : — Vous n'êtes pas d'accord avec le père Tachard, me dit-il. Je lui dis que je ne disais que la pure vérité, que j'ignorais ce que le père Tachard avait dit et les motifs qui l'avaient fait parler, mais que son amitié pour M. Constance, qui, pour arriver à ses fins n'avait rien oublié pour le séduire, pouvait bien l'avoir aveuglé et ensuite le rendre suspect ; que pendant le peu de temps qu'il avait resté à Siam avec M. de Chaumont, il avait su s'attirer toute la confiance du ministre, à qui il avait même servi de secrétaire français dans certaines occasions, et que j'avais vu moi-même des brevets écrits de la main de ce père, et signés par Monseigneur, et plus bas, Tachard. À ce mot, ce révérend père sourit, et reprenant dans un moment son maintien grave et modeste qu'il ne quittait que bien rarement, il s'informa si les missionnaires faisaient beaucoup de fruit dans ce royaume.
Je lui répondis ce que j'en avais dit au roi, ajoutant que ce qui retardait le plus le progrès de l'Évangile, était le genre de vie dur et austère des talapoins. Ces prêtres ou moines du pays, lui dis-je, vivent dans une abstinence continuelle. Ils ne se nourrissent que des charités journalières qu'on leur fait. Ils distribuent aux pauvres ce qu'il ont au-delà de leur nécessaire et ne réservent rien pour le lendemain. Ils ne sortent jamais de leur monastère que pour demander l'aumône, encore la demandent-ils sans parler. Ils se contentent de présenter leur panier, qui, à la vérité, est bientôt rempli, car les Siamois sont fort charitables.
Lorsque les talapoins vont par la ville, ils portent à la main un éventail qu'ils tiennent devant le visage pour s'empêcher de voir les femmes. Ils vivent dans une continence très exacte et ils ne s'en dispensent que quand ils veulent quitter la règle pour se marier. Les Siamois n'ont ni prières publiques, ni sacrifices. Les talapoins les assemblent quelquefois dans les pagodes où ils leur prêchent. La matière ordinaire de leur sermon est la charité. Cette vertu est en très grande recommandation dans tout le royaume, où l'on ne voit presque point de pauvres réduits à mendier leur pain.
Les femmes y sont naturellement fort chastes. Les Siamois ne sont point méchants et les enfants y sont si soumis à leurs pères qu'ils se laissent vendre sans murmurer lorsque leurs parents y sont forcés pour se secourir dans leurs besoins. Cela étant, il ne faut pas espérer de convertir aucun Siamois à la religion chrétienne, car outre qu'ils sont trop grossiers pour qu'on puisse leur donner facilement l'intelligence de nos mystères, et qu'ils trouvent leur morale plus parfaite que la nôtre, ils n'estiment pas assez nos missionnaires qui vivent d'une manière moins austère que les talapoins.
Quand nos prêtres veulent prêcher à Siam les vérités chrétiennes, ces peuples qui sont simples et dociles les écoutent comme si on leur racontait des fables ou des contes d'enfant. Leur complaisance fait qu'ils approuvent toutes sortes de religions. Selon eux le paradis est un grand palais où le maître souverain habite. Ce palais a plusieurs portes par où toutes sortes de gens peuvent entrer pour servir le maître selon l'usage qu'il veut en faire. C'est à peu près, disent-ils, comme le palais du roi qui a plusieurs entrées et où chaque mandarin a ses fonctions particulières. Il en est de même du ciel, qui est le palais du Tout-Puissant, toutes les religions sont autant de portes qui y conduisent, puisque toutes les croyances des hommes quelles qu'elles soient, tendent toutes à honorer le premier être, et se rapportent à lui, quoique d'une manière plus ou moins directe.
Les talapoins ne disputent jamais de religion avec personne. Quand on leur parle de la religion chrétienne ou de quelque autre, ils approuvent tout ce qu'on leur en dit, mais quand on veut condamner la leur, ils répondent froidement : — Puisque j'ai eu la complaisance d'approuver votre religion, pourquoi ne voulez-vous pas approuver la mienne ? Quant aux pénitences extérieures et à la mortification des passions, il ne serait pas convenable de leur en parler puisqu'ils nous en donnent l'exemple et qu'ils surpassent de beaucoup, au moins extérieurement, nos religieux les plus réformés.
Au reste, mon père, continuai-je, les jésuites ne manquent pas d'ennemis dans ces missions. Vos missionnaires, qui ont des talents supérieurs aux autres, viennent facilement à bout de s'attirer la faveur des princes dont ils se servent pour soutenir la religion ; de là il est difficile que la jalousie n'excite bien des cabales contre eux, non seulement en Europe, mais encore dans les Indes.
Pendant mon séjour à Siam, plusieurs Chinois qui ont de l'esprit et du savoir m'ont avoué qu'ils ne comprenaient pas comment des gens d'une même croyance, qui avaient quitté leur patrie et traversé des mers immenses, prétendaient attirer des gentils à eux, tandis qu'eux-mêmes n'étaient pas d'accord dans leur conduite, les uns vivant avec beaucoup de modestie et de charité, et les autres se livrant à la haine et aux dissensions, pour ne rien dire de plus. C'est là le langage que m'ont tenu tous les Chinois à qui j'ai parlé. Cette vérité est si constante et si publique dans les Indes, que non seulement je crois devoir vous en informer, mais encore la publier toutes les fois que j'en aurais occasion.
J'étais à Paris depuis quelques jours, lorsque, ne voyant pas arriver le messager de Brest, je commençai à être inquiet sur les ballots que je lui avais confiés. Pour m'en éclaircir, j'allai au bureau, j'y appris justement ce que j'avais appréhendé. Les commis de la douane de Pontorson y avaient arrêté tous mes effets, et non contents de la confiscation qu'ils prétendaient avoir lieu, parce que j'avais dans mes ballots des indiennes dont l'entrée était pour lors défendue dans le royaume (21), ils m'avaient condamné à une amende de 500 livres, comme ayant contrevenu aux ordonnances du roi.
Je crus dans cet embarras n'avoir rien de mieux à faire que de recourir à M. Céberet, que je savais être fort connu des fermiers généraux. Après l'avoir instruit du contretemps qui m'arrivait, je lui représentai qu'ayant ignoré les défenses du roi, je ne devais pas être puni pour les avoir violées ; que la bonne foi qui paraissait dans toute ma conduite me justifiait assez, puisque j'avais déclaré moi-même au messager la qualité des marchandises en faisant une expresse mention des indiennes, ce que je n'aurais pas fait si je les avais crues défendues. Céberet me rassura le plus qu'il lui fut possible, il me dit qu'il connaissait les fermiers, qu'ils étaient fort honnêtes gens, que je pouvais les aller trouver moi-même quand ils seraient assemblés dans leur grand bureau et qu'il était persuadé qu'ils me donneraient satisfaction.
Je profitai de l'avis qu'il me donnait et je fus me présenter à ces messieurs. Je me plaignis du jugement qui avait été rendu contre moi, je leur fis valoir toutes les raisons que j'avais déduites à M. Céberet. J'insistai principalement sur ma bonne foi et je demandai qu'en conséquence ils ordonnassent que mes ballots me fussent rendus. Sur cet exposé ils condamnèrent unanimement ce que les commis avaient fait par rapport aux marchandises dont l'entrée n'était pas défendue. Quant aux indiennes, il fut dit qu'on ne pouvait pas les relâcher, attendu l'ordonnance qui défendait de les laisser entrer, mais que je pouvais m'adresser au roi et que Sa Majesté, à ma sollicitation et à celle de mes amis, pourrait ordonner qu'elles me seraient rendues.
Ensuite de cette délibération, je priai ces messieurs d'envoyer leurs ordres à Pontorson pour qu'on fît venir dans le bureau de Paris tous les ballots qui étaient à moi, et je déclarai que j'étais prêt d'en acquitter non seulement tous les droits, mais encore de payer tous les frais qu'il faudrait pour le transport. Sur-le-champ, M. de Lulie, président de l'assemblée, ordonna qu'on écrivît aux commis, et la lettre fut faite et signée devant moi.
Au sortir du bureau, je me rendis incessamment à Versailles où je fus trouver Bontemps, et lui ayant raconté ce qui m'arrivait, je le priai d'en parler à M. Le Pelletier, contrôleur général des finances. Bontemps s'employa pour moi avec son zèle ordinaire. Le ministre, qui l'aimait, lui répondit qu'il n'avait rien à lui refuser ; qu'il jugeait pourtant convenable d'en parler au roi avant que de rien ordonner. Sa Majesté accorda tout ce qu'on lui demandait, sur quoi le ministre, qui voulait faire plaisir à Bontemps, me fit expédier un ordre de la part du roi à MM. les fermiers généraux, par lequel il leur était enjoint de faire rendre incessamment, et sans payer aucun droit, toutes les marchandises qui appartenaient au chevalier de Forbin.
Je ne parlai à personne de ce que la Cour venait de faire en ma faveur, mais lorsque je sus que mes ballots étaient arrivés à Paris, je fus signifier moi-même à M. de Lulie l'ordre que j'avais obtenu. Charmé de la satisfaction qu'on me donnait, il fut au bureau et me fit rendre tout ce qui était à moi. Cette affaire se termina ainsi à mon avantage. Je fus redevable de ce bon succès à l'amitié de Bontemps. Je lui dois ce témoignage qu'il n'a jamais manqué de s'employer avec ardeur dans toutes les affaires où je me suis adressé à lui, comme on a déjà pu voir.
Sur quoi je dirai en passant au sujet de cet ami qu'il n'y avait guère à la Cour de protection si utile et si recherchée que la sienne, puisqu'il y avait peu de seigneurs qui eussent autant de crédit que lui. Je pourrais dire ici bien des choses à son avantage. Je ne les passe sous silence que parce qu'elles mèneraient trop loin, mais ce que je ne passerai pas, et ce qui le met bien au-dessus de tant d'autres qui l'emportaient sur lui par la naissance, c'est que son zèle et son attachement sincère pour la personne du roi lui avaient tellement gagné la confiance de son maître, confiance qu'il posséda jusqu'à la mort, qu'il obtenait tout ce qu'il demandait ; et ce qu'on ne trouve presque nulle part, il usa toujours si bien de la faveur, que jamais personne ne la lui envia, aussi observa-t-il toujours d'employer ce qu'il avait de crédit pour rendre service, et jamais pour nuire à personne.
Je passai le reste de cette année à Paris, où quelques mois après mon arrivée, nous apprîmes en France l'entreprise du mandarin Phetracha sur le royaume de Siam. Quoique je n'en aie pas été témoin, tout ce qui se passa dans cette occasion a tant de rapport à ce qui a été dit ci-devant, et justifie si bien par l'événement tout ce que j'avais prédit de l'alliance des deux couronnes et de l'établissement des Français à Bangkok, que je me persuade que le lecteur sera bien aise de trouver ici en peu de mots quel fut le succès de cette entreprise et comment nos Français furent obligés d'abandonner la place qu'on leur avait confiée dans ce royaume.
Ce fut vers le milieu du mois de mai de l'an 1688 que le royaume de Siam, qui était violemment agité depuis quelque temps par des mouvements d'autant plus dangereux qu'ils étaient cachés, devint tout à coup le théâtre d'une révolution qui changea la face de tout ce pays et qui, en éteignant toute la famille royale, coûta beaucoup de sang à tous ceux qui jusqu'alors avaient eu part aux affaires, et détruisit dans un moment tout ce qui avait été fait au sujet de l'alliance avec les Français.
J'ai déjà remarqué que, quoique tout parût tranquille à Siam, il y avait dans le fond peu de mandarins qui dans l'âme ne soupirassent après le changement. Pendant mon séjour dans ce royaume, j'avais reconnu cette disposition dans les esprits, et j'eus encore plus lieu de m'en convaincre dans l'affaire du sieur de Rouan où, comme nous avons vu, l'attente des mandarins fut trompée par le soin que je pris de disculper M. Constance. Parmi ceux qui pouvaient le plus remuer, un mandarin nommé Phetracha, homme de résolution, estimé courageux parmi les siens et respecté pour l'austérité de ses mœurs, osa former le projet de secouer le joug et de monter lui-même sur le trône.
Cet homme, que j'ai connu fort particulièrement, conservait encore dans un âge assez avancé toute la vigueur de sa première jeunesse. Il se comporta avec tant de prudence et mania les esprits si à propos, qu'après avoir engagé les talapoins dans son parti, il y fit entrer non seulement les mandarins, dont il flatta l'ambition en leur promettant de partager le gouvernement avec eux, mais encore tout le peuple qui, toujours amateur de la nouveauté, espérait sous un autre maître un gouvernement moins rigoureux.
Toutes ces menées ne furent pourtant pas si secrètes que Constance n'en eût avis. Il ne tint qu'à lui de prévenir la conjuration, mais soit qu'il se fît une délicatesse mal entendue d'accuser et de faire arrêter Phetracha sans avoir en main de quoi le convaincre pleinement de son attentat, soit qu'il se crût toujours assez en état de réprimer les factieux, il laissa engager l'affaire trop avant. Il s'en aperçut un peu tard, et pour réparer sa faute, autant qu'il était possible, il eut recours aux Français qui étaient à Bangkok. Mais ceux-ci, sur de fausses relations qui leur furent faites des troubles et des mouvements de la Cour, appréhendant de s'engager mal à propos dans une affaire qui pouvait avoir de fâcheuses suites pour la nation, se tinrent tranquilles dans leur forteresse, malgré les lettres et les courriers envoyés coup sur coup par M. Constance qui les conjurait de venir à son secours.
Quand j'appris ce détail, je fus si indigné de la conduite de nos Français que je ne pus m'empêcher de dire à M. de Seignelay qui m'en parla, que si je m'étais trouvé pour lors à Bangkok, je n'aurais pas balancé à voler au secours de M. Constance, quelque sujet que j'eusse d'ailleurs de me plaindre de ses mauvais procédés à mon égard. Et s'il faut dire la vérité, connaissant le peu de valeur des Siamois, je suis persuadé que si je m'étais rendu à Louvo avec cinquante hommes de ma garnison, je n'aurais eu qu'à me montrer pour dissiper toute cette populace qui m'aurait abandonné son chef sans oser entreprendre la moindre chose, trop heureuse d'apaiser ainsi la cour par une prompte soumission.
Le secours qu'on avait sujet d'attendre de la garnison française ayant manqué, et tout concourant à assurer l'entreprise de Phetracha, il se déclara, se mit à la tête du peuple et s'assura de la personne du roi après s'être rendu maître du palais. Au premier bruit de cette démarche, Constance courut auprès du roi, résolu de mourir en le défendant. Mais il n'était plus temps, il fut arrêté lui-même et mis au fer.
Phetracha, qui voulait rendre son usurpation moins odieuse, jugeant que le roi, dont la maladie augmentait chaque jour, ne pouvait vivre que fort peu de temps, non seulement n'entreprit pas sur la personne de son prince après l'avoir fait prisonnier, mais ne prenant pour lui que la qualité de grand mandarin, il affecta de ne donner aucun ordre que sous le nom du roi, à qui il laissa sans peine tout l'extérieur de la souveraineté.
Jusque-là tout avait réussi au gré de l'usurpateur, les suites ne lui furent pas moins favorables. Les différents ordres de l'État s'étant soumis à sa domination, il ne lui manquait plus pour jouir paisiblement de ses crimes que de chasser les Français du royaume. Il ne craignait qu'eux et, en effet, ils étaient les seuls qui eussent pu traverser son bonheur. Il s'aperçut bientôt qu'il avait eu tort de les redouter. Ayant reconnu leur faiblesse, et en particulier le peu de part qu'ils prenaient au sort de M. Constance à qui il n'avaient conservé la vie jusqu'alors que parce qu'il ignorait les dispositions des Français sur ce sujet, il n'hésita plus à se défaire d'un ennemi qui lui avait été si odieux et qu'il avait déjà dépouillé de tous ses trésors.
On a ignoré le genre de mort qu'il lui fit souffrir. Ceux qui étaient à Siam pendant la révolution assurent qu'il supporta tous ces revers avec des sentiments très chrétiens et un courage véritablement héroïque. Malgré tout le mal qu'il m'a fait, j'avouerai de bonne foi que je n'ai pas de peine à croire ce qu'on en a dit. M. Constance avait l'âme grande, noble, élevée ; il avait un génie supérieur, et capable des plus grands projets, qu'il savait conduire à leur fin avec beaucoup de prudence et de sagacité. Heureux si toutes ces grandes qualités n'avaient pas été obscurcies par de grands défauts, par une avarice insatiable, souvent même sordide, et par une jalousie qui, prenant ombrage des moindres choses, le rendait dur, cruel, impitoyable, de mauvaise foi, et capable de tout ce qu'il y a de plus odieux.
Le roi ne survécut pas longtemps à son ministre. Il mourut peu de jours après, et Phetracha fut reconnu tout d'une voix roi de Siam. Enfin, pour que rien ne manquât à son bonheur, nos Français, après un siège de quelques mois où ils eurent tout à souffrir, furent obligés d'abandonner Bangkok et de repasser en France, où nous vîmes arriver leurs tristes débris. Tel fut, par rapport à la nation, le succès de cette entreprise mal concertée, qui coûta beaucoup, qui ne pouvait être d'aucune utilité au royaume, et dans laquelle la Cour ne donna que parce qu'on l'éblouit par des promesses belles en apparence, mais qui n'avaient rien de solide.
Fin des mémoires siamoises du comte de Forbin

NOTES
1 - Étoffes de coton peintes qui se font aux Indes. ⇑
2 - Ville de Bretagne, à l'entrée de la rade de Lorient. ⇑
3 - François Martin (1634-1706) entra à la Compagnie française des Indes Orientales dès sa création en 1664. Il fonda le comptoir de Pondichéry en 1674 et en assura la direction. ⇑
4 - Ici prend place un épisode assez mystérieux dans la vie du chevalier. François Martin assure dans ses Mémoires que Forbin essaya de s'embarquer à nouveau pour le Siam dès juin 1687, mais sans en préciser les raisons : M. le chevalier de Forbin nous parla pour pouvoir repasser à Siam sur le navire le Saint-Louis. Il apporta beaucoup de raisons pour nous persuader qu'il était absolument nécessaire qu'il fît le voyage. On lui représenta l'état où il avait laissé les choses à son départ : M. Constance était extrêmement animé contre lui ; cet espèce de bannissement qu'on lui avait signifié qu'il y avait peu d'apparence qu'il y fût bien reçu, les mêmes choses subsistant toujours, outre que son passage sur le Saint-Louis pourrait apporter du préjudice aux officiers de la Compagnie. M. de Forbin ne se rendit point à nos raisons ; il y répliquait ; son tempérament plein de feu le fit tenir ferme ; nous fûmes même enfin obligés de lui dire qu'on ne lui permettrait point du tout de s'embarquer sur le vaisseau. Notre résolution le porta à nous présenter une requête où il étalait les raisons qui l'engageaient à demander à faire voyage, même qu'il y allait du service du roi. Il faisait des protestations ensuite sur le mal qu'il tâchait de nous persuader qui en pourrait arriver si l'on s'y opposait. On répondit à la requête et la conclusion à la fin, un refus absolu de l'embarquement. Les choses restèrent en cet état. Nous apprîmes depuis que sur l'avis qu'il eut qu'on préparait deux vaisseaux à Madras pour envoyer à Mergui, le bruit commun pour faire la guerre au roi de Siam (mais par des avis qu'on crut plus sûrs, pour faire des plaintes par des lettres que le gouverneur de Madras écrivait à ce prince de la conduite de M. Constance à l'égard de la Compagnie d'Angleterre), il avait écrit à des amis de Madras de tâcher à lui obtenir la permission de passer sur un de ces bâtiments. Il n'y a pas d'apparence qu'elle lui aurait été accordée, mais comme il ne s'avisa que sur le tard à prendre cette voie, les navires étaient à la voile lorsqu'on reçut ces lettres. Ceci est pour le moins étonnant de la part d'un homme qui manifestait une telle aversion pour ce royaume. Dans son ouvrage Un jésuite à la cour de Siam (France-Empire, 1992), Raphael Vongsuratavana émet l'hypothèse que le chevalier de Forbin n'est pas parti de son plein gré du Siam, mais qu'il en a été expulsé. Michael Smithies avance l'idée que Forbin se livrait à des activités commerciales personnelles fort lucratives au Siam, et qu'il n'entendait pas y renoncer. Toutefois, étant donné l'hostilité de Phaulkon, cela aurait été fort difficile de les poursuivre. (A Resounding Failure - Martin and the French in Siam - 1672-1693, 1998, pp. 53-54). ⇑
5 - Il s'agissait du navire le Président. ⇑
6 - Aujourd'hui Bandar, (Andhra Pradesh), port de l'Inde, ancien comptoir anglais, hollandais et français. ⇑
7 - Forteresse et ville historique de l'Inde, près de Hyderabad. Célèbre pour ses trésors, Golconde fut détruite par le grand Moghol Aurangzeb en 1687. ⇑
8 - André Deslandes-Boureau qui fonda le comptoir siamois de la Compagnie française des Indes Orientales en 1680. Apprécié par Phaulkon, il obtint d'importantes garanties pour sa compagnie et épousa la fille de François Martin en 1686. ⇑
9 - L'ambassade Céberet - La Loubère avait quitté Brest le 1er mars 1687 et était arrivée à Ayutthaya le 26 octobre 1687. Céberet, décu par les piètres résultats qu'il avait obtenus, était parti le premier pour Mergui le 13 décembre, d'où il projetait de s'embarquer pour la France. La Loubère ne quitta le Siam que le 3 janvier suivant, sur le navire Le Gaillard. Dans son Journal, Céberet note cette rencontre avec le chevalier de Forbin (Jacq-Hergoualc'h, Journal du voyage de Siam de Claude Céberet, pp.149-150) : Le 30 [décembre 1687], en approchant de Tenasserim, je trouvai un balon bien équipé qu'on avait préparé pour moi, ainsi que plusieurs autres pour ma suite. Mais l'empressement que j'avais d'arriver à Mergui me fit prendre le parti de suivre ma route jusques à Tenasserim sans changer de voiture, ce qui m'aurait retardé. Un peu après avoir rencontré ces balons, je trouvai le chevalier de Forbin et le sieur de Beauregard, opra de Mergui, avec le sieur Ferault, qui venaient au-devant de moi. Je m'embarquai dans leur balon pour me rendre plus promptement à Tenasserim où je mis pied à terre pour dîner. En descendant, je fus salué de plusieurs coups de canon. Je trouvai toutes les rues, depuis la descente jusqu'au logis, bordées d'une double haie de mousquetaires, avec quantité de tambours et étendards. ⇑
10 - Il s'agissait de Kosapan. ⇑
11 - Madras, port de la côte de Coromandel. Également appelée Fort StGeorge, Madras devint comptoir de l'East India Company en 1639. ⇑
12 - Selon Céberet, il s'agissait du père Raphaël (Jacq-Hergoualc'h, op. cit. p. 151). ⇑
13 - Le chevalier de Forbin aurait dû reconnaître immédiatement ce navire, puisqu'il s'agissait de l'Oiseau, celui-là même qui l'avait emmené au Siam en 1685 avec l'ambassade du chevalier de Chaumont. ⇑
14 - Alexandre Bontemps, premier valet de chambre de Louis XIV, personnage considérable parce qu'il bénéficiait de la pleine confiance et de l'écoute du roi. ⇑
15 - Notamment les peaux de rennes, une des principales richesses du pays. ⇑
16 - Biens immobiliers, immeubles, terres, maisons. ⇑
17 - บาท : Baht - Tical - Tikal - Bat - Baat : C'est une monnaie d'argent qui a cours et qui se fabrique dans le royaume de Siam. Elle pèse trois gros et vingt-trois grains. (Encyclopédie de Diderot et d'Alembert). Cette monnaie avait la forme d'une petite bille, appelée pot duang (พดด้วง) en siamois.
 Pot duang. ⇑
Pot duang. ⇑
18 - Deux ecclésiastiques français étaient présents à cette audience : Louis Laneau, évêque de Métellopolis et l'abbé de Lionne. Ce dernier comprenait et parlait très bien le Siamois. ⇑
19 - Le cardinal de Forbin-Janson, évêque de Beauvais, cousin éloigné du chevalier de Forbin. ⇑
20 - François d'Aix de la Chaize (1624-1709) fut le confesseur jésuite de Louis XIV à partir 1675 et jusqu'à sa mort. ⇑
21 - Ces toiles, apportées des Indes orientales par les vaisseaux de la Compagnie, étaient de peu de prix à l'achat, mais, bénéfice oblige, elles coûtaient tout de même très cher à la revente et restaient réservées aux élégants aristocrates fortunés. Elles furent rapidement imitées par des artisans français qui utilisaient comme support des étoffes blanches également apportées des Indes. Cette production était de prix beaucoup plus abordable, mais de qualité médiocre, les couleurs ne résistaient guère au lavage, et de surcroît, l'engouement du public pour ces nouvelles étoffes causait un grave préjudice aux fabricants de soie et de laine du royaume, qui demandèrent l'interdiction des indiennes. Là encore, l'intérêt de l'industrie nationale était en conflit avec celui de la Compagnie.
Le pouvoir trancha en faveur des fabricants français. Un arrêt du Conseil d'État du 26 octobre 1686 prononça l'interdiction de l'importation ou de l'imitation des toiles peintes des Indes et fixa à la Compagnie la date du 31 décembre 1687, dernier délai, pour l'écoulement de son stock. Les directeurs firent valoir que des navires chargés d'étoffes n'étaient pas encore rentrés en France et qu'une telle mesure leur causait un grave préjudice. Ils obtinrent un an de delai supplémentaire, mais Louvois, auteur de l'arrêt, demeura intransigeant : à compter du 1er décembre 1688, toute vente d'indiennes serait interdite, les fabriques qui produisaient des imitations seraient fermées et les étoffes qui restaient chez les marchands devaient être reprises à prix coûtant par la Compagnie et renvoyées hors du royaume. ⇑

2 janvier 2019
