
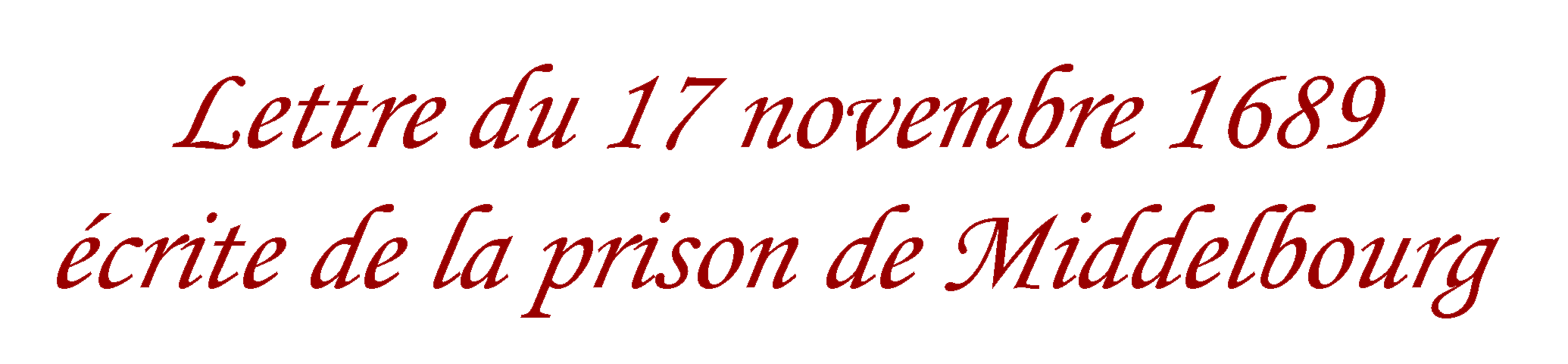
Ayant dû quitter le royaume « la pète au cul », selon l'élégante formule de Véret, les rescapés de la révolution de Siam n'étaient pas au bout de leurs épreuves. Réfugiés à Pondichéry, le comptoir français dirigé par François Martin, il fut décidé qu'une partie d'entre eux retournerait au Siam pour occuper l'île de Joncelung (Phuket) sous la direction de Desfarges tandis qu'une autre regagnerait la France pour apporter à Louis XIV les nouvelles de la révolution qui venait de ruiner tant de belles espérances. Vollant fut de ces derniers, avec notamment les officiers Beauchamp, Sainte-Marie, Saint-Vandrille et Delast et les jésuites Le Blanc et Coluson. Sur le chemin du retour, les deux navires, la Normande et le Coche, voulurent faire escale au cap de Bonne-Espérance, sous contrôle hollandais. Il se souvenaient d'y avoir été très bien accueillis sur la route de l'aller, trois ans auparavant, par le gouverneur Simon van der Stel, et ignoraient que la France était à nouveau en guerre avec les Provinces-Unies depuis quelques mois. Les passagers des deux navires furent faits prisonniers et séjournèrent quatre mois dans les geôles de la Compagnie hollandaise avant d'être envoyés en captivité à Middelbourg, en Hollande, puis renvoyés en France quelques semaines plus tard à l'occasion d'échanges de prisonniers. C'est pendant ce séjour dans les prisons bataves que plusieurs d'entre eux, disposant de nombreuses heures de loisir, se consacrèrent à l'écriture de rélations et de mémoires. Nous reproduisons ci-après celle de Jean Vollant des Verquains. Ce manuscrit est conservé aux Archives Nationales, Colonies, C/1/25, f° 84r. à 90v. Nous en avons modernisé l'orthographe et la ponctuation et parfois rétablis le sens de quelques phrases obscures. Néanmoins, quelques mots demeurent indéchiffrables, nous les avons signalés par des crochets.
Le sieur Vollant à Middelbourg le 17 novembre 1689.
J'ai cru que Votre Grandeur ne serait pas fâchée que j'eusse l'honneur de lui faire un petit détail des principales circonstances de la révolution de Siam. J'ai apporté tous mes soins à le faire avec le plus de justesse possible, étant là-dessus désintéressé plus que personne du monde, et n'épousant d'autre parti que celui de la vérité. C'est pourquoi je vous supplie très humblement, Monseigneur, de me faire l'honneur de la recevoir comme venant de l'homme du monde le moins capable de s'écarter de la droiture avec laquelle on est obligé d'écrire à une personne du caractère de Votre Grandeur (1).
Dès que nos vaisseaux furent partis de Siam, M. Constance passa à Bangkok où il ordonna ce qu'il voulait qu'on fît à la fortification, à laquelle néanmoins on ne commença à travailler qu'au 1er février, attendu que M. Desfarges étant monté à Louvo, dont il ne revint que quinze jours après, il avait souhaité être présent à l'ouverture du travail, le reste du mois ayant été employé à faire des casernes de bambou pour les soldats, si bien que nous devons compter n'avoir travaillé que durant trois mois et demi, pendant lequel temps nous avons transporté 4 572 toises cubes, quoiqu'un homme n'en porte guère à chaque voyage plus d'une centaine de pieds cubes, mais les soins que nous avons pris pour les faire diligenter a fait que nous avons remué cette quantité de bois.
Peu de temps après, le sieur Constance expédia le sieur du Bruant pour aller à Mergui. Il ne fut pas plus tôt parti que le sieur Constance s'aperçut qu'Opra Pitracha, grand mandarin du royaume, commençait à cabaler et à se faire un parti en engageant insensiblement les principaux mandarins dans ses intérêts, mais ne leur ayant découvert rien moins que son but, qui était celui de se mettre la couronne sur la tête. Cet homme était fort aimé des talapoins, qui sont les prêtres du pays, comme aussi du peuple. Il commença par les premiers, et couvrit ses desseins du pieux prétexte de conforter la pagode, c'est-à-dire la religion, dans toute sa pureté, ayant eu plusieurs atteintes par la trop grande indulgence du roi qui avait promis une mission publique et avait donné la liberté à tous ses sujets de se faire chrétiens, ce qui tendait à l'entière destruction de la pagode ; et pour les mandarins qu'il voulait gagner, il leur faisait entendre qu'il était du dernier bien de l'État de prévenir les pernicieux desseins que M. Constance avait formés contre le royaume en y appelant les Français et en les rendant maîtres des deux principaux postes ; que le roi était un bon prince qui ne pénétrait pas fort dans les suites que pouvait avoir cette facilité d'introduire des étrangers, et qui peut-être s'en seraient rendus les maître par la suite du temps ; qu'ils étaient donc obligés, comme zélés défendeurs de leur liberté, de joindre avec lui pour s'affranchir d'une espèce d'esclavage dans lequel ils tomberaient infailliblement si le roi qui succéderait au règne avait la même facilité de se laisser aller à la conduite de M. Constance, duquel il fallait se défaire. Ces paroles avaient les plus belles apparences du monde, et il n'y en avait pas un qui ne donnât dedans tête baissée, aussi ne fut-il pas longtemps à engager beaucoup de mandarins dans son parti, jusqu'à ceux qui étaient extrêmement attachés à la personne du roi.
Cependant, cette grande entreprise ne put pas être conduite avec tant de secret qu'elle ne vînt à la connaissance de M. Constance par plusieurs mandarins que l'intérêt ni les belles espérances n'avaient pu détourner de son parti, et qu'il songeât de son côté aux moyens de prévenir l'entreprise de Pitracha, les desseins duquel il pénétrait mieux que personne, mais il fallait des pièces plus justificatives que des paroles pour le dénoncer au roi, la coutume de ce royaume étant celle de punir un récusant du même supplice qu'aurait subi l'accusé s'il avait été convaincu. D'ailleurs, il appréhendait que les menaces de Pitracha intimidassent si fortement ceux qui lui avaient révélé ce secret qu'il ne soutinssent point devant le roi avec autant de fermeté que le demandait une pareille entreprise, mais le bonheur voulut que, peu de jours après, il reçut du gouverneur de la ville de Siam un ordre du roi contrefait avec les sceaux par Pitracha, où il lui ordonnait de lui livrer une quantité de munitions de guerre. Outre cela, il en reçut un autre peu de jours après de celui de PiplyPhetchaburi (เพชรบุรี), ou Phetburi, la Cité des pierres précieuses, à environ 160 km au sud de Bangkok, à l'extrémité nord de la péninsule Malaise., qui était de même fabrique que le premier, par lequel il lui ordonnait de tenir une quantité d'hommes armés tout prêts à partir au premier ordre.
C'était déjà plus qu'il n'en fallait à M. Constance pour convaincre le roi des mauvais desseins du conspirateur et pour le porter à le punir comme il le fallait, mais comme on lui venait rendre compte chaque jour des mandarins que Pitracha [gagnait à sa cause], il crut que c'était beaucoup hasarder et commettre l'autorité du roi de le faire arrêter dans un lieu où il pouvait avoir des gens prêts à embrasser ses intérêts. Ce fut pourquoi il crut que la chose serait plus sûre d'avoir quelques troupes françaises avec des officiers, et pour cet effet, il manda à M. Desfarges qu'il avait une affaire de la dernière importance pour les deux couronnes à lui communiquer et qu'il le priait de se rendre incessamment à Louvo. M. le général y étant monté, il lui déclara qu'il apprenait de toutes parts que Pitracha faisait son parti, et qu'il ne doutait pas qu'il ne tendît à s'emparer du royaume et à la destruction du christianisme et aux intérêts du roi, notre maître, et que pour prévenir une pareille entreprise, il était expédient qu'il montât à Louvo avec 80 de ses meilleurs hommes et plusieurs officiers, afin de le pouvoir arrêter sans aucun risque ; et afin que M. Desfarges ne s'arrêtât point aux faux bruits que Pitracha faisait courir dans le royaume, touchant la mort du roi, en vue de nous alarmer et d'observer nos démarches, M. Constance lui fit avoir une audience du roi le même jour qu'il partit de Louvo pour aller à Bangkok, où, dès qu'il fut arrivé, il fit prendre les armes à toute la garnison, et en ayant tiré les 80 meilleurs hommes, il en partit le lendemain dans plusieurs mirousLes mirous, ou mirons, étaient de petits bateaux à rames réservés aux trajets côtiers..
Il ne fut pas plutôt arrivé à Siam qu'il fut à la factorie (2) française, où le sieur Véret, chef de la même factorie et depuis longtemps ennemi juré de M. Constance, résolut de mettre tout en usage pour satisfaire sa passion et pour le perdre, comme il fit lorsqu'il fit entendre à M. Desfarges qu'il risquait beaucoup pour sa personne et pour ses troupes d'entreprendre de monter à Louvo, en ce qu'il courait un bruit que le roi était mort, et plusieurs autres choses qui seraient trop longues à déduire. Notre général, quoiqu'il dût être fort persuadé de la santé du roi de Siam et de la nécessité qu'il y avait qu'il secondât les desseins de M. Constance, qui ne tendait qu'au bien de son maître et aux intérêts de Sa Majesté, ne laissa pas d'adhérer aux sentiments du sieur Véret, sans faire réflexion qu'il n'avait aucun but que de perdre M. Constance et de profiter de cette conjoncture pour s'approprier de tous les effets du comptoir, sous prétexte que tout aurait été pillé, comme la suite l'a trop confirmé, n'ayant pu rendre aucun compte au directeur du comptoir de Pondichéry, alléguant que tous les papiers de la loge avaient été pillés, ce qui était contre la vérité (3).
Cet homme, voyant qu'il avait à demi gagné l'esprit de M. Desfarges, il jugea à propos de le mener au séminaire afin qu'on y pût achever ce qu'il avait si heureusement commencé, sachant bien que MM. les évêques n'avaient point d'autres sentiments que ceux qu'il leur avait inspirés. M. de Lionne fut le premier qui demanda à M. Desfarges comme il osait s'exposer à se faire couper la gorge et à tous ceux qui étaient avec lui, que tout le royaume était en arme par la mort du roi qu'on publiait depuis longtemps. Je vous conseille, lui dit-il, de vous en retourner à Bangkok le plus vite que vous pourrez. Mais le vieil évêque M. de Métellopolis, homme de piété et de vertu, dit qu'il ne fallait pas donner si légèrement dans les bruits et qu'il était bon, avant que d'abandonner la partie, de savoir s'il était véritable, quoiqu'il y avait lieu de douter que le roi de Siam fût mort, M. le général en ayant eu une audience il n'y avait pas cinq jours, et que ce bruit courait de ce temps-là, et que pour s'en éclairer davantage, il fallait écrire à M. Constance et lui mander ce qu'on avait appris à Siam. M. Desfarges n'ignorait pas qu'il fût vivant, et ce bruit n'était point une chose imprévue pour lui, puisque M. Constance l'avait prévenu là-dessus et l'avait prié plusieurs fois en lui faisant l'ouverture de son dessein, jusque-là même qu'il pensa s'en fâcher, tant il lui répétait de fois. Cependant, il fut résolu qu'on enverrait à M. Constance un officier, tant pour savoir si les chemins étaient gardés par un très grand nombre de gens armés, comme le sieur Véret l'assurait très positivement, que pour avertir M. Constance que l'on avait appris cette nouvelle, et que pendant ce temps-là, M. Desfarges sortirait de Siam avec ses troupes pour s'aller poster deux lieues en deçà de cette ville.
Le sieur Le Roy, lieutenant, fut destiné pour porter la lettre, et ayant pris toutes les précautions d'un homme qui ne voulait point se laisser surprendre, il fut fort étonné de voir qu'elles avaient été inutiles et que tout ce qu'il avait rencontré dans son chemin étaient des éléphants, des chevaux, des balons et des palanquinsSortes de chaises, ou de litières, portées par des hommes ou par des animaux et dont les personnes importantes se servent, dans une grande partie de l'Asie, pour se faire transporter d'un lieu à un autre. que M. Constance avait envoyés à mi-chemin de Siam à Louvo pour recevoir M. Desfarges et ses troupes. Dès qu'il fut arrivé à Louvo, il crut que tout le monde était égorgé, tant le silence et la tranquillité y étaient grands. Il fut d'abord chez les pères jésuites, d'où M. Constance ne faisait que de sortir avec Madame son épouse, où il avait observé ce soir-là une éclipse de lune. Dès qu'il sut qu'il y avait un officier français arrivé de la part de M. Desfarges, il sortit de sa chambre, il reçut la lettre dont cet officier était porteur, et que même il avait pris la précaution de cacher dans un nœud de sa perruque. M. Constance répondit sur le champ à M. Desfarges et le pria très justement de ne point avoir ces frayeurs, et qu'il devait être assez persuadé du contraire ; qu'outre cela le porteur de la lettre achevait de lui confirmer la grande tranquillité ou tout le monde était. Le sieur Le Roy, ayant reçu sa réponse, retourna à Siam sans voir plus de troupes que lorsqu'il y monta, et comme on était bien aise de s'éclairer de toutes manières, on envoya le sieur Danglas, lieutenant, pour y acheter des vivres pour les troupes, avec ordre d'observer s'il ne s'apercevait point qu'on remuât dans la ville. Cet officier, ayant fait en un après-dîné tous les quartiers de Siam, rapporta que tout était dans la dernière tranquillité.
que M. Constance avait envoyés à mi-chemin de Siam à Louvo pour recevoir M. Desfarges et ses troupes. Dès qu'il fut arrivé à Louvo, il crut que tout le monde était égorgé, tant le silence et la tranquillité y étaient grands. Il fut d'abord chez les pères jésuites, d'où M. Constance ne faisait que de sortir avec Madame son épouse, où il avait observé ce soir-là une éclipse de lune. Dès qu'il sut qu'il y avait un officier français arrivé de la part de M. Desfarges, il sortit de sa chambre, il reçut la lettre dont cet officier était porteur, et que même il avait pris la précaution de cacher dans un nœud de sa perruque. M. Constance répondit sur le champ à M. Desfarges et le pria très justement de ne point avoir ces frayeurs, et qu'il devait être assez persuadé du contraire ; qu'outre cela le porteur de la lettre achevait de lui confirmer la grande tranquillité ou tout le monde était. Le sieur Le Roy, ayant reçu sa réponse, retourna à Siam sans voir plus de troupes que lorsqu'il y monta, et comme on était bien aise de s'éclairer de toutes manières, on envoya le sieur Danglas, lieutenant, pour y acheter des vivres pour les troupes, avec ordre d'observer s'il ne s'apercevait point qu'on remuât dans la ville. Cet officier, ayant fait en un après-dîné tous les quartiers de Siam, rapporta que tout était dans la dernière tranquillité.
Il paraît que tous ces indices, si contraires au bruit qui courait, auraient fait perdre toute crainte à M. Desfarges et le porter à exécuter sa promesse, mais il était trop prévenu et avait déjà pris le change. Il résolut avant que de partir d'envoyer le sieur Dassieu, vieux capitaine, vers M. Constance avec une lettre où il lui marquait qu'il ne pouvait monter à Louvo ni quitter la place sans se mettre en risque de perdre sa tête en France, et que s'il voulait venir à Bangkok, il le recevrait avec plaisir. Cet officier, qui depuis quelques temps était dans la confidence de M. Desfarges, lui dit qu'il ne croyait pas qu'il fût de l'intérêt du roi d'abandonner M. Constance, particulièrement dans une conjoncture comme celle-ci, où il s'agissait d'un coup de partie ; que d'ailleurs, il était assez instruit de la fausseté des bruits qui couraient pour n'avoir pas d'appréhension de monter, mais toute la réponse qu'il tira de ce général fut celle qu'il ne pouvait s'y résoudre, en ce qu'il avait engagé sa parole à MM. les évêques qui, étant gens de considération, seraient écoutés et s'étaient engagés du soin de le disculper vers la Cour. Ensuite de quoi il partit pour s'en retourner à Bangkok, et le sieur Dassieu fut s'acquitter de sa commission à Louvo, où il arriva sans trouver plus d'obstacle en son chemin que le premier officier qui y était allé ; et après avoir rendu sa lettre, il rendit compte à M. Constance de la conférence qu'il avait eue avec notre général sur son sujet, qui le surprit extrêmement et l'obligea de dire qu'il ne croyait point avoir donné de sujet à M. le général de l'abandonner puisque c'était la cause commune qu'il entreprenait, et qu'une démarche pareille à celle-ci n'étant point soutenue, elle plongerait le roi de Siam, les intérêts de Sa Majesté et sa propre personne dans une suite de malheurs dont on ne pourra jamais se relever, comme la suite l'a trop confirmé ; et s'étant retiré ensuite dans sa chapelle pour y mettre toutes choses entre les mains du Seigneur, il renvoya le sieur Dassieu avec le sieur de Beauchamp pour remontrer à M. Desfarges qu'il était encore temps de réparer la chose et qu'il était de la dernière nécessité pour le bien des deux couronnes qu'il montât, sans quoi il devait s'attendre que tout était perdu. Le sieur de Beauchamp l'assura plusieurs fois qu'il n'y avait aucun danger, et que s'il voulait monter, il sauverait tout sans rien risquer, mais toutes ces raisons, quoique d'un homme en qui il avait la dernière confiance, ne purent prévaloir au-dessus des espérances que lui avaient données MM. les évêques de le disculper de toutes choses envers la Cour, ni l'empêcher d'abandonner entièrement M. Constance à la tragique fin qu'il a faite par la suite.
Ce ministre, ayant ainsi perdu toute espérance du côté qu'il en devait le plus attendre, et voyant que la conspiration devenait tous les jours plus puissante, ne songea plus qu'à [s'entretenir] avec le roi de tout ce qui se passait, et ayant trouvé un moment qu'il n'était point obsédé par les créatures de Pitracha, il lui déclara l'état de son royaume, et pour prévenir un pareil malheur, il était bon de ne point éclater, et que sous prétexte de son infirmité, il déclarât sa fille reine, et que celui de ses oncles qui l'épouserait lui succéderait et monterait sur le trône après avoir rendu à son corps les devoirs pendant un an. Le roi approuva beaucoup cet avis, et s'étant déclaré hautement là-dessus, Pitracha songea fortement à empêcher que cette déclaration n'eût son effet. Le roi demanda quelques jours après à M. Constance où étaient les Français, d'où vient que M. le général l'abandonnait dans un aussi pressant besoin, et qu'il avait toujours cru qu'il fût son intime ami, mais il eut encore assez de bonté pour l'excuser, n'osant faire connaître au roi qu'il l'avait aussi abandonné.
Quelque temps après, il sut que le roi était arrêté dans son palais, et abandonné par tous les mandarins gagnés par Pitracha, et que ce rebelle était [ ] talapoin, y introduisait une quantité prodigieuse de gens armés, il se résolut de faire un dernier effort pour sauver son maître ou mourir auprès de lui, et après avoir donné les derniers adieux à Mme Constance, il fut dans le palais avec quelque reste d'espérance de trouver encore quelque zèle pour son prince, qui étant soutenu d'un peu d'Anglais et de Portugais et de deux compagnies siamoises desquelles il a été néanmoins mal suivi, dans la vue de tenter à contrebalancer Pitracha qui s'y était rendu le maître ; mais il ne fut pas plutôt passé dans la seconde cour qu'il l'arrêtât lui-même, en présence des sieurs de Beauchamp, Fretteville, et le chevalier Desfarges, tous trois armés de chacun une couple de pistolets et d'une bonne épée, et lui ayant fait faire le tour sur les murailles du palais, il le fit enfermer dans une prison d'où on ne l'a plus vu depuis, et en lui ayant fait souffrir pendant plus de trois semaines tout ce que la cruauté la plus barbare peut imaginer de plus horrible pour lui faire avouer des choses auxquelles il n'avait jamais songé et pour l'obliger à se rendre soi-même coupable des crimes qu'il n'avait jamais commis. Il le fit transporter à un poste près de Louvo, où ayant protesté devant Dieu qu'il n'avait jamais eu autre dessein que celui de servir son maître et l'État, il eut la tête séparée du corps et ensuite coupé par le milieu selon la manière des criminels siamois. Voilà la fin tragique d'un homme pour qui il était plus honorable au roi que nous périssions que de l'abandonner lâchement, comme nous l'avons fait.
Monpit, fils adoptif du roi, à qui Pitracha avait fait croire qu'il épouserait la princesse et qu'il ne travaillait que pour le mettre sur le trône, n'ayant d'autre envie que celle de se faire talapoin et d'exclure de la couronne les frères du roi, par des raisons qui seraient trop longues à déduire, s'aperçut, mais trop tard, qu'il en avait été la dupe, prit le parti de s'aller jeter aux pieds du roi et lui déclarer toutes les intrigues de Pitracha, lui demandant pardon d'avoir eu la lâcheté de le suivre et de l'écouter. Le roi, qui l'aimait, lui pardonna facilement, mais son ennemi qui voyait par là toute sa trame découverte, et dans la nécessité de lever entièrement le masque, ne fut pas si indulgent pour lui, car ayant fait épier le moment que le roi sortirait de sa chambre, dont Monpit n'était pas sorti depuis son aveu, Pitracha le trouva au bout de deux jours, et l'en ayant fait tirer par force, il le fit massacrer dans l'antichambre et exposer ensuite à la porte du palais. Ce Pitracha s'étant ainsi défait de ces deux têtes qui pouvaient le plus contrebalancer son dessein si elles se fussent toujours demeurées unies, il ne songea plus que d'en faire autant des deux frères du roi, qui étaient deux puissants obstacles au dessein qu'il avait de monter sur le trône. Mais comme ce serait un trop long détail que celui de marquer tout le stratagème dont il s'est servi pour se rendre maître de ces deux princes, je me contenterai de dire qu'étant tous deux dans le palais de Siam, il trouva moyen d'en tirer l'aîné par les belles espérances de succéder au roi, jusqu'à lui faire la sombaye (4), et le reconnaissant pour son maître. Ce prince, que l'envie de régner éblouissait, donna facilement dans ce piège, et étant arrivé à Louvo, il envoya tirer le cadet hors du palais à main forte, et se voyant ainsi maître de ces deux malheureux princes, il leur supposa des crimes contre le roi et contre l'État, particulièrement à l'aîné, d'avoir reçu les hommages qui ne sont dus qu'au roi pendant le vivant du roi même, et ainsi de son autorité les fit exécuter à la manière des princes siamois, de qui ce n'est point la coutume de répandre le sang, mais bien de les faire mettre dans un sac de velours écarlate, où on les étouffe avec le bois le plus précieux des Indes, qui est le bois de santal.
Pitracha étant ainsi parvenu au comble de ses desseins, n'hésita pas de se faire déclarer roi, n'ayant plus rien qui lui fît obstacle, les mandarins ne s'apercevant de ses desseins qu'à mesure qu'il les faisait éclore, et virent à la fin qu'ils avaient été les dupes de son ambition.
Je crois qu'il serait à propos à présent de retourner à Bangkok où nous avons laissé M. Desfarges de retour de Siam. Il n'y fut pas plutôt arrivé qu'il feignit une maladie pour avoir un prétexte de ne pas remonter à Louvo et pour couper court à toutes les instantes prières que lui fit faire M. Constance, tant par les pères Le Royer et Le Blanc, jésuites, qui vinrent exprès pour cela, que par les sieurs Dassia et de Beauchamp, de venir réparer la démarche qu'il avait faite.
Depuis ce temps-là, nos travailleurs diminuèrent considérablement, et voyant que le malheur de M. Constance nous en attirerait bientôt un autre, je proposai à M. Desfarges de faire un retranchement dans la place et de faire miner le cavalier qui était du côté de l'Ouest, vu qu'il [ ] commandait dans la place, à quoi M. Desfarges ne voulut rien entendre, disant qu'outre que ce n'est point la coutume à Siam de faire démolir un ouvrage fait par ordre du roi, c'est que Pitracha prendrait cela pour une irruption et une déclaration de guerre, et qu'étant déjà amis, il ne se mettait pas beaucoup en peine de faire un favorable accommodement avec lui, mais il vit bien par la suite qu'il s'était trompé dans son attente, car dès qu'il le vit entièrement maître dans le palais, ce qui arriva sur la fin d'avril, il l'envoya quérir par M. le premier ambassadeur en France (5), conjointement avec M. de Lionne et M. Véret, après avoir fait arrêter tous les officiers français qui se trouvèrent à Louvo, disant qu'il était nécessaire pour le service du roi qu'il se rendît auprès de lui, quoiqu'il y eut bien plus de risque pour sa personne en ce voyage que lorsque M. Constance le priait de la même chose et beaucoup mieux accompagné. Il ne laissa pas que de suivre le premier ambassadeur, après avoir tenu un conseil là-dessus, comptant toujours qu'il trouverait un accommodement avec Pitracha, comme lui avait fait espérer M. de Lionne, mais il ne trouva rien moins que cela. Lorsqu'il fut arrivé à Louvo, il trouva un homme qui ne parlait que par menaces et d'un air aussi absolu que s'il avait été son maître. Il lui débuta par lui faire trois propositions, savoir pourquoi il avait monté jusqu'à Siam avec ses troupes et d'où vient qu'il en était descendu sans avoir monté à Louvo ; dans quelle vue M. Constance avait appelé les Français dans le royaume. M. Desfarges lui répondit à toutes ces questions, ce qui serait trop long à décrire ici. Pitracha lui dit ensuite qu'étant venu à Siam pour le service du roi, il était de l'utilité de son service qu'il montât avec toutes ses troupes pour aller contre les Laos ennemis du roi, et que s'il lui refusait de donner sa parole pour cela, il ne devait pas compter de retourner à Bangkok. M. Desfarges lui promit tout pour regagner sa place, laissant même ses deux enfants en otages.
Dès qu'il fut arrivé à Bangkok, il trouva sa place en bon état et trouva beaucoup de canon monté, quoi qu'il nous eût défendu à M. de Vertesalle et à moi de ne rien faire qui puisse donner matière de soupçon aux siamois pendant son absence. Le même jour de son arrivée, qui était le 6 juin, après dîné on commença la déclaration ouverte de la guerre, par tirer sur une barque du roi qui passait devant la place et qui nous refusa du sel pour notre argent, après quoi on songea à tirer tout ce qu'il y avait de munitions dans le fort de l'Ouest, et pour lors, M. Desfarges me demanda si je le pouvais faire miner pour le lendemain au matin, je lui dis que ce n'était pas le temps et que des mines pour faire sauter un pareil ouvrage ne se pourraient pas faire en quinze heures de temps comme il souhaitait, que si j'en avais été cru, la chose ne serait plus à faire, ainsi on se contenta de faire crever les canons [ ... ] qui abattirent une partie des parapets. Les troupes étant passées du côté de l'Est, les Siamois se rendirent maîtres de celui de l'Ouest, ne les pouvant point garder tous deux ensemble à cause du peu de monde que nous avions, où ils élevèrent un cavalierTerme de fortification : un cavalier est un amas de terre dont le sommet compose une plate-forme sur laquelle on dresse des batteries de canon pour nettoyer la campagne ou pour détruire quelque ouvrage de l'ennemi. de bois au-dessus de celui de maçonnerie pour y découvrir davantage dans notre place, duquel ils ne purent jamais se servir, ayant été obligés de l'étayer avant même qu'il fût fini. On tira pendant trois jours de suite six pièces de canon, et l'on fut quinze jours sans parler d'aucun [ ] accommodement, au bout duquel temps les Siamois firent les premiers pas et nous firent croire par M. l'évêque de Métellopolis qu'ils étaient d'humeur d'entendre quelque accommodement. Cela fut suivi de plusieurs lettres envoyées de part et d'autre, dont je ne marque point les teneurs aussi bien que les particularités des traités. Pendant que l'on était en pourparler, les Siamois ne laissèrent point de faire autour de notre place, à la portée du mousquet, neuf redoutes dont la moindre contenait six pièces de canon, et lorsque par notre canon nous voulions les empêcher de travailler, M. Desfarges nous le défendait, ne jugeant pas à propos d'user la poudre à cela, quoiqu'elle ne pût servir à un meilleur usage. Nous étions à la veille de manquer de vivres lorsqu'on commença à entrer en accommodement, car tout ce qu'il y avait de viande était presque fini et le bois commençait à être rare dans la place, ce qui obligea notre général de demander qu'on laissât venir le [barcalon ?] à notre forteresse, et enfin, après bien des pas et des démarches, ils accordèrent deux vaisseaux pour lesquels le sieur Véret devait demeurer caution, qui cependant s'en est venu avec nous.
Environ trois semaines avant notre départ, le sieur Delars, autrefois lieutenant de vaisseau, amena Mme Constance à Bangkok, qui avait trouvé moyen de s'échapper des mains de ses persécuteurs et de ceux qui la devaient enfermer dans le palais pour y être prostituée. M. Desfarges en fut fort en colère, en ce qu'il la croyait un grand obstacle à sa sortie pour laquelle il soupirait depuis longtemps, et d'ailleurs il n'ignorait pas qu'en la gardant, il était obligé de restituer certain dépôt duquel je ne crois point devoir parler et dont chacun a pris sa part (6). La pauvre dame était dans le dessein de n'en jamais parler si on l'avait gardée et tirée du malheureux esclavage où elle était réduite, mais voyant que malgré un conseil où toutes les voix, hormis quelques-unes, étaient pour la garder, on la relivra entre les mains de ses bourreaux ; c'est ce qu'elle n'a pu soutenir, se sentant munie de deux lettres les plus obligeantes qu'on puisse recevoir d'un roi, c'est ce qui l'a obligé de dire publiquement qu'on ne se contentait point de la piller, mais malgré la parole du roi, on la vendait, comme on avait vendu son mari. J'en aurais, Monseigneur, presque autant à dire sur ce chapitre que peut contenir le reste de ma lettre, mais les Jésuites, qui sont gens de foi et beaucoup mieux instruits que je ne le suis du secret de cette affaire, en pourront faire à Votre Grandeur un plus ample détail ; d'ailleurs, j'appréhenderais en disant la vérité, de devenir suspect, ayant aussi peu lieu que j'aie de me louer de la manière que M. Desfarges en a usé avec moi depuis mon départ de France, qui de propos délibéré, n'a eu d'autre vue que de me déprécier auprès de Votre Grandeur, et de profiter de mes appointements, desquels je n'ai reçu un seul sol que les six mois d'avance que j'ai reçus de M. Lubert (7) à Paris. Toute la grâce que j'ose vous demander, Monseigneur, est celle ne ne me point condamner sans m'avoir entendu, et de vous ressouvenir de tous les déboires que j'ai ressentis depuis mon départ de France, aussi bien que la misère où nous sommes réduits depuis plus de sept mois.
C'est la grâce que j'ose attendre de votre bonté.

NOTES :
1 - Vollant n'indique pas qui est le destinataire de cette lettre, mais on devine qu'il s'agit d'un personnage considérable qui dispose de pouvoir hiérarchique, peut-être M. de Seignelay, le ministre de la marine. ⇑
2 - La faiturie, ou factorerie, ou factorie, était le bureau où les facteurs, les commissionnaires, faisaient commerce pour le compte de la Compagnie. L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert précise également : On appelle ainsi dans les Indes orientales et autres pays de l'Asie où trafiquent les Européens, les endroits où ils entretiennent des facteurs ou commis, soit pour l'achat des marchandises d'Asie, soit pour la vente ou l'échange de celles qu'on y porte d'Europe. La factorie tient le milieu entre la loge et le comptoir ; elle est moins importante que celui-ci et plus considérable que l'autre. ⇑
3 - Il est de fait que cette révolution était une aubaine pour Véret, qui avait tout intérêt à la disparition des traces de ses malversations. Lanier mentionne des Ordres du Roy des 20 mars et 22 décembre 1689 qui ordonnent son rapatriement (Étude historique sur les relations de la France et du royaume de Siam de 1662 à 1703, 1883, note p. 171) : Quant au fripon Véret, la Compagnie ne put obtenir de lui qu'il rendît ses comptes. Il n'avait pas pris une part si active à la chute de Constance et à la révolution de Siam pour en revenir les mains nettes. Ordre fut donné par le roi à Martin de saisir ses papiers, effets, d'informer contre lui, de le saisir et de le ramener en France. ⇑
4 - Les mots sombaye, ou zombaye, fréquemment employés dans les relations françaises, sont des transpositions du portugais sumbra çumbaya, sumbaïa sumba, etc. L'origine en reste obscure. Il pourrait s'agir d'une déformation du mot malais sěmbah, une salutation, une respectueuse adresse, l'acte de salutation ou d'hommage consistant à élever les mains au visage, (Dictionnaire anglais-malais de R. J. Wilkinson, 1901, p. 404) ou de son dérivé sěmbah-yang (vénération de dieu, prière, rituel). Le dictionnaire Hobson Jobson de Yule et Burnell (p. 850) cite les mots Somba, et Sombay, du malais présent, cadeau. Peut-être est-ce le même mot que le Sěmbah de Wilkinson, les cadeaux, les présents étant habituellement offerts en Asie aux personnes à qui l'on souhaite rendre hommage. ⇑
5 - Okphra Visut Sunthon (ออกพระวิสุทธิสุนทร) dit Kosapan (โกษาปาน), qui fit grande impression en France lors de son ambassade en 1686. Voir sur ce site la page Kosapan. ⇑
6 - Il s'agissait des bijoux de Mme Constance. Voir la 6ème partie, note 3. ⇑
7 - Louis de Lubert, trésorier général de la marine. ⇑

18 février 2019
