
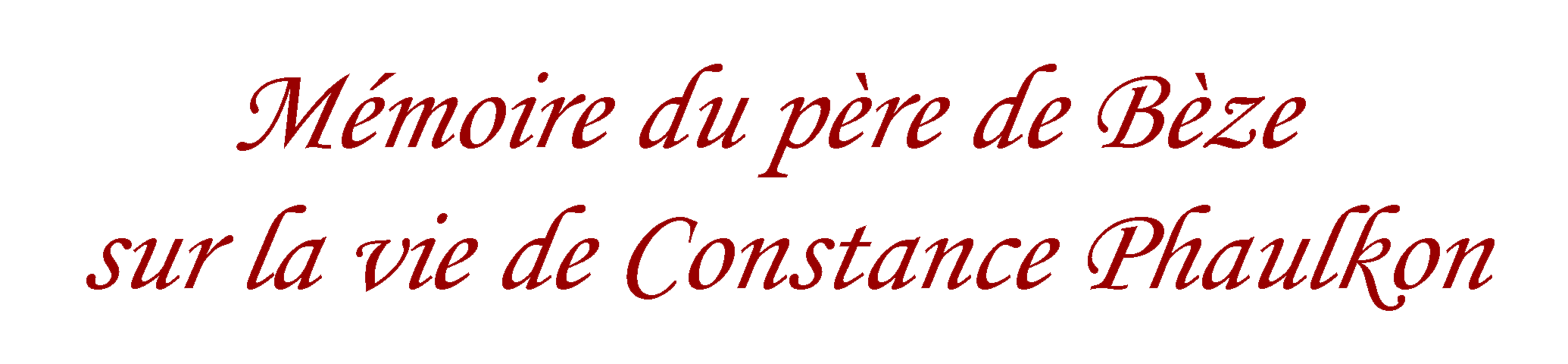
Quatrième partie.
L'escadre et les troupes que Sa Majesté envoyait au roi de Siam sous la conduite de M. Desfarges, arrivèrent à l'embouchure de la rivière du Ménam au mois d'octobre 1687 (1). MM. de La Loubère et Céberet, envoyés extraordinaires du roi pour traiter l'alliance entre les deux couronnes, dirent au Père Tachard qu'ils avaient ordre de la Cour de l'envoyer d'abord proposer à M. Constance les conditions auxquelles Sa Majesté acceptait cette alliance que le roi de Siam lui avait fait offrir et de ne laisser descendre personne à terre qu'il n'eût obtenu de ce ministre ce qu'on demandait, c'est-à-dire Bangkok et Mergui.
La crainte qu'on avait que l'ambassadeur (2) ne fût contraire aux demandes qu'on faisait et ne les traversât s'il se trouvait à terre avant qu'on les eût obtenues, obligea à prendre cette précaution. En effet, comme il savait de quelle importance était Bangkok et l'ombrage que prendraient les Siamois s'ils la voyaient livrer aux Français, il n'avait jamais voulu consentir à la promettre en France de la part de son roi, quelque instance qu'on lui en pût faire. M. de Lionne, cependant, qui avait cette affaire fort à cœur, lui ayant fait voir un mémoire que M. Constance avait donné à M. de Chaumont sur quelques affaires particulières dans lequel il lui marquait, en passant, que la confiance qu'avait le roi de Siam à Sa Majesté très chrétienne était si grande qu'il lui confierait volontiers toutes ses places, il lui dit que puisque M. Constance offrait de la part du roi de Siam la garde de toutes les places du royaume, il pouvait bien promettre celle de Bangkok et de Mergui ; que c'était là l'unique moyen de contenter la France et d'avoir un heureux succès de son ambassade.
Ce Siamois se laissa engager par là, non pas à les promettre, mais à dire à M. de Seignelay, de qui il eut une audience secrète sur ce sujet, qu'il croyait que son roi, vu l'amitié qu'il avait pour Sa Majesté très chrétienne, lui confierait volontiers la garde de ces deux places. Il eut cependant depuis beaucoup de scrupule de cette démarche qu'il avait faite sans ordre, surtout lorsqu'il vit qu'en conséquence de cela, on envoyait grand nombre de troupes. Il ne voulait pas de bien à M. de Lionne de l'avoir engagé à la faire et on appréhendait qu'il ne s'en dédît et n'agît tout au contraire lorsqu'il serait arrivé à Siam (3).
Le père Tachard fut obligé, pour obéir aux ordres du roi que MM. les envoyés lui firent voir, d'aller traiter cette affaire avec M. Constance et de le porter à faire accorder ce que la Cour souhaitait pour éviter de fâcheux inconvénients qui seraient arrivés en cas de refus. Il trouva M. Constance mieux disposé là-dessus qu'il n'espérait. Ce n'est pas que ce ministre ne fût encore dans le même sentiment où il avait toujours été que c'était s'exposer à un soulèvement de livrer d'abord Bangkok aux Français, mais, comme il s'était bien douté qu'on ne manquerait pas de pousser cette affaire en France et d'engager la Cour à demander cette place, il avait disposé l'esprit du roi son maître à accorder cette place et Mergui, exposant quelquefois le danger qu'il y avait que les Hollandais ne se saisissent de Bangkok et les Anglais de Mergui, et il l'avait même mandé en France. Mais il voulut toujours qu'on commençât par faire un établissement à SaingorOu Singor, aujourd'hui Songkhla (สงขลา) dans la région Sud de la Thaïlande. C'est un des ports les plus importants de l'Est de la péninsule Malaise. qui pût assurer les autres et, comme il vit que la France ne voulait point du tout de cette place, il représenta qu'au moins on n'en prît qu'une des deux qu'on demandait et qu'on attendît qu'on eût un nombre de troupes suffisant pour la garde des deux places.
Mais toutes ses remontrances furent inutiles. On lui dit que c'était la volonté du roi et qu'il ne voulait d'alliance avec les Siamois qu'à condition que les Français auraient la garde de Bangkok et de Mergui. M. Constance la croyait trop avantageuse à son prince pour ne la lui pas procurer à quelque prix que ce fût. Il prit cependant des précautions pour mettre sa personne en sûreté, car la première condition qu'il mit fut qu'on donnerait soixante des soldats qui étaient venus pour être gardes du corps du roi. Il demanda encore que, pour ne pas donner d'ombrage aux Siamois et à cause du petit nombre des Français, on laissât les soldats siamois qui étaient dans ces places pour aider aux Français à les garder jusqu'à ce que leur nombre fut plus considérable ; qu'on les réduirait à quatre compagnies dont les officiers seraient tous Français et qui obéiraient au gouverneur tout de même que les Français mêmes. Il laissa à MM. les envoyés et à M. Desfarges le soin de régler les autres articles.
On promit sans peine la garde que le roi de Siam demandait. M. Desfarges fit quelque difficulté à consentir qu'il y eût des soldats siamois dans ses places, mais M. de La Loubère, qui ne jugeait pas pour lors qu'il y eût aucun inconvénient à cela, l'obligea à y consentir. MM. les envoyés dressèrent le traité et le signèrent. Les principaux articles étaient que le roi de Siam donnerait la garde de Bangkok et de Mergui aux Français sans pouvoir jamais, ni lui ni ses descendants, la leur ôter que du consentement de Sa Majesté très chrétienne, laquelle payerait et entretiendrait à ses dépens la garnison ; qu'elle en nommerait toujours le gouverneur et tous les officiers et y entretiendrait tel nombre de soldats qu'elle voudrait ; qu'on y garderait la discipline française à l'égard de toutes les troupes qui y seraient, lesquelles obéiront en tout aux ordres du gouverneur français ; que le gouverneur serait obligé d'obéir aux ordres du roi de Siam qu'il recevrait par son ministre, M. Constance, lorsqu'ils ne seraient pas contraires au dit traité, et que Sa Majesté siamoise pourrait, quand elle en aurait besoin, tirer de la place pour son service jusqu'à la moitié de la garnison, laissant cependant un nombre suffisant de troupes pour la garder ; qu'elle aurait soixante des soldats qu'on amenait pour lui servir de gardes et être toujours auprès de sa personne.
Les envoyés, après avoir signé le traité (4), firent débarquer les soldats français qu'ils envoyèrent tous à Bangkok jusqu'à ce qu'on pût faire passer à Mergui ceux qui y étaient destinés. Ils y furent reçus de M. Constance qui les y régala de toutes sortes de rafraîchissements, et les envoyés du roi y étant venus peu de temps après, ils y furent reçus avec beaucoup de magnificence. Tout s'était passé jusque-là avec beaucoup de joie et de bonne intelligence de part et d'autre, mais une bagatelle qui donna du mécontentement à MM. les envoyés, surtout à M. de la Loubère, commença à mettre la mésintelligence entre eux et M. Constance.
Ce ministre, avant de sortir de Bangkok, voulut, avec M. Desfarges, pourvoir d'officiers les compagnies siamoises et, comme on lui avait mandé de la Cour de France qu'il pourrait tirer pour ce sujet les cadets qui étaient dans les troupes, on en choisit quelques-uns pour les mettre à la tête des Siamois. On oublia un jeune homme que M. de la Loubère avait à sa suite en qualité de gentilhomme et qu'il avait recommandé au père Tachard, souhaitant, pour le récompenser, qu'on le fît officier d'une des compagnies siamoises. Je crois que ce fut un pur oubli car on était très disposé à faire plaisir à MM. les envoyés et le jeune homme dont il s'agissait était fort capable de remplir la place qu'on demandait pour lui. Mais M. de la Loubère, qu'on avait déjà prévenu contre M. Constance, crut qu'on n'avait pas eu assez d'égard à son caractère, et craignant qu'on ne dît de lui qu'il se laissait mener par ce ministre comme on l'avait dit mal à propos de quelques autres, il fit de grandes plaintes de ce qu'il réglait les affaires avec le père Tachard sans sa participation et celle de M. Céberet et de ce qu'on avait fait ce choix d'officiers sans prendre leur avis (5).
M. Constance, qui ne voulait pas qu'ils eussent sujet d'être mécontents, pria le père Tachard, de qui ils se plaignaient principalement, de les aller voir et de leur faire quelque excuse sur ce sujet. Il y alla, mais il trouva M. de La Loubère si piqué qu'il n'en eut pas de satisfaction. M. Constance en fut fâché parce qu'il avait engagé le père à faire cette démarche. Il ne le fut pas moins de ce que M. Desfarges, lui ayant voulu donner des soldats pour l'accompagner comme il s'en retournait à Louvo, MM. les envoyés lui firent entendre qu'ils ne le permettraient pas. Ainsi M. Constance fut obligé de les refuser lui-même pour ne pas donner ce prétexte à MM. les envoyés de lui faire du chagrin. Quelques lettres assez aigres qui s'écrivirent depuis de part et d'autre et le refus que fit M. de La Loubère de s'en tenir au traité qu'il avait signé et de donner les soixante hommes qu'il avait promis pour la garde du roi augmentèrent ces premiers mécontentements, de sorte que MM. les envoyés étaient déjà brouillés avec M. Constance avant qu'ils eussent eu leur première audience.
Comme le roi ne leur accorda pas l'honneur de paraître couverts en sa présence, ainsi qu'ils l'avaient demandé, ils en eurent beaucoup de chagrin contre ce ministre, croyant qu'il leur avait fait refuser cet honneur et je crois bien qu'il ne les servit pas en cela comme il aurait pu et comme il aurait fait s'il avait été plus content de leur conduite à son égard ; mais, comme il était naturellement assez délicat, il ne fut pas fâché, à ce que je crois, de leur faire sentir en cette occasion qu'il avait assez de crédit dans le royaume pour mériter qu'on l'y ménageât lorsqu'on souhaiterait y obtenir quelque chose. Il faut même avouer que MM. les envoyés auraient eu sujet de se plaindre de lui s'il avait été l'auteur, comme ils le prétendaient, de toutes les démarches qu'on leur fit faire pour obtenir cet honneur qu'on leur refusa après cela, ce qui était d'autant plus mortifiant pour eux qu'ils avaient plus fait d'avances pour l'obtenir.
Ils n'osèrent pas, cependant, en témoigner leur mécontentement parce qu'après tout, n'ayant que la qualité d'envoyés, ils ne pouvaient pas prétendre de droit à un privilège qui n'appartient qu'aux ambassadeurs, d'autant plus qu'à cela près, on leur avait accordé tous les honneurs qui avaient été faits à M. de Chaumont, c'est pourquoi on chercha d'autres prétextes de plaintes. Ce ne furent depuis que contestations sur les articles du traité qui avait été signé et je suis persuadé que si M. Constance n'avait eu tout l'attachement qu'il avait pour la France et s'il n'eût vu que M. Desfarges, M. du Bruant et les autres officiers n'approuvaient pas cette conduite de MM. les envoyés, il en serait venu à une rupture ouverte, mais ne doutant pas que Sa Majesté ne dût être fort contente de son zèle pour son service, après avoir fait livrer à ses troupes les deux plus importantes places du royaume et avoir mis à la Compagnie des Indes Orientales cent mille écus pour marque de son attachement à la France comme elle l'avait souhaité, il s'embarrassa peu de toutes les chicanes que lui fit M. de La Loubère sur des minuties. Je ne les rapporterai pas ici parce qu'on pourra les voir dans les mémoires du père Tachard.
Phetracha ne laissa pas que de profiter de ces divisions. L'arrivée des Français avait un peu déconcerté ses mesures car il ne s'attendait pas à voir une si grosse escadre. Il s'opposa d'abord de toutes ses forces dans le Conseil du roi à ce qu'on leur accordât les places qu'ils demandaient et ne se contenta pas de parler plus d'une heure et demie durant contre cette affaire avec beaucoup de véhémence, rapportant tous les exemples des princes des Indes qui, après avoir reçu chez eux les Portugais et les Hollandais, en avaient été dépouillés de leurs États et réduits à la captivité. Mais, voyant que, malgré cela, le roi et tous les autres conseillers d'État étaient d'avis contraire et qu'il devait, suivant la coutume, mettre son sceau au résultat du Conseil, il dit au roi qu'il pouvait ordonner de lui ce qu'il souhaiterait et lui faire couper la tête, mais qu'il ne consentirait jamais à une chose qu'il croyait si contraire aux intérêts de Sa Majesté. Le roi prit cette liberté pour un bon zèle et la lui pardonna. On ne laissa pas de passer outre et de conclure en faveur des Français. M. Constance, qui m'a raconté cela, vit bien, dès lors, qu'il fallait se défier d'un homme qui marquait tant d'opposition à l'établissement des Français dans le royaume, et qu'on devait garder le plus de mesures qu'il serait possible pour ne point augmenter les défiances que cet homme allait semer parmi les Siamois. Mais on croyait, ou au moins ou voulait faire croire, que ces ménagements n'étaient qu'un effet de son peu de bonne volonté pour la France, pour qui il ne voulait pas faire tout ce qu'il aurait pu.
Phetracha, voyant que malgré ces remontrances, on allait livrer Bangkok et Mergui aux Français et que les habitants de ces places, qui avait appréhendé de les voir enlevées par les Hollandais ou les Anglais, étaient bien aises d'y voir venir les Français qu'ils regardaient comme amis, et que la plupart du peuple entrait dans la joie que le roi témoignait avoir d'une alliance si avantageuse pour son royaume, il voulut d'abord réprimer cette joie par une prophétie sinistre, sachant que les Siamois y sont adonnés avec une superstition outrée. Il se servit pour cela d'un bramine mathématicien du roi qui se piquait de prédire les choses futures par la connaissance des astres et qui avait du crédit parmi le peuple. Celui-ci publia, par ses ordres, qu'il avait su dans le ciel que les Français qui étaient à l'entrée du royaume (car nous étions encore à l'embouchure de la rivière) y seraient reçus d'abord avec beaucoup de joie et qu'ils y obtiendraient ce qu'ils souhaitaient, mais que cela leur serait funeste peu de temps après et à tous ceux qui se seraient attachés à eux, parce qu'il devait y avoir de grands troubles à cette occasion, où les Français seraient chassés avec un grand massacre des leurs et de leurs partisans. Nous sûmes cette prophétie avant de nous débarquer et nous nous en moquâmes, quoique nous n'en sussions pas la source.
L'adroit mandarin ne se contenta pas de cela mais, comme il était attentif à tout ce qui se passait dans l'ambassade, il sut bientôt la mésintelligence qui était entre les envoyés et M. Constance et chercha à en tirer profit. Un Siamois, qui était auprès des envoyés et que nous appelions le major parce qu'il en faisait l'office à l'égard de tous les Siamois de la maison de MM. les envoyés, lui donnait avis de ce qui se passait. Il se servit de lui pour former une accusation contre M. Constance au nom de M. de La Loubère, mais je suis persuadé que cet envoyé était trop honnête homme pour y avoir eu aucune part.
Aussitôt qu'on sut à Louvo qu'il était déjà parti pour s'en retourner en France (6), le Siamois demanda audience du roi pour lui dire que M. de La Loubère l'avait chargé, avant son départ, de dire à Sa Majesté que M. Constance la trahissait et le roi de France aussi ; qu'il ne cherchait que ses intérêts et à se rendre maître des places du royaume sous prétexte de les faire donner à la France ; qu'il avait gagné par ses largesses les troupes qui étaient dedans et qu'elles lui étaient plus dévouées qu'aux rois leurs maîtres (7). Le roi de Siam ne fut pas peu surpris d'entendre une accusation si atroce contre un ministre dont le zèle et la fidélité lui étaient si connus. Il fit arrêter le mandarin jusqu'au retour de M. Constance qui était allé à l'embouchure de la rivière pour expédier le départ des vaisseaux, se doutant bien qu'on s'était servi de son absence et du départ de l'envoyé du roi pour soutenir plus hardiment cette imposture. En effet, M. Constance étant de retour, ce délateur ne put justifier ce qu'il avait avancé et il n'osa pas même persister à le soutenir, mais on ne put savoir de lui qui l'avait poussé à former cette accusation. Il fut condamné à être jeté au tigre et il aurait subi cette peine si M. Constance n'avait demandé sa grâce à la sollicitation de M. du Bruant et des autres officiers français que ce mandarin avait obligés en quelques rencontres. Il en fut quitte pour le rotin et vint en remercier M. Constance.
Ce ministre perdit en ce temps le second de ses enfants qu'on nommait Signor Juan (8). Il apprit sa maladie dans le temps que nous retournions de l'embouchure de la rivière et cela lui fit hâter son retour. Il n'arriva quasi que pour voir expirer ce petit innocent qui semblait n'attendre que son père pour mourir entre ses bras. M. et Mme Constance furent sensiblement affligés de la mort de ce cher enfant qu'ils aimaient tendrement et qui était en effet fort aimable. Tout le monde s'empressa de les en consoler et ils reçurent en cette occasion des présents magnifiques du roi, de la plupart des grands du royaume et surtout de Phetracha, car c'est la coutume parmi les Siamois d'accompagner toujours de quelque présent les compliments de condoléance qu'on fait à une personne pour la mort d'un de ses proches.
Tout cela, cependant, consolait peu M. Constance de la perte de son fils, quoiqu'il la prît toujours fort chrétiennement et j'étais surpris qu'ayant autant de fermeté d'esprit qu'il en avait, il parût si peu maître de sa douleur. Un jour que je tâchais à l'en consoler, il me dit qu'il n'était pas seulement sensible à cette mort par la perte qu'il faisait d'un fils qui lui était fort cher, mais encore parce qu'il la regardait comme un secret avertissement que le ciel lui donnait de quelque plus grand malheur ; qu'il voyait déjà naître dans l'État, à l'occasion des Français, ces mouvements qu'il avait appréhendés ; qu'on faisait courir le bruit parmi le peuple qu'il devait arriver au mois de mars ou d'avril une grande révolution dans le royaume parce que celle de Jupiter, qui avait été toujours fatale à l'État, devait se faire en ce temps ; que la hardiesse qu'on avait de publier ces sortes de prophéties était comme l'étendard de la rébellion ; qu'on voulait disposer par là le peuple à quelque nouveauté dont il est toujours avide et l'exciter au soulèvement. Il m'ajouta qu'il s'embarrasserait peu de ces sortes de bruits dont on saurait bien faire punir les auteurs lorsqu'on les aurait reconnus, s'il voyait plus de disposition dans les Français à se joindre à lui pour en prévenir les effets, mais qu'il avait déjà reconnu en passant par Bangkok qu'on avait donné de fâcheuses impressions à quelques-uns des principaux officiers qui ne paraissaient pas trop portés à suivre ses ordres et que, quoique M. Desfarges ne fût pas dans cette disposition, il était à craindre cependant qu'on ne l'y engageât ; qu'il refusait même de donner au roi de Siam les gardes dont on était convenu, quoique cela fut d'une extrême nécessité pour mettre la personne du roi à couvert contre les entreprises des séditieux et réprimer d'abord ceux qui oseraient entreprendre quelque chose contre l'État.
Je tâchai, pour lors, de lui ôter de l'esprit toutes ces défiances en l'assurant que j'avais toujours entendu dire en France que la volonté de la Cour était que les Français suivissent en tout ses ordres et ses lumières ; que M. Desfarges et M. du Bruant paraissaient fort disposés à cela ; que si M. Desfarges refusait de lui donner les soixante hommes qu'on avait promis pour la garde du roi de Siam, c'est qu'il avait trop peu de monde pour garder deux places aussi importantes que celles qu'on lui avait confiées et faire un si gros détachement. Il me répondit qu'on aurait pu se contenter de se fortifier à Bangkok pour cette année et attendre un nouveau secours pour aller garder Mergui ; que c'était une folie de vouloir occuper deux places avec si peu de monde et négliger la personne du roi ; que, tant qu'on en serait maître, on le serait de tout le royaume et que si on le perdait on perdrait tout ; mais que, lorsqu'il proposait ces choses qui étaient pour le bien des affaires, on les rejetait comme si c'eût été une défaite pour ne pas donner à la France tout ce qui lui avait été promis et, qu'ainsi, il se voyait obligé, pour ne pas rendre sa fidélité suspecte, d'envoyer M. du Bruant à Mergui dans un temps où il aurait été si nécessaire à Louvo.
En effet, il partit à la fin de ce mois avec de bons ordres au gouverneur et aux officiers de la province de lui fournir tout ce qui était nécessaire pour se mettre en état de défense (9). Pour ce qui regarde la compagnie des gardes, comme le roi faisait de grandes instances pour les avoir, suivant le traité qui avait été fait, M. Constance obtint enfin de M. Desfarges, qu'au lieu de soixante hommes, on choisirait vingt-cinq jeunes cadets dans les troupes pour en faire une compagnie à cheval et que le fils de M. Desfarges les commanderait avec deux mille écus d'appointements (10). Mais on trouva encore moyen d'éluder cet accord, car M. Desfarges, ayant représenté que ces jeunes gens ne savaient pas monter à cheval et qu'il fallait les instruire avant qu'ils parussent en présence du roi, il demanda qu'on envoyât les chevaux à Bangkok pour y exercer les jeunes cavaliers et, sous prétexte qu'ils n'étaient pas encore instruits, il les retint toujours sans les vouloir envoyer.
Le roi de Siam, qui avait la santé assez délicate, étant attaqué depuis quatre ou cinq ans d'une toux asthmatique, tomba plus malade qu'à l'ordinaire au mois de février. Comme il avait entendu parler de cette prophétie, il appréhenda qu'elle ne regardât sa vie et que sa mort ne fût le malheur que pronostiquait la révolution de Jupiter. Quoiqu'il ne fût pas fort crédule aux oracles des talapoins, il ne laissa pas d'envoyer consulter les pagodes à la sollicitation de la princesse, sa sœur, grande pagodiste, qui lui en faisait de perpétuelles instances – j'ai déjà raconté comme cela se fait.
Le mandarin qui avait été chargé de cette commission, sortant du temple, entendit un homme qui s'arrachant les poils de la barbe avec des pincette, dit : En voilà un grand par terre. Cela fut interprété à mauvais augure pour la vie du roi. Phetracha sut en faire son profit, mais M. Constance à qui le roi, un peu alarmé de cette réponse, la raconta, fut touché de voir ce prince donner encore dans ces superstitions, quoiqu'il n'y ajoutât plus autant de foi qu'auparavant. Il tâcha de lui en faire voir la fausseté et résolut de travailler avec plus d'ardeur qu'auparavant à sa conversion. Ce fut ce qui le porta à introduire auprès de lui un des pères jésuites que le roi de France avait envoyés à Siam pour lui parler de religion, parce que M. de Métellopolis, qui aurait été plus en état de le faire, sachant mieux la langue, se tenait proche Bangkok, à une maison qu'il avait là, et ne voulait pas venir à Louvo. Mais afin de ne pas donner d'ombrage aux talapoins qu'on avait déjà fort alarmés par le bruit qu'on répandait que le roi allait bientôt se faire chrétien et renverser leurs pagodes, on prit pour prétexte la santé du roi et M. Constance, m'ayant fait passer pour un habile médecin, m'introduisit auprès de ce prince qui me témoigna beaucoup de bonté et dit qu'il me voulait voir tous les jours et qu'il souhaitait pour cela que je prisse un appartement dans le palais et que je ne mangeasse pas ailleurs qu'à la table qu'il m'y ferait servir. Je le remerciai de tant de bontés et le priai de me permettre de demeurer toujours avec nos pères dont la maison était proche ; que je viendrais cependant au palais quand il plairait à Sa Majesté. Quoiqu'il laissât cela à ma liberté, il m'assigna cependant un appartement et une table dans le palais, où je mangeais quelquefois pour ne le pas désobliger.
Phetracha fut ensuite chargé de me venir faire rapport de l'état de la santé du roi et de différentes altérations qu'il y avait souffertes depuis quatre ou cinq ans. Comme on avait déjà de forts soupçons contre ce mandarin, on voulait le convaincre par-là que je n'allais au palais que pour la santé du roi afin que ce ne lui fût pas un nouveau prétexte pour brouiller dans l'État. Mais cela ne l'empêcha pas de suivre ses brisées et, soit qu'il ajoutât foi à l'interprétation de l'oracle qui menaçait la vie du roi, soit qu'il fît semblant de la croire, il en fit répandre le bruit parmi tout le peuple et fit autoriser encore la prophétie qui promettait une révolution au commencement du mois d'avril. Un bramine, gagné par ses promesses, donnait cours à ces sortes de rêveries que les partisans de Phetracha appuyaient de tout leur crédit sans que ce mandarin parût y avoir de part, car il avait, jusqu'à ce temps, caché son jeu avec une adresse incroyable.
Voyant cependant que ces bruits de la mort du roi et d'une nouvelle révolution avaient mis du mouvement parmi le peuple et que plusieurs, pour se faire une nouvelle fortune, cherchaient déjà à s'attacher à ceux qu'ils espéraient devoir succéder au roi, il crut devoir agir un peu plus ouvertement et penser à exécuter ses grands projets. Il fallait pour cela avoir du monde et assembler des troupes, ce qu'il ne pouvait faire sans que M. Constance s'en aperçût. Phra Pi avait un puissant parti. Les princes en avaient encore un plus considérable, la plupart du peuple les aimant et les regardant comme les héritiers. Ils étaient à Siam dont la ville leur était toute dévouée et prête à les proclamer sitôt que le roi serait mort. Pour vaincre ces obstacles il prit la résolution de tromper M. Constance par une fausse confidence, de se rendre maître par adresse du parti de Phra Pi et de faire venir les princes à Louvo afin de se rendre maître de leur personne et de s'en défaire pour monter plus aisément sur le trône et voici de quelle manière il s'y prit.
Comme il était accoutumé à faire de fausses confidences à M. Constance avec qui il s'était toujours gouverné fort politiquement, il vint un jour lui dire en grand secret qu'il avait appris de bonne part que lorsque la nouvelle s'était répandue à Siam que la vie du roi était menacée par les dieux et par les astres, toute la ville s'était empressée de faire sa cour aux princes ; qu'ils s'étaient laissés flatter de l'espérance de se voir bientôt sur le trône et de n'attendre pas même la mort du roi ; qu'ils s'étaient découverts à leurs plus intimes amis ; que, sitôt qu'ils seraient les maîtres, les premières victimes de leur ressentiment seraient Oya Vichaigen (c'est le nom siamois de M. Constance) (11), Phra Pi et Phra Phetracha ; qu'il n'avait pas de peine à le croire, parce qu'il savait bien que ces princes ne leur avaient jamais voulu de bien à tous trois parce qu'ils les regardaient comme les auteurs de leur disgrâce. Il lui ajouta qu'il était de leur intérêt de s'unir pour prévenir leurs funestes desseins ; qu'ils étaient en état de leur résister et de disposer même de la couronne pourvu qu'ils fussent tous trois d'intelligence ; que Phra Pi entrait fort là-dedans et l'avait laissé maître de disposer de ses esclaves et de son crédit auprès du roi pour leur bien commun. En effet, il avait tellement persuadé à ce jeune mandarin qu'il le ferait roi, qu'il s'abandonnait entièrement à sa conduite. Il dit donc à M. Constance que pourvu qu'il voulût s'unir à eux et l'aider de son crédit ou même dissimuler et ne pas s'opposer aux levées de gens qu'il pourrait faire, il lui promettait d'assembler à Louvo assez de soldats pour être en état de disposer de la couronne. Il le flattait même de la lui mettre sur la tête s'il voulait faire seulement semblant d'être de la religion des Siamois car, pour lui, il protestait qu'il ne songeait qu'à se retirer dans une pagode sitôt qu'il aurait vu les affaires dans un bon train et qu'il aurait rendu les derniers devoirs au corps du roi.
M. Constance, qui était bien aise de tirer de Phetracha une partie de ses secrets, quoiqu'il fût assez convaincu de ses mauvaises intentions, ne rejeta pas tout à fait sa confidence et les propositions qu'il lui faisait. Il lui dit seulement qu'il ne pouvait consentir à faire aucune levée ni le moindre mouvement dans le royaume que le roi n'y eût consenti, et qu'il ne pouvait abuser de son autorité jusqu'à donner de tels ordres à son insu, mais que, s'il voulait, il lui en parlerait. Phetracha lui répondit qu'il n'était pas encore temps ; que Phra Pi disposerait l'esprit du roi à cela et qu'il espérait que lui, à qui il avait fait cette confidence en ami, n'en absuerait pas pour le perdre. Il avait chargé en effet Phra Pi de faire entendre au roi que ses frères avaient pris la résolution de faire traîner son corps sur la claie après sa mort, afin que le roi fût plus disposé à leur laisser amasser des troupes pour s'opposer à ce qu'on lui fît cet affront. Rien n'est plus sensible aux Siamois et l'ardeur qu'ils ont de se faire brûler magnifiquement après leur mort fait qu'ils épargnent pendant toute leur vie, vivant fort pauvrement, afin de laisser de quoi se procurer cet honneur. On le fait aux corps des rois avec une somptuosité si extraordinaire que les relations qu'on en a faites ont paru peu croyables et il faut toujours plus d'un an pour préparer cette pompe funèbre, quoiqu'on y travaille incessamment.
Pendant que Phetracha tâchait ainsi d'animer le roi contre ses frères, il agissait fortement pour paraître leur plus zélé serviteur et les engager à se venir confier à lui. Le roi avait, comme j'ai dit, une de ses sœurs auprès de lui. C'était une bonne princesse d'un naturel fort doux, mais grande dévote des talapoins. Elle n'avait jamais voulu se marier afin de pouvoir demeurer toujours auprès du roi, son frère, et afin d'imiter la vie des talapoins qui gardent le célibat. Comme elle avait toujours conservé beaucoup d'amitié pour les princes, ses frères, elle avait bien du déplaisir de les voir mal dans l'esprit du roi et elle avait parlé quelquefois en leur faveur, mais inutilement.
Phetracha se servit de cette tendresse qu'elle leur portait afin de la mettre dans son parti et se rendre maître des princes. Comme il ne pouvait pas entrer dans l'intérieur du palais pour parler à la princesse, il se servit d'un talapoin, car les talapoins seuls ont un libre accès dans l'intérieur du palais auprès des femmes – on les y reçoit même avec beaucoup d'honneur, toutes les filles des princesses et des concubines se mettant à genoux le long des galeries où ils passent et, prenant l'écharpe qui leur couvre le sein, elles en laissent un bout sur une de leur épaule et étendent l'autre sur le pavé afin que le talapoin marche dessus et les sanctifie par son passage. J'ai dit d'ailleurs que Phetracha avait fait grande amitié avec le sancratSangkha rat (สังฆราช), chef de la communauté religieuse. de Louvo. Il se servit de lui pour représenter à la princesse auprès de qui il était bien venu, que Oya Vichayen, ayant pris la résolution d'employer tout son crédit et les forces des Français pour élever Phra Pi sur le trône, elle devait faire tous ses efforts pour prévenir le funeste coup qui serait la perte totale de la famille royale et de la religion, parce que Phra Pi avait promis de détruire l'une et l'autre et de se faire chrétien en montant sur le trône ; qu'il n'y avait pas de temps à perdre, non seulement parce qu'on ne savait pas quelle suite aurait la maladie du roi, quoiqu'elle ne fût que légère, mais encore parce qu'il était à craindre que le parti de Phra Pi ne prévînt sa mort ; qu'ainsi il fallait songer à faire venir les princes à Louvo, où la couronne et les trésors du roi étaient, afin qu'ils pussent s'en mettre en possession d'abord que le roi serait mort et se faire reconnaître des grands du royaume ; qu'il était de la dernière conséquence qu'ils se rendissent pour cela à la Cour et, qu'ainsi, il fallait qu'elle disposât le roi à y consentir et que, quand même ce prince le refuserait, il fallait toujours les faire venir ; qu'il promettait de les mettre à couvert du ressentiment du roi ; que tous les mandarins étaient résolus de se déclarer pour eux et de le mettre à leur tête sans cependant perdre le respect qu'ils devaient au roi auquel ils obéiront toujours tant qu'il vivrait.
La princesse se laissa séduire par ce discours, ne doutant pas de la bonne foi de Phetracha, d'autant plus qu'elle en avait des assurances par un sancrat en qui elle avait une extrême confiance. Elle agit si fort auprès du roi, qui l'aimait beaucoup parce qu'elle le servait dans sa maladie avec une assiduité admirable, qu'il consentit enfin que les deux princes ses frères et la princesse sa fille vinssent le voir, à condition cependant que la princesse seule pourrait demeurer au palais mais que les deux princes demeureraient dans un autre palais d'où ils ne pourraient pas sortir ni voir personne que par ses ordres. M. Constance fut bientôt averti de la démarche qu'avait faite Phetracha auprès de la princesse par un mandarin de ses amis nommé Omun Si Munchay. Il était capitaine des pages et premier officier de la chambre du roi auprès de qui il s'était avancé par le moyen de M. Constance. Sa tante, qui était concubine du roi et fort amie de la princesse, le fit avertir de ce qui s'était passé entre elle et le sancrat. Comme ce mandarin était fort attaché aux princes et qu'il savait les mauvais desseins que Phetracha tramait contre eux, il avertit M. Constance afin qu'il les empêchât de venir se mettre entre ses mains.
M. Constance fut assuré par-là de la trahison et des fourberies de Phetracha, mais il eut encore moins sujet d'en douter lorsqu'il apprit qu'il faisait remuer par les talapoins dans les provinces pour y faire exciter des soulèvements et que, pour avoir du monde et des poudres, il avait envoyé de faux ordres à quelques gouverneurs et même à celui de Siam, qui les renvoyèrent à M. Constance pour savoir si cela se faisait par les ordres du roi. Il sut même que, dans un secret conseil que Phetracha avait tenu avec ses plus intimes amis, la résolution avait été prise d'ôter au roi l'administration des affaires parce que, par son trop grand attachement à la France et la confiance entière qu'il avait à Oya Vichayen, il ruinait l'État et se mettait sous la domination des étrangers.
Toutes ces connaissances qui vinrent presque en même temps à M. Constance lui firent prendre la résolution de prévenir Phetracha et de ne lui pas donner le temps d'exécuter sa perfide trahison. Il ne jugea pas cependant à propos de découvrir d'abord au roi tout ce qu'il en avait appris. Il savait que ce prince, naturellement impérieux et accoutumé à voir les Siamois ramper devant lui, était trop peu maître de sa colère pour la pouvoir retenir un moment en cette occasion et il appréhendait avec raison que, venant à éclater à contretemps, il ne donnât occasion à Phetracha de s'enfuir et d'aller faire quelque fâcheux soulèvement avec les talapoins dans le royaume.
Il voulut le faire arrêter d'abord et le mettre entre les mains du roi avec son procès tout instruit, mais il ne crut pas aussi devoir confier cette affaire aux Siamois. Il savait que plusieurs, et même de ceux de la garde du roi, avaient été sollicités et quelques-uns même déjà gagnés par ce mandarin. Il était dangereux de se méprendre dans une affaire si délicate. Il prit donc la résolution de ne se servir que d'Européens et jeta surtout les yeux sur les Français. M. Desfarges était pour lors à Bangkok où il faisait travailler avec toute la diligence possible à fortifier cette place parce que M. Constance l'avait fait avertir, il y avait quelque temps, d'en presser les fortifications le plus qu'il pourrait, parce qu'il voyait des commencements de troubles dont on pouvait craindre les suites. Elle n'avançaient pas cependant autant que l'un et l'autre l'auraient souhaité et cela par l'adresse de Phetracha, comme on l'a su depuis par la déposition des otages siamois. Il avait trouvé moyen de gagner les officiers siamois qui présidaient aux travaux et, pour empêcher qu'on ne les finît, ceux-ci détournaient une grande partie des ouvriers que le roi de Siam entretenait pour travailler à la place et ils les envoyaient travailler ailleurs.
M. Desfarges fit des plaintes à M. Constance de ce que ces mandarins ne tenaient pas le nombre de leurs travailleurs complet et, qu'au lieu de 1 500 que le roi avait envoyés, à peine s'en trouvait-il sept ou huit cents (12). Les Siamois soutenaient hardiment le contraire, mais le roi, ajoutant plus de foi à M. Desfarges qu'aux autres, envoya des mandarins pour leur faire tailler la tête, c'est-à-dire faire de grandes estafilades avec un sabre depuis le haut de la tête jusqu'au col, qui entrouvrent la peau presque jusqu'au crâne (ce châtiment est assez ordinaire à l'égard des mandarins qui manquent aux ordres du roi : on leur coupe avec un sabre la peau de la tête de haut en bas jusqu'au crâne ce qui est fort douloureux). On devait, outre cela, mettre ces mandarins à la question pour savoir pourquoi ils détournaient les ouvriers. Mais M. Desfarges, par une bonté peut-être un peu à contretemps, empêcha qu'on ne leur fît rien, renvoyant ceux qui étaient venus pour les punir sans leur permettre d'exécuter les ordres du roi. Cela empêcha qu'on ne sût la vérité et que la place ne fût sitôt en état de défense. M. Constance travaillait d'ailleurs à la pourvoir de toutes sortes de munitions dont il fournissait la meilleure partie à ses dépens, pressant surtout M. Desfarges de prendre au moins pour un an de poudre qu'il lui offrait gratis et de ne rien négliger pour sa sûreté, l'assurant d'ailleurs qu'il le ferait avertir de tout ce qui se passerait à la cour.
Il n'y manqua pas car d'abord qu'il eut découvert le complot de Phetracha, il écrivit à M. Desfarges et le pria de venir à Louvo où le roi voulait lui parler pour des affaires d'importance. En effet, Sa Majesté, à qui M. Constance avait fait connaître qu'il y avait quelques mouvements, et même à la cour, et qu'il serait à propos d'y faire venir quelques Français pour les réprimer, lui avait donné ordre de faire venir le général des Français pour délibérer de cela avec lui. M. Desfarges, ayant reçu la lettre de M. Constance, se rendit à Louvo sur la fin du mois de mars. Le roi, qui était presque rétabli de sa maladie qui n'avait été que légère, lui donna d'abord audience. Le P. Richaud (13), qui avait à présenter au roi un calendrier qu'il avait fait pour le royaume de Siam, y fut admis et j'y fus aussi appelé.
Le roi, après avoir témoigné l'estime et l'amitié tendre qu'il avait pour M. Constance et avoir fait bien des honnêtetés à M. Desfarges, lui dit qu'il le priait de demeurer quelque temps auprès de sa personne et d'y faire venir le plus de ses soldats qu'il pourrait ; qu'il avait appris que plusieurs tombaient malades et mouraient à Bangkok, ce qui lui donnait bien du chagrin ; qu'il espérait que l'air de Louvo leur serait meilleur et que M. Constance lui expliquerait le reste.
Après l'audience qui dura assez longtemps, le roi me retint au palais et souhaita que j'y dînasse. M. Constance fut obligé d'y rester aussi pour quelques affaires et pria M. Desfarges de l'excuser s'il n'avait pas l'honneur de dîner ce jour-là avec lui. Après que nous eûmes mangé, M. Constance me dit que je savais bien les raisons pour lesquelles le roi avait fait appeler M. le général puisque j'étais instruit de tout ce qui se passait ; qu'il me priait de vouloir bien les lui faire connaître ; qu'il s'agissait de maintenir un prince allié de la France contre les attentats d'un traître, de sauver la vie à ses frères et leur assurer la couronne dont ils étaient les légitimes héritiers, de soutenir enfin la religion et l'honneur de la France contre le plus cruel ennemi de l'un et de l'autre ; qu'il ne s'agissait pour cela que d'arrêter ce mandarin séditieux et peut-être un ou deux autres de la cabale ; que l'affaire était très facile dans un temps où il était sans force et ne se défiait de rien, mais que, si on lui donnait le temps d'exécuter ses entreprises, on devait s'attendre à voir la famille royale détruite, la religion chrétienne ruinée dans le royaume et les Français chassés honteusement. Il m'ajouta qu'il aurait pu se servir pour cela de quelques Anglais qu'il entretenait à Siam au service du roi, mais que, comme il s'agissait de maintenir le roi et établir ses frères sur le trône, il aurait cru faire tort aux Français s'il ne leur avait pas d'abord proposé l'affaire parce que le roi et ses frères, convaincus comme ils le seraient par les preuves évidentes qu'on leur en donnerait qu'ils étaient perdus si on n'avait arrêté ce traître, se croiraient redevables de la vie et de la couronne à ceux qui auraient fait ce coup ; qu'il laissait cependant à M. Desfarges la liberté de prendre là-dessus la résolution qu'il voudrait et qu'il avait souhaité que je lui en parlasse le premier afin qu'il fût plus maître de prendre son parti et de refuser d'entrer dans cette affaire s'il ne le jugeait pas à propos, mais que, s'il se déterminait à secourir le roi de Siam, comme l'honneur de la France et l'intérêt de la religion l'y obligeaient, que je le priasse de se trouver dans la salle de son nouveau logis afin qu'ils pussent s'y entretenir de cette affaire sans témoins et que je leur servirais d'interprète.
Voilà ce que me dit M. Constance, et, comme il vit que j'avais de la peine à me charger de cette commission, n'étant pas bien aise de me mêler de ces affaires qui ne sont pas propres de notre état, il me dit que, n'ayant personne que les jésuites à qui il pût s'ouvrir sur des choses de cette importance et ne sachant pas d'ailleurs assez de français pour s'entretenir sans interprète avec M. Desfarges, je serais responsable de tout ce qui pouvait arriver de mal de cette affaire si je ne l'en instruisais.
Je lui demandai permission au moins d'aller prendre un de nos pères avec moi pour m'accompagner chez M. Desfarges. Il me le permit et, comme le Père Le Royer était pour lors à Siam (14), je pris le père Le Blanc dont ce général aussi bien que M. Constance estimaient fort la piété et la sagesse. Nous exposâmes à M. Desfarges les choses dont M. Constance m'avait chargé. Nous lui fîmes voir toutes les fâcheuses suites qu'on devait attendre de la rébellion de Phetracha si on la lui laissait exécuter et l'avantage et la gloire qu'il y aurait à l'en empêcher, ce qui paraissait assez facile, M. Constance assurant qu'il ne fallait pas plus de cinquante ou soixante Français ; que c'était à lui cependant à examiner le point et à prendre les mesures qu'il croirait les plus sûres.
M. Desfarges ne délibéra pas à prendre son parti. Il nous dit que M. Constance lui aurait fait injure de s'adresser à d'autres qu'à lui ; qu'on ne l'avait envoyé à Siam que pour y maintenir le roi et la religion ; qu'il ne voulait pas confier cette affaire à d'autres, qu'il monterait lui-même à la tête de quatre-vingts ou cent hommes et qu'il saurait bien, avec ce secours, réduire à la raison tous ceux qui oseraient remuer contre le roi.
M. Beauchamp, major de Bangkok, qui avait été appelé à cette conférence parce que M. Desfarges avait beaucoup de confiance en lui, jugea aussi qu'il n'y avait pas à délibérer là-dessus et qu'il n'y avait nulle difficulté à exécuter cette entreprise parce que, comme il était depuis quelque temps à Louvo où il faisait faire l'exercice aux gardes du roi, il savait que Phetracha n'y avait aucunes forces. C'est pourquoi M. Desfarges me renvoya aussitôt dire à M. Constance qu'il l'allait attendre dans la salle où il lui avait donné rendez-vous. M. Constance s'y rendit bientôt après. Ils eurent là, en particulier, un long entretien où je leur servis d'interprète. M. Constance fit encore un détail de toute cette affaire à M. Desfarges et lui en fit voir toutes les conséquences et la gloire et l'avantage qui en reviendraient aux Français d'avoir sauvé le roi et soutenu la couronne dans sa famille ; combien cela disposerait le prince à embrasser la religion chrétienne lorsqu'il verrait que les talapoins, qu'il ménageait tant et qui l'empêchaient de se déclarer, avaient machiné sa perte ; l'obligation que lui auraient les frères du roi quand ils connaîtraient qu'ils étaient près de perdre la couronne et la vie sans ce prompt secours des Français qui, en les sauvant, les remettraient bien avec le roi puisqu'on avait de quoi le désabuser de fausses trahisons dont on les avait rendus coupables auprès de lui. Il lui fit voir après cela qu'il n'y avait rien de plus facile à faire que ce coup important puisque Phetracha était sans forces et n'en pouvait avoir de plus d'un mois ou six semaines.
M. Desfarges étant encore confirmé par tout cela dans sa première résolution, M. Constance lui recommanda surtout trois choses : La première de prendre son parti de manière qu'il ne vînt pas à manquer dans la suite aux mesures qu'ils auraient prises parce que, cela l'empêchant d'en prendre d'autres, ils se trouveraient au dépourvu et donneraient lieu à Phetracha d'exécuter ses desseins ; qu'ainsi il devait venir avec son détachement d'abord qu'il aurait mis les choses en état à Bangkok et ne se point laisser détourner par les bruits qu'on pourrait faire courir pour l'arrêter ; que, s'il arrivait quelque changement, il lui en donnerait d'abord avis. La seconde chose fut de ne communiquer à personne ce qu'il lui avait dit, de crainte que Phetracha, en étant averti, ne prévînt sa perte par quelque coup de désespéré ou ne se retirât dans les provinces où il avait communication et ne les fit soutenir. Enfin il lui recommanda d'user de diligence et de ne pas perdre un moment de temps.
M. Desfarges lui promit tout cela et dit qu'il s'allait disposer à repartir ce soir-là même et qu'il le reverrait bientôt de retour, qu'il le priait seulement de lui envoyer un ordre de la part du roi de monter avec son détachement afin qu'en cas de besoin, il pût faire voir qu'il n'avait agi que par le commandement du roi de Siam qu'il avait ordre de suivre. Les choses étant ainsi réglées, M. Desfarges vint encore dire adieu à M. Constance au palais, où nous couchâmes cette nuit-là, et il en partit à minuit, ayant vu que tout y obéissait aux ordres de ce ministre.
Il ne tint cependant aucune de paroles qu'il lui avait données car, premièrement, au lieu d'user de diligence, il fut près de quinze jours avant de se mettre en marche. Son dessein, d'ailleurs, ne fut pas fort secret car on en avertit m. Véret, chef de la faiturieFaiturie, ou factorie : bureau où les facteurs, les commissionnaires, faisaient commerce pour le compte d'une Compagnie. L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert précise également : On appelle ainsi dans les Indes orientales et autres pays de l'Asie où trafiquent les Européens, les endroits où ils entretiennent des facteurs ou commis, soit pour l'achat des marchandises d'Asie, soit pour la vente ou l'échange de celles qu'on y porte d'Europe. La factorie tient le milieu entre la loge et le comptoir ; elle est moins importante que celui-ci et plus considérable que l'autre. française qui était à trois lieues au-dessus de Louvo où il faisait travailler aux mines dont il avait obtenu le privilège pour le profit de la Compagnie. Il en partit aussitôt qu'il eut reçu une lettre qu'on lui écrivit de Siam et, m'étant venu voir en passant par Louvo le 13 avril, il me demanda comment se portait le roi. Je l'assurai qu'il se portait bien sans savoir à quel dessein il me le demandait. Il se rendit ensuite en diligence à Siam où M. Desfarges arriva le lendemain qui fut le 14 avril. Étant allé se reposer à la faiturie en attendant que les gens qui étaient sur différents bateaux arrivassent, M. Véret lui dit tout ce qu'il put de plus fort pour l'arrêter et le détourner d'aller à Louvo, se servant surtout du bruit de la mort du roi qui courait à Siam et du danger où il s'allait exposer pour un homme et pour une affaire que la France était résolue d'abandonner ; qu'il attendait à tout moment un ordre de M. de Seignelay sur ce qu'il lui avait écrit l'année précédente pour quitter Siam et aller avec les troupes faire un établissement ou à Soccodane (15) en l'île de Bornéo ou à Pol Condor (16). M. Desfarges, cependant, ne se rendant pas à ses raisons, il lui persuada d'aller avec lui au séminaire consulter MM. les évêques. On acheva là de lui persuader d'abandonner M. Constance par tout ce qu'on lui dit de la mauvaise foi de ce ministre et de son peu de crédit auprès du roi de Siam (17). On l'assura que, voulant se soutenir dans son poste malgré ce prince, il faisait venir de son chef les Français, voulant les perdre avec lui ou se soutenir par leur moyen contre tout le royaume. On ajouta que, si ce n'était que pour mettre les princes sur le trône après la mort du roi qu'on le faisait monter, il n'était pas nécessaire qu'il allât jusqu'à Louvo ; que l'aîné étant à Siam, il pouvait aller avec M. de Métellopolis lui offrir ses services.
Ce prélat jugea cependant fort sagement qu'il était à propos, avant de faire cette démarche, de savoir en quel état étaient les choses à Louvo. Ce fut la résolution qu'on prit : on fit partir le sieur Le Roy, officier des troupes, pour porter une lettre à M. Constance de la part de M. Desfarges, où il lui mandait qu'ayant appris à Siam la mort du roi, il n'avait pas osé passer outre de peur de s'engager et de causer du tumulte, mais que, s'il voulait se retirer à Bangkok avec sa femme et sa famille, il l'attendrait un jour ou deux à Siam pour le conduire dans la place.
L'officier arriva à une heure après minuit, le vendredi Saint. M. Constance n'était pas encore couché parce qu'ayant observé avec nous une éclipse de lune à minuit, il avait passé le reste du temps devant le Saint Sacrement qui était exposé dans la chapelle. On peut juger combien il fut surpris de la conduite de M. Desfarges. Il n'en témoigna pas cependant son mécontentement. Il se contenta de lui écrire qu'il s'étonnait qu'il se fût laissé surprendre par un faux bruit contre lequel il l'avait prévenu ; que le roi l'attendait avec impatience et que les affaires étaient toujours sur le même pied. Il me pria de lui écrire aussi que j'avais vu le roi et qu'il se portait bien, ce que je fis, et l'officier partit deux heures après, s'étant convaincu par lui-même qu'il n'y avait aucune émotion dans la ville, car on le mena en différents endroits et surtout auprès du palais.
Mais tout cela ne servit de rien pour engager M. Desfarges à monter. Il avait pris sa résolution, avant que l'officier retournât, de s'en aller à Bangkok, quelque réponse qu'on lui apportât. Il partit aussitôt que son officier fut arrivé sans considérer que, croyant n'abandonner que M. Constance, il abandonnait en même temps l'honneur et les intérêts de la France et sa religion même. Cependant, pour ne pas paraître rompre tout à fait avec ce ministre, ne sachant quelle suite aurait cette affaire, il envoya un capitaine nommé M. Dacieux pour lui faire ses excuses sur ce que, sur les assurances qu'il avait eues des grands armements qui se faisaient à Louvo par Phetracha, il n'avait pas cru devoir risquer le peu de troupes qu'il avait, ni abandonner une place qui lui avait été confiée par le roi, son maître.
Ce capitaine, qui était un fort honnête homme, croyant que c'était-là la véritable raison qui avait obligé M. Desfarges à retourner et ne voyant aucun soldat ni aucun mouvement extraordinaire à Louvo, fut au désespoir qu'on lui eût fait faire une si mauvaise démarche en le trompant si grossièrement. C'est pourquoi il conjura M. Constance de vouloir bien lui permettre de retourner à Bangkok instruire M. Desfarges de ce qu'il avait vu, l'assurant qu'il viendrait indubitablement d'abord qu'on l'aurait désabusé. M. Constance, qui ne pouvait plus faire de fond sur ce gouverneur après ce qui lui était arrivé, rejetait cette proposition et voulait faire venir les Anglais qui étaient à Siam. Mais M. de Beauchamp, pour qui M. Constance avait de la considération, s'étant joint à M. Dacieux, ils le conjurèrent avec tant d'empressement de ne pas faire cet affront aux Français, se faisant forts, d'ailleurs, d'engager infailliblement M. Desfarges à venir, qu'il consentit enfin à les laisser aller et à attendre quel effet aurait leur voyage, d'autant plus qu'il était bien aise que les Anglais ne quittassent pas les deux vaisseaux qu'ils tenaient armés à Siam par ses ordres et qui pouvaient être d'un grand secours dans le besoin. Mais ses espérances furent encore trompées à ce coup. Tous les efforts que firent les deux officiers auprès de M. Desfarges furent inutiles. Ainsi M. de Beauchamp fut obligé de retourner sans avoir rien fait et, ce qui fut le plus fâcheux, c'est qu'il n'usa pas de la diligence qu'il avait promise et qu'on lui avait fort recommandée car, soit qu'il espérât toujours de déterminer enfin M. Desfarges à faire une démarche si avantageuse à la réputation et au bien des affaires, soit qu'il eût honte de revenir seul après les assurances si positives qu'il avait données à M. Constance d'amener M. Desfarges, il fut assez de temps sans revenir, laissant pendant ce temps-là ce ministre en suspens qui ne pouvait, à cause de cela, prendre aucune mesure.

NOTES
1 - L'Oiseau, sur lequel se trouvait les principaux acteurs de l'ambassade, arriva dans la rade de Siam dès le 27 septembre, une dizaine de jours avant les autres navires de la flotte. Le père Tachard se rendit immédiatement à terre avec les pères d'Espagnac et Mazuyer pour prendre les premiers contacts avec Phaulkon. D'innombrables allées et venues, tractations, échanges de courriers s'ensuivirent, dans lesquels le père Tachard joua un rôle plus que trouble, avant le débarquement des troupes qui n'eut lieu que le 17 octobre. ⇑
2 - L'ambassadeur désigne ici Kosapan, qui avait conduit l'ambassade siamoise en France. ⇑
3 - Le texte nous éclaire sur les réticences de Kosapan et nous laisse entrevoir un ambassadeur bien plus critique et soupçonneux que le portrait béatement francophile qu'en ont dressé les articles de Donneau de Visé dans le Mercure Galant. On ne s'étonnera pas que, lors du coup d'État, Kosapan se soit rallié sans réserve à la cause de Phetracha. ⇑
4 - Signé, non sans réticence, et après beaucoup de corrections, ratures et observations. Les principaux points de désaccord portaient sur la présence de troupes siamoises aux côtés des troupes françaises, et leur commandement, sur la manière de fortifier Bangkok et Mergui et sur le rôle de Phaulkon dans la chaîne de commandement. Céberet note dans le résumé de son Journal (cité par Michel Jacq-Hergoualc'h, Journal du voyage de Siam de Claude Céberet, pp. 208-209) : Les conditions demandées par le sieur Constance ne nous parurent point convenables ; ainsi nous voulûmes nous dispenser de les négocier, alléguant le défaut d'ordre, mais le père nous mit dans la nécessité de faire des articles ou de nous en retourner sans rien faire, étant impossible de se servir de la force à cause que les vaisseaux ne pouvaient entrer dans la rivière devant Bangkok. Nous ne pûmes mieux faire que de signer ces articles que nous réformâmes autant qu'il nous fut possible, et nous prîmes le parti de les embrouiller de telle manière qu'ils fussent inutiles, comme en effet ils l'ont été. ⇑
5 - Le père Tachard accumulait les maladresses et les initiatives malheureuses, rajoutant encore de la confusion, des tensions et des inimitiés dans une ambassade déjà bien mal engagée. À propos de ces nominations d'officiers, on peut lire dans le Journal de Céberet : Nous apprîmes ce même jour au soir que dans la revue que M. Constance avait faite des troupes, il avait nommé et reçu plusieurs officiers pour commander les compagnies siamoises et qu'il avait tiré des officiers et des cadets des compagnies françaises pour remplir ces places à l'insu de Monsieur Desfarges, sur le rapport que le père Tachard avait fait au dit sieur Constance de la capacité de ces dits officiers et cadets. Nous témoignâmes à quelques-uns des pères jésuites qui étaient avec nous que le père Tachard aurait pu nous donner avis de tout cela sans se faire tort et je témoignai plus particulièrement que j'étais surpris qu'ils eussent choisi pour premier capitaine le sieur de Fretteville que le père Tachard savait bien m'avoir été recommandé par son père qui craignait, avec quelques raisons, que son fils, prévenu par le père Tachard, ne s'engageât mal à propos au service du roi de Siam sans y trouver de grands avantages. (Michel Jacq-Hergoualc'h, Journal du voyage de Siam de Claude Céberet, p. 67). ⇑
6 - Les envoyés extraordinaires ne s'attardèrent pas au Siam. Après la signature d'un traité commercial le 11 décembre 1687, Claude Céberet eut son audience de congé le 13, jour où il partit pour Mergui où il arriva le 1er janvier et d'où il s'embarqua pour la France le 2 février 1688. La Loubère eut son audience de congé le 23 décembre et quitta le Siam le 3 janvier à bord du Gaillard. ⇑
7 - Cette affirmation, même si elle a les apparences d'un règlement de compte, n'est pas invraisemblable. Les rapports entre La Loubère, Phaulkon et Tachard étaient devenus exécrables. Dans son Journal, Céberet note un événement arrivé la veille de son audience de congé (op. cit. p. 137) : Le même jour, au soir, M. de La Loubère me fit voir un mémoire que lui avait envoyé M. Constance. Je le trouvai plein d'aigreurs et d'invectives pour ne pas dire d'injures. Je fus de sentiment de n'y point répondre qu'en marquant à M. Constance que notre départ ne permettait pas de le faire. Il aurait été inutile de répondre autrement, car il avait résolu de garder avec nous la même conduite qu'il avait commencée, et de se remettre de tout au père Tachard qui partait pour France avec des pouvoirs. Ainsi nous en demeurâmes dans ces termes et nous convînmes, M. de La Loubère et moi, qu'il prendrait prétexte de mon départ pour ne rien signer, au moins qu'il ne fût avantageux, et qu'il attendrait la commodité du roi pour l'audience publique et pour son départ. ⇑
8 - Phaulkon avait deux fils. L'aîné qu'évoque le père de Bèze mourut en 1688. Certaines relations indiquent que le cadet, né vers 1685/86, aurait été tué après le coup d'État de 1688. Cette information est démentie par le père Alexandre Pocquet, professeur et intendant au séminaire des Missions Étrangères d'Ayutthaya, qui écrit dans une lettre du 25 octobre 1694 adressée à M. de Brisacier (citée par Launay, Histoire de la mission de Siam, I, p. 299) : J'ai lu dans une relation qu'on dit avoir couru en France que le fils de M. Constance, qu'on nomme dans cette relation le comte Saint-Georges, apparemment parce que son nom de baptême est Georges, avait été attaché à la tête d'un balon et noyé. Je vous assure qu'il est mon écolier depuis sept ou huit mois, que je viens de lui faire la leçon et à ses autres petits camarades, et que voilà actuellement un clerc tonkinois qui la leur fait répéter à côté de moi, et m'interrompt fort bien. Ce petit Georges a huit ou neuf ans, paraît faible de corps et de santé ; mais il a un bon esprit et de très bonnes inclinations pour sa âge ; depuis le peu de temps qu'il est ici, il ne me parle déjà qu'en latin, et m'entend dans la même langue, quoi que je lui dise ; il ne sait pourtant encore rien de la grammaire, si ce n'est un peu décliner.
Les Archives Nationales (AN, Col. C1/26) conservent des pièces relatives à un procès que les héritiers Phaulkon intentèrent à la Compagnie des Indes pour récupérer des sommes que M. Constance y avaient investies. Parmi ces héritiers, se trouvaient bien évidemment Marie Guimard, la veuve, mais aussi une dame Louisa Passagna, veuve de Georges Phaulkon, le fils de Constantin. On apprend par ces documents que Georges Phaulkon était décédé en 1717, et qu'il laissait un fils prénommé Constantin, comme son grand-père. Sa veuve, la dame Louisa Passagna, se remaria avec un sieur de Crouly. ⇑
9 - Du Bruant quitta Bangkok le 7 février 1688 avec trois compagnies pour aller prendre possession de Mergui. ⇑
10 - Desfarges était venu au Siam avec ses trois fils : l'aîné, le marquis de Desfarges, le cadet, le chevalier, et l'abbé. Le marquis et le chevalier restèrent au Siam avec leur père, l'abbé repartit en France avec l'escadre au début de janvier 1688. Le Journal de Dangeau du 10 novembre 1690 mentionne sa mort. ⇑
11 - Phaulkon avait le titre de Chao Phraya Wichayen (เจ้าพระยาวิชเยนทร์). ⇑
12 - La mauvaise volonté ou l'indolence des Siamois n'étaient peut-être pas les seules causes du peu d'avancement des fortifications. Beauchamp, major de Bangkok, révèle que Vollant des Verquains ne faisait rien pour stimuler l'ardeur des Siamois ; pis encore, s'il faut en croire ces fielleuses et savoureuses confidences, il utilisait cette main-d'oeuvre à des fins strictement personnelles : M. Desfarges fut fort surpris d'apprendre à son retour que Vollant, ingénieur, s'amusait à faire des maisons de plaisance ; qu'il débauchait sous main des ouvriers de la place ; qu'il en avait tiré jusqu'à trente en un seul jour ; qu'il avait fait démolir en partie une très belle maison que les missionnaires lui avaient prêtée, pour la rendre plus spacieuse, comme aussi il en avait fait bâtir une entière à un quart de lieue de celle-là sur le bord de la rivière, à quatre pavillons, avec une grande ménagerie, ce qui fut cause que les Siamois qui travaillaient à Bangkok se plaignirent de lui à M. Desfarges sur ce qu'il leur enlevait leurs travailleurs. Ce fut sur ces plaintes et sur ce que M. Desfarges s'aperçut qu'ils n'étaient plus si assidus aux travaux, qu'il lui dit qu'il ne prétendait pas qu'il quittât les travaux du roi pour bâtir des palais ; qu'il devait se ressouvenir que, manque d'application, les fortifications qu'il conduisait de la place ne valaient rien : que le batardeau qu'il avait fait construire pour retenir l'eau dans les fossés s'était éboulé, en un mot qu'il voulait qu'il fît ce qu'il était obligé de faire ; que ce n'était pas ainsi qu'on gagnait l'argent du roi, et que s'il continuait il en écrirait à la cour. Vollant lui répondit brusquement qu'il s'en souciait fort peu et qu'il en écrirait aussi. M. Desfarges, indigné d'une telle réponse, le mit lui-même en prison, où il ne demeura que deux heures, parce qu'il pria le sieur de la Salle, commissaire, de dire à M. Desfarges qu'il lui demandait pardon et qu'il tâcherait de le mieux contenter à l'avenir. (Manuscrit Bibliothèque Nationale Ms Fr 8210, f° 512v° et suiv.). ⇑
13 - Jean Richaud (1633-1693) faisait partie des 14 jésuites astronomes et mathématiciens envoyés par Louis XIV au roi Naraï. ⇑
14 - Abraham le Royer (1646-1715) était le supérieur des jésuites. ⇑
15 - L'ancien royaume de Sukadana qui se trouvait dans l'actuelle province indonésienne de Kalimantan occidental dans l'île de Bornéo. ⇑
16 - Côn Son, île de l'archipel de Côn Đảo, au sud-est du Viêt Nam. ⇑
17 - Cette décision de rester à Bangkok fut lourde de conséquences. L'abbé de Lionne fut vivement critiqué pour avoir déconseillé à Desfarges de se rendre à Lopburi. Pour se justifier, il écrira plus tard un long Mémoire sur une affaire sur laquelle on m'a demandé quelques éclaircissements qu'on pourra lire sur ce site. ⇑

12 mars 2019
