
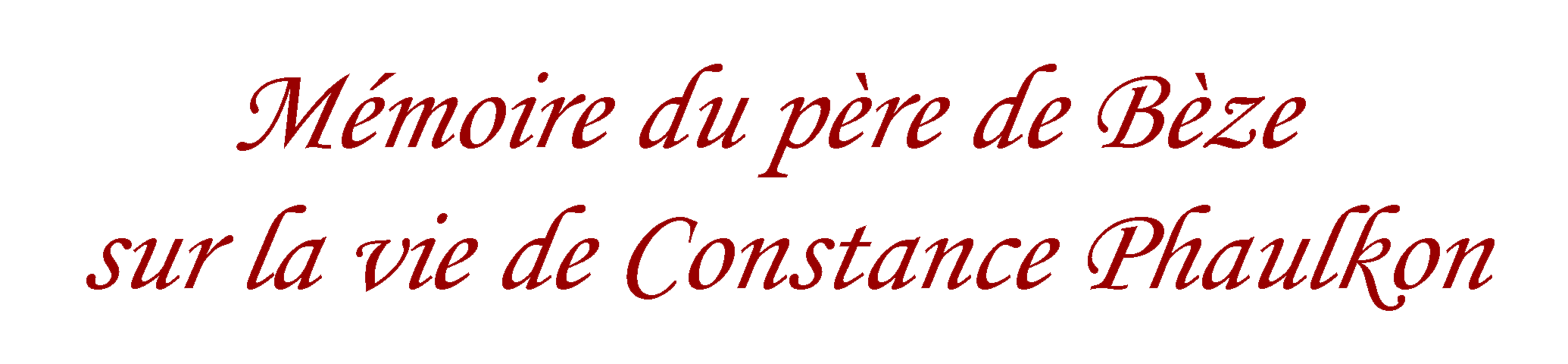
Sixième et dernière partie.
La mort de M. Constance jeta sa femme dans un accablement de douleur qui ne se peut exprimer. Elle avait été assez insensible au renversement de sa fortune et à la perte de tous ses biens, mais elle versa des torrents de larmes à la mort de ce cher mari qu'elle n'avait jamais voulu abandonner, quelques prières qu'il lui eût faites de se retirer à Bangkok, espérant d'avoir au moins la consolation de mourir avec lui, heureuse si, par une cruelle pitié, on ne l'eût pas réservée à de plus rudes traitements. On sait tout ce qu'elle eut à souffrir de la brutalité d'Oluan Sorasak, fils de Phetracha, qui, sans lui donner le temps d'essuyer ses larmes, voulut qu'elle consente à son infâme passion lorsque le sang de son mari qu'il vient de faire égorger est encore tout fumant. Comme il fit succéder aux promesses et aux amitiés les plus rudes traitements, elle eut besoin d'une constance plus qu'humaine pour résister à de si fortes épreuves.
Elle la cherchait dans l'usage des sacrements que nous lui administrions le plus souvent qu'il nous était possible, car il fallait user de beaucoup d'adresse pour pouvoir tromper la vigilance des gardes, la confesser et la communier sans qu'ils sans aperçussent, surtout depuis qu'ils eurent eu des ordres de Sorasak de la veiller de plus près, car ce mandarin m'avait fait dire par Si Munchiay que si nous voulions délivrer Mme Constance des peines qu'il lui faisait, il fallait la faire consentir à ce qu'il demandait d'elle. Comme je rejetai bien loin une telle proposition, lui disant que Mme Constance serait trop heureuse de donner jusqu'à la dernière goutte de son sang pour la conservation de son honneur et de sa religion, et que je l'y encouragerais toujours, même au péril de ma vie, il fit défendre aux gardes de nous laisser parler à Mme Constance qu'en siamois et en leur présence pour être témoin de ce que nous lui dirions.
Il n'osait pas nous faire exclure tout à fait, parce qu'ayant eu permission de son père de la voir et de lui porter à manger tous les jours, il avait peur que nous ne nous allassions plaindre à lui et que, l'informant des mauvais traitements qu'il faisait à cette dame, cela ne lui attirât quelque nouvelle affaire ; car il n'y avait pas longtemps qu'ayant osé faire enlever la fille du grand prêtre des Malais, Phetracha, sur les plaintes que lui en fit le général de cette nation, le fit mettre en prison et le menaça de lui faire couper la tête s'il lui arrivait de faire aucune violence à quelque femme que ce fût, parce qu'il savait qu'il s'était déjà rendu très odieux aux mandarins par ces sortes de débauches. C'est pour ce sujet que, dans les mauvais traitements qu'il faisait faire à Mme Constance, il prenait pour prétexte qu'elle n'avait pas déclaré tous ses biens dont il avait demandé exprès la confiscation à son père, lui faisant dire cependant, en particulier, qu'il se désisterait d'en faire la recherche d'abord qu'elle voudrait consentir à se faire sa femme. Il avait même trouvé le moyen de gagner une de ses parentes qui, par une fausse pitié, croyait lui rendre service en la portant à céder à la force et tâchant de lui persuader qu'il n'y avait pas de péché. Ainsi elle avait besoin qu'on l'animât dans de si rudes combats. Dieu voulut que le nay, ou capitaine (1), qui était chargé de la garder, tombât malade et que je le guérisse. Cela le fit relâcher beaucoup de sa sévérité et Mme Constance s'en trouva beaucoup mieux.
Ce fut par le moyen des remèdes que nous trouvâmes aussi entrée chez les principaux mandarins et dans la maison de Phetracha même, où étaient les jeunes garçons et les jeunes filles chrétiennes que M. et Mme Constance avaient élevés. Tout ce pauvre petit troupeau ainsi dispersé se trouvait à la merci des loups sans aucun secours et on leur faisait toutes sortes de mauvais traitements dans ces maisons dont ils ne sortaient pas, pour les obliger à quitter leur religion. Désolés de les savoir en ce danger de perdre leur foi et cherchant le moyen de les assister, nous allâmes nous présenter aux portes de ces mandarins avec des remèdes à la main. Comme nous les donnions pour rien et que, d'ailleurs, on nous croyait habiles, les gens de la maison venaient nous en demander et ils nous introduisirent même dans la maison pour voir ceux qui étaient malades, nous permettant d'appeler nos prêtres chrétiens pour les exhorter.
Cela fit que les officiers de ces maisons les traitèrent mieux et cela encouragea si fort ces enfants qu'ils s'assemblaient tous les soirs pour prier ensemble, quoiqu'on les châtiât lorsqu'on les trouvait le faire. On a vu ailleurs les exemples de constance et de générosité chrétienne qu'ont donnés ces jeunes chrétiens dont aucun, pendant que nous fûmes-là, ne renonça à la religion, non plus que ceux qui eurent à essuyer les plus rudes prisons où quelques-uns moururent de misère. Le ciel voulut que nous eussions toujours assez de liberté pour les pouvoir secourir et, lorsque nous n'avions presque plus d'argent et que nous nous croyions sans ressource, quoique nous fussions chargés de plus de cent personnes à qui nous portions à manger tous les jours, outre plusieurs autres que nous assistions encore, la Providence voulut que Phetracha lui-même nous envoyât de l'argent contre toutes nos espérances. Le roi de Siam, dont nous ne savions assez reconnaître la bonté, m'avait fait dire qu'un de ses plus sensibles déplaisirs en sa disgrâce était de ne pouvoir plus nous donner des marques de son amitié comme auparavant et de ne pouvoir nous faire du bien dans le besoin où il ne doutait pas que nous ne fussions depuis la mort de M. Constance ; qu'il nous priait cependant d'accepter un peu d'argent qui lui était resté ; qu'il me l'enverrait peu à peu par son valet de chambre. Nous fûmes charmés d'une si grande bonté, mais nous crûmes ne devoir accepter cette offre, dans la crainte que le roi lui-même n'en eût besoin.
Il arriva en ce temps-là que Phetracha prit la résolution d'achever la sanglante tragédie et de faire mourir les deux frères du roi. Le plus jeune des princes était venu à Louvo avant la révolte de Phetracha, à la sollicitation, comme j'ai dit, de sa sœur, et plus encore de sa nièce. Cette jeune princesse, pleine d'ambition et croyant que Phetracha songeait tout de bon à faire reconnaître ce prince qu'elle avait, comme l'on croit, épousé, fit tant qu'elle lui persuada de monter avec elle à Louvo. Phetracha se contenta de lui donner d'abord des gardes lorsqu'il fut le maître et, comme il sut que tout le peuple s'était déclaré à Siam pour l'aîné qui, ne pouvant se fier à ce que lui mandait sa sœur des bonnes intentions de Phetracha, n'avait pas voulu s'aller mettre entre ses mains, il envoya quelques mandarins affidés qui, sous prétexte de lui faire aussi leur cour, l'enlevèrent par une porte de derrière de son palais qui donnait sur la rivière. Ainsi il se vit maître de l'un et de l'autre.
Il n'osa pas, cependant, les faire mourir de son autorité pour ne pas s'attirer la haine de tout le peuple et même de la plupart des mandarins de son parti qui avaient cru agir pour l'intérêt des princes. En se déclarant pour lui, il voulut faire croire que l'ordre venait du roi et il prit pour cela la résolution d'aller voir ce prince et d'avoir une conférence secrète avec lui afin de faire croire qu'il lui aurait donné ce commandement. Il entra dans son appartement. À la vue des mandarins, dont aucun cependant ne le suivit qu'un qui lui était affidé, le roi, à ce que nous sûmes d'un médecin qui se trouva auprès de lui, entra d'abord dans un si grand mouvement d'indignation en le voyant qu'il tomba comme mort. Étant revenu cependant à lui, il lui reprocha la manière indigne dont il le traitait, la mort de son fils et de M. Constance et l'emprisonnement de ses frères. Il lui ajouta ensuite, à notre sujet, qu'il avait bien du chagrin que nous ayant fait venir de France et lui ayant été recommandés si particulièrement par le roi, nous fussions cependant maltraités et dans une si grande nécessité. Phetracha lui dit que la maladie de Sa Majesté l'empêchant de s'appliquer aux affaires, il avait été obligé, par l'avis des mandarins, d'en prendre le soin jusqu'à ce qu'elle fût en bonne santé ; que Phra Pi et Oya Vitchiayen s'étaient trouvés coupables de mort dans le Conseil des mandarins. Pour ses frères, il promit de les lui envoyer et de ne leur point faire de mal, ainsi que lui reprocha depuis la sœur du roi qui fut présente à tout cet entretien, lorsqu'il osa dire que le roi lui avait donné ordre de les faire mourir. Il dit enfin que, pour nous, nous n'avions reçu aucun mavuais traitement et que, si nous manquions d'argent, Sa Majesté n'avait qu'à ordonner, qu'il nous en enverrait. Le roi lui ayant témoigné qu'il lui ferait plaisir, il ne manqua pas de dire aux mandarins qu'il avait reçu cet ordre avec celui de faire mourir les frères du roi pour rendre l'un plus croyable par l'autre et de nous envoyer aussitôt de l'argent avec grand éclat pour faire voir qu'il exécutait ponctuellement les ordres de Sa Majesté.
Le roi lui avait témoigné, dans le même entretien, le chagrin qu'il avait de ne pouvoir plus nous voir, M. Paumard et moi, et Phetracha s'était engagé encore à nous laisser lui parler. Il voulut tenir sa parole et, nous ayant envoyé chercher, il nous fit savoir que le roi voulait nous voir. Il nous défendit en même temps de lui parler ni de religion ni de rien de tout ce qui s'était passé et nous dit qu'il nous ferait couper la tête si nous osions rien faire contre ses ordres. Comme il vit bien cependant que nous nous mettrions peu en peine de les garder, il y pourvut d'ailleurs en donnant ses ordres à ceux qui gardaient le roi.
Nous vîmes ce pauvre prince, mais si abattu et si changé qu'on ne le reconnaissait presque plus. Il nous fit d'abord des plaintes de l'état où il était réduit et nous marqua ensuite le chagrin que lui avait causé la mort de M. Constance, disant qu'on avait fait mourir sans aucune raison ce ministre qui l'avait toujours servi très fidèlement et qui avait rendu de grands services à l'État. Comme on vit qu'il entrait dans ces matières, les gardes, sous prétexte qu'il était faible et qu'il ne pouvait pas parler beaucoup sans s'incommoder, le remportèrent brusquement sans que nous pussions lui parler de religion. Nous eûmes un extrême déplaisir d'avoir perdu une occasion si favorable de faire un dernier effort pour la conversion de ce prince, d'autant plus que nous avions sujet de croire qu'ayant si souvent témoigné tant d'inclination pour la religion chrétienne, il songeait à l'embrasser, au moins à la mort, et qu'il avait demandé à nous voir pour cela.
Comme nous étions dans cette inquiétude, on nous avertit que Phetracha nous permettait de voir encore le roi. Ce prince avait témoigné tant de chagrin de ce qu'on ne lui avait pas laissé le temps de nous parler et tant d'envie de nous revoir que Phetracha, le voyant près de mourir, ne lui put refuser cette consolation. Nous prîmes bien la résolution de commencer d'abord à lui parler de son salut sans nous mettre en peine de ce qui pourrait nous en arriver. En effet, après que ce prince nous eut dit trois mots de sa santé et nous eut entrouvert son justaucorps pour nous faire voir le point de maigreur où il était rendu, nous lui dîmes que, ne pouvant plus espérer de vivre longtemps sans miracle, il devait songer à se procurer une autre vie, plus durable et plus heureuse que celle-ci. Le Chinois qui nous servait d'interprète, entendant ce langage, ne voulut pas interpréter ce que nous disions au roi, car Phetracha, qui savait bien qu'il aurait plus de crainte de ses menaces que nous, le lui avait défendu sous peine de la vie. Ainsi, quelques instances que nous lui fissions, il refusa toujours de le faire, disant qu'il y allait de sa tête.
Le roi avait grande envie de savoir ce que nous disions mais, comme il n'y avait que six mois que j'étais dans le royaume, je ne savais pas assez la langue, surtout celle du roi que je ne commençais à apprendre que depuis peu de temps (2). M. Paumard, qui était depuis dix ans dans le royaume de Siam, ne la savait pas aussi et jamais le roi ne put l'entendre de sorte que, faute d'interprète, nous ne pûmes savoir de lui s'il avait envie d'être baptisé. On le remporta encore car, tout malade qu'il était, on l'avait apporté dans son antichambre. Il mourut deux jours après, c'est-à-dire le 10 de juillet, à dix heures du soir. Je ne sais pas en quelle disposition il était pour la religion, mais je crains que, s'il avait envie de l'embrasser, ce n'ait été par une punition du ciel qu'ayant négligé lorsqu'il pouvait se faire baptiser, remettant toujours cela à la fin de sa vie, il n'ait plus été en son pouvoir, dans ce dernier moment. Mais il faut remettre cela au jugement du Seigneur dont les miséricordes surpassent toujours la justice. On doit seulement rendre ici à M. Constance l'honneur que mérite son zèle, car il n'a rien oublié pour procurer le salut de ce prince. J'ai dit ailleurs une partie de ce qu'il fit pour lui faire embrasser la véritable religion, et il lui en parlait souvent avec une liberté digne d'un véritable chrétien. Une fois entre autres, à l'occasion du miracle fait par Saint François Xavier en faveur du père Mastrilly qu'il raconta au roi, il lui fit voir la nécessité de se faire chrétien pour être sauvé d'une manière si forte que le roi, en étant frappé, dit qu'il y penserait tout de bon et Phetracha, qui était présent, nous dit en sortant que cela l'avait si fort persuadé que, si le roi témoignait y consentir, il était prêt de se faire chrétien. Mais il y avait bien peu de sincérité dans ce qu'il disait, puisqu'il fit même un crime au roi d'avoir pensé à l'être et qu'il fit tout ce qu'il put, d'abord qu'il l'eût arrêté, pour le pouvoir convaincre de nous avoir donné parole d'embrasser notre religion afin de se servir de ce prétexte pour le faire déclarer déchu de la couronne. On nous fit pour cela plusieurs interrogations sur une lettre d'un missionnaire écrite à M. Chevreuil où il parlait des bonnes dispositions où était le roi à l'égard de la religion.
Quelques jours avant la mort du roi, Phetracha avait fait mourir les frères de Sa Majesté (3). Sorasak fut chargé de cette sanglante exécution. Elle se fit avec plus de facilité que ce mandarin même ne l'avait espéré et, en effet, on n'aurait jamais cru que les Siamois dussent voir massacrer tranquillement deux princes pour lesquels ils avaient tant marqué d'attachement. C'est pourquoi Phetracha avait assemblé tout ce qu'il avait de soldats plus affidés à Louvo et avait éloigné les autres sous différents prétextes et, comme il appréhendait que le parti des princes ne vint prendre une douzaine d'ouvriers français qui s'étaient réfugiés chez nous pour les mettre à leur tête, il nous fit dire de fermer ce soir-là nos portes de bonne heure et de ne pas les ouvrir, quelque bruit que nous entendissions, sans nous marquer la raison de cet ordre. Je la sus cependant ce soir-là même car, m'étant trouvé au palais où tout était plein de gens armés, j'appris des eunuques du jeune prince qui se vinrent réfugier dans le lieu où j'étais, qu'on venait d'arrêter leur maître et qu'on le menait au supplice, sans que personne se fût mis en état de s'y opposer que trois de ses officiers qu'on avait pris prisonniers aussi.
L'aîné des princes était gardé dans une pagode où on le prit sans peine. Ils furent conduits à une demi-lieue de la ville, et là, étouffés entre deux pieux de santal (c'est ainsi qu'on fait mourir les princes de la maison royale), sans que le peuple et les mandarins que Phetracha avait depuis longtemps accoutumés à voir ces sanglantes tragédies, osassent s'y opposer. Il est vrai que cette mort le rendit extrêmement odieux parce que tout le monde connut enfin que la seule envie de régner, déguisée sous le prétexte du bien public, lui avait fait prendre les armes et commettre tant de crimes. On l'appelait publiquement traître, on disait hardiment qu'il avait empoisonné le roi, et les talapoins mêmes, au désespoir d'avoir été les dupes de son ambition, publiaient déjà qu'il ne jouirait pas longtemps du fruit de tant de crimes. Le peuple, qui avait paru d'abord si animé contre M. Constance, commençait à le regretter et en faisait l'éloge, disant que Phetracha ne l'avait fait mourir que parce qu'il avait été trop fidèle au roi et aux princes, n'ayant pas voulu consentir que ce mandarin s'élevât sur le trône à leur préjudice. Nous vîmes des talapoins venir chez nous nous dire toutes ces choses et, au lieu qu'auparavant on nous jetait des pierres dans les rues et qu'on nous y chargeait d'injures lorsqu'on nous voyait porter à manger à la famille de M. Constance et aux chrétiens prisonniers parce qu'on nous regardait comme des gens qui nourrissaient des traîtres à l'État, on commença à louer la charité et la constance que nous avions, malgré tant d'avanies, à soulager ces pauvres malheureux qui, sans nous, seraient morts de faim et de misère.
Cependant, comme Phetracha était maître de la soldatesque et des Mores qu'il avait gagnés par ses largesses et qu'il n'y avait plus personne qui lui pût disputer la couronne, il se fit déclarer roi à Louvo et alla ensuite à Siam avec le corps du roi pour s'y faire reconnaître aussi. Le peuple fit d'abord mine de s'y opposer et prit les armes, mais, lorsqu'il vit paraître les balons armés de Phetracha, il les posa bientôt, et tout se réduisit à forcer le palais d'une princesse, sœur du roi, qui y fit quelque résistance. Mais elle fut prise et enfermée avec son autre sœur et la princesse fille du roi que Phetracha avait déjà en son pouvoir. Il voulut en ce temps-là épouser cette jeune princesse pour s'affermir davantage sur le trône par ce mariage, mais elle eut assez de fierté pour n'y vouloir pas consentir et pour lui reprocher qu'il avait mauvaise grâce de lui offrir une main trempée dans le sang de son père et de ses oncles (4). Elle était surtout inconsolable de la mort du plus jeune des princes qu'elle aimait tendrement et elle ne pouvait voir Phetracha qu'avec horreur, qu'elle en regardait comme le bourreau.
Les Français, cependant, se disposaient à sortir du royaume et M. de Métellopolis ménageait cette affaire. Phetracha souhaitait extrêmement s'en défaire par ce moyen, n'ayant pas pu s'en rendre le maître comme il l'avait espéré, car M. Desfarges s'étant tiré de ses mains, comme je l'ai déjà dit, ne voulut plus s'y remettre et aima mieux abandonner la vie de ses enfants à sa fureur que d'y exposer la sienne et celle des troupes du roi. Ainsi ses enfants, lui ayant mandé qu'on leur allait couper la tête s'il ne venait comme il l'avait promis, il leur répondit qu'ils devaient se disposer à mourir en braves gens parce qu'il ne pouvait pas exposer les troupes qu'on lui avait confiées pour leur sauver la vie, outre que les officiers n'étaient pas d'avis de sortir de la place et qu'il ne pouvait les y contraindre.
M. de Lionne et M. Véret ne furent pas aussi d'avis de se revenir remettre entre les mains de Phetracha et, ne se trouvant pas même assez en sûreté à Bangkok, ils prirent la résolution de s'en retirer secrètement sur un petit vaisseau de la Compagnie qui était à l'ancre devant la place (5). Mais les officiers en ayant eu le vent, M. de Vertesalle, lieutenant du roi de la place, alla de leur part représenter à M. Desfarges que ces deux messieurs ayant engagé par leurs conseils les Français dans le danger où ils se trouvaient, ils devaient au moins les aider à s'en tirer et qu'il n'était pas juste que, les ayant jetés dans un si fâcheux pas, il n'en courussent pas les risques aussi bien qu'eux. Qu'on ne devait pas surtout laisser partir le coffre d'argent qu'avait M. de Rosalie dans la place, puisque ce prélat s'était engagé de l'employer au paiement des troupes (en effet M. Desfarges, lui ayant représenté lorsqu'il le dissuadait de monter à Louvo, qu'il n'osait pas manquer à la parole qu'il avait donnée à M. Constance, parce que le fond que le roi avait donné pour le paiement des troupes étant fini, c'était lui qui fournissait maintenant l'argent et qu'on ne pouvait avoir recours à d'autres, M. Véret n'en ayant pas, M. de Rosalie lui répondit que cela ne devait pas le mettre en peine et qu'en cas de besoin, il offrait de prêter quarante mille livres pour cela). M. Desfarges trouva les raisons des officiers bonnes, et quoique ces messieurs lui dirent qu'ils ne songeaient point à sortir que pour aller chercher du secours pour la place, il ne jugea pas à propos de leur en accorder la permission, disant qu'il enverrait un officier pour cela, ce qu'il fit en effet, laissant partir M. de Saint Crit pour aller chercher les deux vaisseaux qui croisaient dans le golfe.
Ainsi, ces messieurs furent obligés de rester à Bangkok et d'y souffrir aussi bien que les autres la disette où on s'y trouva, parce qu'on n'avait pas eu soin de pourvoir la place d'aucune chose. M. de Rosalie, cependant, sauva son argent, n'ayant pas jugé à propos de le donner pour le paiement des troupes, comme il l'avait promis, ce qui fit fort murmurer les officiers et les soldats qui fatiguaient beaucoup et n'étaient pas payés. Mais il fut apparemment cause de ce que le séminaire fut pillé, car Phetracha, fort de ce qu'il ne voulait plus sortir de Bangkok et lui attribuant le manque de parole de M. Desfarges, envoya pour se venger prendre tout l'argent du séminaire. Il s'y trouva 24 000 livres en lingots d'argent, outre 6 000 livres qu'on avait pris à M. de Métellopolis en or et en argent monnayé. Nous y perdîmes deux beaux calices de vermeil et quelque argent que nous lui avions confié, croyant que Phetracha aurait plus de considération pour eux que pour nous. Ce mandarin aurait encore fait ressentir aux fils de M. Desfarges son ressentiment s'il avait osé, mais l'intrépidité de M. de Saint Cry, qui se brûla dans son vaisseau plutôt que de se rendre et fit périr lui seul plus de trois cents Siamois, lui fit appréhender le désespoir des Français (6), outre que plusieurs mandarins remuant fort pour sauver les princes qu'on prévoyait bien qu'il ferait mourir, il eut peur que ce parti ne se joignit aux Français.
Ainsi il fut le premier à rechercher l'amitié des Français. Il renvoya à M. Desfarges ses enfants et fit dire par Mun Pan et M. de Métellopolis d'aller à Bangkok traiter de paix avec M. Desfarges et que, s'il pouvait l'engager à sortir avec les troupes du royaume en bonne intelligence, on lui rendrait l'argent qu'on avait pris au séminaire et que Phetracha fournirait aux Français les vivres et les provisions dont ils auraient besoin. On entra ainsi à négociation. M. Desfarges accepta volontiers l'offre qu'on lui faisait parce que M. Véret lui proposait d'autres établissements qu'il croyait bien meilleurs. On convint de la plupart des choses et les Siamois donnèrent trois vaisseaux avec des vivres pour le transport des troupes. On crut cependant que l'arrivée de l'Oriflamme (7), qui, sur ces entrefaites, vint mouiller à l'embouchure de la rivière, allait rompre ce traité et que M. Desfarges, à qui il était venu un renfort considérable par ce vaisseau qui était de 64 pièces de canon, songerait non seulement à se maintenir dans une place qui lui avait été confiée, mais qu'il vengerait même les affronts qu'on lui avait fait et aux Français, dont un officier même était mort sous les coups. Mais il avait pris sa détermination et ceux aux conseils de qui il déférait entièrement, voulaient qu'il sortît.
Il était près de le faire lorsqu'un nouvel embarras retarda sa sortie de quelques jours. Ce fut l'arrivée de Mme Constance dans la place, le 4 septembre (8). Elle avait été conduite de Louvo à Siam après que Phetracha s'en fut rendu le maître et, comme différents partis qui s'y élevèrent successivement donnèrent les premiers jours beaucoup d'affaires au nouveau roi et à son fils, les prisonniers furent moins veillés qu'à Louvo et Mme Constance eut la liberté de voir ses parents et quelques-uns de ses amis. Ses gardes lui permettaient même de venir quelquefois à l'église des père portugais chez lesquels nous demeurions, mais il fallait qu'elle fût de retour à la prison avant six heures du matin car Sorasak, qui voulait lui faire souhaiter d'être sa femme, avait ordonné qu'on la fît travailler comme une servante afin de la dégoûter d'une vie si pénible. Mais elle se crut la plus heureuse du monde de se voir ainsi traitée, s'imaginant que ce mandarin avait changé en mépris l'inclination qu'il avait pour elle.
Elle partait de la prison dès les trois heures du matin pour être de retour pour le temps de son travail, car il y avait près d'une lieue de chemin qu'elle faisait dans un petit balon découvert, et, comme c'était le temps des pluies, elle était souvent obligée d'en essuyer de grosses, ce qui l'incommodait beaucoup. Elle tomba même dans une si furieuse syncope qu'on désespéra de sa vie pendant douze heures, mais le zèle qu'elle avait d'entendre la messe tant qu'elle pouvait en obtenir la permission fit qu'elle retourna deux jours après, quoiqu'elle fût encore dans une grande faiblesse.
Nous agissions pendant ce temps-là auprès de M. de Métellopolis et de M. le général pour obtenir d'eux qu'ils la demandassent à Phetracha et qu'ils la tirassent de la misère où elle était. Elle leur écrivit aussi elle-même les lettres du monde les plus touchantes là-dessus. M. Desfarges lui fit répondre qu'il ne sortirait pas sans l'emmener et M. de Métellopolis nous chargea de l'assurer de cela. Mme Constance, persuadée qu'il parlait sincèrement, refusa l'offre que lui fit un brave portugais, nommé Hyeronimo d'Abreo (9), de l'emmener hors du royaume dans une chaloupe armée qu'il avait sur la rivière. Elle ne voulait pas, pour la même raison, se rendre aux instances qui lui fit le chef de la loge hollandaise qui voulait la faire transporter à Batavia avec son fils dans un vaisseau qu'il avait tout prêt de faire voile, et j'avoue que je l'en dissuadai moi-même, ne trouvant pas la première de ces voies assez sûre et l'autre me paraissant peu honorable pour la France, parce que les Hollandais cherchaient en cela à se faire honneur au préjudice des Français, comme s'ils eussent abandonné cette dame, outre que, comme ils voulaient avoir ce prétexte pour faire rendre compte aux Siamois de tous les biens de M. Constance et en profiter, ils n'auraient jamais laissé sortir sa femme et son fils de Batavia et auraient élevé cet enfant dans leur religion.
Ce qui détermina encore Mme Constance à ne se confier qu'aux Français fut qu'un officier nommé M. de Sainte-Marie (10), qui vint en ce temps-là à Siam, ayant été la saluer, l'assura en ma présence qu'il avait entendu dire à M. Desfarges qu'il eût voulu, pour toutes choses, qu'elle eût été à Bangkok et qu'il n'en sortirait pas sans l'avoir. L'officier même lui offrit là-dessus ses services, lui disant qu'il s'estimerait trop heureux s'il pouvait, en l'emmenant à Bangkok au péril de sa vie, la tirer de l'état malheureux où elle était et faire un plaisir si sensible à M. Desfarges. Mais Mme Constance, qui ne voulait rien faire sans un ordre précis de ce général, le remercia de ses offres et elle attendait réponse du père Le Royer et du père Le Blanc qui étaient déjà descendus à Bangkok pour solliciter M. Desfarges afin qu'il la demandât au plus tôt, mais remettait toujours sous différents prétextes.
Cependant Phetracha, venu à bout de la plupart des difficultés qu'il avait trouvées à son établissement, donna à son fils le palais des princes pour s'y loger. Celui-ci songea d'abord à y renfermer Mme Constance. Pour faire cependant cela avec moins de bruit et accoutumer cette dame à y venir peu à peu sans qu'elle s'aperçût du piège et que ses parents fissent du bruit, il se servit d'une de ses tantes à qui il avait pour cela donné un appartement dans son palais. Elle alla trouver Mme Constance et, faisant semblant de s'étonner de la trouver dans un si pitoyable état, elle lui en fit des excuses, lui disant que cela se faisait à l'insu du prince, son neveu, qui avait été occupé ailleurs. Elle l'amena ensuite chez elle par une porte de derrière du palais, lui faisant toute sorte d'amitiés et de bons traitements et disant qu'elle voulait qu'elle demeurât toujours avec elle. Mme Constance ne savait pas où elle était. Alarmée cependant d'un si bon traitement et craignant quelque piège, elle pria cette dame de la laisser aller voir sa mère au camp des Portugais où elle était malade. Elle le lui permit, ne voulant pas lui donner sujet de se défier de rien.
Mme Constance me vint d'abord conter ses alarmes, qui étaient d'autant plus grandes que le lieu où on l'avait menée était le palais de Sorasak. Il fallut cependant y retourner, parce que la mandarine la renvoya chercher quelque temps après avec un grand cortège. Mais elle trouva moyen d'en sortir encore sous prétexte qu'elle ne pouvait rien manger de ce qu'on y apprêtait, n'étant pas accoutumée aux mets des Siamois, et elle obtint permission d'aller manger avec une de ses parentes qui ne demeurait pas loin de là jusqu'à ce qu'elle fût faite au manger du pays. Elle attendait cependant avec impatience des nouvelles de Bangkok, lorsqu'elle apprit par une de ses esclaves qui avait été donnée à la tante de Sorasak, qu'on lui avait préparé un appartement dans le sérail et que le lendemain on l'y ferait passer lorsqu'elle serait chez cette mandarine et qu'on dirait à ses parents que, se trouvant bien avec cette dame, elle n'en avait plus voulu sortir.
Cette nouvelle la mit dans une extrême consternation, prévoyant que, si une fois elle y était renfermée, il n'y aurait plus pour elle espérance d'en sortir ni même de faire savoir de ses nouvelles à personne, outre que Phetracha, qui seul pouvait empêcher cette violence de son fils, n'était plus accessible, car depuis qu'il avait été reconnu roi, il affectait, plus que n'auraient fait les autres, la majesté royale que les rois de Siam font consister à ne se montrer qu'une fois ou deux l'année et apparaître comme des dieux descendus du ciel, devant qui il faut que tout le peuple se prosterne la face contre terre. Mme Constance feignit d'être malade pour éviter le malheur dont elle était menacée. Elle se défit ainsi de ceux qui l'étaient venus chercher de la part de la princesse et envoya son oncle pour faire ses excuses et demander un jour seulement pour prendre quelques remèdes.
Sorasak et sa tante, ne se défiant de rien, remirent au lendemain à la faire transporter au palais. Cependant, sitôt qu'il fut nuit, elle me vint trouver et me raconta le danger où elle était et la résolution qu'elle avait prise de s'enfuir cette nuit-là à Bangkok, quelque danger qu'il y eût pour sa vie. J'admirai sa résolution et quoique je visse bien qu'il y avait beaucoup de risques à courir pour elle et pour nous, je ne crus pas cependant devoir l'en dissuader, sachant bien qu'elle ne pouvait pas rester sans être exposée à un péril évident de perdre son honneur et sa religion et, comme elle sut que M. de Sainte-Marie était à Siam où M. le général l'avait renvoyé pour achever de négocier quelques petites affaires, elle me pria de l'envoyer chercher afin de savoir de lui ce qu'il fallait faire pour éviter les corps de garde qui étaient sur la rivière, parce qu'il avait fait plusieurs fois le chemin.
Il se rendit aussitôt chez nous, de la faiturie française où il était et, ayant su le dessein de Mme Constance, il l'assura qu'il s'estimerait trop heureux de lui pouvoir rendre service en cette occasion ; qu'il se disposait à partir le lendemain, qu'il avait un passeport pour cela, mais qu'il était prêt de partir à l'heure même si elle le voulait. La résolution fut prise aussitôt et, comme ils n'avaient pas de balon, je leur en donnai un que je tenais prêt pour m'en aller à Bangkok, car tous les autres pères s'y étaient déjà rendus et j'étais resté seul par ordre du révérend père supérieur pour attendre que M. le général eût demandé Mme Constance, et ne pas l'abandonner dans le besoin où elle était. Il est vrai que le père de la Breuille y était aussi, mais on l'avait destiné à demeurer dans le royaume, lui-même l'ayant souhaité, parce qu'il était un de ceux qui avaient le plus d'avance pour la langue et qui étaient le plus aimé des chrétiens du pays. Je voulus lui persuader de s'en venir aussi à Bangkok, de crainte que la fuite de Mme Constance ne le fit maltraiter, parce qu'on pourrait se défier qu'il en aurait eu connaissance, mais il ne voulut jamais y consentir, s'estimant trop heureux de souffrir pour une si bonne cause.
Il nous aida à disposer toutes choses pour le départ de Mme Constance avec un zèle admirable, se faisant un véritable plaisir de contribuer à sauver cette pauvre dame, quelque chose qui lui en dût coûter. Toutes choses s'étant trouvées prêtes sur les dix heures du soir, elle partit avec son fils et une de ses esclaves qui s'était sauvée de chez Sorasak pour se joindre à elle. Je lui donnai, outre cela un de nos gens pour ramer et deux des esclaves de M. Constance qui s'étaient sauvés de même et s'étaient venus cacher chez nous pour s'en aller avec moi. Elle nous rendit avant de partir de l'argent que nous lui avions donné quelque temps auparavant, nous priant d'en faire des charités aux pauvres chrétiens et de recommander le succès de son voyage à Dieu. Elle conjura ensuite M. de Sainte-Marie que, supposé qu'ils fussent attaqués, il songea plus à lui conserver l'honneur que la vie et qu'il la tuât plutôt que de permettre qu'elle tombât vivante entre les mains des Siamois.
Je partis peu de temps après elle, sur le balon du père de la Breuille, ayant réglé avec lui quelques affaires, et je m'en allai en diligence pour arriver avant elle et disposer M. Desfarges à la bien recevoir. Je ne saurais taire ici la générosité d'un officier de la place nommé M. Danglas. On l'avait envoyé à Siam pour faite hâter le retour de M. de Sainte-Marie. Comme il avait entendu dire quelquefois à M. Desfarges qu'il souhaitait fort avoir Mme Constance et qu'il ne sortirait pas du royaume sans l'emmener, il crut lui faire un signalé plaisir et le surprendre agréablement s'il pouvait la lui amener sans qu'il y risquât son autorité à un refus. C'est pourquoi il apporta de l'argent avec lui dans le dessein d'avoir un balon et des rameurs pour emmener Mme Constance. Il me vint communiquer son dessein en arrivant. C'était le matin même du jour qu'elle partit mais, comme la chose ne paraissait pas encore presser si fort, je lui dis que cette dame était résolue d'attendre des ordres de M. Desfarges. Cependant, ayant vu que j'avais envoyé quérir le soir M. de Sainte-Marie, il se douta de quelque chose et on ne put pas lui cacher la fuite de Mme Constance, mais comme elle connaissait déjà M. de Sainte-Marie et qu'il avait un passeport, il fut obligé de lui céder la gloire de l'accompagner dans cette retraite. Il lui rendit cependant un bon service en demeurant à Siam un jour pour couvrir le départ de M. de Sainte-Marie et empêcher qu'on ne le soupçonnât d'avoir fait ce coup.
Notre voyage fut le plus heureux du monde car on n'arrêta ni l'un ni l'autre de nos balons, et j'arrivai à Bangkok deux heures avant eux, n'ayant été que onze heures en chemin. Nous nous adressâmes d'abord à M. de Métellopolis, le père supérieur et moi, pour avertir M. Desfarges de la venue de Mme Constance, parce que c'était par lui qu'il nous avait souvent fait dire d'assurer cette dame qu'il l'emmènerait avec lui et qu'il s'en faisait un grand plaisir. Mais nous fûmes un peu surpris de voir un homme fort étonné de cette nouvelle et qui fit difficulté de venir avec nous chez M. Desfarges, disant qu'il lui en parlerait en particulier. Cependant, comme la chose pressait, j'allai disposer les choses sur le port pour faire en sorte que Mme Constance descendît de son balon couvert sans que les Siamois qui travaillaient à charger les vaisseaux s'en aperçussent et cela s'exécuta fort heureusement. M. de Métellopolis alla cependant parler à M. Desfarges et le père supérieur y étant allé un moment après, il le traita d'une manière fort indignée, le chassant de sa maison. Je laisse à penser quel étonnement ce fut pour cette pauvre dame qui avait cru, en arrivant, trouver le dernier moment de ses peines et être reçue à bras ouverts de M. Desfarges qu'elle et son mari avaient comblé de biens, lui ayant fait pour plus de dix mille livres de présents dans l'espace de trois mois, de voir qu'il ne voulait pas la laisser entrer dans la place que M. Constance lui avait fait confier, et qu'il la laissait sur la rivière, dans un bâtiment où elle était en danger d'être enlevée par les Siamois. Et ce ne fut, en effet, qu'aux instances de M. de Vertesalle qu'il accorda qu'elle y entrât enfin, permettant à cet officier de la loger chez lui, qui par une honnêteté toute particulière lui céda tout son logis, demeurant pendant tout le temps qu'elle y fut au bivouac.
Comme le père Le Blanc était dans la place aussi bien que moi, il a été témoin des choses qui arrivèrent pendant qu'elle y fut et de tout ce qu'on fit pour l'en mettre dehors, ne pouvant la faire consentir à retourner d'elle-même à Siam, quelque instance qu'il lui en pût faire faire par M. de Métellopolis et MM. du séminaire, ni obliger ses officiers à consentir qu'on la remît aux Siamois malgré elle. Il la fit renfermer dans un des bastions du fort parce que, comme elle ne recevait pas de visite des officiers, elle avait écrit à M. de Vertesalle pour le prier de ne pas l'abandonner et de porter M. Desfarges à avoir compassion d'elle et de son fils. M. de Vertesalle lui ayant fait voir la lettre afin de le toucher davantage, il en fit un grand crime à cette dame, disant qu'elle excitait par-là la garnison à ne lui point obéir et, quoiqu'elle lui eût écrit aussi une lettre fort touchante et lui eût envoyé les deux lettres que le roi avait fait l'honneur à son mari de lui écrire pour lui faire voir que Sa Majesté avait la bonté de prendre toute sa famille sous sa protection, il l'envoya sur-le-champ tirer de la maison de M. de Vertesalle pour la mettre en prison dans le fort et la garder à vue comme une criminelle d'État, retenant les deux lettres du roi dont elle lui avait envoyé les originaux.
Une telle indignité outra tout le monde comme si il n'eût pas été permis à cette dame qu'on mettait au conseil de guerre de prier ceux qu'on lui donnait pour juges d'avoir pitié d'elle, pendant que M. de Métellopolis et ces messieurs sollicitaient fortement, par voix et par écrit, les officiers à la rendre. Mais on vit bien que ce n'était qu'un prétexte. Personne n'eut plus permission de la voir que MM. du séminaire. Ils l'obsédaient sans cesse, lui disant que c'était les jésuites qui lui mettaient en tête de vouloir sortir du royaume pour aller en France. Qu'elle ne devait pas suivre leurs conseils, qu'elle y serait mal reçue, qu'elle ferait bien mieux de s'en retourner à Siam où ils feraient en sorte qu'elle fût désormais mieux traitée ; qu'elle était même obligée en conscience de prendre ce parti pour ne pas attirer une persécution aux chrétiens ; qu'elle ne devait pas aussi s'attendre que la garnison de Bangkok voulût s'exposer à de nouveaux dangers pour la sauver et, qu'ainsi, il fallait qu'elle fît d'elle-même ce qu'on l'obligerait bientôt de faire de force (11).
Elle répondit toujours, avec une présence et une fermeté d'esprit admirable, que ce n'avait pas été par le conseil des jésuites qu'elle s'était venue réfugier à Bangkok, mais par un principe de conscience pour se tirer du danger où elle était de perdre son honneur et sa religion ; qu'ils savaient bien eux-mêmes tout ce qu'elle avait eu à souffrir pour conserver l'un et l'autre et qu'elle n'avait jamais cru qu'ils eussent dû la porter à s'exposer au même danger, connaissant comme ils faisaient sa faiblesse ; qu'au reste, elle ne songeait pas à aller en France ; qu'elle en avait déjà fait assurer M. Desfarges à qui elle avait demandé pour toute grâce qu'il l'exposât dans quelque île déserte qu'il voudrait, pourvu qu'il la tirât de Siam ; qu'elle s'étonnait que M. de Métellopolis lui promît de la protéger à Siam et d'empêcher qu'elle n'y fût plus désormais maltraitée, lui qui n'avait pu empêcher que son séminaire ne fût pillé et ses prêtres mis à la cangue dans un temps où ils se pouvait faire craindre par le crédit des Français sur lesquels il avait tant de pouvoir ; que les Siamois auraient bien moins d'égards pour lui lorsqu'ils les verraient hors de leur royaume ; qu'au reste elle ne voyait pas quels chrétiens pouvaient souffrir à son occasion ; qu'il n'y avait rien à craindre pour les Portugais qui s'étaient déclarés dès le commencement contre les Français et contre M. Constance, et qui, par là, s'étaient tirés d'affaire ; que le peu de chrétiens qu'il y avait du pays avaient été tous faits esclaves et rendus à différents mandarins ; qu'on ne pouvait leur faire plus de mal ; qu'ils ne devaient pas craindre aussi pour les gens de leur séminaire puisque M. Desfarges avait déclaré au second ambassadeur que c'était par l'avis des jésuites seulement qu'elle s'était venue jeter dans la place sans ses ordres ; qu'ainsi il n'y avait que le père de la Breuille qui fût exposé au ressentiment des Siamois et peut-être ses parents, mais qu'elle n'avait rien fait que de leur consentement et par leurs avis et qu'elle était persuadée qu'ils seraient fâchés qu'elle retournât ; qu'enfin elle avait de la peine à croire que les Français fussent en danger à son occasion, ayant maintenant des forces capables de donner plus de sujet aux Siamois de les craindre qu'ils n'en avaient d'appréhender ces barbares, et que le barcalon même avait témoigné que le roi consentirait volontiers qu'elle s'en allât avec les Français si M. le général lui en faisait quelque honnêteté ; mais qu'après tout, si on craignait qu'elle ne fût la cause d'une division fatale entre les deux nations, qu'elle priait au moins qu'on la fît plutôt mourir dans la place que de la livrer aux Siamois ; qu'il lui serait plus avantageux de finir ainsi sa vie que de se voir replongée dans tant de misères et qu'il serait moins honteux à M. Desfarges et à M. l'évêque de l'avoir fait mourir que de la voir prostituée aux emportements brutaux d'un barbare.
Nous sûmes tous ces entretiens par le soin qu'elle eut d'en faire des extraits qu'elle trouva moyen de me faire tenir lorsqu'on la tira du fort pour la livrer aux Siamois. Nous apprîmes aussi tout ce qu'elle y eut à souffrir dans l'abandon où elle s'y trouva, manquant même d'eau pour boire. Il y aura peu de gens qui ne soient pas surpris d'un semblable procédé et il faut avouer qu'il fait peu d'honneur à la nation. Il ne serait peut-être pas difficile de faire voir les motifs secrets qu'eurent M. Desfarges, M. Véret et messieurs du Séminaire de rendre Mme Constance, mais il n'est pas permis de pénétrer dans les intentions dont Dieu seul s'est réservé la connaissance. Je dirai seulement qu'on fut bien surpris lorsqu'on sut que Mgr de Métellopolis et M. Véret, qui avaient fait rendre Mme Constance, songeaient eux-mêmes à se retirer du royaume malgré la parole qu'ils avaient donnée aux Siamois, car ces messieurs avaient représenté aux officiers, avec beaucoup de force que, si on emmenait Mme Constance, les chrétiens demeuraient exposés au ressentiment des Siamois et en seraient cruellement persécutés ; que ces barbares ruineraient la faiturie française, ce qui serait une grande perte pour la Compagnie des Indes et qu'eux-mêmes, qui, pour faire plaisir aux Français et leur obtenir des vaisseaux pour s'en aller, avaient bien voulu se faire garants aux Siamois et demeurer pour otages entre leurs mains jusqu'au retour de ces bâtiments, allaient être exposés aux plus rudes traitements.
Ces raisons mêmes avaient paru assez fortes à quelques-uns qui ne savaient pas que ce n'était que des prétextes et qu'on faisait parler les Siamois comme on voulait. Mais enfin tout le monde fut convaincu que ce n'était qu'une pure mômerie lorsqu'on vit que M. Véret, sans se mettre en peine du pillage de sa faiturie et M. de Métellopolis, sans s'embarrasser de la persécution des chrétiens, songeaient à sortir du royaume et à tromper les Siamois à qui leur sortie devait être plus sensible que celle de Mme Constance. En effet, M. Véret s'étant jeté sur les vaisseaux pendant qu'ils sortaient de la rivière, le barcalon fut outré de cette mauvaise foi et, comme M. Véret s'était trop hâté, ce qui avait empêché M. de Métellopolis de se sauver aussi, comme il l'avait résolu, ce prélat fut arrêté aussitôt et gardé étroitement (12). On prit aussitôt le canon, les bagages et une partie des vivres de nos troupes, et le barcalon menaça de faire les plus rudes traitements aux Français qu'il avait entre ses mains si on ne rendait M. Véret qui s'était offert de lui-même de rester pour garant du retour des vaisseaux. Mais M. Desfarges, qui avait paru si touché du danger chimérique où la sortie de Mme Constance aurait pu mettre les chrétiens, ne le fut nullement de celui où la fuite de M. Véret jetait indubitablement tous les Français chrétiens qui restaient entre les mains du barcalon et, quelques remontrances et quelques prières que lui fit le pauvre M. de Métellopolis qui voyait bien qu'il allait être la victime de la fuite de M. Véret, il ne put se résoudre à renvoyer ce commis dans sa loge où il ne courait aucun danger, lui qui venait de livrer une dame chrétienne à ses plus cruels persécuteurs sous prétexte d'épargner, à ce qu'il disait, une persécution aux chrétiens.
Il faut avouer qu'il agit bien peu conséquemment et que M. de Métellopolis eut bien sujet d'admirer la Providence divine et de se repentir de toutes les démarches qu'on lui avait fait faire, car je suis persuadé que ce prélat, qui d'ailleurs est homme de bien, agissait plus par les mouvements des autres que par les siens dans tout ce qu'il fit contre M. Constance et qu'il ne songeait à sortir de Siam que par complaisance pour M. Desfarges qui avait ses vues en l'emmenant. Au moins il le dit au père Bouchet et au père Le Royer lorsqu'il leur découvrit son dessein, qu'il aurait, à ce que je crois, tenu plus secret qu'il eut prévu qu'il eût dû si mal réussir. Il paya bien cher, aussi bien que tous les autres Français, la sortie de M. Véret. Ils furent tous mis à la cangue et à la chaîne, travaillant comme des esclaves aux ouvrages publics. Le pauvre père de la Breuille n'en fut pas exempt, quoiqu'il n'eût pas trempé dans cette affaire ; il a souffert plus d'un an durant ce rude traitement avec les autres et on ne lui a jamais reproché l'évasion de Mme Constance, mais on lui a fait un crime de celle de M. Véret.
Fin du Mémoire du père de Bèze.

NOTES
1 - Le naï (นาย). Le mot désigne un maître, un patron, un supérieur hierarchique. ⇑
2 - Il existe en Thaïlande, encore aujourd'hui, un langage particulier pour s'adresser au roi ou aux membres de la famille royale, le rachasap (ราชาศัพท์), largement composé de mots palis ou sanscrits. ⇑
3 - Phaulkon fut exécuté le 5 juillet, les frères du roi le 9, et le roi mourut le 10. ⇑
4 - Une très curieuse relation anonyme publiée à Londres en 1690 et intitulée A Full and True Relation of the Great and Wonderful Revolution that hapned lately in the Kingdom of Siam in the East-Indies affirme que la princesse Yothathep, fille unique du roi, fut également exécutée avec ses oncles et de la même manière, enfermée dans un sac de velours rouge et frappée avec de grosses bûches de bois d'aigle, afin que le corps royal ne soit pas pollué par le contact de mains vulgaires. Elle aurait ensuite été jetée dans le fleuve. D'autres sources indiquent qu'elle épousa Phetracha. Le père d'Orléans écrit : Le mariage que cet usurpateur [Phetracha] contracta, si nous en croyons quelques lettres, avec la princesse reine unique héritière du feu roi, l'affermit encore sur le trône ; et personne ne se trouvant en état de lui disputer, il en demeura possesseur paisible. (Histoire de M. Constance, p. 124). ⇑
5 - S'il faut en croire Vollant des Verquains (Histoire de la révolution de Siam, 1691, p. 87 et suiv.) Véret avait soumis à Desfarges un plan pour le moins hasardeux. Il proposait de s'embarquer avec l'abbé de Lionne et un autre missionnaire, se servant pour cet effet d'un petit bâtiment qui, faisant voile à l'île de Bornéo et ayant été obligé de relâcher, était venu mouiller au pied de Bangkok deux jours avant la déclaration de la guerre. Il lui promettait merveille de la faveur des princes voisins, qui devaient lui accorder à sa prière un secours considérable d'hommes et de vivres. Mais il ajoutait aussi que, connaissant l'humeur des Indiens extrêmement intéressée, il était à propos qu'il emportât avec lui l'argent comptant des missionnaires et du comptoir qu'ils avaient sauvé dans la place, afin qu'il ne tînt point à cela qu'il obtînt d'eux promptement les secours qu'il allait demander. La question était évidemment de savoir si Véret serait revenu une fois en possession de la caisse. Le plan ne fut pas abandonné, mais on en écarta Véret – qui fit néanmoins semblant qu'il était bien content de ne point s'exposer à être pris ou brûlé par les Siamois – et on confia à l'officier Saint-Cry la mission d'aller ramasser quelques provisions et donner avis de la révolution sur la côte de Coromandel. Il s'embarqua dans le petit bâtiment, armé de sept hommes de la milice et quinze d'équipage. ⇑
6 - Saint-Crit, Saint-Cric, Saint-Cricq, Saint-Cry, on trouve de nombreuses épellations de ce nom. l'héroïque de cet officier a été amplement rapportée et commentée dans les diverses relations. Le père d'Orléans la relate ainsi (Histoire de M. Constance, 1690, p. 135 et suiv.) : Un capitaine nommé Saint-Cry défendait la rivière avec une petite barque dont tout l’équipage, composé d’Indiens, était ivre, et dormait sur le pont. Il n’avait que deux personnes en état de combattre s’il était attaqué, comme il le fut en effet. Car les Siamois, s’étant aperçus du désordre de ses matelots, vinrent sur lui, et après avoir balancé quelque temps, se mirent en devoir de venir à l’abordage. Leur contenance fit peur à un de ceux qui devait défendre la barque. Il se déroba, se mit à la nage, et alla parler aux ennemis qui le prirent et le mirent aux fers, et qui ensuite, profitant de la terreur où ils s’imaginaient que cette aventure avait jeté Saint-Cry, montèrent en foule dans la barque. Dès que Saint-Cry s’était aperçu de leur dessein, voyant bien qu’il ne résisterait pas et ne voulant pas tomber entre les mains des barbares, il avait disposé sur son pont avec son soldat, nommé Lapierre, aussi déterminé que lui, une partie de ses poudres, ses grenades, et ses mousquets chargés ; et ayant laissé monter dans sa barque un grand nombre de ces infidèles, de la porte de sa chambre il mit le feu aux poudres, qui les firent tous sauter en l’air ou tués, ou blessés, ou fort étourdis. Ni lui ni son soldat n’eurent point de mal, mais la barque souffrit beaucoup et, ne pouvant plus être gouvernée, elle erra quelque temps et échoua. Les Siamois croyant alors que toutes les poudres étaient usées revinrent sans crainte, et montèrent en plus grande foule qu’auparavant. Ils croyaient être en sûreté et pouvoir piller à leur aise, lorsque Saint-Cry, mettant le feu à des barils qu’il avait réservés, fit jouer une seconde fougadeOu fougasse. Espèce de mine qui n’est qu’un petit fourneau en forme de puits, large de deux à trois mètres et profond de trois à quatre, qu’on charge de barils de poudre ou de sacs à poudre, et qu’on fait jouer par le moyen d’une saucisse. La fougasse à bombes consiste dans la réunion de plusieurs bombes enterrées qui éclatent à la fois. (Littré). qui fit périr plusieurs des ennemis ; mais il y périt lui-même, n’ayant pu à temps se jeter à l’eau. Son soldat le fit et aborda le sabre à la main sur le rivage, où accablé par la multitude de ces barbares qui fondirent sur lui, après en avoir tué cinq, il tomba parmi eux percé de coups. ⇑
7 - Le vaisseau du roi l'Oriflamme, commandé par M. de l'Estrille, était parti de France le 19 janvier 1688 et amenait au Siam un renfort de 200 hommes, dont beaucoup avaient péri pendant la traversée. Évoquant l'état piteux où se trouvaient ces nouvelles troupes, Beauchamp écrivit : Ce M. de l'Estrille est arrivé le 20 de septembre en la rade de Siam avec le navire l'Oriflamme et quatre-vingts méchants soldats. Je suis sûr qu'ils ne valaient pas dix bons hommes (A.N. Col. C1/25 f° 79v°). François Martin, confirmant la manière habituelle par laquelle on recrutait alors les troupes et les équipages - quelques chopines d’eau-de-vie, de vagues promesses de gloire et de fortune et une croix tracée au bas d’un engagement que nul ne savait lire - évoque également cette « canaille » : c’était des misérables qu’on avait pris gueusant aux ports de France et qui avaient été embarqués de force sur le navire l’Oriflamme et à qui l’on n’avait pu faire perdre dans les exercices où l’on avait tâché de les dresser la contenance de ce qu’ils avaient été (Mémoires de François Martin, 1934 III, p. 343). Le navire avait fait escale à Batavia, mais les Hollandais, parfaitement informés de ce qui se passait au Siam, n'en avaient pas averti les Français qui ignoraient tout de la situation politique dans le royaume, et qui faillirent tomber dans un piège. ⇑
8 - Cette date est manifestement erronée. La plupart des relations indiquent que Mme Constance arriva à Bangkok le 4 octobre. ⇑
9 - On trouve mention d'un Jean d'Abreo, capitaine de navire, probablement le même, dans le Journal de Siam de l'abbé de Choisy du 8 novembre 1685 : Aujourd’hui s’est fait le mariage d’un Français subalterne de la Compagnie avec la fille d’un Portugais capitaine de navire. Le Français se nomme M. Coche et le Portugais Jean d’Abreo, grand ami des missionnaires qu’il a transportés plusieurs fois au Tonkin et à la Cochinchine. ⇑
10 - Sainte-Marie était un nom de guerre. L'officier se nommait en réalité Delars, ou de Larre. ⇑
11 - L'affaire fut sans doute suffisamment choquante pour contraindre l'abbé de Lionne à rédiger quelques années plus tard une longue et maladroite justification qu'on pourra lire sur ce site : Mémoire sur l'affaire de Mme Constance Phaulkon. ⇑
12 - Le traité de capitulation prévoyait que trois otages resteraient au Siam en garantie des deux frégates prêtées aux Français pour embarquer les troupes. Étaient désignés l'évêque de Métellopolis, Louis Laneau, Véret, le chef du comptoir de la Compagnie, et le chevalier Desfarges, fils cadet du général. Dans la confusion du départ, Véret et le fils Desfarges s'embarquèrent subrepticement à bord de l'Oriflamme, ce qui provoqua la fureur des Siamois, qui passèrent leur colère sur le malheureux Louis Laneau. ⇑

12 mars 2019
