
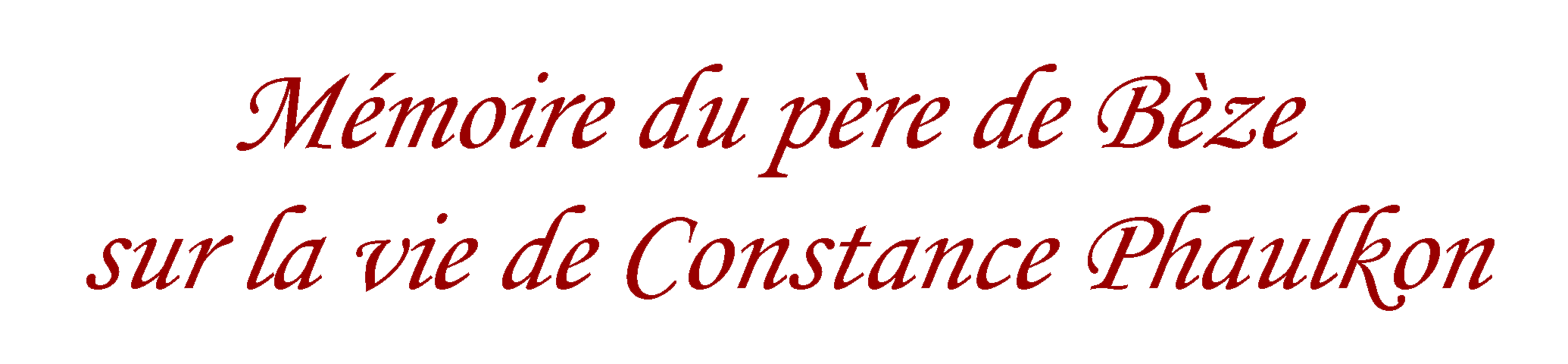
Cinquième partie.
Mais Phetracha ne demeurait pas en repos car, quoique d'abord il n'eut pas eu de défiance de la marche du commandant des Français, croyant avoir mis M. Constance dans son parti, comme la chose cependant ne fut plus si secrète, M. Desfarges s'en étant ouvert à plusieurs personnes, il en eut quelque connaissance. C'est ce qui l'obligea à agir plus fortement pour se faire un parti et à se tenir plus sur ses gardes, de sorte que lorsque M. de Beauchamp fut revenu, il n'était plus temps d'appeler les Anglais parce que Phetracha, ne pouvant plus douter qu'ils ne vinssent pour l'arrêter, aurait prévenu leur arrivée par quelque coup hardi ou se serait retiré dans les provinces où il avait déjà des partis considérables, outre qu'il était à craindre que ses partisans ne se saisissent pendant ce temps-là des vaisseaux, ce qui aurait été d'une fâcheuse conséquence.
Il ne restait donc plus d'autre moyen de prévenir toutes les funestes entreprises de Phetracha que d'en avertir le roi et de prendre avec lui les plus justes mesures qu'on pourrait pour le faire arrêter par quelques Européens qui se trouvaient à Louvo, car le dessein qu'avait eu M. Constance de porter Sa Majesté à nommer un de ses frère pour successeur de la couronne, ce qui aurait ruiné tout le parti de Phetracha, n'avait pas réussi. On avait tellement prévenu ce prince de leur ressentiment et du dessein qu'ils avaient de maltraiter son corps après sa mort qu'il ne put se résoudre à leur mettre le pouvoir entre les mains. Tout ce que put obtenir M. Constance de lui fut qu'il laisserait, par son testament, la couronne à sa fille à condition qu'elle ne pût rien faire que par l'avis d'Oya Vitchayen, de Phra Pi et d'Okphra Phetracha, jusqu'à ce qu'elle eût fait rendre à son corps les derniers devoirs, après quoi il lui permettait de faire part de la couronne auquel elle voudrait des princes, mais cette déclaration du roi ne servait qu'à autoriser encore Phetracha à l'aider à exécuter plus tôt son dessein si on ne le faisait connaître au roi.
Mais le malheur voulut que, dans le temps que M. Constance se disposait à cela, ayant pris quelques mesures auparavant qu'il crut nécessaires avec des mandarins du palais fort affectionnés au roi et au prince, il fut prévenu par Phra Pi. Ce jeune mandarin eut une contestation avec Phetracha pour un poste qu'il avait obtenu du roi et où l'autre voulait maintenir des officiers qu'il y avait fait placer. Il s'aperçut, mais un peu tard, que cet Okphra songeait plus à se faire roi lui-même qu'à l'élever sur le trône, comme il lui avait promis, et qu'il ne s'était servi de l'autorité qu'il lui avait donnée sur ses gens que pour les détacher de leur maître et s'en servir à former son parti.
Outré de cela et de quelques paroles un peu dures que lui dit Phetracha, il alla au roi lui déclarer la conspiration de ce mandarin et tout ce qu'il tramait pour se rendre maître du gouvernement. Le roi ne fut pas maître, à cette nouvelle, de son ressentiment et ayant envoyé chercher sur-le-champ M. Constance, après lui avoir témoigné quelque mécontentement de ce qu'il avait appris par un autre que par lui que Phetracha était l'auteur de tous les mouvements, il dit qu'il voulait le faire arrêter à l'heure même et l'en punir comme il le méritait. M. Constance rendit compte au roi de sa conduite et lui dit que l'inconvénient qu'il avait voulu éviter en différant d'avertir Sa Majesté de ce qui se passait était malheureusement arrivé par la précipitation de Phra Pi et le bruit qu'avait fait Sa Majesté ; que Phetracha, qui en serait sans doute bientôt averti, prendrait ses mesures pour éviter le châtiment dont il était menacé et qu'il ne serait pas aisé de se saisir de lui. C'est pourquoi il conseilla à Sa Majesté de modérer son ressentiment et de l'engager à venir le lendemain au palais où il se trouverait avec la garde anglaise qui était de quinze hommes et quelques autres Européens pour l'arrêter.
Les mesures furent prises pour cela le mieux qu'il fut possible, mais le mandarin, qui n'espérait rien de la clémence du roi après ce qu'il avait fait, chercha à se mettre à couvert de son ressentiment et, étant allé trouver le sancratSangkha rat (สังฆราช), chef de la communauté religieuse. de Louvo et ses plus secrets amis, ils prirent le parti d'en venir à la force ouverte, et comme ils n'avaient pas assez de monde pour cela, le sancrat et les talapoins s'engagèrent à faire soulever le peuple en sa faveur.
Le lendemain, en effet, le sancrat et les talapoins, ayant assemblé le peuple, ils lui dirent qu'il s'agissait de prendre les armes pour le service du roi et de l'État ; que Sa Majesté étant indisposée, elle avait donné l'administration des affaires à Phetracha, l'ôtant à Oya Vitchayen parce qu'elle avait reconnu qu'il trahissait l'État pour le livrer aux étrangers ; que ce traitre, voulant se soutenir malgré le roi dans l'autorité dont il avait tant abusé, Phetracha était obligé de prendre les armes par ordre de Sa Majesté pour le réduire à la raison ; qu'ils le devaient suivre au palais s'ils voulaient être fidèles sujets du roi. Le peuple, animé par les discours des talapoins pour lesquels ils ont beaucoup de respect, s'arme aussitôt de ce qu'il peut et suit le sancrat et quelques talapoins qui marchèrent à leur tête, portés sur les épaules des séditieux jusqu'au palais où Phetracha s'était déjà rendu. Ils y entrèrent sans peine par les intelligences qu'ils y avaient.
On avertit aussitôt M. Constance que le peuple courait en foule au palais. Je me trouvai pour lors chez lui et, comme je savais qu'il devait tout craindre de Phetracha, je fis ce que je pus pour l'empêcher d'y aller, craignant que l'autre n'y fût le plus fort. Mais je le trouvai toujours résolu de mourir plutôt que d'abandonner le roi dans cette occasion, et mes instances furent aussi inutiles que celles que je lui avais faites le matin dans un assez long entretien que nous eûmes ensemble et que j'ai rapporté ailleurs. Pour se défaire de moi, il me pria d'aller avec nos pères prier Dieu dans la chapelle pour la conservation du roi dont la vie était en danger, et sitôt que je fus sorti, il alla prendre congé de Mme Constance comme s'il n'eût dû jamais la revoir, et prenant avec lui M. de Beauchamp et deux autres officiers français, son capitaine et la garde anglaise, qui était de quinze hommes, avec quelques Portugais, tous bien armés, il courut au palais pour y secourir le roi. Mais la trop grande précipitation avec laquelle il s'y jeta par une petite porte qu'il trouva ouverte, sans assez considérer si on le suivait, fut cause qu'il se trouva renfermé avec les trois officiers français seulement, tous les autres ayant été arrêtés à la porte et celui même qui portait ses armes à la manière du pays où jamais les grands ne les portent, non pas même leur épée, mais la font porter par un esclave.
Phetracha, le voyant sans armes, vint d'abord à lui avec un visage riant, environné de gens armés. Si les Français, qui avaient leurs armes, s'en étaient servis en cette occasion, ils auraient pu, par la mort de ce seul mandarin, terminer toute cette affaire. Mais on n'a pas toujours la présence d'esprit dans ces coups imprévus pour voir ce qu'il y aurait à faire et pour profiter des moments que l'on ne retrouve plus après. Ils rendirent leurs armes qu'on leur demanda et furent aussitôt séparés de M. Constance (1). Comme, cependant, ses gardes restaient à la porte bien armés, Phetracha, qui eut peur qu'ils n'entreprissent de sauver leur maître s'ils savaient qu'il fût en danger, le fit monter sur un des bastions du palais et là, se promenant et lui parlant avec un visage riant, il se fit voir en cet état aux Européens qui étaient dehors. Mum Pan, dont j'ai déjà parlé, qui était le premier des ambassadeurs qui furent envoyés en France, vint ensuite dire au capitaine des gardes anglais que M. Constance lui mandait d'aller faire garde à la porte de son logis afin qu'il n'arrivât rien à Mme Constance pendant qu'il serait aux palais où il demeurerait deux ou trois jours pour régler quelques affaires. Cet Anglais, qui craignait pour sa femme dans cette émotion populaire et plus encore pour un coffre-fort qu'il avait rempli au service de M. Constance, ne fut pas fâché d'avoir cet ordre pour pourvoir à ses affaires et, sans examiner s'il était bien fondé, il s'en revint avec les autres Européens. Il lui vint le lendemain un autre ordre de M. Constance de sortir de Louvo et d'aller avec ses gens à Thépousson (2), qui en est à une lieue. Il dit qu'il obéirait si on lui permettait de porter son coffre avec lui, ce qui lui ayant été accordé, il se retira avec tous les Anglais et s'en alla à Thlépousson. On y mena aussi les trois officiers français qui avaient accompagné M. Constance au palais. Les autres Européens se retirèrent chez nous et les Siamois commencèrent à courir par les rues, les armes à la main, pillant d'abord les maisons de Phra Pi et de ses parents.
Nous fûmes bientôt avertis de ce qui se passait au palais. Le roi, qui fut arrêté lui-même, prisonnier dans son appartement où on lui donna des gardes, nous fit savoir par un valet de chambre fidèle qu'on lui avait laissé, l'état déplorable où il se trouvait par l'ingratitude d'un traître qu'il avait comblé de tant de grâces, et qu'il avait le même sort que l'empereur du Japon et le malheur de se voir comme lui détrôné par le fils de sa nourrice (3). Nous sûmes aussi que M. Constance était arrêté et on l'aurait chargé de chaînes si Mme Constance n'avait donné une grosse somme d'argent à celui qui était chargé de le garder pour l'en faire délivrer.
Il envoya chercher chez lui son livre de méditations et ses heures et me fit dire par Omun Si Munchiay (4), si je voudrais bien aller auprès de lui pour le confesser et le disposer à la mort, qu'il en ferait demander la permission à Phetracha et qu'il croyait qu'il ne la lui refuserait pas. Je lui fis répondre que je me ferais un plaisir extrême de lui pouvoir rendre ce service et que j'en solliciterais aussi la permission car, quoique quelques-uns de mes amis m'en dissuadassent, me disant que Phetracha me ferait indubitablement mourir avec M. Constance de peur que je n'allasse publier à son préjudice les secrets qu'il m'aurait confié, je n'avais nulle peine à exposer ma vie pour rendre ce devoir de charité chrétienne à un homme que j'avais tant de sujets d'aimer. Mais toutes ses prières et les miennes furent inutiles et je ne pus avoir la consolation de le voir un seul moment avant sa mort.
La première victime que Phetracha immola à sa fureur fut le pauvre Phra Pi. Ce mandarin, se voyant abandonné de tous ses gens (dont une partie, gagnée par Phetracha, s'était donnée à lui, l'autre avait pris la fuite avec son père), s'était réfugié dans la chambre du roi où il s'était caché ; mais ayant été obligé d'en sortir la nuit pour quelques nécessités, les gardes qui étaient à la porte le saisirent et, le lendemain matin Phetracha lui fit couper la tête, quelques prières et quelques instances que lui fit faire le roi pour obtenir la vie de ce fils adoptif qu'il aimait si tendrement. On a dit depuis que sa tête fut pendue au col de M. Constance, mais je n'en ai jamais entendu parler sur les lieux. Cela cependant pourrait être vrai, car comme Phetracha avait accusé ce ministre de vouloir élever ce jeune mandarin sur le trône au préjudice des frères du roi, il aura pu ordonner cela pour confirmer davantage le peuple dans cette opinion, car lorsque deux personnes sont complices du même crime, c'est la coutume à Siam de pendre la tête de celui qui a été le premier exécuté comme le plus coupable, au col de l'autre et, s'il a été pendu ou tué d'une autre manière, on attache le corps mort au vivant, visage contre visage et on les laisse quelque temps en cet état.
Phetracha eût bien voulu se défaire de M. Constance comme il s'était défait de Phra Pi, mais il craignait le ressentiment des Français et il voulait s'assurer d'eux auparavant. Comme il avait vu le crédit que MM. les évêques et M. Véret avaient auprès de M. Desfarges, par la démarche qu'ils lui avaient fait faire en le faisant retourner à Bangkok, il les avait fort ménagés depuis et leur avait fait faire de grandes promesses. Il s'était pour cela servi de Mun Pan, que M. Constance avait envoyé à M. Véret, pour visiter avec lui tous les vaisseaux chinois, ce commis s'étant plaint qu'on y chargeait du poivre contre le privilège accordé à la Compagnie française qui le devait tout avoir.
Comme M. Véret, qui était depuis longtemps fort animé contre M. Constance, ne put s'empêcher d'en faire de grandes plaintes au Siamois et de l'assurer que tous les Français entraient dans son ressentiment, celui-ci, qui était secrètement engagé dans le parti de Phetracha, quoiqu'à l'extérieur il parut fort attaché à M. Constance, lui dit en confidence que Phetracha allait entrer dans le ministère par ordre du roi et que les Français s'en trouveraient beaucoup mieux ; qu'il aurait bien plus d'égards pour eux que n'en avait ce Grec et que, pour lui en particulier et MM. du séminaire, ils devaient en attendre toutes sortes de bons traitements et de confiance.
Nous avons su de l'ambassadeur même les plaintes que lui fit M. Véret de M. Constance, et ce commis ne garda plus depuis ce temps-là beaucoup de mesures avec lui et lui écrivit des lettres peu respectueuses et eut même la hardiesse, sans savoir ce qui se passait à Louvo, d'écrire au fils de M. Desfarges qui, par ordre de son père, était resté auprès de ce ministre, de ne plus suivre ses ordres et d'obéir désormais à Phetracha à qui le roi avait confié l'administration des affaires. Aussi ce traître ne se fut pas plus tôt révolté qu'il lui écrivit pour l'assurer de son amitié et de la disposition où il était de lui faire plaisir. Il écrivit encore de plus amples lettres à MM. les évêques, leur mandant qu'il souhaitait leur faire part de son autorité et qu'il les priait pour cela de venir à Louvo afin de l'aider par leurs lumières dans l'administration des affaires. Son dessein était de se rendre maître des Français, comme il le fit assez voir par la suite, mais le malheur voulut qu'ils n'en fussent pas persuadés ; que, quelques choses qu'on leur ait pu dire, ils n'aient pu se convaincre que ce mandarin les trompait ; que, lorsque, n'ayant plus besoin de leurs services, il les a plus maltraités que les autres. Il est vrai que M. de Métellopolis ne s'y fiait tout à fait tant et qu'il ne voulut pas même d'abord venir à Louvo sur les premières instances qu'on lui en fit. Il se contenta d'y laisser monter M. de Lionne, qui avait moins de répugnance d'y aller.
Ce prélat y arriva deux jours après la révolte de Phetracha. Nous crûmes qu'il était à propos de le prévenir avant qu'il eût audience et nous allâmes le trouver pour cela. Je lui racontai tout ce qui s'était passé à Louvo. M. Paumard (5) lui confirma l'emprisonnement du roi et la rébellion de Phetracha, en ayant été averti de la part du roi même que personne ne pouvait plus voir. Un témoignage aussi désintéressé que celui de M. Paumard ne put pas encore le désabuser des impressions avantageuses qu'il avait prises pour Phetracha et il crut, ou que nous étions si durs ou que l'envie de sauver M. Constance nous faisait déguiser la vérité. Je passe plusieurs choses qui furent dites dans cet entretien et qu'on peut voir ailleurs. Il vit le grand mandarin, car c'est ainsi que nos Français l'appelaient par honneur depuis qu'il avait détrôné le roi, qui le reçut assez bien, à ce qu'il nous dit, mais qui lui déclara d'une manière bien fière que le roi souhaitait que M. Desfarges vînt à Louvo ; que, comme il avait beaucoup d'autorité sur son esprit, il fallait qu'il allât à Bangkok pour lui persuader d'obéir incessamment aux ordres de Sa Majesté.
M. de Lionne ne s'attendait pas à être chargé de cette commission ; cependant, comme il n'était pas encore convaincu de la trahison et de la mauvaise foi de Phetracha, il paraissait assez disposé à porter M. le général à obéir aux ordres de ce mandarin. Comme nous étions persuadés que M. Desfarges ne pouvait pas faire cette démarche sans abandonner les chrétiens à la fureur de Phetracha qui ne les épargnait à Louvo que parce que les Français étaient maîtres de Bangkok, nous crûmes devoir le représenter à M. de Lionne et le conjurer de ne point engager M. Desfarges à venir se mettre entre les mains de ce traître sans s'être bien assuré de ses intentions ; que le roi nous avait fait dire que ce mandarin n'en avait point d'autre que de faire égorger tous les Français s'il pouvait s'en rendre maître et qu'il sacrifierait ensuite tous les chrétiens à la haine des talapoins ; que ce n'était pas une affaire de si petite conséquence qu'elle ne méritât bien qu'il s'informât mieux qu'il ne l'était de l'état des choses ; que, s'il ne voulait pas nous en croire ni M. Paumard, qu'il demandât à voir le roi et à savoir de lui sa volonté.
M. de Lionne nous répondit qu'il ne voulait pas choquer le grand mandarin par une démarche semblable qui ferait voir qu'il se défiait de lui, mais que, si nous croyions qu'il ne fût pas à propos que M. Desfarges vînt à Louvo, nous lui écrivissions notre sentiment et nos raisons ; qu'il s'offrait de lui porter nos lettres. Nous écrivîmes en effet, le R.P. supérieur et moi, et j'allai lui porter nos lettres comme il était prêt de partir. Je lui dis que, s'il avait de la peine à s'en charger, je les donnerais à M. de Beauchamp qui s'en allait avec lui. Il me dit qu'il n'en avait aucune et, qu'étant envoyé de la part du grand mandarin, il ne craignait pas qu'on le fouillât. Cependant il changea bientôt après de sentiment car, sitôt qu'il fut sorti de Louvo, il déchira nos lettres, à ce qu'il nous dit depuis, craignant qu'elles ne lui fissent de la peine si elles venaient à être surprises. Il se rendit bientôt à Bangkok où Mun Pan l'accompagna avec ordre de faire toutes sortes de promesses à M. Desfarges pour l'engager à venir (6).
C'était un coup de conséquence pour Phetracha, car quoiqu'il se fût rendu maître de Louvo, les autres villes ne s'étaient pas encore déclarées pour lui. La capitale avait refusé de recevoir les ordres qu'il y avait envoyés de la part du roi qu'il feignait toujours être malade et ne pouvoir agir, et toute la ville se disposait à élever sur le trône, en cas que Sa Majesté vint à mourir, son frère aîné qui, ne pouvant se fier aux promesses de Phetracha, n'avait jamais voulu monter à Louvo. Tout le monde cependant, était attentif sur les Français pour voir le parti qu'ils prendraient en cette occasion car, comme on les estimait fort pour leur bravoure et que d'ailleurs ils étaient maîtres de la rivière, ils auraient pu fort ébranler le parti de Phetracha s'ils s'étaient déclarés contre lui et auraient encouragés tous les bons serviteurs du roi.
Les Anglais, qui avaient trois bons vaisseaux sur la rivière (car outre les deux dont j'ai parlé, il y en avait un marchand de 44 pièces) étaient près de se joindre aux Français pour agir contre Phetracha et il y avait outre cela deux autres vaisseaux du roi de Siam que M. Constance avait fait monter par des Français un mois auparavant afin qu'ils puissent servir en cas de besoin et qui croisaient en attendant dans le golfe de Siam (7). Ces cinq vaisseaux auraient pu réduire à la raison les Siamois à qui il n'en restait aucun, quand même ils auraient été tous déclarés contre les Français, parce qu'on aurait été en état de brûler leur capitale et la plupart des villes qu'ils ont sur la rivière, mais M. Desfarges se laissa tellement ébranler par les promesses qu'on lui fit de la part de Phetracha et par la crainte qu'on lui donna de son ressentiment s'il n'obéissait à ses ordres, qu'il refusa le secours des Anglais, négligea de rappeler les vaisseaux et prit la résolution d'aller se mettre entre les mains de ce mandarin et, pour lui témoigner plus de confiance, il lui mena son fils aîné avec lui. M. Véret voulut aussi être de la partie pour aller jouir de l'effet de toutes les grandes promesses qu'on lui avait faites.
Les officiers, cependant, n'étaient pas contents de voir faire cette démarche à M. Desfarges. M. de Beauchamp, qui venait de Louvo et qui savait assez ce qui s'y passait, fit tout ce qu'il put pour empêcher M. Desfarges d'y aller, et M. de Vertesalle, qui était commandant dans la place, prit la résolution de la mettre en état de soutenir un siège, ne doutant pas qu'on en dût venir là, d'autant plus qu'il s'était aperçu que l'ambassadeur (8) en avait examiné curieusement toutes les fortifications et les dehors, ce qui lui avait fait conseiller à M. Desfarges, au lieu de monter, d'arrêter ce mandarin qui paraissait trahir les Français et de ne le pas rendre qu'on n'eût délivré M. Constance. Mais on était encore trop prévenu en faveur de Phetracha pour suivre un si bon conseil. M. Desfarges ne fut pas sitôt hors de la place qu'il se vit environné de plusieurs balons de Siamois armés. Mun Pan lui fit entendre que c'était pour lui faire honneur et qu'un futur successeur de M. Constance ne devait pas marcher avec moins de suite. Il le crut d'abord, mais le cortège devint en peu de temps si gros qu'il commença à craindre que ce ne fût une honnête garde qu'on lui avait donnée. Mun Pan, se voyant sûr de sa proie, donna aussitôt avis, par un courrier, du succès de son entreprise. Nous en apprîmes d'abord la triste nouvelle parce qu'il acheva de mettre tous nos chrétiens en prison sans distinction d'âge, de sexe, ni de nation.
Mme Constance y avait été traînée le jour d'auparavant. Je ne sais si on avait déjà eu nouvelle du départ de M. Desfarges. Cette pauvre dame fut jetée dans une écurie parmi la puanteur et l'ordure, dénuée de toutes choses et n'ayant qu'une claie pour se coucher. On la laissa un jour entier sans lui donner à manger et on l'aurait fait jeûner plus longtemps si une de ses tantes n'avait obtenu la permission de venir nous demander l'aumône pour elle. Ce fut pour nous une chose bien touchante de voir une si sainte et si illustre famille réduite en cet état, mais nous eûmes en même temps quelque consolation de pouvoir l'assister dans ses besoins après en avoir reçu tant de bienfaits.
Comme ceux qui la gardaient ne voulaient pas nous permettre de la voir, j'allai prier Si Munchiay de me procurer cette permission. Ce mandarin, qui avait été fort ami de M. Constance et avec qui j'avais fait connaissance au palais, était pour lors un des plus avant dans les bonnes grâces de Phetracha. Le désir de sauver sa vie et maintenir sa fortune l'avait obligé de se jeter dans le parti de ce mandarin lorsqu'il le vit le plus fort, quoiqu'il conservât toujours beaucoup d'attachement pour le roi et d'amitié pour M. Constance. Il vint avec moi voir me Constance, il la consola et lui dit qu'il la demanderait à Phetracha afin d'avoir soin d'elle et il ordonna à ses gardes de me permettre de la voir et de lui parler quand je voudrais, ce qui s'étendit à tous les autres pères. J'avoue que je fut interdit lorsque je la vis en l'état où elle était et j'aurais eu de la peine à lui parler si elle ne m'avait encouragé elle-même par la résignation à la volonté de Dieu et la joie même qu'elle témoignait de se voir réduite à l'état où avait voulut naître le Sauveur du monde. Elle eut bien besoin, dans la suite, de ce fond de religion et de vertu pour l'animer dans toutes les fortes épreuves qu'elle eut à soutenir et le ciel voulut que nous eussions toujours la liberté de la secourir et de l'encourager.
M. Desfarges arriva à Louvo le 2 de juin. On le mena d'abord au palais parler à Phetracha sans lui vouloir donner le temps de s'aller reposer un moment. Sitôt que je le sus, j'y allai pour tâcher de lui pouvoir parler avant qu'il eût audience du mandarin, mais ils étaient déjà ensemble lorsque j'arrivai. Je trouvai le palais plein de gens armés que Phetracha avait assemblés pour faire ostentation de ses forces, quoique les portes en fussent gardées avec beaucoup plus d'exactitude qu'elles ne l'avaient été auparavant. J'y entrais cependant quand je voulais et cela par ordre de Phetracha. Comme il sut que je n'y retournais plus depuis qu'il s'en était rendu le maître, il me fit prier d'y revenir à l'ordinaire et me dit que le roi le souhaitait, mais comme il ne me voulait pas permettre de le voir, et que je savais bien qu'il ne cherchait par-là qu'à faire croire au peuple que le roi était encore le maître dans le palais et que tout s'y faisait par ses ordres, je ne voulais pas y aller. Mais le R. P. supérieur et les autres pères, croyant qu'il était à propos de ménager ce mandarin pour en obtenir des grâces pour les pauvres chrétiens prisonniers, souhaitèrent que je fisse en cela ce qu'il voulait de peur de le fâcher. Ainsi je fus obligé de retourner au palais et d'y manger même bien plus souvent que je ne faisais auparavant. M. Paumard fut obligé à faire la même chose, mais nous prîmes la résolution de n'y point profiter de la bonne chère qu'on nous y faisait pendant qu'on laissait mourir nos chrétiens de faim et de misère dans les prisons. Ainsi, quoiqu'on nous servît de la viande en abondance, nous ne mangions que des fruits et du laitage, ce qui ne plaisait pas fort à Phetracha qui eût souhaité que nous eussions mieux dissimulé notre déplaisir.
Comme nous sortions de dîner, M. Paumard et moi, et que nous allions pour voir si M. Desfarges serait hors d'avec Phetracha, nous rencontrâmes le valet de chambre du roi qui nous attendait à notre passage et qui nous dit de la part du roi que Sa Majesté avait été bien surprise d'apprendre que M. Desfarges fût venu après ce qu'il nous avait fait dire de lui mander ; qu'il s'était engagé là dans un fâcheux pas ; que Phetracha dans l'audience qu'il venait de lui donner lui avait dit que le roi voulait qu'il fît venir tous les soldats de Bangkok pour aller à la guerre contre les Laos et que M. Desfarges avait promis de le faire, mais qu'il fallait que nous l'avertissions de s'en donner bien de garde ; que Phetracha disait cela de son chef et que c'était un prétexte pour se rendre maître des Français et les faire égorger. Le roi avait su cela par le moyen d'un mandarin fidèle qui était du conseil de Phetracha.
Nous fîmes remercier le roi de sa bonté pour les Français et nous dîmes que nous allions avertir M. Desfarges. Mais comme nous sortions du palais pour l'aller voir dans la maison de M. Constance où on l'avait envoyé dîner, un des gens de Phetracha nous vint prier de sa part de l'aller trouver, ce que nous fîmes. Il nous fit d'abord bien des amitiés et nous dit qu'il avait toujours été de nos amis et qu'il croyait que nous en étions persuadés ; qu'il savait bien que nous avions été fâchés de ce qu'il avait fait emprisonner M. Constance et quelques autres personnes, mais qu'il y avait été obligé pour le bien de l'État et par les sollicitations des mandarins ; que, cependant, toutes les choses allaient s'accommoder à la satisfaction de tout le monde ; que M. Desfarges en prenait les moyens en entrant dans les propositions qu'il lui avait faites ; que nous prissions bien garde de ne l'en pas détourner et de ne lui pas aller redire ce qui s'était passé, dont une partie s'était faite sans ordre ; qu'il serait au reste obligé de nous punir sévèrement, tout notre ami qu'il était, si nous empêchions M. le général de faire venir la garnison de Bangkok. Nous lui répondîmes que M. Desfarges savait assez ce qu'il avait à faire sans prendre conseil de nous ; que nous ne doutions pas qu'il ne prît toujours les moyens les plus propres à entretenir la bonne intelligence entre les deux nations et que nous ne l'en détournions pas. Nous prîmes occasion de lui parler en faveur de nos pauvres chrétiens prisonniers afin qu'il les fît tirer de la misère où ils étaient et qu'il nous fût permis de les voir. Il nous assura qu'ils seraient bientôt tous délivrés ; que, cependant, il voulait bien que nous les visitassions tant qu'il nous plairait, excepté M. Constance qu'il ne nous voulut jamais permettre de voir.
Au sortir de là, je passai à notre maison, et ayant dit au R. P. Le Royer ce que le roi nous avait fait dire, nous allâmes ensemble en avertir M. Desfarges. Nous le trouvâmes sur son lit, tout consterné de la réception que lui avait faite Phetracha, et M. de Lionne et M. Véret auprès de lui qui ne l'étaient pas moins de se voir engagés dans une affaire si délicate, car Phetracha, bien loin de ce bon accueil auquel ils s'étaient attendus, les avaient traités comme des criminels et des ennemis. Il avait obligé M. Desfarges de se mettre par terre, lui qui n'avait jamais paru qu'assis ou debout devant le roi, et avait fait tenir derrière lui un homme debout, le sabre nu à la main pour l'intimider davantage. Lui parlant ensuite avec une fierté extrême, il lui avait fait plusieurs reproches de sa mauvaise conduite et des violences des Français et lui avait enfin ordonné d'écrire à M. du Bruant de sortir de Mergui et d'ordonner en même temps à M. de Vertesalle d'amener la garnison de Bangkok pour aller à la guerre contre les Laos.
M. Desfarges, qui ne s'attendait pas à de pareils compliments après tout ce qu'on lui avait promis, ne sut que répondre. Il promit tout ce qu'on demanda de lui pour se tirer de dessous le sabre du bras-peint (9). On fut surpris, après tout, que Phetracha, pour un homme aussi rusé qu'il l'était, ne l'eût pas plus ménagé puisqu'il voulait attirer le reste des Français, et ce fut une faute que fit ce mandarin, car s'étant imaginé que tenant entre ses mains le commandant général des Français, ses fils, l'évêque et le chef de la faiturie, il ferait aux autres tout ce qu'il voudrait. Il voulut se faire honneur en présence des mandarins et du peuple qu'il avait assemblés dans la salle d'audience et leur faire voir qu'il les voulait délivrer de la domination des Français comme il leur avait promis, au lieu que, s'il avait fait des amitiés à M. Desfarges, on aurait pu croire que cette promesse n'avait été qu'un prétexte pour se révolter et il est sûr que la fierté avec laquelle il lui parla l'accrédita beaucoup parmi les Siamois qui furent bien aise de voir humilié par un de leurs mandarins une nation qui leur paraissait si formidable.
Lorsque nous dîmes à M. Desfarges que le roi avait été surpris qu'il fût venu et que nous ne l'avions pas été moins après ce que nous avions pris la liberté de lui écrire, il nous dit qu'il n'avait pas vu nos lettres. M. de Lionne avoua, comme j'ai dit, qu'il les avait déchirées dans la crainte qu'on ne le fouillât. Nous l'avertîmes ensuite, de la part du roi, du piège que lui tendait Phetracha en demandant la garnison de Bangkok. Il nous dit qu'il le voyait assez mais qu'il était bien embarrassé pour se tirer de cette fâcheuse affaire ; qu'il se trouvait entre les mains de ce mandarin qui le faisait garder par plus de trois cents hommes ; que sa place, d'ailleurs, n'était guère en état de défense et manquait de provisions et qu'il ne savait pas s'il ne valait pas mieux confier les Français à la clémence de Phetracha plus tôt que tard.
Nous lui demandâmes s'il n'avait rien dit à ce mandarin en faveur de M. Constance. Il nous dit qu'il avait eu assez de peine à se tirer lui-même d'affaire sans penser aux autres ; qu'il l'avait vu souvent prêt de s'emporter et de lui faire quelque mauvais traitement. Le second ambassadeur vint sur ces entrefaites prendre des ordres de M. Desfarges pour ceux qui commandaient à Bangkok et à Mergui afin d'en sortir avec leurs garnisons pour venir à Louvo. Nous nous retirâmes pour les laisser délibérer ensemble. M. Desfarges, qui ne laissait pas de voir les terribles conséquences de cette affaire, dit à l'ambassadeur que les Français auraient de la peine à se résoudre à venir à Louvo, mais que si on n'était pas content qu'ils restassent dans les places qu'on leur avait données, qu'il priait le grand mandarin de leur permettre d'acheter des vaisseaux, et qu'ils s'en retourneraient en France.
Phetracha ne fut pas content de cette réponse, soit qu'il crût que ce n'était qu'une défaite dont M. Desfarges usait pour se tirer de ses mains, soit que, ne se contentant pas de mettre les Français hors du royaume, il voulût les sacrifier à sa fureur. Il voulut que M. Desfarges les fît venir à Louvo pour le service du roi. Enfin, après quelques délibérations, M. Desfarges prit ce parti pour avoir la permission de retourner à Bangkok. Il dit qu'il ordonnerait à M. du Bruant, puisqu'on le voulait, de venir avec toute sa garnison à Louvo, mais que, pour ce qui regardait Bangkok, comme il en était lui-même gouverneur en personne, il fallait qu'il y allât quérir la garnison parce que c'est un point de la discipline militaire française de ne recevoir jamais les ordres d'un gouverneur lorsqu'il est absent de sa place.
Phetracha fit d'abord un peu de difficulté. Cependant, persuadé que M. Desfarges reviendrait avec sa garnison, puisqu'il avait mandé celle de Mergui et qu'il laissait ses deux enfants pour otages, il le laissa aller, le menaçant que s'il manquait de venir comme il le promettait, il ferait couper la tête à ses deux fils. M. Desfarges partit le 4 de juin avec M. de Lionne et M. Véret qu'on laissa aller avec lui parce qu'ils firent croire qu'ils l'engageraient à revenir. Phetracha, voyant qu'ils ne lui avaient pas dit un seul mot en faveur de M. Constance, crut que rien ne l'empêchait plus de se défaire de lui. Il le fit exécuter ce jour-là même sur les 10 heures du soir. Un mandarin, parent de Si Munchiai, que je connaissais fort et dont j'ai oublié le nom, fut chargé de le mener au supplice. C'est de lui de qui j'ai su les circonstances suivantes qu'il vint lui-même raconter à me Constance.
Ayant reçu l'ordre de Phetracha, il alla le signifier à M. Constance sur les six heures du soir, lui disant qu'ayant été toujours son ami, il avait eu bien du déplaisir de se voir chargé d'une telle commission, mais qu'il n'avait osé la refuser pour ne se pas rendre suspect à Phetracha qui, sur le moindre soupçon, lui ferait couper la tête. M. Constance ne parut ni surpris ni affligé de cette nouvelle ; il pria seulement le mandarin d'aller demander de sa part à Phetracha, pour toute grâce, qu'il lui accordât un père pour se confesser et un peu de temps pour se disposer à mourir chrétiennement. Phetracha ne voulut jamais consentir à lui donner un confesseur quoiqu'il nous eût promis que, supposé qu'il fût obligé de le faire mourir, il nous permettrait de le voir. On lui dit seulement qu'il pourrait se disposer à la mort jusqu'à dix heures du soir et que, s'il avait quelque chose à recommander pour sa famille et ses affaires, il en pourrait charger le mandarin qui l'accompagnerait.
Ce mandarin l'alla prendre sur les dix heures du soir et, lui ayant fait traverser la ville sur un éléphant, il le conduisit en un lieu que Phetracha avait marqué pour l'exécution (10). Il nous dit que M. Constance, y étant arrivé, se mit à genoux, et qu'ayant prié Dieu quelque temps, il lui dit qu'il protestait en présence de Dieu, devant qui il allait paraître, qu'il mourait innocent des crimes que Phetracha lui avait voulu imposer. Qu'il n'avait rien fait que pour le service et la gloire du roi et que pour maintenir la famille royale sur le trône. Il pria ensuite le mandarin d'avoir soin de sa femme et de son fils et de protéger les pauvres chrétiens qu'on persécutait sans sujet. Il lui donna la croix de l'ordre de Saint Michel, le priant de la conserver pour son fils comme une marque de l'affection du roi de France et de la lui donner quand il serait en état de la pouvoir conserver. Il tendit ensuite le col au bras-peint qui, lui ayant déchargé dessus un grand coup de sabre, du revers lui fendit le ventre, comme ils font ordinairement à ceux à qui ils coupent la tête.
Ainsi mourut M. Constance, à l'âge de 40 ans, d'une manière bien triste en apparence, puisque ce fut par la main d'un bourreau, mais glorieuse en effet si on considère que le zèle qu'il avait pour la religion chrétienne et pour le service de deux grands rois dont il avait procuré l'alliance, la lui ont attirée. Car je dois lui rendre ce témoignage que, quoiqu'il vît bien le danger où il était depuis que M. Desfarges lui eût manqué de parole, il ne voulut pas l'éviter en se retirant, quelques instances que nous lui en fissions, nous disant toujours qu'il ne pouvait pas, sans trahir sa conscience et manquer à la fidélité qu'il devait à deux grands princes, abandonner leurs intérêts et la religion chrétienne dont Dieu semblait lui avoir confié le soin dans ce royaume, pour mettre sa vie à couvert ; qu'il résisterait tant qu'il espérait que le ciel bénirait ses soins, mais que s'il voulait qu'il y perdît la vie, il serait trop heureux de la donner pour une si bonne cause.
Il vivait d'ailleurs comme un homme qui se disposait à mourir, surtout depuis la mort de son fils qu'il regarda toujours, par un certain pressentiment secret, comme un avertissement de la sienne, quelque chose que je fisse pour lui ôter cette pensée de l'esprit, prenant pour une vaine crainte ce que j'ai regardé depuis comme une faveur particulière du ciel, car cela le fit vivre d'une manière encore plus chrétienne qu'il n'avait fait jusque-là. Tout accablé qu'il fut d'affaires, il employait un temps de la journée fort considérable à prier Dieu. J'en était témoin moi-même, surtout lorsque nous étions à Thlé pousson, qui est une maison de plaisance qu'avait le roi à une petite lieue de Louvo. Comme M. Constance n'était pas bâti là, il me faisait coucher dans la chambre aussi bien que M. de Fretteville, qu'il estimait beaucoup à cause de sa piété. J'étais charmé de la dévotion avec laquelle ils priaient Dieu l'un et l'autre, surtout M. Constance. Il se levait régulièrement à cinq heures et faisait une heure entière de méditation à genoux, d'une manière très édifiante. Il travaillait ensuite à ses affaires et, quoiqu'il ne sortît souvent qu'à onze heures du palais, il allait à Louvo entendre la messe que je lui allais dire dans la chapelle, quoique cela fût fort pénible pour lui et pour toute sa maison et que je lui offrisse de lui épargner cette peine en lui disant la messe à Thlépousson sur l'autel portatif que j'avais. Il ne voulut pas d'abord y consentir, me disant qu'il n'était pas juste que, pour s'épargner un peu de peine, il fît dire la messe dans un lieu peu décent, pouvant l'aller entendre dans une église consacrée et ce ne fut que la nécessité qui l'y contraignit, la chaleur extrême qu'il fallait essuyer jointe à la fatigue du carême qu'il gardait fort exactement l'ayant fait tomber malade.
Le soir, à quelque heure qu'il revînt de chez le roi, il était souvent près de dix heures, il ne se mettait pas à table qu'il n'eût fait sa demi-heure d'oraison. Il obligeait cependant la compagnie de s'y mettre et venait manger un morceau à la fin du repas. Il ne manquait jamais d'assister aux sermons que nous faisions dans la chapelle. Il avait demandé congé pour cela au roi tous les dimanches et, les mercredis au soir, il secondait avec beaucoup d'attention et, comme nous ne savions pas encore assez bien le siamois pour prêcher en cette langue et que les chrétiens qui n'entendaient point le portugais étaient au sermon sans en profiter, il les assemblait tous, après le sermon, dans le vestibule de l'église et, se mettant au milieu, il leur répétait en siamois tout ce que le père avait dit, avec une bonté et une humilité qui charmaient ces bonnes gens, voyant celui devant qui tout le royaume ployait se familiariser avec eux et les traiter de frères. Et c'était en effet une chose très édifiante pour tous ceux qui connaissaient le caractère d'esprit de M. Constance qui était naturellement un peu fier.
Il donnait deux fois la semaine, au carême, à manger aux pauvres et les servait lui-même avec Mme Constance, instruisant aussi son fils, qui n'avait que cinq ans, à rendre ce service de bonne heure aux membres de Jésus-Christ. Il lava les pieds à douze pauvres le jour de la Cène et leur fit un régal magnifique où il les servit à genoux. Il obtint du roi permission, quoiqu'avec bien de la peine, de consacrer les derniers jours du carême à la retraite et d'être dispensé d'aller au palais. Il les passa tous dans des exercices continuels de dévotion, quoique les démarches de M. Desfarges, dont il apprit en ce temps les irrésolutions, lui dussent donner bien des distractions. Mais comme il avait un caractère d'esprit vif et ferme, il prenait d'abord son parti et remettait le reste à la Providence. Il sut le jour de Pâques au matin que M. Desfarges l'avait abandonné. Il ne laissa pas d'aller communier et de passer toute la matinée en dévotion avec la même tranquillité que si les affaires fussent allées le mieux du monde. Il fit ensuite une aumône très considérable à tous les pauvres du pays, au nombre de 2 000 qui venaient ainsi tous les ans pour avoir part à ses charités, et il eut la consolation qu'on lui en fît un crime à sa mort, Phetracha l'accusant de s'être servi de ces moyens pour séduire le peuple et le porter à quitter la religion du pays et embrasser la chrétienne.

NOTES
1 - Beauchamp, principal témoin de la scène, rapporte cet épisode dans sa relation écrite probablement à Middelburg : Nous entrâmes dans le palais, et comme je fus à vingt pas en dedans, je dis à M. Constance : « Pourquoi, monsieur, n'avez-vous pas voulu me donner l'ordre d'arrêter Phetracha ? » Il me dit : « Ne parlons point de cela. » Aussitôt nous aperçûmes Phetracha à la tête de plus de 2 000 hommes, entouré de tous les officiers du palais, qui vint à nous, et nous ayant abordés, prit par la manche M. Constance, lui disant : « Ah, le voici », et aussitôt dit à un mandarin de lui couper le col. M. Constance, à demi-mort, se tourna du côté de Phetracha en posture de suppliant, à qui il parla à l'oreille. En même temps, six personnes me prirent sans beaucoup me presser et le fils de Phetracha toucha le bout de mon épée. Aussitôt, je mis les deux mains sur la garde, afin d'en être toujours maître, en regardant fixement M. Constance, pour, au moindre signe qu'il m'aurait fait, la passer au travers du corps de Phetracha, croyant que c'était la volonté du roi de s'en défaire, comme il me l'avait dit. M. Constance, tournant la tête de mon côté, me dit d'une voix tremblante : « Seigneur major, rendez à Phetracha votre épée ». Je la tirai, et comme je la tenais par le milieu pour la donner à Phetracha, son fils, qui était derrière moi, la prit par la garde. Je me tournai brusquement, et comme j'eus vu qui c'était, je la laissai aller. Les chevaliers Desfarges et de Fretteville qui nous suivaient furent désarmés et arrêtés à quelques vingt pas avant dans le palais. Comme je fus désarmé, ils me menèrent avec les chevaliers Desfarges et de Fretteville dans une salle du palais sous la garde du second ambassadeur et de cinquante Siamois, ayant tous leurs sabres nus. Phetracha prit par le bras M. Constance, lui fit quitter ses souliers et son chapeau, et le promena ainsi tout autour du palais pour le montrer au peuple qui s'y était rendu en foule ; après, on l'amena dans la salle où nous étions. À peine il fut-il entré qu'il me dit en m'abordant : « Seigneur major, je suis bien fâché de vous voir ici ». Je lui répondis : « Votre Excellence l'a bien voulu, car si vous m'aviez cru, ni vous ni moi n'y serions pas. » Phetracha, voyant que nous nous parlions, le vint prendre et l'emmena. On le chargea de fers, on lui mit la cangue au col et on lui brûla la plante des pieds. Ensuite Phetracha s'en alla dans l'antichambre du roi, y fit prendre Mon Pi et là, le fit couper en trois en sa présence. La princesse reine, la fille du roi, qui était dans le palais lorsque tout cela se faisait, disait tout haut qu'il fallait exterminer tous les chrétiens qui étaient dans le royaume. (Relation manuscrite BN Fr 8210, f° 521v° et suiv.) ⇑
2 - Thale Chubson (ทะเลชุบศร), une île au milieu d'un ancien lac à trois kilomètres de Lopburi, où le roi Naraï avait fait construire une résidence, le pavillon Kraisorn-Sriharaj (ตำหนักไกรสรสีหราช). On peut penser que la fraîcheur de l'eau rendait cette retraite agréable pendant les mois chauds. Elle était également connue sous le nom de Pratinang yen (พระตี่นั่งเย็น), la Résidence fraîche. Elle servait au roi Naraï pour les réceptions et pour séjourner lors de ses parties de chasse ou de ses promenades en forêt.
 Le pavillon Kraisorn-Sriharaj.
Le pavillon Kraisorn-Sriharaj.
 Les vestiges du système d'irigation de Thale Chubson, peut-être dû à l'ingénieur La Mare. ⇑
Les vestiges du système d'irigation de Thale Chubson, peut-être dû à l'ingénieur La Mare. ⇑
3 - Dans le Mémoire du père de Bèze sur la vie de Constance Phaulkon, Drans et Bernard (p. 118, note 2) suggèrent qu'il s'agit peut-être d'une allusion à la succession du shogun Tokugawa Ietsuna, mort en 1680. Toutefois, si le haut dignitaire Sakai Tadakiyo tenta d'imposer un fils de l'empereur Go-Sai comme successeur, c'est en réalité Tokugawa Tsunayoshi, un jeune frère de Ietsuna qui lui succéda. ⇑
4 - Le père de Bèze avait déjà évoqué ce dignitaire, qu'il présentait comme capitaine des pages et premier officier de la chambre du roi. ⇑
5 - Étienne Paumard (vers 1640-1690) était un missionnaire des Missions Étrangères. Ses connaissances médicales lui permirent d'approcher le roi et les hauts dignitaires, et d'échapper à la rigueur de la persécution qui frappait les Français. On trouvera davantage de détails biographiques sur le site des Missions Étrangère à la page Étienne Paumard. ⇑
6 - Dans une lettre aux directeurs du séminaire des Missions Étrangères, le missionnaire Bernard Martineau relate l'entrevue entre Phetracha et l'abbé de Lionne (cité par Launay, Histoire de la mission de Siam, I, p. 205) : Dans le même temps, le grand mandarin fit écrire avec beaucoup de civilités à Mgr de Métellopolis et à Mgr de Rosalie [l'abbé de Lionne, qui ne sera officiellement évêque de Rosalie qu'en 1696], les invitant à monter à Louvo en toute diligence. Mgr de Métellopolis étant incommodé, il n'y eut que Mgr de Rosalie qui y alla. Il partit de notre séminaire le 24 mai. Quand il arriva à Louvo, tout ce que j'ai écrit était déjà fait, excepté que M. Constance n'était pas encore mort, mais était à la question. Il n'y fut pas plutôt arrivé qu'il parut devant le grand mandarin qui lui parla avec beaucoup de chaleur de l'affaire des Français ; de ce que M. le général, qui protestait n'être ici que pour le service du roi de Siam, refusait à ses ordres de monter à Louvo avec ses troupes. Il lui dit de plus de prendre bien garde à ce qu'il avait à faire et d'écrire et de parler à M. le général de telle manière qu'il le portât efficacement à faire ce que le roi demandait de lui ; c'était ainsi qu'il prenait toujours le nom du roi. « Car autrement, reprit-il en criant et menaçant fortement, il lui en prendrait mal à lui et à tous les pères français ; qu'il les ferait amarrer à la bouche du canon ». Mon dit seigneur répondit qu'il n'avait rien à commander à M. le général, que tout au plus il pourrait lui parler et tâcher de le persuader. ⇑
7 - Ces deux navires, partis le 1er mars 1688 et qu'on crut quelque temps perdus, étaient le Siam et le Louvo, commandés par M. de Sainte-Marie, nom de guerre du lieutenant de Larre ou Delars, et Suhart. Ils avaient été envoyés en mer par Phaulkon pour des raisons assez obscures. Le but avoué de cette expédition était d'aller faire la chasse aux pirates, mais il eut un second ordre, plus confidentiel. Selon le père Le Blanc (Histoire de la révolution du royaume de Siam, I, p. 32), il s’agissait d’un ordre secret qu'ils avaient de M. Constance d'interrompre leur course aux premiers bruits de guerre et de troubles qui pourraient arriver dans le royaume, et d'aller se mettre sous le canon de Bangkok, où ils recevraient les ordres de M. Desfarges pour le service des deux rois. Beauchamp donne une autre version, tout aussi vraisemblable : M. Desfarges vit l'ordre que ces deux officiers lui montrèrent qui était d'aller après ces forbans, et un autre ordre que mon dit sieur Constance avait donné pour aller brûler les vaisseaux anglais qui seraient en rade de la ville de Madras, côte de Coromandel. Les sieurs de Sainte-Marie et Suhart écrivirent à M. de Constance que cela ne se pouvait, la saison étant contraire. M. Constance leur écrivit de sortir et qu'ils tinssent la mer et d'aller où ils voudraient et de ne revenir que dans quatre mois (A.N. Col. C1/25 f° 73v°). Desfarges, pour se justifier, accusa plus tard Sainte-Marie de lui avoir dissimulé ce second ordre mais il est vraisemblable, comme le laisse entendre François Martin, que le général et tous les Français étaient parfaitement informés de la mission des deux officiers et que d’ailleurs les personnes qui n’entraient point dans les sentiments de M. Constance étaient surpris de la facilité de M. Desfarges à permettre l’embarquement des troupes du roi pour faire la guerre aux Anglais. (Mémoires de François Martin, 1934, III, p. 17). L'expédition de Sainte-Marie et Suhart dura plus longtemps que prévue, puisque selon un abrégé de ce qui s’est passé à Bangkok pendant le siège en 1688 (Archives Nationales, Col. C1/24 140r°-171v°), les deux navires ne furent de retour que le 5 septembre. ⇑
8 - Kosapan, que le père de Bèze appelle Mun Pan. ⇑
9 - Les bras-peints (ken laï : แขนลาย), ainsi appelés parce leurs bras scarifiés avaient été recouverts de poudre à canon, ce qui, en cicatrisant, leur donnait une couleur bleue mate, sont ainsi décrit par La Loubère : Ils sont les exécuteurs de la justice du prince, comme les officiers et les soldats des cohortes prétoriennes étaient les exécuteurs de la justice des empereurs romains. Mais en même temps, ils ne laissent pas de veiller à la sûreté de la personne du prince, car il y a dans le palais de quoi les armer aux besoin. Ils rament le balon du corps, et le roi de Siam n'a point d'autre garde à pied. Leur emploi est héréditaire comme tous les autres du royaume, et l'ancienne loi porte qu'ils ne doivent être que six cents, mais cela se doit sans doute entendre qu'il n'y en doit avoir que six cents pour le palais, car il en faut bien davantage dans toute l'étendue de l'État parce que le roi en donne, comme j'ai dit ailleurs, à un fort grand nombre d'officiers. Ces bras-peints donneront toute la mesure de leur cruauté lors de la révolution de 1688. ⇑
10 - L'exécution eut lieu dans les fossés de Thale Chubson. ⇑

12 mars 2019
