

1ère partie.
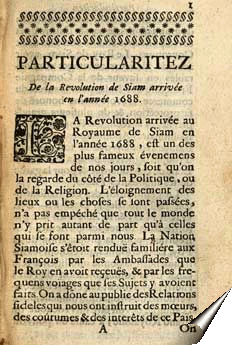
La révolution arrivée au royaume de Siam en l'année 1688 est un des plus fameux événements de nos jours, soit qu'on la regarde du côté de la politique ou de la religion. L'éloignement des lieux où les choses se sont passées n'a pas empêché que tout le monde n'y prît autant de part qu'à celles que se font parmi nous. La nation siamoise s'était rendue familière aux Français par les ambassades que le roi en avait reçues et par les fréquents voyages que ses sujets y avaient faits. On a donné au public des relations fidèles qui nous ont instruits des mœurs, des coutumes et des intérêts de ce pays.
On avait recueilli en peu de temps de grands fruits de part et d'autre de la correspondance établie entre les deux couronnes. Le roi de Siam avait accordé plusieurs avantages considérables en faveur de la Compagnie française des Indes pour la sûreté du commerce. Il avait même honoré de sa protection et de plusieurs grands privilèges la religion romaine et les missionnaires apostoliques. Le roi de France avait envoyé de son côté des troupes aguerries pour la sûreté des États de ce monarque et pour la garde de ses meilleures places.
Le grand motif de ces liaisons était la piété de Louis le Grand et le zèle qu'il fait paraître dans toutes ses glorieuses entreprises pour la propagation de la foi. Les personnes qui étaient les instruments de la bonne intelligence et le canal de la communication de l'un à l'autre lui avaient fait espérer la conversion d'un monarque infidèle dont l'exemple devait être suivi de tout un grand royaume, à cause du pouvoir absolu qui assujettit les Siamois à leurs souverains, et toutes choses étaient concertées de manière à pouvoir se promettre une alliance éternelle sous le nœud sacré d'une même religion.
Les bonnes dispositions où était le roi de Siam donnaient lieu à ces espérances. Il était avantageusement prévenu de la grandeur du roi. La gloire de son nom, la réputation de ses armes et l'étendue de son pouvoir en Europe, qui s'était répandue dans toute l'Asie, lui avaient fait concevoir une haute idée de ce monarque et lui avaient donné un tendre respect pour lui. Il recevait les Français avec des marques d'une estime et d'une bienveillance extraordinaire. Il ordonnait expressément dans les traités qu'il faisait avec eux de ménager leurs intérêts, et quant aux troupes qu'on lui avait amenées sous la conduite de M. Desfarges, maréchal des camps et armées du roi, il leur avait donné, avec sa confiance, la possession de ses forteresses et de ses postes les plus importants.
Il avait permis aux missionnaires catholiques venus dans son royaume sous l'inspection de deux prélats français, M. l'évêque de Métellopolis (1) et M. l'abbé de Lionne, nommé évêque de Rosalie (2), de s'y établir et d'y exercer leurs fonctions. Il leur avait fait bâtir des églises et des chapelles magnifiques. Il donnait aux jésuites qui enseignaient les mathématiques des collèges, des maisons et des observatoires, ayant favorisé ces pères dans toutes les rencontres depuis qu'on lui eut fait connaître le mérite de cette compagnie et les bonnes intentions qui les faisaient agir.
La source de la bonne volonté de ce prince pour tout ce qui portait le nom Français était le fameux M. Constance (3), qui possédait entièrement la faveur de son maître, ayant été élevé au plus haut degré du ministère. On ne doutait pas qu'avec l'ascendant qu'il s'était acquis sur son esprit et le zèle fervent dont il était pénétré en faveur de la religion catholique qu'il venait d'embrasser nouvellement, surtout après les assurances de ses services qu'il avait données aux ministres de France, on ne vînt à bout de toutes les difficultés.
Cependant le roi de Siam, sans témoigner de la répugnance pour une religion qu'il estimait utile à ses sujets, avait fait connaître qu'il ne songeait pas à se convertir et vivait dans une indifférence qui, quoique très dangereuse pour lui, ne donnait pas lieu de désespérer qu'il ne fît un jour profession de la vérité. On attendait du ciel le moment favorable où il se laisserait toucher, et l'on prenait prudemment des mesures pour l'avenir, lorsque inopinément on vit arriver un accident qui ruina ces heureux commencements.
Le prince toujours idolâtre tomba grièvement malade. Plusieurs factions déchirèrent le corps de son État, et le ministre, ami et protecteur des Français, perdit tout d'un coup sa fortune et sa vie par le revers d'une triste destinée.
Ainsi ce grand édifice, dont le dessein avait eu des vues si nobles, qui avait été manié par de si habiles mains, ne reposant que sur la fortune d'un favori, et celle-ci sur la santé de son maître, disparut au moment qu'une maladie survint et qu'une nouvelle autorité s'éleva contre la légitime, qui ne fut pas soutenue. Alors la décoration changea et l'on vit une image de ce qui se passe dans la plupart des occasions où le premier rang est disputé entre des concurrents. Il est bien rare que la scène ne soit ensanglantée par le vainqueur, et qu'il n'arrose du sang de quelque victime les degrés par où il doit monter sur le trône.
On a parlé sur ce sujet en différentes manières et l'on n'en doit pas être surpris. Comme il se trouve dans le monde un mélange bizarre d'actions et d'intérêts opposés, il y a de même divers jugements, et la plupart des hommes se laissent plutôt conduire à la passion et à l'opinion qu'à la raison et à la vérité.
Pour faire un juste discernement dans la matière que je traite, il ne faut que faire un simple détail de plusieurs faits qui ont conduit cet incident à sa fin, disposés par ordre et accompagnés de leurs circonstances les plus remarquables, afin que la vérité de cette histoire paraisse dans un plein jour et que le monde soit désabusé des fausses notions qu'on lui a données, et qu'il soit mieux informé des particularités d'un événement si considérable qui a changé, comme en un moment, la face d'un royaume qui ne nous était pas indifférent, et qui a exposé plusieurs de nos Français, gens de considération dans l'Église et de réputation dans la guerre, à des périls plus affreux que la mort, qui a renversé tout d'un coup les fondements de la vraie religion que nous avions jetés parmi des peuples idolâtres, qui enfin doit apprendre à la postérité que les ennemis jaloux de la gloire de Louis le Grand ont suscité toutes les forces de l'enfer jusqu'aux extrémités de la terre, et qu'ils y ont soutenu les plus hautes trahisons pour empêcher les pieux desseins de Sa Majesté en faveur du vrai christianisme.
On ne prendra pas les choses de plus haut que du départ des vaisseaux français qui avaient amené les troupes à Siam, parce que les relations qui ont parues depuis les voyages qu'on a faits en ces pays ont suffisamment instruit le public des mœurs et des coutumes de ce royaume.
Ce fut donc le 2 janvier de l'an 1688 à trois heures du soir qu'ils levèrent l'ancre pour s'en retourner en France, et M. Constance, après avoir vu appareiller les vaisseaux, s'embarqua dans son balonBateau siamois de cérémonie, on parle aujourd’hui de barge. pour s'en retourner à Siam, et passant devant Bangkok il y descendit pour examiner le projet des fortifications que l'ingénieur en chef (4) jugeait à propos de faire pour la sûreté des troupes du roi, auxquelles néanmoins on ne travailla qu'après le retour de M. Desfarges qui le suivit jusqu'à LouvoLopburi (ลพบุรี), à quelques dizaines de kilomètres d'Ayutthaya., lieu de plaisance du roi de Siam, d'où il ne revint que vers la fin du mois de janvier, en attendant qu'on fût en état de commencer un nouveau projet.
pour s'en retourner à Siam, et passant devant Bangkok il y descendit pour examiner le projet des fortifications que l'ingénieur en chef (4) jugeait à propos de faire pour la sûreté des troupes du roi, auxquelles néanmoins on ne travailla qu'après le retour de M. Desfarges qui le suivit jusqu'à LouvoLopburi (ลพบุรี), à quelques dizaines de kilomètres d'Ayutthaya., lieu de plaisance du roi de Siam, d'où il ne revint que vers la fin du mois de janvier, en attendant qu'on fût en état de commencer un nouveau projet.
M. du Bruant, destiné pour commander dans la forteresse de Mergui, ne donnait aucune relâche à M. Constance qu'il ne l'eût expédié avec un détachement de nos troupes pour se rendre à son poste, mais le sage ministre, qui n'ignorait pas ce qu'il devait craindre, divisant les troupes, différait de jour en jour à lui délivrer la commission, voulant pourvoir à la sûreté du roi son maître qui, en cas de besoin, pouvait espérer un plus prompt secours des forces françaises réunies à Bangkok que lorsqu'elles seraient partagées entre cette place et Mergui, d'où il ne fallait pas moins de six semaines pour se rendre en la capitale du royaume, encore devait-on faire diligence et n'avoir pas les vents contraires.
Néanmoins, les pressantes poursuites de M. du Bruant l'emportèrent sur une si bonne politique. La prudence du ministre céda au zèle de l'officier, et M. Constance fut enfin obligé de consentir qu'il partît avec trois compagnies françaises composées de 40 hommes chacune, pour ne pas donner lieu de croire qu'il refusât d'exécuter l'article du traité qu'il venait de faire avec les envoyés extraordinaires de France, par lesquelles on était convenu de mettre les Français en possession de ces deux places (5).
Ce fut là, au jugement des plus éclairés, la première fausse démarche qui encouragea les ennemis de M. Constance dans le dessein d'arrêter le cours des progrès favorables à nos intérêts et de renverser l'établissement que nous nous étions promis dans ce royaume. On s'aperçut bientôt que les vues du ministre n'avaient été qu'au vrai bien, lorsqu'il n'avait pu être d'avis qu'on s'affaiblit par la séparation des troupes.
M. du Bruant ne fut pas plutôt parti qu'un mandarin qui tenait le premier rang après la personne du roi et qui, par ses intrigues, a su devenir le principal personnage de la révolution, crut avoir trouvé le moment favorable pour le projet qu'il avait conçu de perdre M. Constance, de tromper les espérances des Français et de se placer lui-même sur le trône.
C'était Opera Piteratia, que nous avons nommé Pitracha par une mauvaise habitude de prononcer, qui couvrant sous un extérieur désintéressé une ambition désordonnée, s'était rendu très puissant dans le royaume (6).
Il était d'une très illustre famille, qu'on disait même être l'unique qui se fût soutenue depuis un temps immémorial dans les honneurs et dans les charges les plus éclatantes de l'État, quoique la coutume de la nation soit que les enfants des plus grands mandarins demeurent sans crédit et sans considération, confondus parmi le peuple après la mort de leur père, s'ils n'ont soin de les élever à quelque dignité pendant leur vie.
Outre le crédit que lui donnait son rang et sa naissance, il avait acquis une grande estime à la cour, où pour l'ordinaire tout le mérite d'un homme roule sur un beau dehors. Le roi, qui avait été nourri par la mère de Pitracha et qui avait épousé sa sœur, lui donnait un très libre accès auprès de sa personne, mais de plus, ce qui le rendait fort recommandable, c'est qu'il était d'une très haute considération chez les talapoins, étant adonné à l'idolâtrie autant que ces ministres de la religion païenne, et pour avoir demeuré assez longtemps parmi eux, il y avait étudié un air de probité qui lui attirait l'affection et le respect des peuples.
M. Constance, qui tenait les yeux arrêtés sur le mandarin, le soupçonna d'abord de quelque attentat secret contre l'autorité légitime, mais ne voulant pas faire éclater sa défiance en faisant monter à Louvo des troupes française, crut donner moins d'ombrage et se précautionner assez contre une entreprise dont on avait encore lieu de douter, en tirant de Bangkok deux compagnies moitié siamoise et moitié portugaise des Indes, commandées par des officiers français, qu'il ordonna pour la garde du palais, résolu de prendre d'autres sûretés quand il serait mieux éclairci de la trahison et qu'il aurait entre les mains des preuves assez convaincantes pour hasarder d'en faire la déclaration au roi.
Cependant Pitracha s'assurait de ses créatures, et son parti secret devenait puissant dans le royaume. Les sancrasSangkha rat (สังฆราช), chef de la communauté religieuse., ou principaux talapoins, et les plus illustres mandarins étaient séduits par les artifices de ce rusé conspirateur, d'autant plus insinuant qu'il n'affectait rien et qu'il paraissait bien éloigné de porter son ambition jusqu'au trône, car assurément ses partisans l'eussent abandonné dans ce dessein et n'eussent jamais donné les mains pour en dépouiller la famille royale, mais dissimulant ses prétentions, il savait les prendre par leurs intérêts particuliers et favoriser l'inclination d'un chacun.
Envers les talapoins, il se servait du pieux prétexte de rétablir la religion des pagodes, c'est-à-dire la religion du pays, dont il leur faisait voir la ruine prochaine et presque inévitable si l'on ne réparait promptement le dommage qu'elle avait souffert depuis que le roi, par une trop dangereuse facilité, avait permis une mission publique, et qu'il avait donné la liberté à tous ses sujets de se faire chrétiens. Envers les grands du royaume, il affectait d'être terriblement touché des maux qui menaçaient l'état, si l'on laissait gouverner plus longtemps un homme qui voulait les asservir sous une nouvelle domination dont ils ne pourraient plus secouer le joug, quand on lui aurait donné le temps de l'affermir. Il leur disait qu'il était instruit de bonne part que M. Constance n'avait appelé les Français que pour leur donner des tyrans, mais qu'il n'en voulait point d'autres preuves que la conduite de ce ministre qui leur avait livré les deux plus importantes places du royaume, où ils ne songeaient qu'à se mettre en état de se faire respecter de la nation et de lui imposer la loi ; qu'après tout le roi n'autorisait ce traité que par un excès de bonté dont on abusait en ne lui permettant pas de réfléchir sur les suites d'une tolérance si contraire à toutes les lois de la politique, de laisser fortifier au milieu des terres des étrangers sujets du plus puissant prince de l'Europe. Il les conjurait ensuite par tout ce qu'il croyait plus capable de les engager, de racheter leur liberté en sacrifiant à leurs justes ressentiments un homme qui n'usait de sa faveur que pour les opprimer, et dont il était de la dernière importance pour le public que le ministère ne durât pas davantage.
Il y eut peu des deux ordres qui ne se laissassent persuader à des discours qui avaient pour fondement la religion et la liberté publique. Ceux même qui étaient plus étroitement attachés à la personne du roi en furent ébranlés, soit que le péril leur parût effectivement tel qu'on leur avait raconté, soit qu'il se trouvât dans plusieurs esprits des semences de haine pour M. Constance, qui s'étaient répandues depuis qu'il eut fait ôter aux grand la liberté du commerce pour rendre celui du roi plus fructueux.
Quoique Pitracha gardât toutes les mesures nécessaires pour tenir ses pratiques secrètes, il ne put si bien faire que M. Constance n'en fût averti. Quelques mandarins fidèles lui apprirent bientôt qu'il se formait une faction dont Pitracha était le chef, et que sa perte avait été résolue par les conjurés. Mais par sa pénétration, le ministre alla plus avant dans les desseins du conspirateur et ne douta plus qu'il n'en voulût à la couronne de son maître.
Sachant contre quels ennemis il avait à se défendre, il songea aux moyens dont il se fallait servir, et pour aller au devant du mal par un coup qui fît trembler tout le parti et qui le dissipât proprement, il jugea qu'il était important de se saisir de l'auteur de ce désordre en faisant arrêter Pitracha. Mais il fallait des preuves de sa perfidie plus convaincante pour enflammer la jalousie du prince et l'animer à punir dès aussitôt le coupable. La déposition des témoins eût été d'une assez longue discussion et peut-être qu'il s'en fût trouvé peu de ceux qui avaient révélé le secret qui eussent eu assez de courage et de résolution pour maintenir la vérité en présence du roi, qu'il fallait persuader, et de Pitracha qui devait être convaincu, car il était redouté, ayant intimidé par des menaces ceux qu'il n'avait pu gagner par de spécieuses raisons. Cependant sans être assuré de lui faire faire son procès, il ne fallait pas risquer de le prendre, la coutume du royaume étant de condamner celui qui en accuse un autre sur de fausses conjectures au même châtiment qu'eût mérité le crime prétendu s'il avait été bien avéré.
M. Constance, impatient de remédier au mal qui prenait tous les jours de nouvelles forces, était arrêté par ces considérations lorsqu'il reçut par un exprès du gouverneur de la ville capitale l'original d'un faux ordre, que Pitracha lui avait envoyé, de tenir prêt deux milliers de poudre, plusieurs bombes et bon nombre de grenades, avec quantité d'autres armes et munitions. Il était scellé des sceaux du royaume qui avaient été surpris ou contrefaits, et il alléguait pour prétexte la sûreté de la personne du roi et de toute la nation siamoise. Presque en même temps, il en reçut un autre de même nature adressée au gouverneur de PipeliPhetchaburi (เพชรบุรี), ou Phetburi, la Cité des pierres précieuses, à environ 160 km au sud de Bangkok, à l'extrémité nord de la péninsule Malaise., place frontière de l'État, par lequel on lui enjoignait d'armer les milices de son gouvernement et des environs et de les tenir prêtes à marcher au premier signal.
Un secours de pièces comme celles-là, venu si à propos, acheva de déterminer M. Constance à exécuter promptement ce qu'il avait résolu. Il était informé chaque jour des progrès nouveaux que Pitracha faisait dans son entreprise et des mandarins qu'il engageait dans ses intérêts. Ce ministre demeura persuadé que ce n'était pas assez de sa bonne fortune et de la sagesse pour venir à bout de tant d'ennemis, et qu'en cas de résistance, c'était commettre l'autorité royale si l'on ne la soutenait avec vigueur ; c'est pourquoi il jugea prudemment qu'il fallait confier l'exécution de son dessein au courage des Français.
Il y avait auprès de lui un petit nombre d'officiers à la tête des deux compagnies de Siamois et de Portugais des Indes, dont il avait renforcé la garde du roi au premier avis qu'il avait eu de la conjuration. Mais il n'osait faire fond sur la fidélité de ces troupes, et la valeur des officiers français, quoique toujours prête à se signaler pour son service, n'était pas seule capable d'enlever Pitracha au milieu de ses partisans, qui auraient voulu faire quelques efforts pour le sauver. On ne délibéra point s'il ferait agir les forces des Français qui étaient à Bangkok. Il écrivit à M. Desfarges qu'ayant à lui communiquer une affaire de la dernière importance pour le bien des deux couronnes, il le priait de se rendre à Louvo avec peu de suite. M. Desfarges ne différa pas de partir après qu'il eut reçu cette lettre, et il ne fut pas plutôt arrivé près de M. Constance qu'il apprit de lui qu'il s'élevait un parti dans le royaume aussi contraire aux intérêts du roi du Siam et de la famille royale qu'à l'établissement de la religion chrétienne et de la Compagnie de France ; que Pitracha qui en était l'auteur, disposait secrètement toutes choses pour faire bientôt éclater quelque dessein funeste aux deux nations ; que le sien était de prévenir l'effet d'une si dangereuse cabale et de la déconcerter en lui ôtant son chef, mais que pour cette expédition il avait besoin du secours des armes françaises, et que c'était pour prendre avec lui des mesures sur cela qu'il avait désiré de voir.
M. Desfarges le remercia de la confiance qu'il lui témoignait et l'assura qu'il s'efforcerait de seconder ses bons desseins avec les troupes qui étaient en sa puissance, et qu'il trouverait avec plaisir une occasion de se distinguer par une action si utile au repos de l'État et à la conservation de leurs intérêts communs. Après une ample considération des choses et les réflexions que peut fournir une assez longue conversation, il fut arrêté que M. Desfarges irait à Bangkok et reviendrait incessamment à la cour, amenant avec lui l'élite de sa garnison, après quoi le ministre, qui ne laissait rien échapper à la prévoyance, l'avertit plusieurs fois et le pria de ne pas ajouter foi aux bruits qui commençaient à se répandre de côté et d'autre touchant à la mort du roi. Il lui fit entendre que c'était un artifice de Pitracha pour exciter un soulèvement général et pour prendre de là occasion d'armer ouvertement contre plusieurs factions, que cette nouvelle pressait de se déclarer, ajoutant que c'était peut-être un piège pour surprendre les Français et pour les engager à prendre parti afin de les faire soupçonner de quelque intelligence contre le bien de l'État.
Mais afin que le général des Français eût lieu de mépriser davantage ces rumeurs fomentées par un esprit de sédition, M. Constance voulut qu'il fût lui-même témoin oculaire de la vérité. Il demanda pour lui une audience particulière à laquelle il fut admis le matin du jour de son départ et où il lui fut aisé de s'instruire par lui-même de la bonne ou mauvaise disposition de la santé du roi, voici au vrai ce qu'il en était.
Ce prince, âgé d'environ cinquante à cinquante-cinq ans, devenait infirme et usé, et quoiqu'il fût ennemi des excès et peu adonné à certains vices plus ordinaires aux princes d'Orient, néanmoins étant d'une complexion délicate et ne s'étant pas entièrement refusé à toutes sortes de plaisirs, sa santé en avait reçu plus d'altération qu'elle n'aurait fait seulement par le cours des années (7). On avait remarqué dès le commencement du mois de janvier un acheminement à quelque fâcheuse maladie, mais il n'en était pas encore attaqué jusqu'à ne pouvoir plus quitter le lit. Il ne laissait pas de s'appliquer aux affaires de son royaume, donnant tous les jours à différents conseils les heures qui étaient destinées pour cela. On en peut juger par l'audience qu'en eut M. Desfarges, où le monarque, n'ayant pas à l'entendre sur aucun sujet important, le reçut pour lui marquer seulement qu'il continuait toujours dans son affection pour la nation française, et en particulier pour l'assurer de l'estime singulière qu'il faisait de sa personne.
M. Constance ayant ainsi découvert au commandant des Français la véritable situation des affaires de l'État, consentit qu'il partît de la Cour, en lui recommandant tant de fois de se donner de garde des faux bruits que l'on débitait que M. Desfarges, reconnaissant qu'il y avait de la défiance dans l'esprit du ministre, lui fit entendre qu'il se l'était tenu pour assez dit dès la première fois. En effet, ayant résolu de le servir, il usa de diligence et il fut bientôt rendu à sa forteresse, où dès le lendemain de son arrivée, il fit mettre la garnison sous les armes et tira 80 soldats des compagnies qui la composaient, avec dix officiers pour les commander, gens intrépides et hardis à tout entreprendre. Le jour suivant, il les distribua sur plusieurs bateaux, et s'étant mis à leur tête, il monta le long de la rivière.
C'était sur les actions d'une troupe si courageuse que roulait la destinée d'un empire, la fortune de son ministre et l'avènement de toutes les grandes entreprises dont il était l'âme et le principal fondement. On s'étonnera peut-être qu'on fît tant de fonds sur une poignée de gens dans un royaume aussi considérable qu'est celui de Siam. Néanmoins il n'est rien de plus constant que le petit nombre des Français qu'on y avait introduit suffisait pour tenir en bride toute la nation siamoise, et par conséquent on ne sera pas surpris qu'on eût lieu d'espérer qu'un détachement des plus braves réduisît un parti de factieux, ennemis du nom Français. Ceux qui en ont eu plus de connaissance n'ont pu disconvenir de cette vérité, et ils ont avoué dans leurs relations que si les nôtres eussent continué leur route, il eût été assez difficile d'empêcher de se saisir de la personne de Pitracha et de changer la disposition des affaires. Mais tel était l'ordre de la providence qui les conduisait à une grande révolution. Il se trouva de la contradiction de la part de celui qui devait être l'unique instrument d'un projet qui avait été si largement conçu. La chose arriva ainsi.
Pour aller à Louvo, selon le cours de la rivière, il fallait passer par la ville capitale du royaume à qui les Portugais ont donné de nom de Siam, quoiqu'elle s'appelle IudiaUne des innombrables versions du nom d'Ayutthaya (อยุธยา), alors capitale du royaume de Siam. dans la langue du pays. M. Desfarges y étant arrivé, alla malheureusement descendre à la faiturie (8) française où le sieur Véret, chef du comptoir, le reçut et apprit de lui le sujet de son voyage.
Cet homme, qui avait intérêt de brouiller et de souhaiter la perte de M. Constance, en haine de ce qu'il connaissait sa mauvaise foi dans la direction des effets de la Compagnie, songea d'abord à détourner le coup qui allait dissiper l'orage et apaiser tous les troubles en élevant son ennemi au plus haut point de bonheur et de prospérité où il pouvait arriver.
Il employa toutes les inventions dont il était capable pour persuader ce qu'il voulut au général des Français, lui disant d'un air effrayé que c'était fait de sa personne et de ses troupes s'il prétendait les transporter à Louvo, que le roi n'était plus et que son ministre était déchu de sa fortune et perdu sans ressource ; ne pouvant y avoir de chute médiocre pour lui, d'autant plus qu'il était étranger, et que descendant du poste où il avait été élevé, il tombait entre les mains de ses ennemis.
La raison décisive fut que Pitracha était le maître, et l'assurance qu'il lui donna que ce mandarin ennemi capital de leur nation avait mis tout le royaume sous les armes pour l'arrêter entre Siam et Louvo et lui couper la gorge à son passage. Que c'était là la seule récompense qu'il pouvait espérer du service qu'il avait promis au ministre, lequel voyant la décadence de ses affaires, avait voulu envelopper tous les Français avec lui dans une ruine inévitable.

NOTES :
1 - Monseigneur Louis Laneau (1637-1696). Voir sur ce site la page consacrée aux missionnaires. On trouvera une biographie détaillée de l'évêque de Métellopolis sur le site des Missions-Etrangères de Paris. ⇑
2 - Artus de Lionne (1655-1713), fils du secrétaire d’État Hugues de Lionne. M. de Lionne, nommé coadjuteur de Mgr Laneau le 20 mai 1686 et évêque de Rosalie le 5 février 1687, refusa cette double nomination. Il n'accepta qu'en 1696 d'être évêque. (Adrien Launay, Histoire de la Mission de Siam, I, p. 205). Voir également sur ce site la page consacrée à l'abbé de Lionne. ⇑
3 - Constantin Phaulkon, aventurier grec qui devint un personnage considérable dans le royaume de Siam sous le règne du roi Naraï. Voir sur ce site la page consacrée à Monsieur Constance. ⇑
4 - Il s'agissait de M. La Mare, ou Lamare, ingénieur brillant, qui demeura au Siam et y entreprit de nombreux travaux. Dans son ouvrage L'Europe et le Siam du XVIe siècle au XVIIIe siècle - Apports culturels, 1993, p. 181 et suiv., Michel Jacq-Hergoualc'h énumère les projets de fortifications élaborés par l'ingénieur : Nakhon si Thammarat (Ligor), Phattalung (Bourdelun), Songkhla (Singor), Inburi (Inbourie) Lopburi (Louvo), Mergui, etc. Mais c'est Bangkok, la clé du royaume, qui devrait constituer pour lui une priorité. Toutefois, les travaux n'avancèrent guère, et lorsque l'ambassade Céberet - La Loubère arriva au Siam en 1687, presque rien n'était fait, et Vollant des Verquains, ingénieur certainement moins brillant, mais particulièrement imbu de lui-même, accabla de reproches et de sarcasmes le pauvre La Mare, accusé de grave incompétence. ⇑
5 - Bangkok et Mergui (aujourd'hui en Birmanie) étaient considérées comme les clés du royaume de Siam. Ces villes avaient été offertes par Phaulkon comme sur un plateau, avec la ville de Singor (aujourd'hui Songkhla), dont les Français ne voulurent pas. Le plan de Phaulkon est dévoilé dans les instructions secrètes qu'il laissa au père Tachard avant le départ de l'ambassade du chevalier de Chaumont : Il faut faire venir dans les navires du roi soixante ou soixante-dix personnes fort intelligentes dans le maniement des affaires, et si le Père général voulait envoyer quelques pères de la compagnie qui fissent partie de ce nombre, il est nécessaire qu’ils soient habillés en laïques, et que même ceux avec qui ils seront ne les connaissent point. Je me charge de leur procurer les avantages les plus notables qui soient au royaume de Siam, comme de les faire gouverneurs de provinces, villes forteresses, de leur faire donner le commandement des armées de terre et de mer, de les introduire dans le palais et dans le gouvernement des affaires ; même de faire tomber sur eux les principales charges de la maison du roi, et de m’en servir comme conseillers dans mes négociations et affaires. Et afin que l’on ait un prompt et infaillible succès, il faut bien faire entendre au roi la nécessité qu’il y a de s’emparer tout d’abord de Singor, où il est important d’amener deux bonnes colonies et des gens de guerre, parce qu’une fois que la place sera prise, on n’a plus rien à craindre. (Launay, op. cit., 1920, I, pp. 179-180). Toutefois, M. du Bruant ne pourra partir pour Mergui que vers la mi-février 1688, soit un mois et demi après le départ des ambassadeurs français. ⇑
6 - Phra Phetracha (พระเพทราชา) était général chargé des éléphants royaux. On consultera sur ce site la page qui lui est consacrée. ⇑
7 - Cette brutale dégradation pourrait étayer la rumeur selon laquelle le roi aurait été empoisonné. Les Archives Nationales conservent une déclaration du français Jean Rival, ancien gouverneur de Phuket, (AN Cl 25, fs. 58-59) et datée du 25 novembre 1691 qui révèle qu'une conjuration s'était nouée entre Phetracha, le capitaine de la loge hollandaise, le médecin de la VOC Daniel Brouchebourde et quelques mandarins pour faire mourir le roi : Ok Pra Phetracha demanda au capitaine hollandais : comment pouvons-nous entreprendre cette affaire ? Le capitaine hollandais fit répondre à Daniel qui lui servait d'interprète : il faut que vous fassiez donner du poison lent au roi, et Daniel le préparera, et Ok Meun Sri Meun Chaya, qui est auprès du roi, le donnera au roi, et quand le roi se trouvera un peu atteint, il faut que Ok Meun Sri Meun Chaya vous donne le cachet du roi, et surtout, si Ok Pra Vitticamheng apportait des médecines pour les donner au roi, il faut que Ok Meun Sri Meun Chaya ne les donne pas au roi, sinon celles que Daniel lui donnera, et tant qu'il pourra empêcher Ok Pra Vitticamheng d'approcher du roi. ⇑
8 - La faiturie, ou factorerie, ou encore factorie, était le bureau où les facteurs, les commissionnaires, faisaient commerce pour le compte de la Compagnie. On appelle ainsi dans les Indes orientales et autres pays de l'Asie où trafiquent les Européens, les endroits où ils entretiennent des facteurs ou commis, soit pour l'achat des marchandises d'Asie, soit pour la vente ou l'échange de celles qu'on y porte d'Europe. La factorie tient le milieu entre la loge et le comptoir ; elle est moins importante que celui-ci et plus considérable que l'autre. (Encyclopédie de Diderot et d'Alembert).
 La loge de la VOC au Bengale en 1665. ⇑
La loge de la VOC au Bengale en 1665. ⇑

18 février 2019
