

3ème partie.
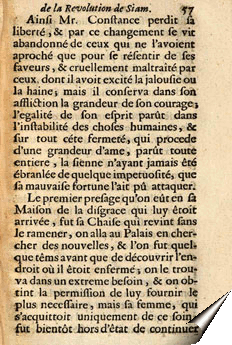
Ainsi M. Constance perdit la liberté, et par ce changement se vit abandonné de ceux qui ne l'avaient approché que pour se ressentir de ses faveurs et cruellement maltraité par ceux dont il avait excité la jalousie ou la haine ; mais il conserva dans son affliction la grandeur de son courage. L'égalité de son esprit parut dans l'instabilité des choses humaines, et surtout cette fermeté, qui procède d'une grandeur d'âme, parut toute entière, la sienne n'ayant jamais été ébranlée de quelque impétuosité que sa mauvaise fortune l'ait pu attaquer.
Le premier présage qu'on eut en sa maison de la disgrâce qui lui était arrivée, fut sa chaise qui revint sans le ramener (1) ; on alla au palais en chercher des nouvelles, et l'on fut quelque temps avant que de découvrir l'endroit où il était enfermé. On obtint la permission de lui fournir le plus nécessaire, mais sa femme, qui s'acquittait uniquement de ce soin, fut bientôt hors d'état de continuer à soulager son mari. Elle fut gardée à vue dans sa maison que les Siamois pillèrent quatre jours après, ayant passé par-dessus plusieurs formalités, quoiqu'ils feignissent de les vouloir observer. Ces barbares, après s'être saisi de toutes les richesses qui se trouvèrent sous leurs mains, n'étant pas encore assouvis de tant de biens, se persuadèrent que M. Constance avait détourné beaucoup de ses effets, et pour l'obliger à déclarer ses trésors cachés, ils mirent sa femme à la torture, ce qui fut un spectacle bien douloureux pour sa famille de la voir traitée par des bourreaux d'une manière impitoyable.
Mais laissons là cette histoire qui fait horreur et supprimons les circonstances de cette sanglante tragédie qui s'est passée au logis de M. Constance pour revenir au palais, où le roi et celui qui régnait alors étaient deux personnes différentes. Le reste de la vie de ce prince ne fut plus qu'un misérable interrègne durant lequel, n'ayant plus aucun pouvoir, il paraissait autoriser tout le mal qui se faisait. Enfin ce n'était plus que son effigie qu'on servait et à qui on rendait quelques devoirs, tous les grands ayant entièrement secoué le joug de la puissance légitime et naturelle pour se ranger sous celle d'un usurpateur. Ce prince si malheureux apprit le désastre de son ministre et en témoigna une extrême douleur. Pour surcroît d'ennuis, deux jours après, on lui enleva de sa chambre l'unique consolation qui lui restait. C'était Mompi qui s'y étant cherché un asile en fut enlevé de force par ordre de Pitracha et fut massacré dans l'antichambre, son corps exposé publiquement à la grande porte du château, la tête jetée par opprobre dans la prison, aux pieds de M. Constance, en lui disant ces mots : Voilà ton roi, quoique quelques-uns uns aient raconté qu'on la pendit à son cou pour marquer qu'il était complice de sa trahison.
Pendant que toutes ces violences se commettaient à l'ombre de la nouvelle autorité, Pitracha qui croyait à peine ce qu'il voyait du procédé des Français envers M. Constance, lequel semblait leur être devenu indifférent quoiqu'ils fussent redevables de leur établissement dans le royaume aux seuls soins de ce ministre, craignit que sa chute ne leur fît ouvrir les yeux et qu'ils n'entreprissent quelque chose en sa faveur. Il ne souhaitait pas apparemment d'avoir cet obstacle à surmonter par la force pendant que les affaires demeureraient encore indécises et en suspens durant la vie du roi, et qu'il avait la faction des princes à redouter qui aurait pu se prévaloir de ces inconvénients. Comme il était rusé et fin politique, il envoya un mandarin faire civilité à M. Desfarges et le prier de ne se point alarmer de ce que le roi avait fait arrêter M. Constance, que Sa Majesté était toujours dans la résolution de maintenir la bonne intelligence avec le roi de France, et qu'il n'avait rien diminué de l'estime et de la considération singulière qu'il avait pour la nation, l'assurant au reste comme par manière de confidence, qu'une des principales raisons qui avaient causé la disgrâce du ministre, c'était que le roi avait remarqué en lui moins de zèle qu'à l'ordinaire pour les intérêts d'une couronne pour laquelle il prétendait que tous ses sujets fussent aussi bien intentionnés que lui. Un autre mandarin alla aussi de sa part vers MM. les évêques des Missions-Étrangères avec une lettre où il leur mandait de le venir trouver à Louvo pour des affaires importantes, et d'être bien persuadés que ce qui était arrivé n'apporterait aucun préjudice à la religion chrétienne ni à l'intérêt de la nation.
Il est vrai néanmoins que ni l'un ni l'autre n'étaient pas encore à se ressentir du changement qui était arrivé ; et tandis que Pitracha faisait mine de vouloir maintenir la paix et qu'il envoyait prévenir par des compliments affectés les prélats et le gouverneur de Bangkok, il faisait mettre aux fers tout le christianisme de Louvo, et ce n'était point à son insu ni sans dessein de lui plaire qu'on venait de maltraiter des officiers français d'une manière qu'on n'eût point exercé envers des ennemis dans la plus rude et la plus forte guerre.
L'occasion fut que quelques-uns, au nombre de huit, appréhendant les suites du tumulte et de la confusion qui étaient à la cour, songèrent à profiter du peu de liberté qu'on leur laissait pour quitter un séjour où ils ne voyaient plus rien que de funeste et se rejoindre aux leurs. Toute la difficulté était de tromper la vigilance d'un garde que le tyran leur avait donné pour observer leurs démarches et répondre de leurs personnes (2).
Ils le firent heureusement, et afin que, si on s'apercevait de leur évasion, on les cherchât où ils ne seraient pas, ils prirent des chevaux et tournèrent du côté de la rivière, résolus de s'emparer de la première commodité que le hasard leur offrirait. Il ne s'y trouva qu'un balon plein de talapoins, qui, surpris de leur arrivée, s'enfuirent et les laissèrent maîtres du balon. Étant entrés dedans, ils se flattèrent d'être plutôt rendus à Bangkok que l'on n'eût découvert la route qu'ils avaient prise, s'assurant qu'on ne les soupçonnerait pas d'être sur l'eau.
En effet le garde ayant averti Pitracha de leur fuite, il mit après eux une troupe de trois cents Maures bien montés qui les poursuivirent sur le chemin qui conduit par terre à Siam. Ce fut inutilement : il n'y parut aucun vestige des fugitifs. Cela leur donna à penser qu'ils seraient peut-être retranchés dans une pagode qui était aux environs. Ils y allèrent, et l'investirent avec cette précaution qu'ils n'avancèrent pas trop près et qu'ils se tinrent toujours éloignés de la portée du mousquet. De temps et temps ils envoyaient quelqu'un des leurs avec un Siamois, qui s'efforçaient par diverses postures de faire signe de loin qu'on se rendît et qu'on s'assurât qu'il ne ferait tort à personne. On dit qu'ils y demeurèrent près de deux jours entiers. Enfin par un effort de hardiesse, il visitèrent la pagode, et n'y ayant rien trouvé de ce qu'ils cherchaient, ils quittèrent honteusement ce poste et perdirent l'espérance de les ramener.
Cependant les talapoins à qui on avait ôté le balon étaient aller soulever le peuple, qui pour venger les prétendues violences commises en leurs personnes, était accouru en foule sur le rivage, et suivant sa pointe avait bientôt atteint le balon qui n'était plus gouverné qu'avec peine par les Français, depuis que leurs rameurs avaient déserté à la faveur de la nuit, s'étant sauvés à la nage sans qu'on s'en aperçût.
Au bruit de cette émotion populaire, nos gens se trouvèrent dans un étrange embarras, mais avant que de se laisser envelopper, ils redoublèrent leurs efforts pour aborder en lieu favorable pour se défendre. Y étant descendus, ils gagnèrent les plaines, espérant de s'échapper de cette populace qui les insultait par des huées insupportables, n'osant néanmoins en venir aux mains avec eux. Mais voyant qu'à la fin ils ne pouvaient éviter d'être enveloppés par cette troupe de peuple qui augmentait toujours, et étant abattus de fatigues et pressés par la faim, ils résolurent entre eux de demander composition (3), ce qu'ils firent, ne se livrant qu'à condition qu'il leur serait donné des vivres. On leur promit, mais on ne leur tint pas parole. Ces bêtes féroces se jetèrent sur eux, et après les avoir dépouillés, les attachèrent par les mains à la queue de quelques chevaux qui furent ensuite poussés au galop à travers les ronces et les épines.
Ils furent encore traités plus inhumainement par ce parti de mahométans qui les avait cherchés et dans lequel ils tombèrent comme on les ramenait à Louvo. Ces barbares, enragés de ce qui s'était passé autour de la pagode, les lièrent au pommeau de la selle de leurs chevaux, en sorte qu'ils ne pouvaient marcher que de côté, et les chargeant à grands coups de rotin, couraient à toute bride. Le tourment fut si rude qu'un ingénieur nommé Breci mourut sous les coups. Le reste après avoir été exposé quelque temps à la raillerie et aux insultes de la canaille fut gardé en prison avec plus de soin (4).
Le mandarin qui avait ordre de faire venir les évêques à la cour n'y revint accompagné que de M. de RosalieArtus de Lionne, évêque de Rosalie. , n'ayant pu amener M. de Métellopolis qui était arrêté par quelque indisposition. On mena le prélat à l'audience de l'usurpateur, qui s'était attribué le maniement de toutes les affaires avec la qualité de régent du royaume. Il le chargea de porter un ordre au gouverneur de Bangkok, l'obligeant de lui remontrer l'engagement où il était de faire ce voyage dont il ne se pouvait dispenser sans rompre la correspondance qui était entre les deux nations. Il voulut aussi que le sieur Véret allât pour le seconder, et joignit encore à leur compagnie le premier ambassadeur siamois venu en France (5) auquel il confia ses plus secrètes commissions.
, n'ayant pu amener M. de Métellopolis qui était arrêté par quelque indisposition. On mena le prélat à l'audience de l'usurpateur, qui s'était attribué le maniement de toutes les affaires avec la qualité de régent du royaume. Il le chargea de porter un ordre au gouverneur de Bangkok, l'obligeant de lui remontrer l'engagement où il était de faire ce voyage dont il ne se pouvait dispenser sans rompre la correspondance qui était entre les deux nations. Il voulut aussi que le sieur Véret allât pour le seconder, et joignit encore à leur compagnie le premier ambassadeur siamois venu en France (5) auquel il confia ses plus secrètes commissions.
Cependant M. Desfarges vivait à Bangkok dans la tranquillité d'un homme qui n'avait rien à craindre, content d'avoir reçu quelque honnêteté de Pitracha et de lui avoir envoyé un placet pour lui demander la liberté de M. Constance et avec le collier de l'ordre de Saint-Michel, qu'on avait ajouté à tous les honneurs que ce ministre avait reçus de la cour de France et auxquels il s'était montré extrêmement sensible (6). N'en recevant pas de nouvelles, il n'en fit pas paraître plus d'inquiétude et rejeta toujours l'avis de ceux qui l'assurèrent du dernier malheur de M. Constance, n'ayant jamais voulu croire qu'on en pût venir à une si déplorable extrémité.
Néanmoins les travailleurs des fortifications de Bangkok diminuaient tous les jours et les mandarins ne paraissaient plus sur le travail comme de coutume (7). Tout cela était un assez mauvais présage qui menaçait des maux qui suivirent peu de temps après. Ce fut pour y prévoir de bonne heure que l'ingénieur en chef s'avisa de proposer à M. Desfarges un expédient pour la sûreté de la place. Il lui représenta que, dans l'incertitude, si on avait le temps de relever deux bastions auxquels on n'avait encore rien fait, il ne serait pas mauvais de munir l'un et l'autre d'un bon retranchement de palissade que l'on avait toutes prêtes, ajoutant que c'était une précaution qui n'empêchait pas d'achever les travaux en cas qu'on en eût le loisir et les moyens, qu'au contraire laissant tout un côté de la place sans défense, il faudrait pour le garder plus de la moitié de la garnison si l'on venait à être assiégé.
M. Desfarges était trop préoccupé de la sincérité de Pitracha et trop désireux de la paix pour approuver un dessein qui pouvait lui donner quelque ombrage et passer pour un signe de guerre. Il fit réponse qu'il se donnerait bien de garde d'en user de manière avec les Siamois qu'ils eussent lieu de soupçonner qu'il craignît une rupture avec eux, puisqu'il ne doutait pas qu'en quelque état qu'ils fussent, ils ne recherchassent l'amitié des Français.
Ce qui le confirma encore davantage en son opinion fut l'arrivée des députés parmi lesquels le sieur Véret le pressa autant pour le faire aller à Louvo qu'il avait fait six semaines auparavant pour l'obliger de n'y point aller. L'évêque de Rosalie suivit aussi cet avis, croyant ce voyage utile aux intérêts de la Mission, et le Siamois l'ayant pris en particulier, lui dit qu'outre le service des deux rois, il y allait encore pour lui non seulement être déchargé de ce que M. Constance avait déposé à son désavantage, mais aussi de se montrer digne de l'estime que Sa Majesté siamoise faisait de sa personne, laquelle il voulait honorer des grands emplois de ce ministre et y faire élever son fils aîné, afin de le rendre capable de les posséder après lui.
Il est aisé de juger que l'appât était grossier et que cette démarche qu'on exigeait de lui l'exposait à un danger bien plus évident que celle que M. Constance n'en avait pu obtenir ; aussi personne n'en pressentit rien d'heureux, et il n'y eut que ceux qui avaient commission de ménager sa venue qui en augurèrent bien, quoiqu'ils sussent aussi bien que les autres ce qu'on avait fait aux officiers français du nombre desquels était un des fils de M. le général. Il partit néanmoins, se flattant de l'espoir qu'on lui avait donné, ou du moins, se promettant que Pitracha en viendrait au terme d'un fort honorable accommodement, et pour marque de la confiance qu'il en avait, il voulut que son fils aîné l'accompagnât. Sur le chemin, il commença de prendre ombrage de ce que son escorte grossissait à mesure qu'il avançait, plusieurs balons se trouvant d'espace en espace qui l'attendaient sur le fleuve. Mais l'accueil qu'on lui fit à son arrivée lui donna entièrement sujet de se repentir de son voyage, et il ne douta plus qu'on ne l'eût attiré sous de fausses promesses pour l'avoir hors de sa place, car il se vit en l'état d'un homme dont on se veut assurer, ayant toujours à ses côtés des soldats bien armés qui le conduisirent à l'audience.
Il trouva le fier Pitracha avec un appareil de souverain, assis sur de riches carreauxCoussins carrés pour s'asseoir ou s'agenouiller., selon l'usage des rois de Siam, avec une cour nombreuse des plus grands seigneurs du royaume et de plusieurs mandarins portant auprès de lui le sabre nu. On avait placé un siège dans un lieu fort au-dessous de lui sur lequel on fit signe au général de s'asseoir, et le grand mandarin, prenant un air de hauteur, l'interrogea avec beaucoup d'insolence sur les articles suivants : savoir pourquoi il était venu quelque temps auparavant dans la capitale avec un gros détachement de ses troupes, et ce qui l'avait obligé de s'en retourner sur ses pas, à quel dessein M. Constance avait eu besoin de leurs armes. Mais surtout dans quelle vue le ministre avait appelé les Français à Siam et ce qu'il avait prétendu de leur établissement dans le royaume. M. Desfarges répondit avec beaucoup de sang-froid qu'il n'avait pas pénétré les intentions de M. Constance, mais qu'ayant ordre de faire ce qu'il souhaiterait, il n'avait pu lui refuser de se rendre à la capitale, où ayant appris la mort du roi, il avait jugé à propos de n'embrasser aucun parti et de laisser aller les choses selon les lois du pays, toujours prêt de rendre au monarque héritier de la couronne les mêmes devoirs dont il s'était acquitté envers le feu roi ; qu'au surplus le roi son maître ne lui avait ordonné que de commander ses troupes dans les Indes, et de faire tout ce qui serait de son service et de celui du roi de Siam. Cette réponse fut interprétée sur-le-champ par l'évêque de Rosalie, mais à peine se donna-t-on la patience d'écouter. On prit occasion des derniers mots pour lui répartir que le service de Sa Majesté siamoise demandait donc qu'il menât toutes ses troupes contre les Laos ses ennemis, et que pour cet effet, il fallait qu'il envoyât un ordre à celui qui commandait en son absence dans Bangkok d'en sortir incessamment avec toute la garnison et de le venir joindre. Le général répondit que son ordre n'aurait pas le succès qu'on en espérait, à cause que la discipline de France était qu'un commandant hors de son poste n'y était plus ouï, mais que si on lui permettait d'y aller lui-même, il engageait sa parole de faire ce qu'on désirait, à quoi Pitracha ayant consenti, il fut convenu que pour sûreté de l'exécution, M. Desfarges laisserait ses deux fils comme en otages à Louvo.
Il ne put néanmoins s'empêcher d'écrire au gouverneur de Mergui, quelque raison qu'il apportât pour s'en excuser. Pitracha voulut dicter lui-même la lettre, où il marquait au commandant l'endroit que se devait faire la jonction de ses troupes avec celles de Bangkok. Au lieu de signature il y fut mis selon la manière des Siamois un sceau de cire rouge. Mais M. Desfarges avait tout sujet de croire qu'un ordre de la façon de celui-là serait de nul crédit auprès de M. du Bruant, n'ayant ni la forme ni le style français, à cause que M. de Rosalie avait interprété mot pour mot ce que le Siamois avait prononcé.
Après avoir promis et fait ce qu'on voulait, le général des Français fut régalé de quelques présents et reçut des marques de faveur non commune, sur ce qu'on le trouva de si bonne composition et qu'on se flatta de retirer par douceur la forteresse d'entre ses mains. Cependant ce n'était aucunement ses intentions, et néanmoins il laissait ses enfants et ses amis exposés au ressentiment des barbares qui ne pouvait pas manquer d'éclater et de causer des effets bien funestes, quand ils sauraient qu'il les avait trompés ; pour lors il n'en eurent aucune défiance, au contraire Pitracha, voyant les Français si traitables, ne balança plus s'il se déferait de M. Constance, ne le voulant pas garder dans un lieu où il s'attendait qu'ils dussent venir.
C'était un homme qui s'était rendu trop considérable à son parti, et qu'il regardait comme la principale victime qui devait être immolée à la sûreté de son nouveau gouvernement ; c'est pourquoi le même jour que M. Desfarges partit de Louvo qui fut le cinquième juin, veille de la Pentecôte, il ordonna son dernier supplice et en remit l'exécution à l'Oya Soyatan son fils (8). Outre les rigueurs de sa prison, on lui fit endurer plusieurs tourments dont on n'a point su les particularités, pour arracher les confessions qu'on voulait tirer de lui touchant le crime de Mompi, dont on l'accusait d'être complice. On ne sait point ce qu'il avoua ou ce qu'il n'avoua pas, on a seulement su que ces tourments l'avaient tellement affaibli qu'il ne pouvait plus se soutenir. Sans garder aucune forme requise en pareil cas, on lui signifia qu'il fallait mourir, et au coucher du soleil, on le mit sur un méchant palanquin de bambou, et ainsi il fut porté hors les portes de Louvo à l'entrée d'une forêt, où ayant eu le temps d'achever sa prière et voyant la mort prochaine, il prit le ciel à témoin de son innocence et protesta en langue siamoise devant la nombreuse escorte qui l'avait conduit au supplice qu'il mourait plein de zèle et d'affection pour le service de son roi et le bien de l'État, dont les lois lui avaient toujours été saintes et inviolables ; quelques soins que ses ennemis eussent pris pour faire douter de sa fidélité, qu'il leur pardonnait de bon cœur, comme il désirait que le vrai Dieu lui pardonnât ses fautes particulières, et après avoir confié à Soyatan le collier de Saint-Michel et un reliquaire qu'il portait sur lui, le priant de le donner à son fils et de conserver à sa femme, non pas les biens, mais seulement la vie et la liberté, il fut mis à mort, sa tête lui ayant été enlevée de son corps, lequel on coupa ensuite par le milieu du ventre, et on le jeta au même endroit dans une fosse, ainsi que l'ont rapporté les gens du pays, car on n'a pas appris qu'aucun Européen ait été présent à l'exécution.
Voilà quel fut le sort tragique de l'infortuné Monsieur Constance connu dans les Indes sous le nom et dignité d'Oya Vitraigent (9), dont le vrai nom était Constantin Faulkon, l'autre lui ayant été donné par abus et lui étant demeuré par coutume. Il avait eu au commencement plus de naissance que de fortune, car il était fils d'un noble vénitien, et durant ses premières années, il fut réduit au service des Anglais de la Compagnie d'Orient, mais il eut toujours plus de courage et de grandeur d'âme que de naissance et il se montra digne des plus grands emplois, après s'être volontairement assujetti aux plus petits. Il devait le commencement de sa fortune au malheur qu'il avait eu dans le commerce, s'étant introduit à la cour de Siam par une générosité qu'il exerça envers un grand de ce royaume, il s'y fit valoir par des services importants, ayant eu la force de résister à un parti qui faillit à renverser l'État (10), et s'y mit en crédit par la seule recommandation de son mérite. Aussi c'était un homme d'un jugement exquis et d'une expérience consommée. le roi de Siam qui le reconnut et qui aimait les étrangers habiles gens, donna des preuves d'estime et d'affection à sa sagesse et à sa vertu, et après la mort du barcalon le voulut mettre en sa place, mais il s'en excusa, se contentant de posséder en effet toute l'autorité avec les bonnes grâces du prince sans s'attirer l'envie de cette première dignité.
Il était bien juste qu'il ne départît pas des honneurs communs à un sujet où le ciel avait versé ses grâces ; depuis que par les soins du père Thomas Maldonat, jésuite de Mons en Hainaut (11), il était entré dans le sein de la vraie Église, après avoir renoncé aux erreurs de la religion protestante dans laquelle il avait été élevé parmi les Anglais. Si malgré ses nobles et pieux desseins et les mesures qu'il avait prises pour les conduire à leur entière perfection il a succombé sous l'effort de ses ennemis, ses disgrâces n'ont rien qui déshonore, au contraire on jugera qu'elles lui ont été glorieuses, si l'on tient pour maxime que les seules fautes que nous faisons sont les seuls malheurs qui nous arrivent et que la consolation que reçoit un homme qui ne perd point par son imprudence, mais par l'infidélité d'autrui, est préférable aux bons succès de celui qui gagne par son crime, et non par la vertu.

NOTES :
1 - Un manuscrit anonyme intitulé Relation succincte du changement surprenant arrivé dans le royaume de Siam en l’année 1688 conservé aux Archives Nationales (C1/24 f° 130v-139v) confirme ce retour du palanquin de M. Constance vide de son occcupant : Il [Phaulkon] se rendit à la cour le 19 mai avant midi, fut de là dîner chez lui et donner ordres à quelques affaires. Il lui échappa de dire à sa garde européenne que la nuit suivante, on devait exécuter une entreprise considérable qui ferait changer entièrement les affaires. Il la quitta fort inquiet et retourna à la Cour, mais comme ses domestiques virent un peu de temps après revenir son palanquin d'argent sans lui, ils en tirèrent un mauvais augure et ils apprirent un moment après que leur maître avait été arrêté avec le fils adoptif du roi et le capitaine des gardes, et mis en prison, et eux-mêmes furent aussi arrêtés, menés au palais et mis aux fers. (f° 131r). ⇑
2 - Les relations diffèrent quant au nombre de captifs français qui furent les acteurs de cet épisode. On peut citer sûrement le chevalier Desfarges, fils cadet du général, le chevalier de Fretteville, Saint-Vandrille, peut-être Delas, et un officier nommé Des Targes, dont le nom apparaît dans la relation de La Touche, et qui est confondu avec Des Farges dans la relation du père Louis Le Blanc. L'ingénieur qui périt dans cette aventure se nommait Brécy, ou Bressy. ⇑
3 - Furetière donne pour définition de ce mot, capitulation, traité, accord où l'on fait grâce ou remise. Selon Littré, on appelle composition un accord entre deux parties qui transigent sur leurs prétentions respectives. ⇑
4 - Cette démonstration de barbarie souleva l'indignation de tous les Français. Dans une lettre du 27 décembre 1693 adressée à M. Brisacier, supérieur des Missions-Étrangères, Kosapan, qui fut ambassadeur du roi de Siam en France en 1686 et rallia le parti de la révolution à son retour dans le royaume, donne une version un peu différente des évènements : De plus, les fils de M. le général et les autres officiers qu'il avait laissés à Louvo pour gage de sa parole, étant allés se promener à cheval comme ils faisaient quand ils le désiraient, s'enfuirent et voulurent se rendre à Siam, et ne sachant pas que c'était les enfants de M. le général, ni des officiers français, mais croyant voir là quelques Anglais et gens de la faction de M. Constance, les poursuivirent, se saisirent de plusieurs d'entre eux qui s'étaient déjà embarqués sur la rivière et de plusieurs qui étaient encore à terre ; les ayant attachés, elles les ramenèrent à Louvo. Aussitôt que les mandarins eurent connus que ce n'étaient pas des gens de la faction de M. Constance, mais les enfants de M. le général avec les officiers français, ils les firent détacher, et leur donnèrent des hommes qui eussent soin de les traiter et nourrir, comme auparavant, dans leur maison. Il est vrai que l'ingénieur, se voyant poursuivi et pressé par les sentinelles, donna plus de peine à prendre que les autres ; mais après avoir bien couru de côté et d'autre, étant extrêmement fatigué, il s'arrêta pour se reposer ; aussi il tomba comme évanoui ; on fit ce qu'on put pour le soulager, mais les remèdes qu'on lui donna furent inutiles : il mourut. (Adrien Launay, Histoire de la Mission de Siam, 1920, I, p. 285). ⇑
5 - Voir sur ce site la page consacrée à Kosapan. ⇑
6 - En 1687, La Loubère avait apporté à Phaulkon de la part de Louix XIV le brevet de l'ordre de Saint-Michel, des lettres de naturalité, le droit de porter trois fleurs de lys d'or dans ses armes, et pour son fils, le don d'une terre de trois mille livres de rente avec le titre de comte. (Lanier, Étude historique..., 1883, p. 96). ⇑
7 - Beauchamp, major de Bangkok, révèle que Vollant des Verquains ne faisait rien pour stimuler l'ardeur des Siamois qui travaillaient aux fortifications ; pis encore, s'il faut en croire ces fielleuses et savoureuses confidences, il utilisait cette main-d'oeuvre à des fins strictement personnelles : M. Desfarges fut fort surpris d'apprendre à son retour que Vollant, ingénieur, s'amusait à faire des maisons de plaisance ; qu'il débauchait sous main des ouvriers de la place ; qu'il en avait tiré jusqu'à trente en un seul jour ; qu'il avait fait démolir en partie une très belle maison que les missionnaires lui avaient prêtée, pour la rendre plus spacieuse, comme aussi il en avait fait bâtir une entière à un quart de lieue de celle-là sur le bord de la rivière, à quatre pavillons, avec une grande ménagerie, ce qui fut cause que les Siamois qui travaillaient à Bangkok se plaignirent de lui à M. ,Desfarges sur ce qu'il leur enlevait leurs travailleurs. Ce fut sur ces plaintes et sur ce que M. ,Desfarges s'aperçut qu'ils n'étaient plus si assidus aux travaux, qu'il lui dit qu'il ne prétendait pas qu'il quittât les travaux du roi pour bâtir des palais ; qu'il devait se ressouvenir que, manque d'application, les fortifications qu'il conduisait de la place ne valaient rien : que le bâtardeau qu'il avait fait construire pour retenir l'eau dans les fossés s'était éboulé, en un mot qu'il voulait qu'il fît ce qu'il était obligé de faire ; que ce n'était pas ainsi qu'on gagnait l'argent du roi, et que s'il continuait il en écrirait à la cour. Vollant lui répondit brusquement qu'il s'en souciait fort peu et qu'il en écrirait aussi. M. ,Desfarges, indigné d'une telle réponse, le mit lui-même en prison, où il ne demeura que deux heures, parce qu'il pria le sieur de la Salle, commissaire, de dire à M. ,Desfarges qu'il lui demandait pardon et qu'il tâcherait de le mieux contenter à l'avenir. (Bibliothèque Nationale, manuscrit Fr 8210, f° 514r-515v). ⇑
8 - Fils de Petratcha, Sorasak ou Luang Sarasak (หลวงสรศักดิ์) devint à la mort de son père, en 1703, le 33ème roi d’Ayutthaya sous le titre de Sanphet 8 (สรรเพชญ์ที่ ๘), mais il reste surtout connu sous le surnom de Phra Chao Süa (พระเจ้าเสือ : le roi tigre). W.A.R. Wood brosse ainsi son portrait : Ce fut un homme cruel, intempérant et dépravé. Turpin dit qu’il a épousé la princesse Yothathep, une des veuves de son père [par ailleurs fille de Phra Naraï]. Une des portes de son palais était connue sous le nom de Porte des Cadavres en raison du grand nombre de petits cercueils qui en sortaient, contenant des enfants assassinés victimes de sa luxure et de sa cruauté. (…) Le roi Tigre, usé par l’alcool et la débauche, mourut en 1709, terminant ainsi un règne court et peu glorieux. (A history of Siam, 1924, pp. 225 et suiv.). ⇑
9 - Phaulkon était connu au Siam sous le titre de Chao Phaya Wichayen (เจ้าพระยาวิชเยนทร์). ⇑
10 - Vollant des Verquains désigne ici les Maures qui s'étaient rendus coupables de malversations et détournements des deniers de l'État et qui furent dénoncés au roi par Phaulkon. L'abbé de Choisy évoque l'anecdote dans son Journal du 29 septembre 1685 : Il a découvert les friponneries des mahométans, qui étaient les maîtres des affaires avant qu’il s’en mêlât. C’est par-là qu’il s’est élevé. ⇑
11 - Vollant des Verquains fait une confusion : Thomas Maldonat désigne en fait deux jésuites : Antoine Thomas, (1644-1709) et Jean-Baptiste Maldonat (1634-1699). Par ailleurs, nous n'avons trouvé aucun document confirmant d'éventuelles origines protestantes de Jean-Baptiste Maldonat élevé parmi les Anglais, et cette affirmation de Vollant des Verquains paraît tout à fait fantaisiste, voire totalement erronée.
Antoine Thomas, jésuite flamand, fut un remarquable mathématicien, astronome et cartographe. Il s'embarqua pour l'Extrême-Orient en 1680 et atteignit Goa, avant d'essayer en vain de gagner le Japon, alors fermé aux étrangers. Il se trouva au Siam en 1681 et c'est vers cette époque qu'il convertit Phaulkon. On le retrouve à Pékin en 1686 où il occupe les fonctions de collaborateur et secrétaire de Ferdinand Verbiest, président du Tribunal des mathématiques à la cour de l'empereur Khang Xi. Il succède à son compatriote à la mort de ce dernier en 1688, puis laisse la place à Claudio Filippo Grimaldi en 1694. Il continuera son oeuvre apostolique en Chine, réalisant de nombreuses cartes géographiques jusqu'à sa mort à Pékin en 1719.
Jean-Baptiste Maldonat, (1634-1699) jésuite né à Mons, s'établit au Siam en 1673 et se trouve dès cette époque au cœur de la querelle qui oppose les Portugais aux évêques apostoliques français, à qui tous les religieux sont tenus de prêter serment. Le père Maldonat, d'abord réticent se range finalement aux consignes de Rome et fait allégeance à Mgr Laneau en 1681. Il se trouve au Siam en 1686 et entretient d'excellentes relations avec les six jésuites mathématiciens. Lors de la révolution de Siam et des persécutions qui la suivent, il assiste les prisonniers, parmi lesquels ne se trouve qu'un seul jésuite français, le père de la Breuille. ⇑

18 février 2019
