

4ème partie.
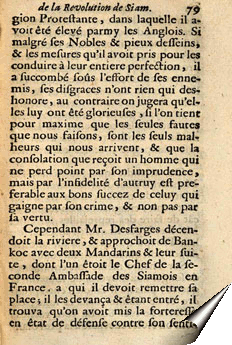
Cependant M. Desfarges descendait la rivière et approchait de Bangkok avec deux mandarins et leur suite, dont l'un était le chef de la seconde ambassade des Siamois en France, à qui il devait remettre sa place. Il les devança et étant entré, il trouva qu'on avait mis la forteresse en état de défense contre son sentiment, dont il était pour lors bien revenu. Il fit d'abord assembler le conseil de guerre, il exposa la réception qu'on lui avait faite à Louvo et la promesse qu'on avait exigée de lui. Sur quoi tous les avis furent qu'il fallait se tenir dans son poste et s'y défendre jusqu'à la dernière extrémité, n'y ayant pas lieu de douter que le prétexte d'aller combattre les Laos ne fût un artifice pour les avoir en rase campagne et les exterminer tous.
On attendit quelque temps les mandarins pour leur déclarer la résolution du conseil, mais ils n'osèrent venir, craignant qu'on commençât de faire des représailles sur eux. M. Desfarges fit avertir le chef de leur troupe, qui s'excusa sur une indisposition qui lui était survenue.
Sur l'heure même on commença de songer aux moyens de soutenir la guerre, puisqu'il fallait l'entreprendre, et de subsister dans la suite. On délibéra de tuer 80 ou 100 vaches, dont on était redevable à la prévoyance de M. Constance et de les saler, mais il se trouva qu'il manquait de sel dans les magasins. Dans l'embarras où l'on était, il passa devant Bangkok une somme chinoise, c'est un grand bâtiment à trois mats fort relevé de bord et fait à plate varangue afin d'entrer facilement dans toutes les rivières qui sont au-delà des détroits, lesquelles sont toutes barrées à leur embouchure.
Ayant eu avis que sa cargaison était de sel et de poivre, on envoya un officier avec quatre mousquetaires à bord de ce bâtiment pour y acheter ce qui était nécessaire, mais le capitaine en refusa à quelque prix que ce fût et on n'en put rien obtenir, ni par prière ni par menaces ; au contraire l'officier lui ayant dit en le quittant qu'on allait tirer sur lui avec le canon de la forteresse, il répondit fièrement qu'il en avait aussi dans sa somme, se laissant néanmoins toujours dériver par la marée. Son refus ayant été rapporté à M. Desfarges, il ordonna de lui envoyer plusieurs volées de canon qui furent sans effet, mais le Chinois ne répondit pas des siens, comme il l'avait promis.
Bangkok, qui est la clé du royaume de Siam du côté de la mer du sud, a deux forteresses, l'une à l'ouest de la rivière, l'autre vis-à-vis, qui avait été rebâtie de nouveau et fortifiée plus régulièrement par les Français (1). Les mandarins qui étaient demeurés dans le fort de l'ouest, ayant ouï le bruit du canon, jugèrent que c'était le signal de la guerre et partirent promptement pour en porter la nouvelle à Pitracha, pendant que le Siamois gouverneur de la contrée allait de tous côtés ramasser des milices et prendre les précautions nécessaires pour prévenir la suite des hostilités qui commençaient.
De l'autre côté, M. Desfarges mit en délibération qu'il était expédient de s'emparer des deux forteresses ou de se retrancher tous dans celle qui était la mieux fortifiée ; sur quoi l'ingénieur en chef ayant été consulté, fit son rapport de l'état des deux places et représenta la difficulté qu'il y avait de les garder ensemble, tant à cause du petit nombre de troupes qui suffisaient à peine pour occuper tous les postes du fort de l'est, qui était le plus sûr, que parce que la communication ne se pouvant faire de l'une à l'autre que par bateaux, il était à craindre qu'on ne pût se secourir mutuellement si l'on était attaqué pendant que la marée serait basse et les chaloupes échouées.
Pour ces considérations, on abandonna la même nuit le fort de l'ouest, on fit transporter dans l'autre toutes les munitions qu'on pût emporter et détruire ce qu'on fût contraint de laisser ou dont on pouvait se passer. On fit crever le canon et l'on enclouaEnclouer un canon, c'est enfoncer avec force un clou dans la lumière de ce canon pour empêcher qu'on ne puisse s'en servir. (Littré). ceux qu'on ne pût faire crever, on éboula les parapets, on démolit les magasins et dès le lendemain matin on commença de canonner ce fort sans relâche trois jours durant afin de le mettre tout à fait hors d'état de servir aux ennemis.
A peine avait-on cessé de tirer qu'on s'aperçût que les Siamois travaillaient en diligence à la réparation du fort, y ayant fait entrer du monde pour le mettre en défense et observer en même temps la contenance des Français. On jugea qu'il fallait les aller repousser, et M. Desfarges y envoya un détachement de trente hommes commandé par un capitaine, un lieutenant, un enseigne, qui furent mis dans deux chaloupes. Ils traversèrent ainsi le fleuve, et ayant mis pied à terre sur l'autre rive, posèrent des échelles contre la muraille et montèrent sur le rempart. D'abord les Siamois prirent la fuite, mais soutenus d'un très grand nombre des leurs, ils revinrent aussitôt vigoureusement à la charge et pressèrent tellement les Français qu'ils furent obligés de sauter du haut du rempart en bas, où ayant à essuyer le grand feu de la mousqueterie des ennemis, ils remontèrent dans leurs chaloupes avec beaucoup de confusion. Il y eut dans cette rencontre quatre soldats tués sur la place et six dangereusement blessés, dont quatre moururent ensuite de leurs blessures.
On ne saurait dire combien cet avantage enfla le cœur aux Siamois qui commencèrent à voir que les Français n'étaient pas si invincibles qu'ils l'avaient cru. Dès le lendemain, ils élevèrent sur les ruines du vieux cavalierTerme de fortification : un cavalier est un amas de terre dont le sommet compose une plate-forme sur laquelle on dresse des batteries de canon pour nettoyer la campagne ou pour détruire quelque ouvrage de l'ennemi. de leur fort, un autre cavalier de bois construit de plusieurs troncs d'arbres de coco, dont l'assemblage était si mal entendu qu'il tomba de lui-même, et ce prodigieux travail qui n'était pas de l'invention des barbares, et duquel on leur avait fait espérer de grand succès, leur fut par après fort incommode à cause qu'étant devenu inutile, il empêchait encore l'usage de celui sur lequel il avait été bâti. Il est vrai néanmoins qu'ils en eussent tiré beaucoup d'avantages s'il avait pu subsister, car, de sa hauteur on découvrait jusqu'au pied intérieur du rempart de la forteresse des Français.
Les Siamois s'appliquèrent ensuite à former des redoutes qui resserrèrent étroitement les assiégés dans leurs places. Les premières en étaient éloignées de deux à trois portées de mousquet, mais insensiblement, ils s'avancèrent jusqu'à la contrescarpe et à une petite portée de pistolet de la place. M. Desfarges souffrit toutes ces insultes sans y vouloir donner ordre, ayant au contraire défendu de tirer sur les travailleurs sous prétexte de ménager sa poudre, dont à la fin du siège, il lui resta environ seize à dix-sept milliers (2) de vingt que le vaisseau du roi avaient apportés dans Bangkok. Il n'avait pas tenu à M. Constance qu'il n'y en eût dans les magasins une plus grosse provision, mais le gouverneur n'avait pas jugé cela nécessaire et avait remercié le ministre toutes les fois qu'il en avait voulu envoyer.
Pour plus grande précaution, les Siamois envoyèrent beaucoup de monde pour garder le bas de la rivière, lesquels depuis l'embouchure jusqu'à cinq lieues de Bangkok firent élever sept batteries qui contenaient en tout 180 pièces de canon dont la meilleure partie appartenait aux Hollandais, qui leur avaient encore fourni plusieurs autres munitions, et barrèrent la rivière de palissades en trois endroits différents, et ils y mirent une forte garde pour empêcher qu'on ne pût entrer ni sortir sans leur permission.
Ainsi on ôtait aux Français l'espérance de se sauver ou d'être secourus, et ils étaient réduits à la dure nécessité de languir quelque temps, et à la fin d'aller chercher une mort assurée parmi leurs ennemis, laquelle ils ne pouvaient éviter dans leurs propres retranchements quand ils auraient consumé le peu qu'ils avaient de nourriture.
Ce fut dans ces tristes conjonctures que le sieur Véret, qui ne s'était pas attendu à des suites si fâcheuses quand il avait détourné M. Desfarges de servir M. Constance, voulut employer toute son adresse et user du crédit qu'il s'était acquis sur l'esprit du général pour tirer, comme on dit, son épingle du jeu. Il tâcha de lui persuader qu'il devait lui permettre de partir de Bangkok avec M. de Rosalie et un autre missionnaire, se servant pour cet effet d'un petit bâtiment qui, faisant voile à l'île de Borneo et ayant été obligé de relâcher, était venu mouiller au pied de Bangkok deux jours avant la déclaration de la guerre. Il lui promettait merveille de la faveur des princes voisins, qui devaient lui accorder à sa prière un secours considérable d'hommes et de vivres. Mais il ajoutait aussi que, connaissant l'humeur des Indiens extrêmement intéressée, il était à propos qu'il emportât avec lui l'argent comptant des missionnaires et du comptoir qu'ils avaient sauvé dans la place, afin qu'il ne tînt point à cela qu'il obtînt d'eux promptement les secours qu'il allait demander.
Un officier qui eut part à cet entretien en donna avis aux principaux de la garnison qui furent sur-le-champ trouver M. Desfarges pour lui remontrer que le sieur Véret leur allait jouer un mauvais tour, puisqu'après avoir mis les affaires au plus mauvais point qu'elle pussent arriver, il cherchait à se mettre à couvert de l'orage ; qu'il pouvait néanmoins partir, s'il était résolu d'aller chez les princes voisins solliciter le secours qu'il en espérait, auxquels il pouvait promettre toutes sortes de satisfactions tant pour les troupes que pour les vivres qu'ils lui fourniraient, mais qu'il ne fallait pas souffrir qu'il emportât l'argent.
En effet, son prétexte n'était pas recevable à des gens qui n'ignoraient pas que de tous les Indiens, il n'y en avait pas un qui, bien loin d'assister, ne voulût avoir égorgé le dernier Européen ; ainsi le sieur Véret ne put obtenir sa demande et fit néanmoins semblant qu'il était bien content de ne point s'exposer à être pris ou brûlé par les Siamois.
On ne laissa pas dès le lendemain de faire mettre à la voile le petit bâtiment, armé de sept hommes de la milice et quinze d'équipage sous les ordres d'un enseigne de vaisseau (3), pour aller ramasser quelques provisions et donner avis de la révolution sur la côte de Coromandel, les Français ne croyant pas d'en porter jamais eux-mêmes des nouvelles en France. La barque descendait la rivière et était déjà à deux lieues au-dessous de Bangkok, lorsqu'elle fut observée par plusieurs mirous, petit bâtiment construit en forme de galère et propre à naviguer le long des côtes. Ils n'osèrent d'abord en approcher, mais s'étant aperçus qu'il n'y avait dedans que deux ou trois hommes qui tinssent mine, ils se mirent en disposition de venir à l'abordage et incontinent ils montèrent dessus en grand nombre.
L'officier qui ne voulait pas tomber entre les mains des barbares, voyant qu'il n'y avait pas moyen de résister, prit la résolution de mourir, mais d'en faire périr bien d'autres avec lui, car ayant disposé auparavant sur sa dunette une partie de ses poudres, il ne la vit pas plutôt couverte d'ennemis qu'il y mit le feu et fit sauter tout ce qui était dessus. Ce rude échec rebuta si fortement les infidèles qu'il ne fut pas possible aux mandarins et aux talapoins de les faire retourner à la charge. Ces derniers s'étaient trouvés à cette expédition pour encourager le peuple par leurs superstitions, lui faisant accroire que le vent de leurs éventails ou parasols avait la vertu de guérir leurs blessures. Ils furent donc obligés de tenter d'avoir par ruse ce qu'ils n'avaient pu prendre par la force ; un des principaux s'avisa de faire crier de loin en langue portugaise qu'on envoyât un homme de la barque, pour lui donner un tarraTra (ตรา) : document officiel, permis, autorisation. ou passeport, ne voulant plus s'opposer à ce que le bâtiment sortît de la rivière.
Le Français, qui l'avait commandé lorsque la compagnie de France avait voulu l'envoyer à l'île de Bornéo, se présenta pour aller chercher le tarra, et ne fut pas plutôt parmi les Siamois que ces perfides, ravis d'avoir entre leurs mains de qui pouvoir s'informer du véritable état de la barque, et le Français content de son côté d'être à l'abri du malheur qui allait tomber sur les autres, ne se fit pas beaucoup prier pour déclarer que de tout l'équipage, il n'y avait que le capitaine et deux soldats qui fussent en état de se défendre, tout le reste étant mort ivre entre deux ponts.
Un pareil avis renfla le cœur des mandarins et des talapoins. Les premiers se servirent de toute leur autorité et les autres de toute leur superstition, distribuant aux soldats des espèces de chapelet dont ils se ceignaient la tête et le milieu du corps, et qu'ils assuraient avoir la vertu de les rendre invulnérables. Malgré tout cela, ce ne fut pas sans peine que ces lâches ennemis se mirent en devoir de recommencer l'assaut, tant ils étaient rebutés.
Le capitaine de la barque, voyant que son homme ne revenait point et que les Siamois le tâtonnaient de tous côtés pour l'aborder une seconde fois, ne douta plus de la perfidie de celui qu'il avait envoyé, et toujours résolu de mourir plutôt d'une mort prompte et soudaine que d'en attendre une longue et cruelle de cette barbare nation, disposa tout ce qui lui restait de poudre, en sorte que le bâtiment pût s'ouvrir et sauter en l'air, avec généralement tout ce qui se trouverait dessus.
Les ennemis, ne voyant paraître aucun homme, ne doutèrent plus de la vérité du rapport que leur avait fait le traître et se résolurent enfin d'aborder le bâtiment ; mais ils le firent avec une quantité de monde si prodigieuse qu'à peine pouvaient-ils se remuer, et crurent que pour être sur le pont de la barque, ils en étaient entièrement les maîtres. Le capitaine qui les avait toujours attendus, voyant qu'il y en avait autant que son bâtiment pouvait en contenir, mit le feu à ses poudres et fit périr avec lui près de cinq cents hommes ; il y eut néanmoins un soldat de l'équipage qui se sauva de l'incendie, s'étant jeté de bonne heure à la nage ; mais ayant pris terre sur le rivage, il y fut tué par les infidèles après en avoir étendu plusieurs sur la place (4).
Pendant que les Français donnaient des marques de leur courage et qu'on les tenait étroitement bloqués dans Bangkok, Pitracha trouvait encore d'autres affaires à démêler. Voyant que la maladie du roi, qui était dégénérée en hydropisie, augmentait tous les jours, il songeait à s'assurer de ses deux frères, légitimes successeurs de la couronne, dont le plus jeune, que plusieurs mandarins voulaient élever sur le trône, n'oubliait rien pour fortifier son parti. Il ne témoigna pas au commencement de s'en mettre beaucoup en peine et il avait ses raisons pour dissimuler, ne jugeant pas qu'il y eût alors assez de sûreté pour lui en déclarant son dessein.
Il continua de feindre et s'en alla trouver ce prince au palais de Siam où le roi le faisait garder. Il lui proposa de se mettre en état de recevoir la couronne dès que le roi son frère serait mort, puisqu'il était celui à qui elle appartenait et qu'il avait d'autant plus droit d'y prétendre que le choix de la princesse sa nièce tombait sur lui, qu'il venait l'en assurer de sa part et le prier de venir auprès d'elle recevoir les témoignages de son affection. Ensuite, pour lui faire mieux entendre le changement de sa fortune, il joignit les effets aux paroles et lui fit la sombaye (5), honneur qu'on ne rend aux rois de Siam qu'à leur avènement à la couronne.
Le prince se laissa prendre à ces amorces et conduire à Louvo, où au lieu de recevoir une couronne, il ne fit que changer de captivité. Pitracha eut quelque contestation avec le gouverneur de Siam pour avoir aussi l'aîné en sa puissance, et ne l'ayant pu obtenir, il envoya ses créatures sous main corrompre les gardes de ce prince, qui le livrèrent à l'insu du gouverneur, et par-là il vit son pouvoir entièrement affermi et son injuste domination respectée de tout le monde.
Pour la mettre entièrement hors d'atteinte, il voulut disposer du sort des princes avant que le roi mourût. Il allait souvent le visiter et ne souffrait pas qu'aucune personne suspecte approchât de lui, de sorte qu'étant comme le seul canal par où ce malheureux prince pouvait se communiquer, il supposait tous les ordres qui devaient venir d'un endroit si digne de vénération et d'obéissance. Il assembla donc le conseil en vertu de l'autorité qu'il avait en main et affecta d'y paraître extrêmement touché de ce qu'il allait proposer.
Il prépara doucement les esprits en racontant les justes raisons que le roi avait de haïr ses frères, et dit que les injures qu'il en avait reçues avaient fait une si grande impression sur son cœur, que tout prêt qu'il était de mourir, il n'en pouvait perdre la mémoire, il voulait en tirer vengeance ; et pour ne leur point laisser un bien dont le désir les avait rendus infidèles et dénaturés, il ordonnait qu'ils fussent mis à mort.
Quoique ce perfide imposteur témoignât qu'il avait horreur de cette action, il pressa néanmoins les mandarins de donner au roi cette marque de soumission à ses dernières volontés ; et il n'y eut personne qui osât lui refuser ce qu'il voulût ; au contraire chacun, avec une complaisance aveugle, consentit à cette exécution dont on lui laissa le soin.
Pitracha tenait les deux frères enfermés et toutes choses prêtes pour leur supplice. Il ne jugea pas qu'il fût à propos de le différer plus longtemps, c'est pourquoi le dix-neuvième de juillet il les livra à un gros détachement de ses plus affidés sous les ordres de Soyatan son fils, qui les conduisit vis-à-vis d'une pagode entre Louvo et Telipouson (6), maison de plaisir du roi de Siam, où ayant été mis chacun dans un sac de velours écarlate, on leur pressa l'estomac avec du bois de santal, qui est le plus précieux des Indes, et ainsi on les étouffa selon la coutume de ces nations qui ne répandent jamais le sang de leurs princes et estiment ce genre de mort le plus honorable.
Ces malheureux princes furent les victimes de l'ambition de Pitracha et les deux derniers degrés du trône où il voulait monter. Il ne craignit plus après cela de faire éclater son dessein, et il n'attendit que la mort du roi pour se faire déclarer son successeur. Elle arriva peu de jours après, pendant lesquels ses derniers soins se tournèrent du côté des révérends pères jésuites, à qui il envoya par son trésorier, à chacun environ cinquante écus, n'en ayant pas davantage à sa disposition. Il leur fit promettre qu'ils témoigneraient au roi de France, qu'il appelait le grand roi, que le plus sensible déplaisir qu'il avait en mourant était de n'avoir pu lui donner jusqu'au dernier moment de sa vie des marques de sa sincère affection, mais que pour avoir été malheureux, il n'en était pas moins digne de son amitié et de son estime. La destinée de ses frères étant venue à sa connaissance augmenta tellement son chagrin et son mal, qu'avec quelque remède violent que peut-être on y ajouta, il mourut le onzième de juillet après avoir gouverné glorieusement son royaume pendant près de trente-deux ans.
La fin de son règne si peu semblable au reste nous met naturellement devant les yeux un tableau en raccourci de l'inconstance et du néant des choses humaines, et nous montre à quoi tient la grandeur des monarques. Il n'y a peut-être point dans le monde de rois dont le pouvoir soit si absolu et respecté que celui des rois de Siam. Personne n'oserait prononcer le nom du roi vivant (7), ses sujets l'adorent comme s'il était leur dieu et le regardent comme le maître de la nature, car lorsque les eaux qui inondent une grande partie du pays la moitié de l'année commencent à s'écouler, il paraît en pompe sur le fleuve, et frappant la surface des eaux de trois coups de sabre, il leur commande de se retirer et de découvrir la terre pour mettre au jour ses moissons (8). Il passe ensuite au milieu de plus de vingt mille hommes qui bordent le rivage, et qui les mains jointes et le visage contre terre, lui rendent les honneurs divins.
Cependant ce dieu mortel voit éclipser la grandeur dès qu'il tombe malade ; il voit immoler devant ses yeux les deux idoles de sa faveur, son fils adoptif et son ministre favori, on y ajoute même ses deux propres frères, et la douleur qui achève de le mettre au tombeau fait monter sur le trône celui qu'il n'y avait pas destiné.
Il faut néanmoins avouer que ceux qui ont plus connu ce prince ont rendu de lui ce témoignage qu'il regardait avec assez d'indifférence ces adorations que ces sujets étaient obligés de lui rendre, et qu'il sentait l'infirmité de sa condition humaine ; aussi avait-il plus de connaissance de la divinité que tous les docteurs indiens, et il en jugeait plus sainement que ces idolâtres n'ont coutume de faire, prenant plaisir à s'informer de la religion, des mœurs et des coutumes des autres nations.
Il donnait un libre accès à tous les étrangers, avec qui il conférait d'une manière affable, n'étant pas toujours comme cloué sur le trône, ainsi que demande l'incommode gravité des rois des Indes.
Au reste il était petit et maigre, mais d'une taille droite et bien prise, d'une physionomie agréable, ayant de grands yeux noirs, vifs, pleins d'esprit. Il parlait vite, ce qui causait souvent du désordre dans ses paroles, il avait le jugement bon, était habile, curieux, actif, vigilant, et attentif à tout ce qui pouvait contribuer à la prospérité de ses affaires et à la gloire de son gouvernement. Il prenait son plus grand divertissement à la chasse des éléphants, il n'aimait pas la guerre parce qu'il aimait le soulagement et le repos de ses sujets : mais quand il ordonnait de prendre les armes, il se faisait craindre et respecter ; pour toutes ses bonnes qualités, il passait pour le plus grand et le meilleur prince qui eût jamais régné sur les Siamois.
Il ne faut pas regarder l'attachement qu'il eut pour son ministre et son affection pour les Français comme l'effet d'un naturel trop bon et trop facile, c'est plutôt une marque de sa grande pénétration, par laquelle ayant reconnu la légèreté des Siamois et voyant le désordre de sa maison, il avait jugé que l'assistance d'un puissant ami lui était nécessaire, ne se fiant pas tellement à lui-même qu'il crût empêcher de sa seule force les suites funestes de ces discordes domestiques.
Il crut aussi trouver dans M. Constance un ministre digne de lui, éclairé des plus vives lumières pour le conseil, plein de zèle et de courage pour l'exécution : et il eût cherché en vain dans toute l'étendue de son royaume un meilleur instrument de ses glorieuses entreprises et un homme plus capable pour l'établissement de l'alliance qu'il désirait ardemment de pratiquer avec notre invincible monarque, depuis qu'on lui eût fait entendre quel était le pouvoir de ce prince en Europe, et que l'ayant pour ami et pour allié, il en pouvait attendre un grand secours en cas de besoin.
Pitracha ayant été averti que le roi était à l'extrémité, alla en diligence donner ses ordres, auxquels il trouva tout le monde entièrement soumis. Il voulut que le reste du mois fût employé à rendre au défunt roi les honneurs ordinaires, et le premier jour du mois d'août, il sortit de Louvo avec le corps et se rendit à la capitale dans un pompeux équipage, où il se fit proclamer roi, et ensuite couronner, ayant épousé la princesse héritière du royaume afin de rendre son règne plus assuré et d'ôter tout prétexte de l'y troubler (9).
Tous les Siamois témoignèrent à l'envie la joie qu'ils avaient de son avènement à la couronne. Les talapoins lui rendirent hommage comme au restaurateur de leur religion et se promirent la destruction totale du christianisme. Les mandarins le regardèrent comme vengeur de leur liberté et de leurs privilèges contre des étrangers qui avaient possédé tout le crédit sous le règne précédent. Enfin le peuple, ravi d'un changement si extraordinaire, accompagna les respects dont il idolâtra le nouveau roi d'acclamations et d'applaudissements universels. Il en avait toujours été beaucoup aimé, parce qu'il avait la réputation d'être populaire et fort porté pour le soulagement des misérables, s'étant opposé plusieurs fois à diverses impositions qui avaient été mises par M. Constance.
Pour jouir en repos du fruit de tant de prospérité, il ordonna de travailler sérieusement à conclure un accommodement avec les Français dont il craignait le courage, et en faisait assez d'estime pour ne pouvoir s'empêcher d'en regretter la perte, ayant dit plusieurs fois qu'il était fâcheux que de si braves gens s'obstinassent à souffrir tant de misères, dont l'issue la plus certaine était une mort affreuse.
Dans le commencement du blocus, il avait tâché d'intimider le gouverneur en lui faisant appréhender la vengeance qu'on pouvait prendre de son manque de parole sur les otages qu'il avait laissé à Louvo.
C'était ses propres enfants qui le conjurèrent par une lettre, qui leur fût permis d'écrire et qu'un Siamois attacha au bout d'un bâton qu'il vint planter pendant la nuit sur le bord du fossé de la place, d'être sensible à leur malheur ; mais l'intérêt particulier céda et on ne jugea pas à propos de sacrifier toute une garnison dans l'espérance de tirer seulement deux personnes d'un mauvais pas. Cela fut suivi d'une chose à laquelle on ne s'attendait pas : c'est que Pitracha, se piquant de générosité, renvoya les deux fils au père, et fit connaître par là qu'il ne porterait pas les choses à la dernière extrémité.
Depuis il fit sommer le général plusieurs fois de sa promesse ; mais enfin n'ayant plus que cette affaire sur les bras qui lui causât de l'inquiétude et du trouble dans ses États, il résolut de la terminer et lui fit dire que son prédécesseur avait eu ses raisons pour entretenir commerce avec les étrangers et leur donner sa protection dans ses terres, mais que pour lui, il avait une politique tout opposée et qu'il était résolu de n'en souffrir aucun. Que néanmoins, en considération de l'alliance du feu roi avec le roi de France, il ne refuserait pas de procurer aux Français toutes les commodités qui leur pourraient apporter du soulagement, si de leur part ils voulaient lui remettre ses forteresses et sortir de son royaume.

NOTES :
1 - Dans son journal du 10 octobre 1685, l'abbé de Choisy évoque ces deux forteresses : Nous avons passé ce matin entre deux forts de bois qui nous ont salués, l'un de dix coups de canon, et l'autre de huit. Il n'ont ici que du canon de fonte, et la poudre est fort bonne. Le fort à main droite s'appelle Hale [Halle ?] de cristal, et celui de la gauche Halle de rubis. Sur la rive droite du fleuve, dans la province de Nonthaburi (นนทบุรี) se trouvait la forteresse de rubis (Phom thatphim : ป้อมทับทิม), un simple fort de bois, et sur la rive gauche, du côté de l'est, la forteresse de cristal (Phom kheo : ป้อมแก้ว), la plus importante et la plus solide, à l'emplacement de l'actuel Wat Chalerm Phra Kyat. ⇑
2 - Un millier représentait un poids de mille livres. Il s'agissait sans doute de la livre poids de marc qui valait 489 g ce qui portait le millier de poudre à 489 k. ⇑
3 - Ce bateau était commandé par M. de Saint-Cry (ou Saint-Cri, ou encore Saint-Cricq), et selon le père Le Blanc, il n'y avait pour passagers que huit soldats et un équipage indien qui avait pour maître un Français engagé au service de la Compagnie. (Histoire de la révolution du royaume de Siam, 1692, I, p. 266). ⇑
4 - Le père Le Blanc donne un récit détaillé de cet épisode : Les Siamois, voyant descendre ce bâtiment à la faveur de la marée, crurent que tous les Français s'y étaient embarqués et s'enfuyaient. Déjà les compagnies des Mores, animées d'une ardeur guerrière, étaient sorties de leurs postes en ordre de bataille pour venir s'emparer de notre fort, qu'ils croyaient abandonnés. (...) La frégate cependant descendait la rivière, sans que personne s'opposa à son passage, jusqu'à une lieue près de l'embouchure, où elle trouva la rivière toute bordée de petites galère, de mirous et de balons. Plusieurs de ceux-ci se détachèrent pour voltiger de loin autour du bâtiment français, mais sans oser en approcher ; il n'y eut qu'un Malais qui se hasarda de venir seul dans une petite nacelle et monta à bord en faisant le signe de la croix, et criant en portugais qu'il était chrétien. Il venait pour observer ce qu'il y avait de force dans le bâtiment. Il rapporta à ses gens qu'il n'y avait que huit soldats français presque tous ivres et couchés sur le pont. La chose était ainsi, un accident léger y avait donné occasion. La frégate, en se retirant, avait reçu de la batterie des ennemis un coup de canon qui avait cassé une cave remplie d'eau-de-vie. Les soldats avaient recueilli cette liqueur avec trop de soin, et pour n'en laisser rien perdre, ils s'étaient enivrés.
Le rapport du Malais donna aux ennemis plus de hardiesse pour approcher, mais ils n'osaient encore venir à l'abordage, et l'on aurait passé sans peine si le maître qui gouvernait n'eût manqué de courage. La peur le saisit, et il voulut s'embarquer dans sa chaloupe pour aller, disait-il, à terre parler au commandant des ennemis. Saint-Cry l'arrêta et lui dit qu'il fallait passer ou périr ; mais peu de temps après cet officier étant occupé ailleurs à donner des ordres, le maître se déroba et fut se rendre aux Siamois qui le reçurent comme il méritait et le mirent aux fers. Saint-Cry voulut faire prendre les armes à ses soldats, mais il les trouva, comme j'ai dit, hors d'état de combattre, à la réserve d'un seul nommé La Pierre. Alors, jugeant tout perdu, il prit la résolution de périr avec honneur plutôt que de tomber entre les mains des barbares qui l'auraient fait mourir inhumainement. Assisté de son soldat, il disposa sur le pont une partie des poudres avec des grenades et des mousquets le bassinet ouvert, pour mieux prendre le feu quand les ennemis viendraient à l'abordage. En effet, les Malais étant montés en foule, Saint-Cry, de la porte de sa chambre, mit le feu aux poudres et fit sauter dans l'eau, mort ou blessé, tout ce qu'il y avait d'ennemis dessus et autour de la frégate, ce qui ralentit beaucoup l'ardeur des autres qui venaient au pillage. Mais par malheur le bâtiment qui ne se gouvernait plus échoua. L'ennemi se reconnut et revint à la charge, dans la pensée que les poudres étant entièrement usées et les Français tués, il n'y avait plus rien à craindre pour eux. Saint-Cry les laissa venir encore en aussi grand nombre qu'ils voulurent, et quand il en vit le pont et les haubans bien remplis, il mit le feu à plusieurs barils de poudre qu'il avait réservés. La barque s'ouvrit avec un fracas épouvantable ; les débris du pont, les éclats des grenades, les pots d'artifice et les canons mêmes qui avaient pris feu embrasèrent ou coulèrent à fond tous les balons qui avaient environnés le bâtiment. Les Siamois et les Malais qui étaient venus à l'abordage, portés en l'air et à demi brûlés, retombaient dans la rivière, d'autres étaient jetés sur le rivage et quelques-uns sur les arbres voisins. Ils perdirent plus de deux cents hommes dans cet embrasement. Saint-Cry voulut se jeter à l'eau par un sabord en mettant le feu, mais il n'en eut pas le loisir ; il fut surpris par la poudre et étouffé. Le soldat La Pierre, plus heureux, gagna le bord du fleuve à la nage, portant son sabre à la bouche. Quand il fut à terre, il se vit aussitôt environné d'une troupe de Siamois contre lesquels il se défendit longtemps, en tua cinq et tomba enfin sur eux percé de coups. Un jeune français ayant eu le bras cassé d'un coup de mousquet et le talon emporté d'un éclat de grenade fut pris dans cette occasion ; un portugais qui avait le bras tout brûlé eut le même sort, et tous deux avec le maître de la barque qui avait abandonné Saint-Cry furent amenés de Louvo, où ils nous racontèrent comme cette action s'était passée. (Op. cit., pp. 265 et suiv.). ⇑
5 - Les mots sombaye, ou zombaye, fréquemment employés dans les relations françaises et qu'on pourrait traduire par prosternation, sont des transpositions du portugais sumbra, çumbaya, sumbaïa sumba, etc. L'origine en reste obscure. Il pourrait s'agir d'une déformation du mot malais sěmbah, une salutation, une respectueuse adresse, l'acte de salutation ou d'hommage consistant à élever les mains au visage, (R. J. Wilkinson, A Malay-English Dictionary, Singapour, 1901, p. 20) ou de son dérivé sěmbah-yang (vénération de dieu, prière, rituel). Yule et Burnall (Hobson-Jobson: A Glossary of Colloquial Anglo-Indian Words and Phrases, p.851) citent les mots Somba, et Sombay, du malais présent, cadeau. Peut-être est-ce le même mot que le Sěmbah de Wilkinson, les cadeaux, les présents étant habituellement offerts en Asie aux personnes à qui l'on souhaite rendre hommage. ⇑
6 - Thale Chubson (ทะเลชุบศร), une île au milieu d'un ancien lac à trois kilomètres de Lopburi où le roi Naraï avait fait construire une résidence, le pavillon Kraisorn-Sriharaj (ตำหนักไกรสรสีหราช). On peut penser que la fraîcheur de l'eau rendait cette retraite agréable pendant les mois chauds. Elle était également connue sous le nom de pratinang yen (พระตี่นั่งเย็น), la Résidence fraîche. Elle servait au roi Naraï pour les réceptions et pour séjourner lors de ses parties de chasse ou de ses promenades en forêt. C'est là que fut exécuté Phaulkon.
 Le pavillon Kraisorn-Sriharaj.
Le pavillon Kraisorn-Sriharaj.
 Le pavillon Kraisorn-Sriharaj.
Le pavillon Kraisorn-Sriharaj.
 Le pavillon Kraisorn-Sriharaj.
Le pavillon Kraisorn-Sriharaj.
 Le pavillon Kraisorn-Sriharaj. ⇑
Le pavillon Kraisorn-Sriharaj. ⇑
7 - Le père Tachard rapporte cette coutume dans sa relation : Je n'omettrai pas une circonstance assez particulière qui fera connaître une partie du caractère et de l'éducation des Siamois. Tandis que notre mandarin recevait les respects des habitants de la première tabanque, je m'informai en langue du pays de la santé du roi de Siam. À cette demande, chacun regarda son voisin, comme étonné de ma demande, et personne ne me fit de réponse. Je crus manquer à la prononciation ou à l'idiome même des gens de cour. Je m'expliquai en portugais par un interprète, mais je ne pus rien tirer du gouverneur, ni d'aucun de ses officiers. À peine osaient-ils prononcer entre eux et fort secrètement le nom de roi. Quand je fus arrivé à Louvo, je racontai à M. Constance l'embarras où je m'étais trouvé en demandant des nouvelles du roi de Siam, sans avoir pu obtenir aucune réponse : j'ajoutai que le trouble de ceux auxquels je m'étais adressé et la peine qu'ils avaient eue à me répondre m'avaient causé beaucoup d'inquiétude, dans la crainte qu'il ne fût arrivé à la cour quelque changement considérable. Il me répondit qu'on avait été fort étonné de mes questions, parce qu'elles étaient contraires aux usages des Siamois, auxquels il est si peu permis de s'informer de la santé du roi leur maître que la plupart ne savent pas même son nom propre, et que ceux qui le savent n'oseraient le prononcer ; qu'il n'appartient qu'aux mandarins du premier ordre de prononcer un nom qu'ils regardent comme une chose sacrée et mystérieuse ; que tout ce qui se passe au-dedans du palais est un secret impénétrable aux officiers du dehors, et qu'il est rigoureusement défendu de rendre public ce qui n'est connu que des personnes attachées au service du roi dans l'intérieur du palais ; que la manière de demander ce que je voulais savoir était de m'informer du gouverneur si la cour était toujours la même, et si depuis un certain temps il n'était rien arrivé d'extraordinaire au palais ou dans le royaume ; qu'alors, si on m'avait répondu qu'il n'était arrivé aucun changement, c'eût été m'assurer que le roi et ses ministres étaient en parfaite santé ; mais qu'au contraire, si la face du gouvernement eût été changée par quelque révolution, on n'eût pas fait difficulté d'en parler, parce qu'après la mort des rois de Siam, tout le monde indifféremment peut apprendre et prononcer leur nom. (Second voyage des pères jésuites..., Paris, 1689, p. 147). ⇑
8 - On trouve des descriptions de cette cérémonie dans beaucoup de relations. Ainsi Jean-Baptiste Tavernier écrit au milieu du XVIIe siècle : La seconde fois que le roi sort en public, c'est pour aller à une autre pagode qui est à cinq ou six lieues au-dessus de la ville en remontant la rivière. Mais personne ne peut entrer dans cette pagode que le roi avec ses prêtres. Pour ce qui est du peuple, sitôt qu'il en peut voir la porte, chacun se jette la face en terre. Alors le roi paraît sur la rivière avec deux cents galères d'une prodigieuses longueur, chacune ayant quatre cents rameurs et étant dorées et enjolivées pour la plus grande partie. Comme cette seconde sortie du roi se fait au mois de novembre et qu'alors la rivière commence à s'abaisser, les prêtres font accroire au peuple qu'il n'y a que le roi qui puisse arrêter le cours des eaux par les prières et les offrandes qu'il fait en cette pagode, et ces pauvres gens se persuadent que le roi va couper les eaux avec son sabre, afin de les congédier et de leur ordonner de se retirer dans la mer. (Les six voyages de Jean-Baptiste Tavernier […], 1677, II, p. 434).
Ce rituel magique sans doute d'inspiration brahmanique s'appelait laï nam (ไล่น้ำ), littéralement chasser les eaux ou encore laï rua (ไล่เรือ : chasser le bateau) parce qu'elle se terminait généralement par une course de bateaux. Comme beaucoup de spectateurs occidentaux, Tavernier fait une confusion. Le roi ne coupe pas les eaux avec son sabre, mais il agite dans l'eau un éventail à long manche.
Environ deux siècle plus tard, en 1854, Mgr Pallegoix évoque lui aussi cette cérémonie dans sa Description du royaume de Siam (1854, II, p. 56), mais à cette époque, le roi ne se déplace plus en personne pour accomplir le rituel, son prestige risquant d'être écorné si les eaux continuent à monter malgré ses royales injonctions, comme c'était souvent le cas. Il délègue ses pouvoirs à des bonzes : Lorsque l'inondation a atteint son plus haut point, et dès que les eaux commencent à se retirer, le roi députe plusieurs centaines de talapoins pour faire descendre les eaux du fleuve. Cette troupe de phra, montée sur de belles barques, s'en va donc signifier aux eaux l'ordre émané de Sa Majesté, et, pour en presser l'exécution, tous ensemble se mettent à réciter des exorcismes pour faire descendre la rivière; ce qui n'empêche pas que, certaines fois, l'inondation augmente encore en dépit des ordres du roi et des prières des talapoins.
D'après H. G. Quaritch Wales, (Siamese State Ceremonies, their History and Function, 1931, pp. 225-226), ce rituel n'avait pas lieu tous les ans. Le dernier monarque à l'accomplir fut le roi Mongkut (Rama IV) en 1831, année où la mousson fut exceptionnellement abondante. La cérémonie fut définitivement abolie sous le règne du roi Phumiphon Adunyadet. ⇑
9 - L'histoire officielle veut que la princesse Yothathep ait épousé Phetracha après la mort du roi Naraï. Peut-être cela s'est-il fait plus tard, mais il a dû falloir vaincre beaucoup de résistance, car selon le père de Bèze, la première réaction de la princesse fut un refus catégorique : Il [Phetracha] voulut en ce temps-là épouser cette jeune princesse pour s’affermir davantage sur le trône par ce mariage ; mais elle eut assez de fierté pour n’y vouloir pas consentir et pour lui reprocher qu’il avait mauvaise grâce de lui offrir une main trempée dans le sang de son père et de ses oncles. Elle estait surtout inconsolable de la mort du plus jeune des princes qu’elle aimait tendrement et elle ne pouvait voir Pitratcha qu’avec horreur, qu’elle en regardait comme le bourreau. (Drans et Bernard, Mémoires du père de Bèze sur la vie de Constance Phaulkon [...], 1947, p. 147). ⇑

18 février 2019
