

2ème partie.
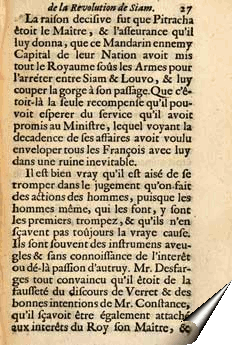
Il est bien vrai qu'il est aisé de se tromper dans le jugement qu'on fait des actions des hommes, puisque les hommes même qui les font y sont les premiers trompés et qu'ils n'en savent pas toujours la vraie cause. Ils sont souvent des instruments aveugles et sans connaissance de l'intérêt ou de la passion d'autrui. M. Desfarges, tout convaincu qu'il était de la fausseté du discours de Véret et des bonnes intentions de M. Constance, qu'il savait être également attaché aux intérêts du roi son maître et zélé pour ceux du roi très chrétien, n'étant de sa part suscité ni par aucun mouvement de haine, ni par aucun avantage particulier qu'il eût lieu d'espérer dans une confusion générale, cependant ne suit plus désormais que les conseils d'un homme intéressé que la passion aveugle et qui croit trouver son compte dans le trouble, songeant à profiter de l'occasion, non seulement pour se mettre à l'abri des disgrâces dont il était menacé de la part de MM. les intéressés de la Compagnie Royale des Indes, mais encore afin de s'approprier tous les effets du comptoir, comme il fit, supposant qu'ils avaient été pillés, comme on le verra dans la suite (1).
Ainsi les remontrances de Véret eurent tout le succès qu'il avait attendu, et il s'insinua si bien dans l'esprit de M. Desfarges qu'il le mit au point de balancer s'il continuerait sa route ou s'il s'en retournerait sur ses pas. Le voyant irrésolu, il lui proposa de voir MM. les prélats supérieurs des missionnaires apostoliques, où l'évêque de Rosalie, prévenu de bonne foi de la mort du roi de Siam et croyant effectivement qu'il y avait grand nombre de troupes postées sur les avenues de LouvoLopburi (ลพบุรี), à quelques dizaines de kilomètres d'Ayutthaya., qui attendaient que les Français donnassent dans l'embuscade pour les tailler en pièces, confirma l'avis de Véret sur ce qu'il avait appris de Véret même ou de la renommée (2), ce qui fit une telle impression sur le commandant qu'il déclara qu'il était prêt de désister de son entreprise (3).
Mais M. l'évêque de Métellopolis, voyant qu'on désespérait avant que de savoir au vrai s'il fallait seulement craindre, usa de sa prudence ordinaire et ne jugea pas qu'il fût à propos de reculer n'y d'abandonner la partie sans être bien persuadé qu'il n'y avait plus de ressource. Il n'ignorait pas que celui qui donne un conseil timide est le pire de tous les lâches, et plus il faisait de fortes réflexions sur les bruits que le vulgaire autorisait, moins il y trouvait d'apparence. On voulait que le roi fût mort, mais M. Desfarges en avait eu une audience depuis cinq jours et la nouvelle courait par tous les quartiers de la ville avant ce temps-là, on assurait qu'il y avait des embûches dressées sur les routes de Louvo, mais on pouvait s'informer si les rapports de Véret étaient véritables. Sur toutes ces considérations, on délibéra d'écrire à M. Constance pour lui donner avis de la cause du retardement et en attendant des nouvelles, M. Desfarges retira son détachement de la ville et s'alla poster à deux lieues au-dessous.
Un lieutenant d'infanterie fut chargé de la commission, lequel prenant toutes les précautions pour éviter les surprises et les mauvaises rencontres, cacha adroitement sa lettre dans un nœud de sa perruque, et s'éloignant le plus qu'il put des routes communes, suivit les sentiers détournés et le plus souvent marcha à travers champ. Mais il fut bien étonné de ne voir aucune apparence de danger, et à mesure qu'il avançait, approchant des chemins ordinaires et côtoyant quelquefois le rivage, il aperçut seulement de loin tantôt quelques balons sur le fleuve, tantôt des éléphants, des chevaux et des palanquinsSortes de chaises, ou de litières, portées par des hommes ou par des animaux et dont les personnes importantes se servent, dans une grande partie de l'Asie, pour se faire transporter d'un lieu à un autre. dans la plaine – voiture qu'il sut depuis avoir été envoyée par les soins du ministre au-devant du général et de sa suite pour la commodité du voyage.
dans la plaine – voiture qu'il sut depuis avoir été envoyée par les soins du ministre au-devant du général et de sa suite pour la commodité du voyage.
L'officier, sans savoir ce que c'était, n'en conçut pas moins de soupçon, mais il s'imagina que ce serait au terme qu'il trouverait d'étranges désordres. Il y fut encore trompé ; entrant à Louvo il vit la cour, quant au-dehors, dans une grande tranquillité, quoiqu'elle refermât au-dedans les semences du trouble et de l'agitation qui n'a éclaté que plusieurs jours après et que, pour lors, on pouvait facilement étouffer. Le roi y était aussi absolu que jamais, prenant alors le divertissement d'observer dans son palais une éclipse de lune avec les pères jésuites à qui il faisait l'honneur de demander l'explication de diverses questions d'astronomie (4), enfin tout était calme dans la situation ordinaire, mais particulièrement chez M. Constance qui se reposait sur la parole qu'on lui avait donnée et qui se flattait de se voir bientôt délivré d'un redoutable ennemi.
On alla dire à ce ministre qu'il venait d'arriver un officier français de la part de M. Desfarges. Il n'eut pas la patience qu'il vînt à lui, il alla au-devant recevoir la lettre et il y répondit sur-le-champ, priant instamment M. le général d'être moins facile à croire des faussetés qu'il devait assez bien connaître pour ne s'en pas alarmer, de se souvenir de l'état auquel il avait vu lui-même la cour et de croire qu'il n'était pas arrivé de changement depuis ce temps-là, de quoi il ne doutait pas qu'il n'eût une entière assurance par le récit qu'on lui ferait. Il recommanda à l'officier de bien considérer ce qui se passait dedans et dehors Louvo et de s'en retourner par le chemin le plus fréquenté afin de rapporter le tout plus fidèlement à M. Desfarges, ce qui fut exécuté de point en point, et on n'en apprit rien qui eût aucun rapport avec les avis du Sieur Véret.
Pendant qu'on était allé du côté de Louvo pour découvrir la vérité, M. Desfarges, qui s'était éloigné de la ville capitale, y envoya un officier pour tirer un entier éclaircissement de toutes choses. Sous prétexte d'acheter des provisions pour le rafraîchissement de ses troupes, cet officier avait ordre d'observer la contenance des habitants et de remarquer exactement leurs démarches. S'y étant rendu, il parcourut pendant près d'une journée entière tous les quartiers des différentes nations, et n'ayant trouvé lieu de rien soupçonner d'aucun soulèvement secret, ni un seul homme armé autrement que de coutume, il s'en revint le soir faire son rapport, au même moment que celui qu'on avait dépêché vers M. Constance rendait compte de sa commission. Les nouvelles se confirmèrent mutuellement, et il n'y eut pas une circonstance qui démentît l'autre.
Il arrive souvent que les hommes ont peine d'abandonner un dessein qu'ils ont entrepris, on voit que l'honneur est engagé à le maintenir et qu'on ne saurait le changer sans condamner sa conduite et rendre un témoignage public ou de son aveuglement passé, ou de sa légèreté présente. C'est un effet de l'amour-propre et une complaisance que peu de gens se refusent à eux-mêmes, mais ce n'est presque jamais que lorsqu'on a commencé de faillir, car ne voulant pas avouer qu'on soit capable de le faire, c'est alors qu'on entreprend de justifier par la constance ce qui s'est fait contre la raison. M. Desfarges, qui s'était avancé jusqu'à Siam dans la résolution de passer outre, n'a pas plutôt commencé de reculer qu'il est inaccessible à toute autre persuasion. Il se dérobe lui-même à ses propres lumières, il se défie de la vérité si nettement découverte et n'usant que des raisons empruntées d'un homme plein de mauvaise foi, il veut garder par opiniâtreté une fausse opinion qu'il n'a pris que par rencontre.
Un capitaine d'infanterie qui l'accompagnait eut beau lui présenter l'engagement où il était de secourir M. Constance, particulièrement dans une conjoncture où il s'agissait d'un coup de partie (5) et où il devait être persuadé qu'en exposant ni lui ni son monde à aucun péril, il remporterait la louange de s'être acquitté généreusement d'une action aussi glorieuse pour lui qu'utile aux intérêts des deux rois et à ceux du ministre protecteur de leur nation, le général ne connut plus d'autre raison que la sienne et ne voulut jamais entrer dans le sens de personne, mais au contraire, pour marque que, s'étant retiré en arrière, il avait agi avec beaucoup de jugement, il le fit avec persévérance et donnant les ordres sur-le-champ pour s'embarquer, il retourna à son gouvernement, laissant ce même officier chargé d'une dépêche pour M. Constance où il s'excusait de ce qu'il ne l'allait pas trouver, sur le risque qu'il aurait couru de perdre sa tête en France s'il sortait de son poste et en tirait ses meilleures troupes pour les employer ailleurs. Ce fut la couleur qu'il donna à son procédé, sans faire réflexion que si sa sortie hors de sa place était une faute qu'on lui dût imputer, il en était déjà coupable et qu'il ne s'agissait plus que du plus ou du moins. On ne laissa pas de lui en faire l'objection, mais se sentant pressé, il dit résolument que son parti était tout pris, et qu'au reste, MM. les évêques, dont le mérite et la prudence étaient connus de la cour et de qui il avait ordre de suivre les avis, s'étaient bien voulus charger de le disculper.
Toutes ces réponses furent portées à Louvo, et ce fut comme un coup de foudre qui étonna M. Constance, lequel ne songeait pas à la tempête pendant que le temps semblait encore calme et serein. Il se plaignit de ce qu'on l'abandonnait dans une nécessité pressante où le danger était commun ; mais l'officier ne put que lui offrir une retraite dans Bangkok, selon l'ordre qu'il en avait reçu de M. le général, et où il l'assura qu'il trouverait toujours un asile pour lui et pour sa famille. C'était peut-être alors le parti le plus sûr qu'il avait à prendre. Il se retira à part sous prétexte d'aller répondre à la lettre, mais bien moins pour délibérer là-dessus que pour s'abandonner librement à a toute sa douleur dans le pressentiment qu'il avait des malheurs dont il allait être accablé ; car quoi qu'il connût le danger, il ne pouvait néanmoins se résoudre à la fuite, soit que, piqué de générosité, il crût honteux de laisser son maître à la merci de ses ennemis, soit que se flattant encore, il espérait toujours plus qu'il ne craignait, et qu'il ne voulût pas tourner le dos à la fortune qui semblait le vouloir favoriser.
C'est pour cela qu'il entreprit de faire un dernier effort pour engager M. Desfarges à renouer la partie. Il en parla au major de Bangkok (6) qui avait toujours été auprès du ministre depuis l'arrivée des troupes à Siam, et connaissant le crédit de cet officier envers son général, dont il était la créature, et la confiance que le général avait en son officier, il le pria d'aller lui-même à Bangkok pour presser l'effet des promesses dont il avait été le témoin, faisant entendre qu'il n'était point trop tard et que l'occasion n'était pas encore perdue, et qu'un peu de diligence pouvait réparer la faute du retardement. Le major promit de se servir de tout le crédit qu'il s'était acquis sur l'esprit de M. Desfarges pour le porter à faire ce qu'il devait. Il partit de Louvo, très convaincu de l'extrême besoin où l'on était de venir seconder M. Constance dans une expédition d'où dépendait le bon ou le mauvais succès de toutes choses.
Mais on n'a jamais vu plus de légèreté et de bizarrerie dans aucun procédé. Le major, arrivé à Bangkok, n'eut pas plutôt fait l'ouverture du sujet de son voyage qu'on lui ferma la bouche, et voyant qu'on l'arrêtait dès le premier pas et qu'il ferait mal sa cour s'il parlait davantage en faveur de M. Constance, il tourna tout court et alla du blanc au noir, prenant le parti d'approuver hautement la démarche de M. Desfarges, surtout en sa présence, où il n'eut jamais le courage de proférer une vérité qu'il crût tant soit peu désagréable à ce général et dangereuse à sa fortune, quoique très importante au service du roi.
M. Constance ayant perdu toute espérance de secours du côté qu'il en devait le plus attendre, fut contraint de laisser aller le cours des choses ; afin néanmoins de mettre en usage tout ce qui pouvait contribuer à la guérison ou à l'adoucissement du mal qui allait bientôt causer des terribles effets, il jugea qu'il était temps de donner avis au roi de tout ce qui se passait au préjudice de ses intérêts et du repos de son État, et de lui proposer pour dernier remède de faire choix d'un successeur qui ralliât en sa faveur les volontés de tous ses sujets et fît cesser toutes leurs divisions. C'était bien le conseil le plus utile dans la conjoncture présente, mais aussi le plus difficile à insinuer. On en jugera par l'état où se trouvait la famille royale, à cause de la désunion qui y était depuis longtemps.
Le roi n'avait point d'autres enfants qu'une seule princesse (7), à qui le doit de régner n'appartenait pas immédiatement parce que, selon la coutume du pays, les frères du roi succèdent à la couronne préférablement à ses enfants, auxquels néanmoins elle revient après la mort de leurs oncles. Il y avait deux princes frères du roi, tous deux d'une humeur inquiète et qu'il était obligé de tenir sous bonne garde dans ses palais. L'un était impotent, l'autre plus jeune était bien fait et sans aucun défaut naturel en sa personne, quoique quelques-uns disent qu'il était muet, et d'autres qu'il affectait de le paraître. La mauvaise conduite de ces princes ayant plusieurs fois désobligé le roi, il avait conçu beaucoup d'aversion pour tous deux, et quelques-uns avaient tellement pris soin d'augmenter les soupçons qu'il en pouvait avoir qu'ils avaient entièrement éloigné d'eux la bonne volonté du prince. C'est pourquoi il faisait élever un fils adoptif nommé Mompi, lequel apparemment il destinait pour être un jour son successeur (8).
Mais M. Constance, qui croyait que la gloire de son maître était de faire en sorte que sa couronne ne sortît pas de sa maison, aurait bien voulu lui persuader de nommer un de ses frères pour gouverner après lui, ce qui fait bien voir qu'il n'avait jamais flatté Monpi de l'espérance de régner, comme ses ennemis ont tâché de lui imputer. C'est pour cela qu'il chercha le moyen de s'introduire auprès de ce prince et de se ménager une favorable audience. Il n'en trouva pas l'occasion sans quelque difficulté, quoiqu'il eût beaucoup de part dans la confiance et dans l'estime de son maître à cause qu'il le voyait alors plus rarement qu'à l'ordinaire, encore le trouvait-il souvent entouré des créatures de Pitracha.
Jusque-là le ministre avait caché au roi les menées de ce puissant mandarin, craignant que ce prince, dont les forces commençaient à diminuer par la maladie et qui baissait tous les jours, ne fût pas assez maître de son ressentiment pour garder la modération nécessaire au dessein qu'il avait toujours eu de le faire arrêter. Néanmoins ce n'était plus la raison de lui rien dissimuler. S'étant donc un jour approché de son lit, et le pouvant entretenir sans témoin, il lui représenta avec tant de force le péril qui menaçait la cour et sa personne par les cabales que ce perfide sujet avait formées pour s'assurer du gouvernement, et la nécessité qu'il y avait d'en prévenir les malheureuses suites, qu'il le fit résoudre à faire une déclaration de sa dernière volonté en présence de grands de son royaume, touchant le règne de la princesse sa fille à laquelle il laisserait la liberté de choisir pour époux celui de ses oncles qu'elle jugerait plus digne de son affection et plus capable de commander après lui.
M. Constance aurait peut-être encore souhaité que le roi eût voulu déterminer lui-même le choix que devait faire la princesse, mais il se faisait déjà trop de violence en consentant de proposer seulement d'une manière indirecte des frères dont il n'avait pas lieu d'être content ; et d'ailleurs cette précaution ne pouvait être nécessaire que pour ôter le doute du parti auquel on se devait arrêter. Or il était peu important que ce soit à l'un ou à l'autre des deux princes, pourvu qu'on demeurât inviolablement attaché aux intérêts de la famille royale et qu'on abandonnât ceux de Pitracha, dont on découvrirait les mauvaises intentions s'il continuait de cabaler après la déclaration du roi ; car alors n'ayant plus sujet d'armer pour le droit des princes, tout le monde serait convaincu qu'il ne le ferait que pour soutenir ses injustes prétentions, ce qui ne pouvait manquer d'abattre sa faction, plusieurs n'y étant engagés que sur les assurances qu'il leur donnait que toutes ses vues étaient de conserver la couronne aux légitimes héritiers. Ajoutez à cela qu'il était difficile de se méprendre, vu que suivant la peinture qui a été faite des deux princes, il n'y avait que le plus jeune qui fût propre au mariage et en état de gouverner, et qu'enfin l'on n'ignorait pas quelle était en sa faveur la disposition du cœur de la princesse (9).
Le roi ayant déféré au conseil de son ministre en ce qu'il pouvait contribuer au rétablissement des affaires, ne le laissa pas aller sans lui faire des reproches de ce qu'il avait attendu si tard à lui donner connaissance de tous ces troubles. M. Constance s'en excusa sur la maladie de ce prince à laquelle il n'avait pas voulu ajouter le chagrin d'apprendre de si fâcheuses nouvelles, et lui raconta les mesures qu'il avait tâché de prendre avec M. Desfarges pour remédier d'abord à ces malheurs, mais que ce général les avait toutes rendues inutiles en refusant d'amener ses troupes à Louvo après lui en avoir donné sa parole. On ne peut exprimer quel fut l'étonnement de ce prince quand il entendit cela. Il ne fit point paraître plus de sensibilité dans tout le reste de ses malheurs. Comment donc, disait-il, mêlant sa plainte à sa douleur, le général des Français nous abandonne dans un aussi pressant besoin, lui que vous m'aviez tant de fois assuré avoir ordre du roi son maître de me donner tous les secours qui me seraient nécessaires. Auriez-vous donc été d'intelligence à me tromper, mais vous vous seriez trahi vous-même le premier. M. Constance l'interrompit et pouvant se justifier en donnant le blâme à celui qui le méritait, il ne perdit point le temps en d'inutiles discours et crut que l'importance était de songer uniquement à la sûreté du roi et à l'exécution du projet qu'il lui avait conseillé. Pour l'un il lui représenta qu'il était de la dernière importance de garder le secret touchant l'entreprise de Pitracha et de cacher son ressentiment jusqu'à ce qu'il le pût faire éclater en souverain, et pour l'autre il lui fit comprendre que tous les moments étaient précieux et qu'il ne fallait pas différer davantage de montrer à ses sujets le maître qu'ils auraient après lui.
Aussitôt l'assemblée des grands du royaume fut convoquée, où le roi se fit porter, tout malade qu'il était, et y ayant exposé ce qu'il avait ordonné du gouvernement à venir, suivant ce qui avait été concerté, il harangua les mandarins avec toute la vigueur que ses forces lui purent permettre et les exhorta puissamment de lui garder la fidélité et de porter les autres à rentrer dans leur devoir. C'était assez s'il en fût demeuré là, mais son discours, animé de son ressentiment, le mena plus loin qu'il ne devait aller. Il parla de traîtres qui séduisaient les serviteurs pour s'assurer par leur crédit un chemin vers le trône auquel la naissance ne les destinait pas, puisqu'il n'appartenait qu'aux princes du sang royal, et il fit entendre trop clairement le nom de Pitracha parmi les plaintes que sa douleur lui fournit pour laisser aucun doute aux assistants qu'il ne fût celui qu'il accusait d'une si criminelle usurpation.
Les mandarins donnèrent grande attention au discours de leur roi, et quand il eut achevé de parler, commençant à ouvrir les yeux, ils se regardaient l'un l'autre avec quelque sorte d'étonnement, comme s'ils se fussent reproché la facilité qu'ils avaient eue de donner dans le piège qu'on leur avait tendu. Le conseil finit et chacun se retirant faisait d'étranges réflexions ; mais Pitracha qui n'avait osé y venir, craignant qu'on se saisît de sa personne, ne fut pas plutôt averti par les affidés de ce qui s'était passé qu'il alla au devant de ses partisans pour les raffermir, leur disant que le roi n'avait parlé que comme l'organe de M. Constance, et qu'ils pouvaient juger quelle était la malignité de ses suggestions, que pour lui il espérait qu'ils seraient convaincus par la suite de la droiture de son procédé. Cependant il ne se fia pas tellement à ses persuasions qu'il ne songea à les assujettir par la force. Il crut qu'il fallait leur ôter le loisir de réfléchir davantage. C'est pourquoi dès le même jour sur le soir, ayant donné le signal, il fit avancer les milices qu'il entretenait aux environs de Louvo, et ayant posé des corps de garde sur toutes les avenues du palais, il introduisit les soldats dans les cours et aux lieux plus intérieurs dont il voulut s'assurer, si bien qu'en moins d'un jour il se rendit maître de tout et de la personne du roi.
Ce prince ignorait encore qu'il était captif de son propre esclave lorsqu'il vit entrer dans sa chambre Mompi, son fils adoptif et son favori, qui se jetant à genoux devant son lit, déclara toute l'intrigue de laquelle il avait eu le malheur d'être complice. Il venait lui demander pardon et implorer sa clémence en donnant toutes les marques d'un véritable repentir, qui pouvait bien encore lui attirer le pardon de son crime, mais qui ne pouvait plus lui en faire éviter la punition. Le jeune mandarin avait été premièrement dans les intérêts de M. Constance. Il s'en sépara sur la fin, et il fit paraître qu'il avait dessein de succéder à la couronne. On travaillait sous-main à lever des troupes de tous côtés pour son service, à quoi son propre père s'employait avec plusieurs autres personnes, jusque-là qu'on assure qu'il avait déjà près de quatorze mille hommes sur pied (10). Comme c'était le concurrent qui donnait plus de jalousie à Pitracha, ce fut aussi celui qu'il prit plus à tâche de tromper. Il flatta l'ambition qu'il avait de régner et sut bientôt lui persuader qu'en toutes ses entreprises il ne se proposait pour but que de lui faire épouser la princesse et de lui assurer par ce moyen la succession de la couronne, que pour lui il avait tous les sujets du monde d'éloigner les princes du gouvernement et de les mettre hors d'état de se ressentir jamais des mauvais traitements qu'ils avaient reçus, quoique par ordre du roi, particulièrement le cadet, qu'il haïssait mortellement pour avoir été cause de la mort funeste de sa sœur, laquelle ayant l'honneur d'être femme du roi et mère de la princesse, avait bien voulu céder à l'amour du jeune prince, et pour son infidélité avait été jetée aux éléphants et misérablement écrasée sous leurs pieds (11).
Mompi n'ignorait pas tous ces principes de haine et courait avec d'autant plus de précipitation à sa perte qu'il croyait voir dans cette confidence l'image de la sincérité même. Il s'imagina qu'il était hors de toute apparence que Pitracha eût envie de feindre lorsqu'il lui protestait qu'après avoir donné tous ses soins à l'établissement de ce nouveau règne, il ne voulait pour tout fruit de ses peines que la liberté de se retirer parmi les talapoins et finir tranquillement ses jours avec eux. Ainsi, l'esprit dégagé de toute appréhension et rempli de sa grandeur prochaine, il voguait à pleines voiles poussé du vent de cette fortune apparente, mais l'orage n'était pas loin qui le devait faire échouer contre un écueil dont il ne se défiait pas. Pitracha eut beaucoup d'égard pour lui tant que le succès de son entreprise fut douteux, mais depuis qu'il commença d'avoir le dessus, il cessa de le ménager et trouva bientôt le moyen de rompre.
Leur différend éclata le même jour que le roi fut prisonnier dans son palais, ce fut le dix-huitième de mai, parce que Mompi s'étant voulu attribuer le premier rang dans un conseil que tinrent les conjurés, Pitracha enflé de ses avantages prit cette occasion pour lever le masque et de l'insulter, l'appelant téméraire et jeune ambitieux, qui n'ayant ni naissance ni mérite osait se flatter de posséder une couronne qui appartenait à d'autres par toute sorte de titre. Alors Mompi confus et désespéré, sans ressource, sans pouvoir et sans amis, se voyant le jouet d'un ennemi puissant auquel il n'était plus capable de nuire et dont il pouvait tout appréhender, courut se chercher un asile dans la chambre du roi, et par un aveu sincère de l'état des choses, tâcha de mériter sa grâce. Le roi, qui l'affectionnait, n'eut pas de peine à lui pardonner, mais troublé au dernier point de la nouvelle qu'il apprenait, il se leva et parut aux fenêtres de son antichambre, demandant raison de l'attentat qui se commettait contre la Majesté royale. Tous ceux qui furent présents se prosternèrent devant lui et personne ne voulut lui répondre. Ce silence obstiné acheva de le désoler. Il rentra dans sa chambre, disant qu'il fallait donc se résoudre à mourir, et demanda à son fils s'il n'y avait point d'Européens à la cour qui pussent le secourir ; lui ayant réparti que non, il lui ordonna de demeurer auprès de lui et de ne point quitter sa chambre.
Ce qui se trouvait alors d'Européens à Louvo dont on pût espérer quelque service était en très petit nombre, car à l'exception de quelques officiers français et d'environ dix-huit ou vingt gardes anglais que M. Constance entretenait pour la sûreté de sa personne, on ne devait plus compter sur rien. Le ministre les avait tous ramassés auprès de lui dès qu'il eut avis de ce qui était arrivé et tenait conseil avec les Français sur ce qu'il était expédient de faire dans un si triste événement. C'est une erreur de s'imaginer que la sagesse ne puisse jamais être courageuse, comme si elle devait dégénérer en langueur. Il faut quelquefois appeler le péril au secours du péril et sortir d'un danger par un autre danger. M. Constance, saisi de douleur et de regret de savoir que son maître était tombé en la puissance de ses sujets rebelles et qu'il allait mourir dans une si malheureuse captivité, résolut de le mettre en liberté ou de perdre la sienne avec sa vie. Il ouvrit son dessein, dont on tâcha premièrement de le dissuader, et puis d'en surseoir l'exécution pour quelques temps ; mais il désapprouva une si lâche patience et remontra que les affaires étant encore en mouvement, il y avait moyen de les rétablir et de se soutenir contre le torrent, si l'on allait au plus tôt attaquer le chef de la révolte à la tête de son parti dont plusieurs mandarins se détacheraient lorsqu'il en paraîtrait un contraire, n'y étant entraînés que par la nécessité.
Les Français, engagés tant par honneur que par les bienfaits qu'ils avaient reçus du ministre, lui promirent de le suivre partout où il les mènerait et de faire ce qu'il leur commanderait. Ayant pris leur parole, il mit ordre à quelques affaires et n'oublia pas celles de sa conscience, se disposant chrétiennement à recevoir avec soumission ce qui était ordonné de son sort.
Ce fut le 19 de mai qu'après avoir dit adieu à sa femme, qui put bien remarquer dans ses yeux le trouble de son esprit qu'il dissimulait sous un discours étudié plein de confiance et d'espoir, et qu'ayant répandu dans son logis qu'il devait arriver un événement considérable qui déciderait des affaires et qui donnerait le dessus à l'un ou à l'autre parti, il se fit porter droit au palais accompagné de quatre officiers français (12) armés chacun de deux pistolets et d'une bonne épée.
Il laissa sa chaise à l'entrée du château où, se mettant à marcher avec sa suite d'un pas déterminé, il traversa la première cour et ne fut pas plutôt entré dans la seconde qu'il aperçut Pitracha venant à lui suivi d'un mandarin seulement, qui portait un sabre nu à la main. Sitôt que ce mandarin se vit en mesure, il le leva pour en décharger un coup sur la tête de M. Constance, mais l'ayant évité en se retirant deux pas en arrière, il regarda le major de Bangkok qui s'était chargé de tirer le premier, et le voyant immobile comme les autres, qui crurent la partie trop inégale pour s'engager au combat à cause du grand nombre de mandarins accourus au secours des uns des autres, dont ils étaient déjà environnés de toutes parts, il lui dit : Seigneur Major, rendez vos armes, il n'est plus temps de songer à se défendre, vous avez trop attendu. Cet ordre ne trouva point de résistance. Ils furent tous désarmés et conduits dans une salle pendant que Pitracha, ayant saisi son prisonnier par la manche, le fit promener le long des murailles du château, démarche dont on n'a point su la raison. Ensuite il ordonna qu'il fût chargé de chaînes et resserré étroitement dans une prison faite de pieux où on lui brûla d'abord la plante des pieds, selon la coutume de ces barbares, pour empêcher les prisonniers de se sauver.

NOTES :
1 - Le sieur Véret, personnage faisandé, principalement préoccupé de son enrichissement personnel, était arrivé au Siam le 23 septembre 1685 avec l'ambassade du chevalier de Chaumont. Il avait été nommé par la Compagnie des Indes orientales pour remplacer à la tête du comptoir Deslandes-Boureau qui était parti pour Surate. François Martin écrit dans ses Mémoires de mars 1686 : Le sieur Véret ne renvoyait rien en France pour retour du capital dont il était chargé ; il s'excusait à la Compagnie sur ce qu'il n'avait point trouvé de marchandise à acheter ; il nous écrivit une lettre de compliment. Lucien Lanier ne le ménage pas, mais reconnaît que ses témoignages doivent être pris en considération (Étude historique sur les relations de la France et du royaume de Siam de 1662 à 1703, 1883, p. 101) : Cet employé subalterne, dont le langage est souvent grossier, le style toujours incorrect et l'orthographe des plus fantastiques paraît surtout préoccupé d'intérêts secondaires et de querelles mesquines ; mais il a vu de près les choses qu'il raconte, il a vécu au milieu des intrigues et des conflits ; il a été mêlé à toutes les opérations commerciales, et parfois aux affaires politiques et religieuses ; on peut recueillir dans ses lettres des détails utiles, à condition de ne pas perdre de vue la versatilité de ce témoin équivoque, qui proclame tour à tour Constance le « meilleur homme » et le « plus grand fourbe du monde », qui se résigne, comme tous les autres, à ramper devant lui, et se soucie fort peu d'accorder les sévérités de son langage avec les contradictions et les lâchetés de sa conduite. ⇑
2 - Le texte original dit : « ou dé-là renommée » (?). Il faut entendre renommée dans le sens de « rumeur publique ». ⇑
3 - Avec le recul, il paraît évident que cette décision de ne pas intervenir alors qu'il en était peut-être encore temps marqua un tournant décisif dans le cours des événements et entraîna les désastres qui allaient suivre. La question était de savoir précisément si les forces siamoises étaient alors suffisamment nombreuses et organisées pour mettre en déroute les troupes de Desfarges. Entre ceux qui n'ont vu aucun signe alarmant dans des campagnes paisibles et ceux qui ont affirmé que le royaume entier était en ébullition et sous les armes, il est bien difficile de dégager la vérité. Dans une lettre du 3 mars 1689 adressée à Deslandes, Véret se montre formel : J'ai déjà dit qu'on faisait par tout le royaume des lances et de sagaies, ce que nous savions si bien que nous avions appris qu'on en faisait même dans Bangkok au lieu de travailler aux affûts de canon que nos charpentiers faisaient, le bruit courant déjà que l'on voulait massacrer tous les Français et les autres chrétiens. (Robert Lingat, Une lettre de Véret sur la révolution siamoise de 1688, T’oung Pao N° 31, 1934, p. 349). Analyse partagée par L'abbé de Lionne : Il était encore certain que tout le royaume était en armes ; tous les jours on voyait monter à Louvo des gens armés ; tout le chemin de Siam à Louvo en était plein. Il n'y avait pas jusqu'à la plus vile populace et jusqu'aux rameurs de balon, qui ne portassent des armes, chose inouïe dans le royaume, si ce n'est dans un temps de révolte ou de trouble extraordinaire ; enfin, il était constant qu'on répandait dans le royaume des bruits désavantageux contre les Français pour les rendre plus odieux. On les accusait publiquement de vouloir envahir le royaume, ce qui se confirmait, parce que, dès que M. Desfarges avait paru près de Siam, les femmes qui tenaient le marché près de la ville et tout le peuple avaient pris l'alarme, et s'étaient enfui comme à la vue d'un ennemi déclaré ; enfin l'on avait redoublé les gardes pour empêcher, disait-on, que les Français ne pillassent le palais de Siam. (Mémoire sur une affaire sur laquelle on m'a demandé quelques éclaircissements, cité par Launay, Histoire de la Mission de Siam, I, 1920, p. 212).
Artus de Lionne n'en sera pas moins mis en accusation, ainsi qu'en témoigne une lettre de Laurent de Brisacier, directeur du séminaire des Missions-Étrangères, en date du 11 février 1692 (cité par Launay, Histoire de la Mission de Siam, I, 1920, p. 208) : Il y a une chose qui me fait beaucoup souffrir, et dont je vous supplie de faire le sacrifice avec moi : c'est que le père Verjus publie partout à ceux qui veulent l'entendre, même à nos meilleurs amis (témoin Mgr de Laon qui me le disait chez nous il y a aujourd'hui huit jours), que c'est vous qui, par le conseil que vous avez donné à M. Desfarges, avez été cause de la mort de M. Constance, du malheur des Français et du renversement des affaires de la religion à Siam.
Quant à Desfarges, le principal intéressé, on peut lui reprocher de s'être contenté des informations fournies par les missionnaires et Véret et de n'avoir pas dépêché quelques observateurs sur les routes pour s'assurer de la réalité de la situation : J'appris aussitôt de M. l'évêque de Métellopolis, de M. l'abbé de Lionne et du sieur Véret, chef de la loge française, qu'il courait un bruit public que le roi de Siam était mort, que tout était en armes à Louvo et sur les chemins, qu'on parlait d'arrêter le sieur Constance, et qu'il se débitait mille choses très désavantageuses pour les Français ; qu'on avait aussi nouvelle qu'il était descendu des soldats vers Bangkok en bon nombre, et qu'on disait être pour surprendre et pour massacrer les Français qui y étaient.
Je ne crus pas sur ces nouvelles qu'il fût de la prudence de continuer mon chemin. Je m'arrêtai donc aux environs de Siam, et j'écrivis en toute diligence au sieur Constance les bruits fâcheux qui couraient si publiquement ; et que je croyais beaucoup plus à propos pour son bien et pour le nôtre qu'il se rendît lui-même où je l'attendais, pour aller offrir nos services aux princes, vrais héritiers de la couronne, qui étaient tous deux dans la ville de Siam, et dissiper par-là les soupçons qu'on avait conçus contre nous. (Relation des révolutions arrivées à Siam dans l'année 1688, Amsterdam, 1691, pp. 11-12). ⇑
4 - Le roi de Siam avait chargé le père Tachard de faire venir douze mathématiciens dans le royaume et d'installer un observatoire à Lopburi, à l'image de celui que Ferdinand Verbiest avait fait bâtir à Pékin. Plusieurs gravures ont illustré cette soif de connaissance astronomique du monarque siamois.
 Palais de Louvo d'où le roi de Siam observe l'éclipse de lune. Gravure publiée dans le Voyage de Siam du père Tachard.
Palais de Louvo d'où le roi de Siam observe l'éclipse de lune. Gravure publiée dans le Voyage de Siam du père Tachard.
 L'éclipse de soleil à Siam en 1688 au mois d'avril.
L'éclipse de soleil à Siam en 1688 au mois d'avril.
Elle fut spéculée par les missionnaires jésuites et mathématiciens envoyés par le roi aux Indes orientales en 1687. Ce fut à Louvo dans le palais du roi qu'on l'observa en présence de ce prince qui était à une fenêtre d'une grande salle de son palais, assis sur un fauteuil, et les jésuites avec M. Constance qui leur servait d'interprète était assis les pieds croisés sur un grand tapis où était une rangée de mandarins prosternés la tête contre terre des deux côtés. On se servait en cette occasion de la belle machine parallactique qui est une espèce d'horloge où est attachée une lunette d'approche qui suit le mouvement du soleil. L'on voit là le mandarin Opra Pitracha qui vint voir de près cette machine. C'est celui qui s'est emparé du royaume de Siam et a chassé les Français. (Bibliothèque Nationale, Paris, Cabinet des Estampes). ⇑
5 - On appelait coup de partie un coup décisif, un coup qui décide du succès. ⇑
6 - Il s'agissait de Beauchamp, également auteur d'une précieuse relation. Par un brevet signé à Versailles le 31 janvier 1687 le sieur de Beauchamp, ci-devant capitaine au régiment de la Reine, était commandé pour occuper les fonctions de major dans le premier poste qui sera occupé à Siam (A.N. C1/27 ff° 41v°-42r°). Selon le témoignage du père de Bèze, il avait la confiance de Desfarges et bénéficiait de la considération de Phaulkon. Vollant des Verquains, qui le détestait, dénonca largement son opportunisme et son appât du gain, le décrivant comme une créature du général Desfarges. ⇑
7 - La princesse Sudawadhi (สุดาวดี) Krom luang (princesse de 3ème rang) Yothathep (กรมหลวงโยธาเทพ) 1656-1735, fille unique du roi Naraï et de la Princesse Suriyong Ratsami (สุริยงรัศมี), une de ses concubines, a été fréquemment évoquée dans les relations occidentales, et a intrigué, voire fasciné tous les étrangers. Auréolée d'un grand mystère, cette princesse qu'aucun occidental ne vit jamais fut l'objet de toutes les rumeurs et de tous les fantasmes. Un mariage secret de cette reine avec le demi-frère cadet du roi Narai, Chaofa Noï paraît assez invraisemblable. Ses sentiments anti-français ont été rapportés par de nombreuses relations. ⇑
8 - Mom Pi (หม่อมปีย์) ou Phra Pi (พระปีย์), parfois appelé Prapié, Monpy, Monpi, etc. dans les relations occidentales. D'origine incertaine, peut-être fils d'un courtisan, les sources thaïes évoquent un dignitaire subalterne de Phitsanulok, ce jeune garçon fut emmené très jeune au palais pour y exercer les fonctions de page et fut élevé par une sœur du roi Naraï. Toutes les relations s'accordent à reconnaître la tendresse quasi paternelle que le roi lui prodiguait et les privilèges exceptionnels dont il jouissait. Le père de Bèze en dresse un portrait de parfait courtisan : Il n’avait pas l’esprit fort vif et fort brillant mais il compensait cela par son bon air, ses manières aisées et engageantes et surtout par sa complaisance à l’égard du roi et son application à étudier et à prévenir tout ce qu’il pouvoit souhaiter. Il entra par là si avant dans ses bonnes grâces que le roi ne pouvait plus être un moment sans lui. (Mémoires du père de Bèze sur la vie de Constance Phaulkon, J. Drans et H. Bernard, Tokyo, 1947, p. 74). ⇑
9 - Le jésuite Claude de Bèze se trouvait au Siam pendant la révolution de 1688 et ses connaissances en histoire naturelle et en médecine lui permirent d'occuper une place privilégiée dans l'intimité du palais royal. Son Mémoire sur la vie de Constance Phaulkon et sa triste fin, écrit autour de 1689-1690 et publié par J. Drans et H. Bernard S.J. en 1947 aux Presses Salesiennes, Tokyo, nous donne de nombreuses et très précieuses précisions sur des épisodes peu connus ou mal connus de l'histoire siamoise. C'est à ce texte que sont empruntés les passages en italique de ce paragraphe.
La tradition siamoise veut que, sauf disposition contraire arrêtée par le roi, le pouvoir se transmette entre frères, c'est donc l'un des frères du roi Naraï qui aurait dû hériter de la couronne, car les Siamois regardent les frères du roi comme plus proche de la tige du sang royal que les enfants et ils succèdent ordinairement à moins que le roi n’en dispose autrement par son testament, les Siamois ayant beaucoup de déférence pour ses dernières volontés. (p. 35). Le plus âgé des deux, Chao Fa Apai thot (เจ้าฟ้าอภัยทศ) semblait d'emblée disqualifié. Le père de Bèze en dresse un portrait peu flatteur : ... mal fait de corps, il avait les jambes de travers dont à peine pouvait-il se servir et était d’ailleurs d’un naturel fort emporté et fort adonné au vin. (p. 67). Accusé – à tort ou à raison – d'avoir conspiré, il fut assigné à résidence dans le palais dont il ne pouvait sortir. Le frère cadet Chao Fa Noi (เจ้าฟ้าน้อย) partait avec de meilleures chances. Toujours selon de Bèze, le peuple, qui l’aimait tendrement, à cause de ses belles qualités, le regardait avec joie comme le successeur de la couronne et il avait en effet tout ce qui peut rendre un prince aimable : il était bien fait de sa personne et assez blanc, ce que les Siamois estiment beaucoup ; il était affable et populaire, l’esprit agréable et les manières fort engageantes, ce qui le rendait les délices de la cour et du peuple. (p. 69) Le roi Naraï songea à en faire son héritier au préjudice de l’aîné et, afin de rendre son choix plus solide, il songea à lui faire épouser la princesse son unique fille. (p. 69). Laquelle princesse Yotathep, follement éprise de son oncle, ne demandait pas mieux. Las pour le petit prince, une liaison qu'il eut avec une des principales concubines de son père entraîna sa disgrâce. La concubine fut condamnée à être dévorée par le tigre, qui est un des exécuteurs ordinaires des Siamois. (p. 72). Le prince fut également condamné à mort, puis gracié, il dut néanmoins subir une sévère correction qui lui laissa une grande faiblesse des jambes avec une espèce de paralysie sur la langue qui l’empêchait de parler ; quelques-uns, cependant, ont prétendu qu’il contrefaisait le muet pour ne pas donner d’ombrage au roi à qui l’attachement que les grands du royaume et sa fille même conservaient encore pour ce prince, était suspect. (p. 73). Les deux frères désormais hors course, restait le favori Mom Pi (หม่อมปีย์). D'origine roturière, recueilli dès son plus jeune âge par le roi, il avait été choyé et élevé comme un fils, si bien qu’il ne retint rien de la bassesse de son extraction, mais il prit tout l’air et les manières d’un homme de naissance et devint un parfait courtisan. Il n’avait pas l’esprit fort vif et fort brillant mais il compensait cela par son bon air, ses manières aisées et engageantes et surtout par sa complaisance à l’égard du roi et son application à étudier et à prévenir tout ce qu’il pouvait souhaiter. (p. 74). Toutefois, transmettre le trône à un roturier n'étant guère envisageable, le roi Naraï essaya en vain de marier Mom Pi à sa fille Yotathep, qui refusa catégoriquement, soit par fierté, soit, nous dit encore le père de Bèze, parce qu’elle était engagée d’inclination et même par les liens du mariage, au prince son oncle ; car c'était un bruit constant que, malgré la défense du roi et l’infidélité de ce prince qui s’était trouvé dans d’autres engagements, elle n’avait pas laissé, depuis sa disgrâce, de consommer avec lui le mariage que Sa Majesté avait d’abord projeté. (p. 74). Aucun successeur n'ayant été formellement désigné, et la santé du roi déclinant, c'était au plus ambitieux et au plus téméraire de mettre à profit les évènements pour s'emparer de la couronne. Phetracha sera celui-là. Sans la moindre goutte de sang royal, d'une naissance à servir sur un balon plutôt qu'à monter sur un trône, il sut habilement tisser sa toile, se rendre populaire auprès des mandarins et des talapoins influents, et pour tuer dans l'œuf toute opposition, il fit exécuter les deux frères du roi et Mom Pi. Épousa-t-il ensuite la princesse Yotathep ? C'est ce qu'on lit dans quelques relations. Le père de Bèze dément cette information : Il voulut en ce temps-là épouser cette jeune princesse pour s’affermir davantage sur le trône par ce mariage ; mais elle eut assez de fierté pour n’y vouloir pas consentir et pour lui reprocher qu’il avait mauvaise grâce de lui offrir une main trempée dans le sang de son père et de ses oncles. Elle était surtout inconsolable de la mort du plus jeune des princes qu’elle aimait tendrement et elle ne pouvait voir Phetracha qu’avec horreur, qu’elle en regardait comme le bourreau. (p. 147). ⇑
10 - Cette information n'est reprise dans aucune autre relation, et paraît peu crédible. D'après les témoignages, il semble que Monpi ait été d'une naissance trop obscure pour avoir un père capable de mettre sur pied une armée de 14.000 hommes. Néanmoins, même s'il fut la première victime de la révolution, il n'est pas exclu qu'il ait été manipulé par Phetracha et qu'il ait pris part au complot – dans la limite de ses modestes moyens. C'est ce que prétend Lanier (Étude historique..., 1883, p. 156) : Le roi témoignait une vive affection à un jeune mandarin qu'il gardait toujours auprès de lui, et dont il avait fait, disait-on, son fils adoptif : il se nommait Opra-Py ou Monpit. Pitracha le jugea propre à jouer un rôle utile dans le complot. Il eut avec lui quelques entretiens secrets et lui jura de le faire roi, s'il l'aidait à renverser Constance et le parti étranger. Monpit ébloui, se prêta naïvement à cette trahison. Il se chargea de garder et d'obséder le roi nuit et jour, si bien que personne n'aurait accès auprès de lui ; il livra à Pitracha les sceaux, et celui-ci s'en servit pour répandre partout de fausses nouvelles. ⇑
11 - Vollant des Verquains fait allusion à la concubine Tao Sri Chulalak (ท้าวศรีจุฬาลักษณ์), sœur de Phetracha qui, s'il faut en croire le père de Béze, avait un tempérament à la limite de la nymphomanie. Cette malheureuse créature, dont les infâmes débauches étaient connues de tout le monde, excepté du roi, était entrée si avant dans l’esprit et les bonnes grâces de Sa Majesté qu’elle avait un pouvoir presque absolu dans le palais. (De Bèze, op. cit. p. 69). Afin d'échapper aux regards des Siamois, elle allait faire ses frasques dans le camp des Portugais dont quelques-uns étaient fort dans ses bonnes grâces, précise de Bèze (p. 70). Condamnée à mort pour sa liaison avec Chao Fa Noi (เจ้าฟ้าน้อย), le frère cadet du roi, elle mourut non pas sous les pattes d'un éléphant, mais sous les crocs d'un tigre, et contrairement à ce qu'affirme Vollant des Verquains, elle ne fut certainement pas la mère de la princesse Yothathep, qui était la concubine Suriyong Ratsami (สุริยงรัศมี). Quant à la détermination de Phetracha à venger sa sœur, elle paraît dictée bien davantage par un calcul politique que par un sincère amour fraternel. Là encore, le témoignage du père de Bèze laisse peu de doutes sur les sentiments du général des éléphants : Pitratcha, qui y avait obtenu une des principales places par le crédit de sa sœur, ne se récusa pas en cette occasion ni ne demanda pas sa grâce, mais il fut au contraire le premier, pour soutenir sa fortune, à condamner celle à qui il avait la principale obligation, et à demander sa mort. (Op. cit. pp. 71-72). ⇑
12 - Les autres relations ne mentionnent que trois officiers : Beauchamp, major de Bangkok, le chevalier Desfarges, fils cadet du général Desfarges et le chevalier de Fretteville. ⇑

18 février 2019
