

7ème partie.
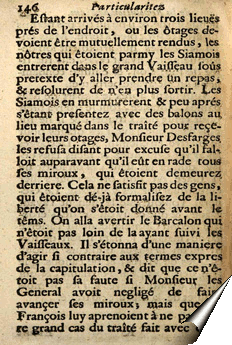
Étant arrivés à environ trois lieues près de l'endroit où les otages devaient être mutuellement rendus, les nôtres qui étaient parmi les Siamois entrèrent dans le grand vaisseau sous prétexte d'y aller prendre un repas, et résolurent de n'en plus sortir. Les Siamois en murmurèrent, et peu après, s'étant présentés avec des balons au lieu marqué dans le traité pour recevoir leurs otages, M. Desfarges les refusa, disant pour excuse qu'il fallait auparavant qu'il eût en rade tous ses mirousLes mirous, ou mirons, étaient de petits bateaux à rames réservés aux trajets côtiers., qui étaient demeurés derrière. Cela ne satisfit pas des gens qui étaient déjà formalisés de la liberté qu'on s'était donnée avant le temps. On alla avertir le barcalon qui n'était pas loin de là, ayant suivi les vaisseaux. Il s'étonna d'une manière d'agir si contraire aux termes exprès de la capitulation, et dit que ce n'était pas de sa faute si M. le général avait négligé de faire avancer ses mirous, mais que les Français lui apprenaient à ne pas faire grand cas du traité fait avec eux, puisqu'ils y donnaient atteinte les premiers.
Ainsi on renouvela la mésintelligence sur le point de se quitter. Les Siamois reçurent ordre de se saisir des mirous, et le ministre déclara qu'il ne les lâcherait point qu'il n'eût premièrement ses otages.
Mgr de Métellopolis, qui restait à Siam, fut en butte à tous les reproches des barbares que cet incident rendait plus hardis à insulter la nation. Le barcalon, l'ayant fait venir, lui en fit hautement les plaintes, et lui ordonna d'écrire à M. Desfarges pour lui témoigner son ressentiment et l'obliger, par le pouvoir attaché à son caractère, de lui faire justice. On fit plusieurs allées et venues de part et d'autre, enfin le ministre siamois accorda de donner et laisser passer les mirous, quand il aurait un de ses otages, et voulut que ce fût l'oya gouverneur de la ville de Siam, laissant les deux autres au pouvoir des Français, pour être rendus après qu'ils seraient maîtres du reste de leurs équipages. Il fallut accepter le parti, et l'otage fut remis en liberté, mais le barcalon ne tint pas sa parole, et se souciant peu de recouvrir ce qu'on avait à lui, il fut sourd à tous les moyens d'accommodement qu'on voulut ensuite lui proposer.
On fut très sensible à cette perte, de laquelle les deux otages que l'on emmenait ne consolaient aucunement. L'un était le second ambassadeur venu en France, et l'autre le gouverneur de la tabanque au bas de la rivière, mais on abandonnait environ douze Français qui se trouvaient ainsi exposés aux outrages d'un ennemi cruel et vindicatif, trente-six pièces de canon, avec pour plus de mille écus de toutes sortes de vivres.
Cependant la saison était déjà fort avancée, et la disposition des choses se trouvait telle qu'on ne pouvait pas se dispenser plus longtemps de mettre à la voil. On le fit le 22 novembre (1), et on s'éloigna d'une terre où l'on avait couru tant de fortunes en moins d'une année, au commencement de laquelle on s'était vu élevé au point de la plus glorieuse prospérité, et ensuite presque anéanti dans la plus humiliante disgrâce ; c'est ce que l'avenir aura peine à croire, s'il juge de cet événement selon les lois communes, car tout semblait être de concert à favoriser ce projet.
On arrive dans un pays non pas comme des étrangers voyageurs, mais comme des alliés de qui on avait recherché l'amitié. Le roi, qui y gouverne avec un pouvoir absolu, est le mieux intentionné du monde ; il fait toutes les démarches nécessaires pour arriver à une parfaite union, il envoie le premier ses ambassadeurs et les fait paraître avec assez d'éclat pour être jugé digne qu'on reçoive honnêtement ses avances ; il n'épargne ni magnificence pour bien régaler, ni caresses pour mieux engager à une alliance qu'il estime utile à ses intérêts et glorieuse à sa mémoire ; enfin après avoir achevé le plan de son dessein, et voyant tous les fondements établis, il donne à son ministre un plein pouvoir pour travailler à la perfection de son ouvrage.
Le ministre revêtu d'une autorité si étendue s'en sert utilement pour l'exécution du dessein. Il prend la chose à cœur autant que son maître, non pas par un motif d'ambition, mais par un pur zèle de religion pour laquelle il veut bien courir risque de sa fortune, qui était pour lors au plus haut point de son élévation. Effectivement, c'est ce qu'il a perdu, mais il est vrai que ce malheur était bien éloigné de toutes les apparences.
Il connaissait le prince qu'il avait l'honneur de servir, ferme dans ses résolutions, et le possédait assez pour ne pas craindre un revers de sa part. Après lui, il était tout-puissant dans ses États. Les mandarins éblouis de sa grandeur lui venaient rendre leurs hommages, étant pour la plupart attachés à sa personne par des bienfaits ou par l'espérance d'en recevoir, et il avait fait voir à ceux qui auraient eu envie de le traverser qu'il avait de la prudence pour dissiper une cabale, de la force pour y résister, et de l'autorité pour châtier des rebelles.
Dans ces circonstances, il traite avec les Français et il arrive ainsi au but des intentions du roi son maître, mais pour aller aussi à ses fins, qui étaient de planter solidement la foi, il leur accorde des conditions très favorables, et persuadé que la mission ne jouirait jamais paisiblement de ses privilèges qu'à l'abri d'une puissance redoutée des infidèles, il reçoit des troupes et les met en possession de deux places avec tous les agréments que l'on peut souhaiter, leur fournissant abondamment de quoi se fortifier, et cela dans un pays où il n'y a ni villes murées, ni troupes réglées, mais seulement selon le besoin quelques milices mal disciplinées. Ces choses sont assez connues de tous ceux qui ont ouï parler de la forme de ce gouvernement.
Les Français qui travaillent à se munir dans leurs retranchements n'ignorent pas que les différents États du royaume en murmurent, mais ils n'ont pas lieu de s'en mettre beaucoup en peine tant que leur protecteur sera dans la faveur, laquelle étant en assurance du côté du roi, semble ne devoir plus appréhender de disgrâce, surtout depuis le nouveau poids ajouté à son autorité par la présence des troupes dont il attend toute sorte d'alliance.
Cependant les murmures confus se lèvent comme des vapeurs et forment une petite nuée qu'un souffle pouvait dissiper au commencement. Le ministre le voit et fait connaître aux Français, afin de lui aider à détourner l'orage ; mais l'intérêt d'un homme perdu et la trop grande crédulité d'un chef lui ôtent toute espérance de secours. La nuée s'épaissit et crève enfin sur la tête du ministre, sur le roi, la famille royale et la nation française, qui s'est vue entraînée par le torrent.
Si M. Constance a eu le malheur de n'avoir point été secondé dans ses justes projets, son épouse a eu cela de commun avec lui qu'une crainte vaine a causé aussi la plus rigoureuse circonstance de sa mauvaise fortune ; et la prudence qui a eu un objet si faible est sans doute bien blâmable, mais que sert-il d'en chercher dans la suite d'une affaire où on l'a bannie dès le commencement ? Il n'y a pas jusqu'à la retraite que l'on a faite en sortant du royaume de Siam où il n'y ait eu de l'impudence, et les infidèles ont pris de là occasion de se moquer du traité fait avec eux, aussi la religion en a reçu en ce royaume le dernier coup de sa ruine. M. l'évêque de Métellopolis, chargé de fers avec tous ses missionnaires (2), a pu se désabuser à loisir que c'était assez d'une victime pour sauver le reste, et il aura connu sans doute que toute autre considération a cédé à la peur de ne pas sortir assez tôt des mains des Siamois.
C'est de ce principe qu'est venu aussi le désordre qui arriva dans l'embarquement des Français qui avaient occupé la forteresse de Mergui. Une trop grande précipitation a beaucoup diminué le mérite de cette action, qui eût eu plus de succès si elle eût été faite avec plus de sang froid. Cela est moins pardonnable à des gens qu'une longue expérience avait bien dû convaincre de la lâcheté de leurs ennemis. Il n'y en a jamais eu de plus méprisables, et c'est ce qui a fait dire que les Siamois faisaient la guerre comme les anges, ils ne s'efforcent qu'à faire lâcher le pied à leurs adversaires, mais ils combattent rarement pour avoir leur vie, crainte d'y laisser la leur. On en jugera par les exploits dont ils se signalèrent à l'attaque de Mergui.
M. du Bruant qui commandait ne fut pas deux mois dans ce poste, où il avait tant souhaité de se voir, qu'il comprit que son séjour n'y serait pas de longue durée, ses ouvrages abandonnés, la familiarité presque bannie entre les deux nations. Des différends suscités sur un point que la Cour avait décidé et des pièges tendus à des officiers de la garnison lui firent connaître assez clairement qu'il fallait songer à faire retraite. Il s'y disposait effectivement, lorsqu'il reçut la lettre que M. Desfarges avait été forcé de lui écrire. Il en reconnut aisément l'artifice et déclara qu'il n'obéissait point à un ordre semblable à celui-là.
Sa réponse fut la déclaration de la guerre. Aussitôt une multitude prodigieuse de barbares amassés des lieux circonvoisins investit la place, jetant des cris épouvantables. Mais ils n'osèrent jamais en approcher de plus près que de la portée du mousquet, et ne firent point de mal aux assiégés que de les étourdir de leur criaillerie, car on les mit bientôt hors d'état de se servir de leurs canons, la batterie qu'ils avaient faite ayant été démontée et leur canonnier tué.
Néanmoins, voyant les affaires ruinées, et que l'on ne gagnerait rien à défendre la forteresse, de laquelle tôt ou tard on serait obligé de sortir, on jugea de ne point différer davantage. Il y avait au port sous le canon des assiégés un petit vaisseau anglais, et un autre moyen bâtiment du roi de Siam, que le commandant avait eu soin de tenir prêts avant le blocus. Il ne fut point trouvé de plus sûr moyen que de les aller prendre à la barbe de l'ennemi et de s'abandonner à la destinée.
Ce fut le 24 juin que, n'ayant laissé dans la place que ce qu'on ne pouvait pas emporter, la garnison parut hors des retranchements, et eût fait croire aux Siamois effrayés quand ils la virent, qu'on leur faisait grâce de ne les pas aller attaquer, si la contenance des nôtres avait été mieux assurée (3). Mais chacun se hâtant d'aborder au rivage, pour se décharger du fardeau qu'il portait, cela causa beaucoup de confusion dont les infidèles s'étant aperçus, ils accoururent en foule avec leurs cris ordinaires et donnèrent une telle épouvante à leur tour, que les troupes en désordre s'étant embarrassées à l'embarquement, se renversèrent l'une sur l'autre, jusque-là qu'une chaloupe coula à fond, où il y eut plusieurs soldats et quelques officiers noyés, et qui pour avoir songé à sauver plus que l'honneur et la vie, perdirent le tout à la fois.
M. du Bruant avec sa suite s'étant mis en mer, eut dans sa route des aventures fort extraordinaires ; mais enfin malgré les vents, les mauvaises rencontres, et la perte de ses vaisseaux, il arriva à Pondichéry vers le 15 janvier de l'année 1689. C'est un endroit sur la côte de Coromandel où la Compagnie Royale des Indes a un comptoir, et où pour commencer à s'établir, elle a fait bâtir une petite enceinte de murailles flanquées de quatre tours, après en avoir obtenu la permission par des présents considérables qu'elle a fait à un prince nommé Sivagi, lequel ayant secoué le joug du grand Moghol, a réduit une partie de la côte sous son obéissance.
Les Français de Bangkok y étant venus relâcher environ quinze jours après, trouvèrent ceux de Mergui, et ce fut un vrai miracle que tous se fussent rassemblés en ce lieu, car si cela avait été difficile du côté de M. du Bruant, à cause des dangers qu'il avait courus, il n'avait pas aussi tenu au sieur Véret que l'on n'allât se confiner à PoltimonPulau Tioman, une des minuscules îles qui émaillent la côte est de la Malaisie., qui est une île déserte faisant face à la rivière qui sépare le Tonkin d'avec la Cochinchine, et où il faisait entendre au général qu'il trouverait une habitation fort saine et commode pour ses gens qui y seraient les maîtres, et autant avantageuse à la Compagnie des Indes pour la facilité du commerce que favorable au Séminaire pour y établir le centre de ses missions. Mais quoique l'on donnât aveuglément dans tout ce qui pouvait être un sujet de demeurer aux Indes, où l'on se flattait de rencontrer quelque établissement tout autrement considérable qu'au royaume de Siam, il fallut céder aux vents, qui furent toujours contraires aux desseins qu'on se proposa, et le meilleur parti fut de dresser sa route vers Pondichéry.

NOTES :
1 - Les témoignages divergent quant à la date de départ des Français. Beauchamp la fixe au 6 novembre. Le texte anonyme Relation de ce qui s'est passé au royaume de Siam indique le 2 novembre. Les trois vaisseaux ne sont peut-être pas tous partis en même temps. François Martin, qui n'y était pas, indique pour sa part le 2 décembre. ⇑
2 - Louis Laneau fut durement rudoyé dès le départ des troupes française, ainsi que le rapporte le Missionnaire Martineau dans le Journal de la mission cité par Launay (Histoire de la Mission de Siam, I, pp. 220-221) : À peine les navires sur lesquels les dites troupes étaient embarquées eurent-ils commencé à appareiller, que Mgr de Métellopolis, qui avait été obligé de reconduire les troupes jusqu'à l'embouchure de la rivière, afin, disait-on, de tenir toujours la balance en équilibre au milieu des deux partis, fut arrêté prisonnier, mais d'une terrible et étrange manière. Une troupe de Siamois se ruèrent sur lui, le dépouillèrent d'abord de tout ce qu'il avait de tant soit peu considérable, lui arrachèrent sa croix pectorale et son anneau pastoral, lui tirèrent même jusqu'à son chapeau ; (...) Ce ne fut pas assez pour eux de dépouiller ainsi mon dit seigneur, ils le chargèrent encore de coups de poing et de bâton, le renversèrent par terre, le traînèrent dans la boue, lui mirent la corde et col, et bien lié et garrotté le jetèrent comme à la voirie dans des broussailles, exposé à une infinité de moustiques et de maringoins, et bien davantage encore à la barbarie de canailles qui ne cessaient de passer, aller et venir, et chacun s'efforçait, comme à l'envi, de le maltraiter, invectiver et railler. Il fut ainsi exposé, en attendant que les cangues, ceps, alzèmes (bois que l'on met au col, aux jambes et aux mains) fussent achevés ; alors on les lui mit sur son pauvre corps déjà bien affaibli ; on ne manqua pas aussi d'y ajouter les fers aux pieds et les chaînes au col. ⇑
3 - Cette date est confirmée par le père Le Blanc. La relation de La Touche indique le 27 juin. ⇑

18 février 2019
