

Chapitre VII
Du mariage et du divorce des Siamois
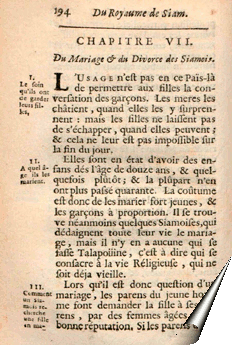
| I. Le soin qu'ils ont de garder leurs filles. |
L'usage n'est pas en ce pays-là de permettre aux filles la conversation des garçons. Les mères les châtient quand elles les y surprennent, mais les filles ne laissent pas de s'échapper quand elles peuvent, et cela ne leur est pas impossible sur la fin du jour.
| II. À quel âge ils les marient. |
Elles sont en état d'avoir des enfants dès l'âge de douze ans, et quelquefois plus tôt, et la plupart n'en ont plus passé quarante. La coutume est donc de les marier fort jeunes, et les garçons à proportion. Il se trouve néanmoins quelques Siamoises qui dédaignent toute leur vie le mariage, mais il n'y en a aucune qui se fasse talapoüine (1), c'est-à-dire qui se consacre à la vie religieuse, qui ne soit déjà vieille.
| III. Comment un Siamois recherche une fille en mariage, et comment leur mariage se conclut. |
Lorsqu'il est donc question d'un mariage, les parents du jeune homme font demander la fille à ses parents par des femmes âgées et de bonne réputation. Si les parents de la fille y ont du penchant, ils répondent favorablement. Ils se réservent néanmoins la liberté de consulter auparavant le goût de leur fille, et en même temps ils prennent l'heure de la naissance du garçon et donnent celle de la naissance de la fille, et des deux côtés on va aux devins pour savoir principalement si le parti proposé est riche et si le mariage durera jusqu'à la mort sans divorce. Comme chacun cache avec soin ses richesses pour les mettre à couvert de la concussion des magistrats et de l'avidité du prince, il faut qu'ils aillent au devin pour savoir si une famille est riche, et c'est sur l'avis des devins qu'ils prennent leur résolution. Si le mariage se doit conclure, le jeune homme va voir la fille trois fois et lui porte des présents de bétel et de fruit, et rien de plus précieux. À la troisième visite, les parents de part et d'autre s'y trouvent aussi, et l'on compte la dot de l'épouse et ce que l'on donne de bien à l'époux, auquel le tout est délivré sur-le-champ et en présence des parents, mais sans aucune écriture. Les nouveaux mariés reçoivent aussi pour l'ordinaire en cette occasion des présents de leurs oncles, et dès lors et sans aucune cérémonie de religion, l'époux a droit de consommer le mariage. Il est même défendu aux talapoins d'y assister (2). Quelques jours après seulement, ils vont chez les nouveaux mariés jeter beaucoup d'eau bénite et réciter quelques prière en langue pali.
| IV. Fête de la noce. |
La noce est, comme partout ailleurs, accompagnée de festins et de spectacles. Ils y appellent des danseurs de profession, mais ni l'époux, ni l'épouse, ni aucun des convives n'y dansent. La fête se fait chez les parents de la fille où l'époux a soin de faire bâtir une salle exprès, qui est isolée, et de là on mène les nouveaux mariés dans un autre bâtiment isolé, bâti aussi exprès par les soins et aux frais de l'époux dans l'enceinte de bambou qui fait la clôture du logis des parents de la fille. Les nouveaux mariés y demeurent pendant quelques mois, et ensuite il vont habiter où il leur plaît de bâtir un logis pour eux. Un ornement singulier pour les filles des mandarins que l'on marie, c'est de leur mettre sur la tête ce cercle d'or que les mandarins mettent à leur bonnet de cérémonie. À cela près la parure consiste à avoir de plus belles pagnes (3) qu'à l'ordinaire, de plus beaux pendants d'oreille, et de plus belles bagues aux doigts, et en plus grande quantité. Il y en a qui disent que le prétendu beau-père, avant que de conclure le mariage de sa fille avec son gendre, le garde chez lui pendant six mois pour le mieux connaître. On m'a nié absolument que cela fût véritable. Et tout ce qui, à mon avis, peut avoir donné occasion de le dire, c'est que c'est à l'époux à faire bâtir la salle de noces et le logement qu'il doit avoir chez son beau-père, pendant quoi, c'est-à-dire pendant deux ou trois jours tout au plus, sa future épouse lui porte à manger sans qu'on en appréhende les conséquences, parce que le mariage est déjà conclu, quoique la fête en soit différée.
| V. La richesse des mariages de Siam. |
La plus grande dot à Siam est de cent catis (4) qui font quinze mille livres, et parce qu'il y est ordinaire que le bien de l'époux soit égal à celui de l'épouse, il s'ensuit qu'à Siam la plus grande fortune de deux nouveaux mariés ne passe pas dix mille écus (5).
| VI. De la pluralité des femmes. |
Les Siamois peuvent avoir plusieurs femmes, quoiqu'ils estiment que ce serait mieux fait de n'en avoir qu'une, et il n'y a que les gens riches qui affectent d'en avoir davantage, plus par faste et par grandeur que par débauche.
| VII. Distinction considérable entre elles. |
Quant ils ont plusieurs femmes, il y en a toujours une qui est la principale : ils l'appellent la grande femmeMia luang : เมียหลวง. Les autres, qu'ils appellent les petites femmesMia noï : เมียน้อย, sont à la vérité légitimes, je veux dire permises par les lois, mais elles sont soumises à la principale (6). Ce ne sont que des femmes achetées, et par conséquent esclaves, de sorte que les enfants des petits femmes appellent leur père Pô TcháouPho chao : พ่อ เจ้า, c'est-à-dire Père seigneur, au lieu que les enfants de la femme principale l'appellent PôPho : พ่อ simplement, c'est-à-dire Père.
| VIII. Degrés d'alliance défendus, et comment les rois de Siam en usent sur cet article. |
Le mariage dans les premiers degrés de parenté leur est défendu, ils peuvent néanmoins épouser leur cousine germaine. Et quant aux degrés d'alliance, un homme peut épouser les deux sœurs l'une après l'autre, et non pas en même temps. Néanmoins les rois de Siam se dispensent de ces règles et ne croient pouvoir guère trouver de femmes dignes d'eux que dans les personnes qui leur sont les plus proches. Celui d'aujourd'hui avait épousé sa sœur, et de ce mariage est née la princesse, sa fille unique, laquelle on dit qu'il a épousée (7). Je ne l'ai pu savoir au vrai, mais c'est le bruit commun, et j'y trouve de l'apparence en ce qu'on lui a fait sa maison comme à une reine et les Européens, qui l'ont appelée la Princesse-reine, en ont jugé comme moi. Les relations nous apprennent qu'il y a ailleurs qu'à Siam des exemples de ces mariages du frère avec la sœur, et il est certain qu'ils ont été fréquents autrefois parmi beaucoup de nations païennes, au moins dans les familles royales, soit afin que la fille succédât à la Couronne avec le fils, soit par la crainte que je viens de dire que ces rois ont eue de se mésallier s'ils n'épousaient leurs propres sœurs. Car pour ce que d'autres ajoutent que c'est afin que les peuples ne puissent douter d'avoir un maître du sang royal au moins par sa mère, je n'y trouve nulle vraisemblance à l'égard de l'Orient où les peuples sont si peu attachés au sang de leurs rois, et où les rois croient s'assurer de la fidélité de leurs femmes en les gardant fort étroitement.
| IX. Les lois de la succession pour les veuves et pour les enfants. |
La succession dans les familles particulières de Siam est toute pour la grande femme, et puis pour ses enfants qui héritent de leurs parents par portions égales. Les petites femmes et leurs enfants peuvent être vendus par l'héritier, et ils n'ont que ce que l'héritier leur donne ou ce que le père, avant de mourir, leur a donné de la main à la main, car les Siamois ignorent l'usage des testaments (8). Les filles nées des petites femmes sont vendues pour être elles-mêmes petites femmes, et les plus puissants achetant les mieux faites, sans prendre garde aux parent dont elles sortent, font de cette manière des alliances très inégales, et ceux avec qui ils les font n'acquièrent guère par-là ni plus d'honneur, ni plus de protection.
| X. En quoi consiste la fortune d'un Siamois. |
Les biens des Siamois consistent principalement en meubles (9). S'ils ont des terres, ils en ont peu, parce qu'ils n'en sauraient acquérir la pleine propriété : elle appartient toujours à leur roi, qui reprend quand il lui plaît les terres qu'il a vendues aux particuliers, et qui les reprend souvent sans en rembourser le prix. La loi du pays est néanmoins que les terres soient héréditaires dans les familles et que les particuliers se les puissent vendre l'un à l'autre, mais le prince n'a égard à cette loi qu'autant qu'il lui convient, parce qu'elle ne peut préjudicier à son domaine qui s'étend généralement sur tout ce que possèdent ses sujets. Cela fait qu'ils acquièrent le moins d'immeubles qu'ils peuvent et qu'il tâchent toujours à dérober leurs meubles à la connaissance de leur roi, et parce que les diamants sont les meubles les plus aisés à cacher et à transporter, ils sont recherchés à Siam et dans toutes les Indes et s'y vendent chèrement. Quelquefois les seigneurs indiens donnent en mourant une partie de leur bien au roi leur maître pour assurer le reste à leur famille, et cela leur réussit pour l'ordinaire.
| XI. Le divorce. |
Les ménages sont presque tous heureux à Siam, comme on en peut juger par la fidélité des femmes à nourrir leur mari tant qu'il sert le roi, service qui par une espèce de concussion dure non seulement six mois par an, mais quelquefois une, deux et trois années de suite. Mais lorsque le mari et la femme ne peuvent se supporter l'un l'autre, ils ont le remède du divorce. Il est vrai qu'il n'est guère en usage que parmi le peuple ; les riches, qui ont plusieurs femmes, gardent également celles qu'ils n'aiment pas et celles qu'ils aiment.
| XII. Quelles en sont les lois. |
Le mari est naturellement le maître du divorce, mais il ne le refuse guère à sa femme quand elle le veut absolument ; il lui rend sa dot, et leurs enfants se partagent entre eux en cette manière : la mère a le premier, le troisième, le cinquième et tous les autres en rang impair ; le père a le second, le quatrième, le sixième et tous les autres en rang pair. Par là, il arrive que s'il n'y a qu'un enfant, il est pour la mère, et que si le nombre des enfants est impair, la mère en a un de plus, soit qu'ils aient jugé que la mère en aurait plus de soin que le père, soit que les ayant portés dans ses flancs et les ayant nourris de son lait, elle semble y avoir un plus grand droit que le père, soit qu'étant plus faible, elle ait plus de besoin que lui du secours de ses enfants.
| XIII. Et les suites. |
Après le divorce, il est permis au mari et à la femme de se remarier à qui ils veulent, et il est libre à la femme de le faire dès le jour du divorce sans qu'ils se soucient du doute qui en peut arriver touchant le père du premier enfant qui peut naître après les secondes noces. Ils se fient à ce que la femme en dit : grande marque du peu de jalousie de ce peuple. Mais quoique le divorce leur soit permis, ils ne laissent pas de le regarder comme un fort grand mal et comme la perte presque certaine des enfants qui sont d'ordinaire fort mal traités dans les seconds mariages de leurs parents. De sorte que c'est une des causes que l'on donne de ce que le pays n'est guère peuplé, quoique les Siamoises soient fécondes et qu'elles aient même assez souvent des jumeaux.
| XIV. De la puissance paternelle. |
La puissance du mari est despotique dans sa famille jusqu'à pouvoir vendre ses enfants et ses femmes, hormis sa femme principale qu'il peut seulement répudier. Les veuves héritent du pouvoir de leurs maris avec cette restriction qu'elles ne peuvent vendre les enfants qu'elles ont en rang pair si les parent du père s'y opposent, car les enfants n'oseraient s'y opposer. Après le divorce, le père et la mère peuvent vendre chacun les enfants qui leur sont demeurés en partage selon la division que j'ai dite. Mais les parents ne peuvent tuer leurs enfants, ni le mari tuer ses femmes, parce qu'en général tout meurtre est défendu à Siam.
| XV. Des commerces amoureux. |
L'amour des personnes libres n'y est point honteux, au moins parmi le menu peuple ; il y est regardé comme un mariage, et l'inconstance comme un divorce. Les parents néanmoins y gardent leurs filles, comme j'ai dit, et nulle part il n'est permis aux enfants de disposer d'eux-mêmes au préjudice de la puissance paternelle, qui est le plus naturel de tous les droits. D'ailleurs, les Siamoises sont naturellement assez glorieuses pour ne se donner pas aisément aux étrangers, ou au moins pour ne les pas appeler. Les pégouanes qui sont à Siam, comme étant étrangères elles-mêmes, font plus de cas des étrangers et passent pour débauchées dans l'esprit de ceux qui n'entendent pas qu'elles cherchent un mari. Aussi sont-elles fidèles jusqu'à ce qu'on les abandonne, et si elles deviennent grosses, elles n'en sont pas moins estimées parmi celles de leur nation, et même elles font gloire d'avoir eu pour mari un homme blanc. Il se peut faire aussi qu'elles sont de complexion plus amoureuse que les Siamoises ; elles ont au moins plus de vivacité (10). C'est une opinion établie dans les Indes que les peuples y ont plus ou moins d'esprit selon qu'ils sont plus voisins ou plus éloignés du Pégou.

NOTES
1 - Plus loin dans son ouvrage (I, p. 455), La Loubère reviendra sur ces semi-religieuses : Les talapoüines s'appellent Nang Tchii [นางชี]. Elles sont vêtues de blanc comme les Tapacáou, et ne sont pas estimées tout à fait religieuses. Un simple supérieur suffit à leur donner l'habit, aussi bien qu'aux Nens [เณร : novices], et quoiqu'elles ne puissent avoir aucun commerce charnel avec les hommes, néanmoins on ne les brûle pas pour cela comme on brûle les talapoins qu'on surprend en faute avec les femmes. On les livre à leurs parents pour les châtier du bâton, parce que les talapoins ni les talapoüines ne peuvent frapper personne.
Un siècle et demi plus tard, Mgr Pallegoix apportera quelques précisions supplémentaires : Il y a, aux environs des pagodes, une certaine classe de femmes qu'on appelle nang-xi ; ce sont des veuves qui, ne sachant que devenir, se dévouent au service des phra. L'abbé du monastère leur donne un habit blanc au moyen duquel elles ont droit d'aller demander l'aumône, non seulement pour elles, mais encore pour le monastère auquel elles sont attachées. Si elles se conduisent mal, on les chasse et on les livre à leurs parents pour les châtier. Ces demi-religieuses doivent réciter une espère de chapelet, et l'on dit que quand elles prient, elles sont obligées de se tourner le dos. (Description du royaume thai ou Siam, 1854, II, p. 43).
 Nonnes (mae chi : แม่ชี) en Thaïlande. ⇑
Nonnes (mae chi : แม่ชี) en Thaïlande. ⇑
2 - Rappelons que contrairement au christianisme, le bouddhisme ne considère pas le mariage comme un sacrement, mais comme un simple engagement privé sans connotation religieuse. ⇑
3 - Voir la Note 3 du 1er chapitre de la 2ème partie. ⇑
4 - Le cati ou catti était une mesure de poids d'argent chinoise, mais il est impossible de savoir s'il s'agissait du cati chinois ou de sa déclinaison siamoise, le chang (ชั่ง]), qui valait seulement la moitié. Le mot de cati est chinois, et s'appelle schang en siamois, mais le cati chinois vaut deux catis siamois. (La Loubère, Du royaume de Siam, 1691, II, p. 62). Cette différence est confirmée par Jacques Savary des Brûlons dans son Dictionnaire universel de commerce (1726, II, p. 1507) : Le Schan [chang], que les Chinois appellent cati, est un poids dont on se sert dans le royaume de Siam. Le cati chinois vaut deux changs siamois, en sorte que celui de la Chine vaut seize taels, et celui de Siam seulement huit. Quelques-uns mettent le cati chinois à vingt taels, et le siamois à la moitié. Aujourd'hui en Thaïlande, le poids du chang est officiellement fixé à 1,2 k. Selon la plupart des relations, un cati valait effectivement 150 livres. ⇑
5 - Un écu valait 3 livres. ⇑
6 - Si la monogamie était de règle dans les classes populaires – pour des raisons économiques, entretenir plusieurs femmes coûte cher –, la polygamie était d'usage au Siam dans les classes aisées, et jusqu'à une époque relativement récente, puisqu'elle ne fut abolie qu'en 1935. Dans sa Description du Royaume de Siam (op. cit., II, pp. 316-317), Mgr Pallegoix écrivait : Le roi [Mongkut, Rama IV] a des centaines de concubines ; les ministres, les mandarins, les gouverneurs et autres grands officiers suivent son exemple. Tous les riches se procurent un plus ou moins grand nombre de concubines selon leur plus ou moins de fortune. Il n'est donc pas étonnant que la partie la plus puissante et la plus influente de la nation ne s'accommode pas de la religion chrétienne qui réprouve une licence de mœurs aussi effrénée. Dans ces familles polygamiques, les épouses étaient considérées selon leur ancienneté, chacune ayant autorité sur les épouses d'un rang inférieur. L'épouse du premier mariage était l'épouse officielle, la mia klang muang (เมียกลางเมือง), la seconde épouse était la mia klang nok (เมียกลางนอก), et les troisièmes, du rang le plus bas, étaient les mia klang thasi (เมียกลางทาสี). Aujourd'hui encore, pour perpétuer la tradition, beaucoup d'hommes – parmi ceux qui en ont les moyens – entretiennent plus ou moins discrètement une maîtresse, une petite épouse, une mia noi (เมียน้อย), au risque de s'exposer à la jalousie et aux foudres de leur mia luang, l'épouse officielle. Mais après tout, entretenir une maîtresse n'est pas un comportement spécifiquement thaïlandais. ⇑
7 - Si tous les témoignages s'accordent sur le fait que le roi Naraï avait une fille élevée au rang de Krom Luang Yothathep (กรมหลวงโยธาเทพ), il apparaît impossible de déterminer avec certitude qui était la mère de cette princesse, tant les unions consanguines, les boursouflures des titres et des noms et les témoignages contradictoires des Chroniques royales et des Occidentaux présents dans le royaume viennent brouiller les cartes. Gervaise nous dit : Il [le roi Naraï] épousa solennellement la fille de son père ; il la fit déclarer reine avec toutes les cérémonies accoutumées. Il maria sa sœur utérine à un de ses frères qui était un parfait honnête homme. (Histoire naturelle et politique du royaume de Siam, 1688, p. 246). Si l'unique sœur utérine cadette de Naraï est à peu près identifiée comme Sri Suphan (ศรีสุพรรณ), la Krom Luang Yothathip (กรมหลวงโยธาทิพ), nous ne savons rien sur la fille de son père, curieuse périphrase pour désigner une sœur, ou au moins une demi-sœur. Quant à La Loubère, il écrit (I, p. 387) : La feue reine qui était sa femme et sa sœur en même temps s'appelait Nang Acamahisii (Akramehesi : อัครมเหสี). Malheureusement, Akramehesi n'est pas un nom, mais le titre qu'on donne à la reine consort. S'agissait-il de Tao Sri Chulalak (ท้าวศรีจุฬาลักษณ์), la concubine – sœur de Phetracha – qui fut jetée aux tigres pour avoir eu une liaison avec un frère du roi, comme le pense (sans doute à tort) Dirk van der Cruysse (Siam and the West, 2002, p. 81) ? Nous ne perdrons pas davantage de temps à essayer de résoudre une énigme qui restera sans doute à jamais insoluble, et nous adopterons la version Wikipédia qui, s'appuyant sur un ouvrage de Sansani Weerasilpichai (ลูกแก้ว เมียขวัญ : Luk kaeo mia khwan, Matichon, 2016) affirme que la princesse Yothathep était la fille d'une concubine du roi Naraï nommée Suriwong Ratsami (สุริยงรัศมี), version qui, à défaut d'être historiquement irréfutable, a le mérite d'être aussi crédible qu'une autre… et simple. ⇑
8 - W.A.R. Wood rapporte que le roi Prasat Thong promulgua en 1635 une loi sur l'héritage et les testaments, ce qui contredit les propos de La Loubère. Selon Wood, cette loi était même supérieure à la loi anglaise appliquée en 1926 : Prétendument basée sur le Dhammathat, elle représentait tout de même une grande amélioration par rapport au code anachronique de Manu. Il est intéressant de noter que, même si cette pratique n'était pas une nouveauté au Siam à cette époque, la loi du roi Prasat Thong prévoyait l'établissement de testaments. En revanche, les bouddhistes birmans, même de nos jours, ne peuvent toujours pas faire de testaments. Les dispositions de la loi siamoise concernant les témoins d'un testament sont très intéressantes et, de l'avis de l'auteur, sont supérieures à la loi anglaise en la matière. Les témoins doivent être des personnes respectables, leur nombre variant selon le rang du testateur. De plus, ils ne sont pas, comme en Angleterre, simplement témoins de la signature du testament, mais aussi de son contenu et de la compétence du testateur. Ces dispositions rendent difficile pour un homme de faire un testament hâtif ou excentrique, car il aura du mal à trouver le nombre requis de personnes respectables pour en témoigner. Il est donc pratiquement impossible pour un Siamois, sur son lit de mort, de déshériter sa femme et ses enfants et de laisser son argent à un foyer pour chiens perdus. (A History of Siam, 1926, pp. 185-186). ⇑
9 - Dans le sens juridique de biens qui peuvent être déplacés, par opposition à immeubles. ⇑
10 - Le prude Chaumont avait noté cette disposition des femmes de Pégou à la débauche : Dans ce grand royaume il y a beaucoup de Pégouans qui ont été pris en guerre, ils sont plus remuants que les Siamois et sont d'ordinaire plus vigoureux. Il y a parmi les femmes du libertinage, leur conversation est périlleuse. (Relation de l'ambassade de M. le chevalier de Chaumont […], 1686, p. 131). Les raisons avancées pour expliquer ces fâcheuses dispositions sont pour le moins curieuses. Le Marseillais Vincent Leblanc avait évoqué la reine Tirada, qui obligeait les femmes de Pégou à se montrer impudiques pour détourner les hommes du péché de sodomie auquel, paraît-il, ils étaient fort inclins. (Les voyages fameux du sieur Vincent Leblanc, Marseillais, 1648, pp. 155-156). On trouve davantage de détails dans la Relation de Johan Albrecht de Mandelslo aux Indes orientales, publiée dans la Suite de la relation du voyage en Moscovie, Tartarie et Perse d'Adam Olearius, traduit par Abraham de Wicquefort, II, Paris, 1659, p. 298-299 : La sodomie était autrefois si commune en ce pays-là, que pour extirper ce vice qui allait détruire toute l'espèce, une reine de Pégou s'avisa d'ordonner par édit que les hommes porteraient dans la verge une sonnette qui l'enfle en sorte qu'ils ne sont plus capables d'outrager la nature. Et afin que les femmes ne soient point frustrées de ce qui leur est dû, on leur ôte la virginité dès la première jeunesse par le moyen d'une certaine composition qui fait un effet tout contraire à celle dont les femmes publiques se servent en quelques endroits pour donner plus de plaisir à leurs ruffians. (…) Les femmes font tout ce qu'elles peuvent pour se rendre aimables pour attirer les hommes, en ne se couvrant les parties honteuses que d'un petit linge qui ne les cache pas si bien que le moindre vent ne découvre tout ce qu'elles portent.
 Les Péguiens portent aux parties honteuses des balles de plomb. La Galerie agréable du monde, Pieter vander AA, 1729. ⇑
Les Péguiens portent aux parties honteuses des balles de plomb. La Galerie agréable du monde, Pieter vander AA, 1729. ⇑

18 mai 2020
