

Chapitre XXIII
De l'origine des talapoins et de leurs opinions
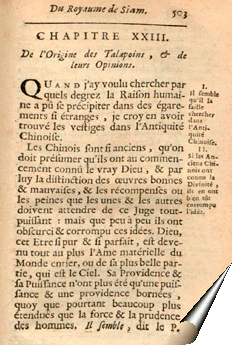
| I. Il semble qu'il la faille cherche dans l'Antiquité chinoise. |
Quand j'ai voulu chercher par quels degrés la raison humaine a pu se précipiter dans des égarements si étranges, je crois en avoir trouvé les vestiges dans l'Antiquité chinoise.
| II. Si les anciens Chinois ont connu la divinité, ils en ont bientôt corrompu l'idée. |
Les Chinois sont si anciens qu'on doit présumer qu'ils ont au commencement connu le vrai dieu, et par lui la distinction des œuvres bonnes et mauvaises et les récompenses ou les peines que les unes et les autres doivent attendre de ce juge tout puissant, mais que peu à peu ils ont obscurci et corrompu ces idées. Dieu, cet être si pur et si parfait, est devenu tout au plus l'âme matérielle du monde entier, ou de sa plus belle partie qui est le ciel. Sa providence et sa puissance n'ont plus été qu'une puissance et une providence bornées, quoique pourtant beaucoup plus étendue que la force et la prudence des hommes. Il semble, dit le père Trigaut, au premier livre de son expédition chrétienne à la Chine, chapitre 10, que les anciens Chinois aient cru le ciel et la terre animés, et qu'ils en aient adoré l'âme comme un dieu suprême, l'appelant le Roi du Ciel, ou simplement le Ciel et la Terre (1). Le père Trigaut pouvait former le même doute sur toutes choses, car la doctrine des Chinois a de tout temps attribué des esprits aux quatre parties du monde, aux astres, aux montagnes, aux rivières, aux plantes, aux villes et à leurs fossés, aux maisons et à leurs foyers, et en un mot à toutes choses. Et tous les esprits ne leur paraissent pas bons : ils en reconnaissent de méchants, pour être la cause immédiate des maux et des désastres auxquels la vie humaine est sujette. D'ailleurs, comme ils ont cru que la terre et la mer tenaient au ciel par l'horizon, ils n'ont attribué qu'un même esprit, ou qu'une même âme au ciel et à la terre, quoique néanmoins, et peut-être par quelque pensée contraire à leur première opinion, ils aient bâti deux temples différents, l'un consacré au ciel, et l'autre à la terre.
| III. Ils ont ôté à Dieu la providence infinie et la toute-puissance. |
Comme donc l'âme de l'homme était, à leur avis, la source de toutes les actions vitales de l'homme, ainsi ils donnaient une âme au Soleil pour être la source de ses qualités et de ses mouvements, et sur ce principe, les âmes répandues partout, causant dans tous les corps les actions qui paraissent naturelles à ces corps, il n'en fallait pas davantage pour expliquer dans cette opinion toute l'économie de la nature, et pour suppléer la toute-puissance et la providence infinie qu'ils n'admettaient en aucun esprit, non pas même en celui du Ciel.
| IV. Ils ont fait de Dieu comme un roi de toute la nature, mais non pas un roi toujours obéi. |
À la vérité, comme il semble que l'homme, usant des choses naturelles pour sa nourriture ou pour sa commodité, a quelque pouvoir sur les choses naturelles, l'ancienne opinion des Chinois donnant à proportion un semblable pouvoir à toutes les âmes, supposait que celle du Ciel pouvait agir sur la nature avec une prudence et une force incomparablement plus grandes que la prudence et la force humaine, mais en même temps, elle reconnaissait dans l'âme de chaque chose une force intérieure, indépendante par sa nature du pouvoir du Ciel, et qui agissait quelquefois contre les desseins du Ciel. Le Ciel gouvernait la nature comme un roi puissant ; les autres âmes lui devaient obéissance ; il les y forçait presque toujours, mais il y en avait qui se dispensaient quelquefois de lui obéir.
| V. Confucius croit l'extrême vertu impossible, et par conséquent il croit impossible l'idée que nous avons de Dieu. |
Confucius, parlant de la vertu sans bornes qui est la vraie idée que nous avons de la divinité, la croit impossible. Quelque vertueux, dit-il, que soit un homme, il y aura encore un degré de vertu auquel il n'aura pu atteindre. Le Ciel même, et la Terre, ajoute-t-il, quoique si grands, si parfaits et si bienfaisants, ne peuvent néanmoins satisfaire les désirs de tout le monde, à cause de l'inconstance des temps et des éléments, de telle sorte que l'homme trouve en eux de quoi reprendre, et même de justes sujets d'indignation. C'est pourquoi si l'on comprend bien la grandeur de l'extrême vertu, on avouera nécessairement que l'univers entier n'en peut contenir ni soutenir le poids. Si au contraire on songe à ce point subtil et caché de perfection en quoi elle consiste, on avouera que le monde entier ne la saurait diviser ni pénétrer. Ce sont les paroles de Confucius tel que le père Couplet nous les a données (2), par où ce philosophe semble n'avoir eu d'autre intention que de décrire la véritable divinité, laquelle il croit impossible, puisqu'il ne la trouve nulle part, non pas même dans l'esprit du Ciel et de la Terre, qui est ce qu'il croyait le plus parfait.
| VI. Le culte dû au créateur divisé aux créatures par les anciens Chinois. |
La puissance et la providence divines étant ainsi distribuées comme par morceaux à une multitude d'âmes infinie, les anciens Chinois se trouvèrent obligés d'adresser à cette infinité d'âmes ou d'esprits les vœux et le culte qu'ils ne devaient qu'à un seul.
| VII. Ils firent de toute la nature un État pareil aux leurs. |
Ils firent de la nature une monarchie invisible qu'ils moulèrent sur la leur, et dont ils croyaient que les membres invisibles avaient une continuelle correspondance avec les membres de la monarchie chinoise, qu'ils croyaient occuper à peu près toute la terre. Ils donnèrent à l'esprit du Ciel six principaux ministres, comme le roi de la Chine en a six, qui sont les présidents des six premiers tribunaux, où eux seulement ont voix délibérative. Ils croyaient que le roi du Ciel (car ils donnaient ce titre à l'esprit du Ciel) ne se mêlait que de la personne et des mœurs du roi de la Chine ; que tous les hommes devaient honorer ce suprême esprit, mais qu'il n'y avait que le roi de la Chine qui fût digne de lui offrir des sacrifices, et ils n'avaient pour ces sacrifices aucun autre prêtre. Les ministres de la Chine offraient des sacrifices aux ministres du Ciel et chaque officier chinois honorait ainsi un officier pareil à lui auprès du Ciel. Le peuple sacrifiait à la foule des esprits répandus partout et chacun était prêtre en cette sorte de culte, sans qu'il y eût aucun ordre ou corps religieux pour le service des temples et pour les sacrifices.
| VIII. Ce que les Indiens ont ajouté à ces erreurs. |
Les Indiens croient aujourd'hui, comme les anciens Chinois, des âmes tant bonnes que mauvaises, répandues partout, auxquelles ils ont distribué, pour ainsi dire, la toute-puissance divine. Et l'on trouve encore des restes de cette opinion même parmi les Indiens qui ont embrassé le mahométisme. Mais par une nouvelle erreur, les païens des Indes ont cru toutes ces âmes de même nature, et ils les ont fait toutes rouler d'un corps en un autre. L'esprit du Ciel des anciens Chinois avait quelque air de divinité : il était, ce semble, immortel et non pas sujet à vieillir et à mourir et à laisser sa place à un successeur ; mais dans la doctrine indienne de la métempsycose, les âmes ne sont fixes nulle part, et se succédant partout les unes aux autres, elles ne valent pas mieux l'une que l'autre par leur nature : elles sont seulement destinées à de plus hautes ou à de plus basses fonctions dans la nature, selon le mérite de leurs œuvres.
| IX. Pourquoi les Indiens n'ont point consacré de temple aux esprits, non pas même à celui du Ciel. |
Aussi les Indiens n'ont-ils pas consacré de temples aux esprits, non pas même à celui du Ciel, parce qu'ils les croient tous des âmes comme toutes les autres, qui sont encore dans la voie des transmigrations, c'est-à-dire dans le péché et dans les peines de différentes sortes de vie, et par conséquent indignes d'avoir des autels.
| X. Les anciens Chinois ont divisé la justice de Dieu. |
Que si les anciens Chinois avaient pour ainsi dire mis en pièces la providence et la toute-puissance de Dieu, ils n'avaient pas moins divisé sa justice. Ils assuraient que les esprits, comme des magistrats cachés, étaient principalement occupés à punir les fautes cachées des hommes ; que l'esprit du Ciel punissait les fautes du roi, les esprits ministre du Ciel les fautes des ministres du roi, et ainsi des autres esprits à l'égard des autres hommes.
| XI. La justice du Ciel était principalement occupée à punir les fautes des rois de la Chine. |
Sur ce fondement, ils disaient à leur roi qu'encore qu'il fût le fils adoptif du Ciel, le Ciel néanmoins ne se laisserait mener à son égard par aucune sorte d'affection, mais par la seule considération du bien ou du mal qu'il ferait dans le gouvernement de son royaume. Ils appelaient l'empire chinois le Commandement Céleste, parce, disaient-ils, qu'un roi de la Chine devait gouverner son État comme le Ciel gouvernait la nautre, et que c'était au Ciel qu'il devait demander la science de gouverner. Ils reconnaissaient que non seulement l'art de régner était un présent du Ciel, mais que la royauté même était donnée par le Ciel, et qu'elle était un présent difficile à conserver, parce qu'ils supposaient que les rois ne se pouvaient maintenir sur le trône sans la faveur du Ciel, ni plaire au Ciel que par la vertu.
| XII. Comment ils croyaient leurs rois responsables envers le Ciel des mœurs de leurs sujets. |
Ils portaient cette doctrine si avant qu'ils prétendaient que la seule vertu des rois pouvait rendre tous leurs sujets vertueux, et que par-là les rois étaient les premiers responsables envers le Ciel des mauvaises mœurs de leur royaume. La vertu des rois, c'est-à-dire l'Art de régner selon les lois de la Chine, était à leur avis un don du Ciel, qu'ils appelaient Raison céleste, ou Raison donnée par le Ciel et pareille à celle du Ciel. La vertu des sujets, c'est-à-dire, selon eux, les égards des citoyens, tant des uns envers les autres que de tous envers leur prince, selon les lois de la Chine, était l'ouvrage des bons rois. C'est peu, disaient-ils, de punir les crimes, il faut qu'un roi les empêche par sa vertu. Ils louent un de leurs rois d'avoir régné vingt-deux ans sans que le peuple s'en aperçût, c'est-à-dire sans qu'il sentît le poids de l'autorité royale, non plus que la force qui meut la nature et qu'ils attribuent au Ciel. Ils disent donc que pendant ces vingt-deux années il n'y eut pas un seul procès dans toute la Chine ni une seule exécution de justice : merveille qu'ils appellent gouverner imperceptiblement comme le Ciel, et qui seule peut faire douter de la fidélité de leur histoire. Un autre de leurs rois, rencontrant, disent-ils, un malheureux que l'on menait au supplice, s'en prenait à soi-même de ce que sous son règne il se commettait des crimes dignes de mort. Et un autre, voyant la Chine affligée d'une stérilité de sept années, se condamna, s'il en faut croire leur histoire, à porter les crimes de son peuple, comme s'en estimant seul coupable, et voulut se dévouer à la mort et se sacrifier lui-même à l'esprit du Ciel vengeur des crimes des rois. Mais leur histoire ajoute que le Ciel, content de la piété de ce roi, l'exempta de ce sacrifice et rendit la fertilité aux terres par une pluie subite et abondante. Comme le Ciel donc ne fait justice que du roi et qu'il ne s'en prend qu'au roi de ce qu'il voit de punissable dans le peuple, les ministres du Ciel font justice des fautes secrètes que font les ministres du roi et tous les officiers qui dépendent d'eux, et de la même manière, les autres esprits veillent sur les actions des hommes qui ont dans le royaume de la Chine un rang pareil à celui que ces esprits occupent dans la monarchie invisible de la nature, dont l'esprit du Ciel est le roi.
| XIII. Les Chinois craignent leurs parents morts. |
Outre cela, l'horreur naturelle que la plupart des hommes ont des morts qu'ils ont fort connus vivants, et l'opinion que plusieurs ont de les avoir vu s'apparaître à eux, soit par un effet de cette horreur naturelle qui les leur représente, soit par des songes si vifs qu'ils ressemblent à la vérité, portèrent les anciens Chinois à croire que les âmes de leurs ancêtres, qu'ils estimaient être d'une matière fort subtile, se plaisaient à demeurer auprès de leur postérité et qu'elles pouvaient encore après leur mort châtier les fautes de leurs enfants. Le peuple chinois est encore aujourd'hui dans ces mêmes pensées des peines et des récompenses temporelles qui viennent de l'âme du Ciel et de toutes les autres âmes, quoique d'ailleurs pour la plus grande partie, ils aient embrassé l'opinion de la métempsycose inconnue à leurs ancêtres.
| XIV. Impiété des Chinois d'aujourd'hui qui sont gens de lettres. |
Mais peu à peu les gens de lettres, c'est-à-dire ceux qui ont des grades de littérature et qui seuls ont part au gouvernement, étant devenue tout à fait impies et n'ayant pourtant rien changé au langage de leurs prédécesseurs, ont fait de l'âme du Ciel et de toutes les autres âmes je ne sais quelles substances aériennes et dépourvues d'intelligence, et pour tout juge de nos œuvres, ils ont établi une fatalité aveugle qui fait, à leur avis, ce qui pourrait faire une justice toute puissante et tout éclairée. Combien cette impiété est ancienne à la Chine, il ne m'appartient pas de le décider. Le père de Rhodes, dans son Histoire du Tonkin (3), en accuse Confucius même ; le père Couplet, à qui nous devons la traduction de plusieurs ouvrages de ce philosophe, l'en prétend justifier, et il rapporte en même temps plusieurs raisonnements des Chinois récents par lesquels ils tâchent de faire voir que c'est une chose toute conforme aux principes de la nature, que par des sympathies secrètes, mais certaines, entre la vertu et le bonheur et entre le vice et le malheur, la vertu soit toujours heureuse et le vice toujours malheureux ; mais en vérité, leurs raisonnements sont si guindés et si forcés et conviennent si mal au langage de leurs ancêtres qu'on voit bien qu'ils ne sont que l'effet d'un grand dérèglement d'imagination qui n'était point dans leurs ancêtres.
| XV. Les Siamois n'ont point d'autre juge des actions humaines que la fatalité. |
Les Siamois ne craignent pas moins les esprits que les Chinois, quoiqu'ils n'imaginent peut-être pas de la conformité entre le royaume des morts et leur leur, et comme d'ailleurs ils n'ont pas moins perdu que les Chinois l'idée de la divinité, et qu'ils ont pourtant conservé cette ancienne maxime qui promet des récompenses à la vertu et qui menace le crime de châtiment, ils n'ont pu prendre d'autre parti que d'attribuer cette justice distributive à une fatalité aveugle. De sorte que selon eux, c'est la fatalité qui fait passer les âmes d'un état à un autre, meilleur ou pire, et qui les y retient plus ou moins proportionnément à leurs œuvres bonnes ou mauvaises. Et c'est par ces degrés que les hommes sont tout à fait déchus de la vérité quand ils ont voulu se conduire par cette raison si faible dont ils se glorifient si fort.
| XVI. Les Indiens croient les talapoins et leur doctrine aussi anciens que le genre humain. |
Quant à l'origine des talapoins et de leurs pareils, qui sont répandus dans tout l'Orient sous divers noms, comme de bramine, de jogues (4) et de bonzes, elle est si cachée dans l'Antiquité qu'il est difficile, à mon avis, qu'on la découvre jamais. Il paraît que les Indiens croient ce genre d'hommes et leur doctrine aussi anciens que le monde. Ils ne nomment point leur instituteur, et ils pensent que c'est de cette profession qu'ont été tous les hommes dont les statues sont honorées dans leurs temples et tous ces autres qu'ils supposent avoir été adorés avant ceux qu'ils adorent aujourd'hui.
| XVII. Les Chinois nomment Che-Kià pour l'auteur de cette doctrine. |
Les Chinois disent que les bonzes et leur doctrine leur sont venus des Indes la huitième année du règne de Mim-ti, qui répond à la 65ème de notre salut (5) ; et comme ils aiment à donner l'origine de toutes choses, ils disent que ce fut un Siamois nommé Che-Kià (6) qui en fut l'auteur environ mille ans avant la naissance de Jésus-Christ, quoique les Siamois mêmes ne disent rien de pareil, et que se piquant d'ancienneté en toutes choses, comme tous les autres Indiens, ils pensent que la doctrine de la métempsychose soit aussi ancienne que les âmes mêmes. Les Japonais appellent Chakà le Che-Kià des Chinois, et les Tonkinois ont corrompu ce même nom d'une autre sorte, car ils l'appellent Thicà, selon le père de Rhodes.
| XVIII. Que ce Che-Kià n'est apparemment que le nom siamois des talapoins. |
Or ces mots de Che-Kià et de Chakà approchent assez de ces mots siamois, Tcháou-càChao kha : เจ้าข้า et tcháou-coùChao ku : เจ้ากู pour me faire soupçonner qu'ils n'en sont qu'une légère corruption (7). Tcháou-cà et Tcháou-coù veulent dire Monseigneur, ou mot à mot, Seigneur de moi, avec cette différence que le mot de cà qui veut dire moi ne s'emploie que par les esclaves en parlant à leur maître, ou par ceux qui veulent rendre un pareil respect à celui à qui ils parlent ; au lieu que le mot de coù, qui veut dire aussi moi, n'est pas si respectueux, et se joint au mot de Tcháou pour parler en tierce personne de celui qu'on traite de son seigneur. En parlant donc à un talapoin, on lui dira Tcháou-cà, et en parlant de lui à un autre, on le nommera Tcháou-coù. Mais ce qui est à remarquer, c'est que les talapoins n'ont point d'autre nom en siamois, si bien qu'on dit mot à mot : Je veux être Monseigneur, pour dire : Je veux être talapoin, cráï pen Tcháou-coùKhrai pen chao ku : ใคร่เป็นเจ้ากู. Ils appellent leur Sommona-Codom Prá-poutì TcháouPhra Phutthi Chao : พระพุทธิเจ้า, ce qui mot à mot veut dire Le grand et l'excellent seigneur, et c'est en ce sens-là qu'ils le disent de leur roi, mais ces mots peuvent aussi vouloir dire Le grand et l'excellent talapoin. De même, parmi les Arabes, le mot de Moula, qui veut dire un docteur de la Loi, signifie proprement Seigneur, et le mot de Maître est équivoque en notre langue : on le dit d'un docteur et on le dit aussi du roi. Je trouve donc de l'apparence à croire que les Chinois ayant reçu la doctrine de la métempsycose de quelque talapoin siamois, ils ont pris le nom général de la profession pour le nom propre de l'auteur de la doctrine, et cela est d'autant plus plausible qu'il est certain d'ailleurs que les Chinois appellent aussi du nom de Che-Kià leurs bonzes, comme les Siamois appellent Tcháou-coù leurs talapoins. On ne peut donc assurer sur le témoignage des Chinois qu'il y ait eu mille ans avant Jésus-Christ un Indien nommé Che-Kià, auteur de l'opinion de la métempsycose, puisque les Chinois qui n'ont reçu cette opinion que depuis la mort de Jésus-Christ, et peut-être bien plus tard qu'ils ne disent, sont obligés d'avouer qu'ils n'ont rien dit de ce Che-Kià que sur la foi des Indiens, lesquels n'en disent pas un seul mot, ne songeant pas qu'il y ait jamais eu aucun premier auteur de leurs opinions.
| XIX. L'ancienne manière d'instruire les peuples était par la poésie et par la musique. |
Avant les bonzes venus des Indes à la Chine, les Chinois n'avaient aucun prêtre ni religieux, et ils n'en ont pas encore pour leur ancienne religion, qui est celle de l'État. Parmi eux, comme parmi les Grecs, la plus ancienne manière d'instruire les peuples était par la poésie et par la musique. Ils avaient trois cents odes, dont Confucius fait grand cas, pareilles aux ouvrages de Salomon, car elles contenaient non seulement la connaissance des plantes, mais tous les devoirs d'un bon citoyen chinois, et sans doute toute leur philosophie, et peut-être que ces odes se sont encore conservées. Les magistrats avaient soin de les faire chanter publiquement, et Confucius se plaint de ce qu'il voyait de son temps cette pratique presque éteinte et toute l'ancienne musique perdue. Selon lui, la plus sûre marque de la perte d'un État était la perte de la musique, et Platon croyait comme lui la musique essentielle à la bonne politique. Ces deux grands philosophes avaient compris que les mœurs ne se peuvent conserver sans l'instruction continuelle du peuple, et que les lois, c'est-à-dire l'unique fondement de l'autorité publique et du repos public, ne peuvent durer longtemps où les mœurs sont corrompues, car où les mœurs sont corrompues, on ne songe qu'à violer ou à éluder les lois. Les savants remarquent dans le Pentateuque les vestiges d'une pareille poésie qui contenait l'Histoire des hommes illustres, même de ceux qui étaient plus anciens que le déluge ; Moïse en cite de certains endroits où l'on remarque le style poétique.
| XX. Comment les talapoins et leurs pareils peuvent avoir succédé à l'ancienne poésie et à la musique. |
Je m'imagine donc que les hommes ennuyés de chanter toujours les mêmes choses, et perdant peu à peu l'intelligence des vieilles chansons, ont cessé de les chanter et ont cherché des commentaires aux vers qu'ils ne chantaient plus, faute de les bien entendre ; qu'alors les magistrats ont laissé le soin de ces commentaires à d'autres hommes, et que ceux-ci, abusant peu à peu de la créance des peuples, ont mêlé à leurs leçons bien des choses à leur avantage particulier, qui sont le source de la vénération superstitieuse que les Indiens ont encore aujourd'hui pour les talapoins et pour leurs confrères.
Quoi qu'il en soit, leur habit, leurs couvents et leurs temples sont inviolables, encore que les révolutions de ce pays-là aient fait voir des exemples du contraire. Vliet, que j'ai souvent cité, rapporte que quand le père du roi qui règne aujourd'hui s'empara de la Couronne, il ne crut pas pouvoir attenter sûrement sur la personne de l'un des princes de la famille royale, que par adresse il ne lui eût fait quitter auparavant la pagne de talapoin qu'il portait (8). De même, lorsque cet usurpateur fut mort, son fils qui règne aujourd'hui, voyant son oncle paternel s'emparer du trône, se fit talapoin pour mettre sa vie en sûreté, comme je l'ai rapporté au commencement de cette relation.

NOTES
1 - Nicolas Trigaut, missionnaire jésuite (1577-1628), auteur d'une Histoire de l’expédition chrétienne au royaume de la Chine entreprise par les Pères de la Compagnie de Jésus (…) tirée des mémoires du R.P. Matthieu Ricci publiée en 1616. Le passage auquel La Loubère fait référence se trouve page 85 : Je lis en leurs livres que les Chinois, dès le commencement, ont adoré une suprême et seule déité qu'ils appelaient Roi du Ciel, ou d'un autre nom Ciel et Terre, d'où il paraît que les Chinois ont cru que le ciel et la terre étaient animés, et qu'ils ont adoré leurs âmes pour suprême déité. ⇑
2 - Philippe Couplet (1623-1693), missionnaire jésuite brabançonnais, auteur notamment d'un Confucius Sinarum philosophus, sive Scientia sinensis publié en France en 1687. ⇑
3 - Alexandre de Rhodes (1591-1660), jésuite français. Son Histoire du royaume de Tonquin et des grands progrès que la prédication de l'Évangile y a faits en la conversion des infidèles depuis l'année 1627 jusqu'à l'année 1646 publiée en 1651 eut une grande influence et incita de nombreux prêtres à se consacrer aux missions étrangères. ⇑
4 - Yogi, du sanskrit yogīn, ascète qui pratique le yoga. Yule et Burnell mentionnent de nombreuses variantes : Jogee, chughi, joghi, ioghe, jauguis, Yoguee, etc. (Hobson Jobson, 1903, pp. 461-462). ⇑
5 - Il s'agit de l'empereur Mingdi (28-75). C'est sous son règne que seraient parvenus en Chine les premiers textes bouddhistes. Nous reproduisons ici des extraits de l'article très documenté de Wikipédia : Selon le Livre des Han postérieurs, c’est en 64 que l’empereur Mingdi de la dynastie Han vit en rêve un être auréolé de lumière arriver par les airs depuis l’ouest. Le ministre Zhong Hu ayant proposé qu’il s’agissait d'un dieu appelé Bouddha, l’empereur aurait envoyé vers l’Inde à la recherche de son effigie une délégation de dix-huit personnes menées par Cai Yin, Qin Jing et Wang Zun. Il semble qu’ils se soient arrêtés en Afghanistan chez les Yuezhi, d’où ils revinrent en 67 en compagnie des moines indiens Kasyapamatanga et Dharmavanya (ou Dharmaraksa). Ils apportaient des effigies du Bouddha et le Sūtra en quarante-deux articles, premier texte bouddhique parvenu en Chine selon la tradition.
En 68, les moines furent logés sur ordre de l’empereur dans les locaux administratifs - sens originel du terme si - Honglu, où étaient accueillis les religieux étrangers, qui devinrent ainsi le premier établissement bouddhiste de Chine. (…) L’emplacement du temple aurait été décidé par le cheval qui accompagnait les moines, qui s’arrêta net peu avant la capitale, refusant d’aller plus avant ; les chevaux blancs sont dans la tradition bouddhique le moyen de transport des soutras et des objets religieux. Temple du Cheval blanc.
 Le temple du Cheval blanc, premier établissement bouddhiste de Chine. ⇑
Le temple du Cheval blanc, premier établissement bouddhiste de Chine. ⇑
6 - Che Kia est vraisemblablement une transcription de Shakyamuni, le « Sage des Shakyas », l'un des noms de Siddhārtha Gautama, le Bouddha. ⇑
7 - Les spéculations linguistiques de La Loubère sont ici hautement fantaisistes et totalement erronées. ⇑
8 - Le prince Sri Sin (ศรีศิลป์), fils (ou peut-être frère) du roi Chairachathirat (ไชยราชาธิราช), ayant été évincé du trône et craignant pour sa vie, s'était réfugié dans un monastère et avait pris la robe, ce qui rendait sa personne sacrée et inattaquable. Le Kalahom Siworawong, qui usurpera la Couronne sous le nom de Prasat Tong, décida de le faire mourir, mais il fallait pour cela que le prince quittât l'état ecclésiastique. L'aventurier japonais Yamada Nagamasa, son fidèle lieutenant, fut envoyé pour persuader Sri Sin de sortir de son monastère, lui assurant qu'il l'aiderait avec son armée de mercenaires à prendre le pouvoir. Mais ce déloyal, commençant à mettre en effet ce qu'il avait promis à Oya Calahom, dit au prince que ces amis qu'il trouverait dans le palais, étant armés et ne faisant qu'attendre l'arrivée du prince pour commencer à agir, il était nécessaire que Son Altesse se mît au même état qu'eux et qu'il quittât son habit ecclésiastique, qui lui serait désormais inutile, pour se faire voir en homme de cœur et d'exécution. Le prince n'eut point de peine à suivre ce conseil, et ainsi jetant son habit, il parut en prince. Mais à peine était-il entré en cet état dans le palais avec Oya Senaphimocq et avec quelques soldats japonais qu'il se vit saisi et lié, et fut en cet état conduit devant le roi. (Jérémie Van Vliet, suite de la Relation du voyage de Perse et des Indes orientales de Thomas Herbert, 1663, pp. 576-577). ⇑

18 mai 2020
