

Livre VII - Fin.
Voyage de Siam au cap de Bonne-Espérance.
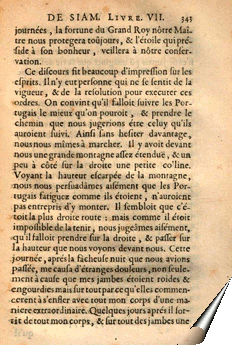
Ce discours fit beaucoup d'impression sur les esprits. Il n'y eut personne qui ne se sentît de la vigueur et de la résolution pour exécuter ces ordres. On convint qu'il fallait suivre les Portugais le mieux qu'on pourrait, et prendre le chemin que nous jugerions être celui qu'ils auraient suivi. Ainsi sans hésiter davantage, nous nous mîmes à marcher. Il y avait devant nous une grande montagne assez étendue, et un peu à côté sur la droite une petite colline. Voyant la hauteur escarpée de la montagne, nous nous persuadâmes aisément que les Portugais, fatigués comme ils étaient, n'auraient pas entrepris d'y monter. Il semblait que c'était la plus droite route, mais comme il était impossible de la tenir, nous jugeâmes aisément qu'il fallait prendre sur la droite, et passer sur la hauteur que nous voyions devant nous. Cette journée, après la fâcheuse nuit que nous avions passée, me causa d'étranges douleurs, non seulement à cause que mes jambes étaient raides et engourdies, mais surtout parce qu'elles commencèrent à s'enfler avec tout mon corps d'une manière extraordinaire. Quelques jours après, il sortit de tout mon corps, et surtout des jambes, une eau blanchâtre et pleine d'écume avec des douleurs très cuisantes qui me durèrent pendant tout le voyage. Sans cette expérience, je n'eusse jamais pu imaginer que la vie de l'homme eût été assez forte pour résister si longtemps à une si grande multitude de maux si violents.
Nous allions fort vite. Au moins nous semblait-il que nous faisions grande diligence, quoiqu'en effet nous ne fissions pas beaucoup de chemin. Sur le midi, nous arrivâmes bien las et bien fatigués au bord d'une rivière qui pouvait avoir soixante pieds de large, et sept ou huit pieds de profondeur. Quand nous arrivâmes au rivage, nous doutâmes si les Portugais l'avaient traversée, car quoiqu'elle ne fût pas extraordinairement large, elle était furieusement rapide. Nous essayâmes de la passer, mais le courant était si précipité qu'il nous allait emporter si nous ne fussions retournés sur nos pas au plus vite.
Cependant, dans l'incertitude où nous étions si les Portugais étaient passés au-delà, on résolut de tenter encore une fois le passage. Pour le faire avec moins de péril, on s'avisa d'une invention qui ne réussit pourtant pas. On lia ensemble toutes les écharpes que nous avions, formant le dessein que le plus robuste d'entre nous passerait de l'autre côté pour y porter un bout qu'il attacherait à un arbre qu'on voyait sur le bord, afin qu'ensuite chacun, à la faveur de cette grande écharpe, pût passer de l'autre côté sans être emporté au fil de l'eau. Un mandarin le plus robuste de la troupe se chargea de cette commission, mais il ne fut pas au milieu de la rivière que ne pouvant résister au courant de l'eau, il fut obligé de quitter le bout de l'écharpe pour gagner l'autre bord, ce qu'il ne put faire qu'avec un extrême péril de sa vie. L'eau coulait avec tant d'impétuosité, que malgré tous ses efforts et toute son adresse, il fut jeté contre une avancée de terre qui entrait dans la rivière, dont il eut l'épaule toute froissée et le corps fort maltraité. Il remonta à pied le long du rivage vis-à-vis de nous, et nous cria qu'il était impossible que les Portugais eussent pris cette route-là. On lui dit de venir nous rejoindre, et pour le faire, il fut obligé de monter bien haut au-dessus de nous avant que de se mettre à la nage, encore eut-il assez d'affaire à aborder au lieu où nous l'attendions.
Persuadés ainsi que les Portugais n'avaient pas traversé la rivière, nous conclûmes aisément qu'ils avaient suivi le long des bords en remontant. Nous prîmes ce chemin, après nous être rafraîchis avec un peu d'eau que nous bûmes, car nous ne trouvâmes de tout ce jour-là quoi que ce soit qu'on pût manger. Nous n'eûmes pas fait une demi-lieue que nous trouvâmes un bas tout déchiré, ce qui nous assura que les Portugais avaient pris cette route. Après bien des peines, nous arrivâmes au bas d'une montagne qui était creuse par le pied, comme si la nature en avait voulu faire un logement pour les passants. Il y eut assez d'espace pour nous y loger tous ensemble, et nous y passâmes la nuit qui fut bien froide, et par conséquent bien douloureuse. Il y avait déjà quelques jours que les pieds et les jambes m'étaient tellement enflés que je ne pouvais porter ni bas, ni soulier, mais cette incommodité s'augmenta extraordinairement par l'extrême froid que j'endurai cette nui t-là, et par l'humidité du rocher. En m'éveillant le matin, je trouvai sous moi un espace de terre assez considérable couvert d'eau et d'écume qui étaient sortis de mes pieds. Cependant, quelque faible que je fusse, je trouvai des forces le lendemain quand les autres se mirent en état de partir. Il me semblait qu'à mesure que je souffrais plus de maux, je prenais aussi plus de soin à prolonger ma vie, comme si elle m'eût paru plus précieuse, étant devenue plus misérable, soit que j'espérasse plus que jamais de la conserver après avoir si longtemps et si cruellement pâti et couru tant de risques sans la perdre.
Nous côtoyâmes encore tout le lendemain les bords de la rivière, dans l'espérance de trouver les Portugais que nous jugions n'être pas fort éloignés. De temps en temps nous trouvions des marques de leurs traces et des endroits où ils avaient passés. À un quart de lieue du rocher où nous avions couché, un de nos gens aperçut un peu à l'écart un fusil avec une boîte à poudre toute pleine qu'un Portugais y avait sans doute laissés, n'ayant pas la force de les porter davantage. Cette rencontre nous fut d'une grande utilité par la suite. Nous détachâmes le bois et le canon, et nous reprîmes la batterie avec la boîte à poudre pour faire du feu. Cela nous vint fort à propos, car depuis que nous avions suivi le rivage, nous n'avions absolument rien trouvé, et nous étions presque morts de faim. Aussitôt nous fîmes du feu, et voyant que mes souliers m'étaient non seulement inutiles, ne les pouvant chausser, mais même embarrassants, ayant voulu les porter toujours à la main dans l'espérance de guérir de mes enflure, la nécessité l'emporta sur toute autre considération. J'en séparai toutes les pièces, et les ayant bien fait griller, nous les mangeâmes d'un fort grand appétit. Ce n'est pas que nous y trouvassions du goût, car le cuir en était si sec qu'il n'y était resté aucun suc, mais c'était assez qu'il n'y eût point d'amertume, et qu'on pût les avaler, si grande était la faim qui nous tourmentait alors. Nous essayâmes ensuite de manger le chapeau d'un de nos valets, après l'avoir bien fait griller, mais nous n'en pûmes jamais venir à bout. Pour le pouvoir mâcher, il fallait en faire cuire les pièces jusqu'à les mettre en cendre, et dans cet état elles étaient si amères et si dégoûtantes qu'elles nous révoltaient l'estomac, tout affamé qu'il pût être.
Après ce repas, nous reprîmes notre route, et nous vîmes encore en passant le long d'un coteau, des preuves bien sensibles que les Portugais côtoyaient les bords de la rivière comme nous. Ce fut un de nos interprètes qui les avait suivis, que nous trouvâmes mort, les genoux en terre et les mains, la tête et le reste du corps appuyés dessus. Les deux interprètes qui nous restaient étant métis, c'est-à-dire nés de Portugais et de Siamoise, n'avaient pas voulu se séparer des Portugais et nous avaient abandonnés le jour que ceux-ci nous quittèrent pour se mettre avec eux. Celui-ci nous paraissait être mort de froid, le voyant ainsi ramassé sur ses genoux et appuyé contre un coteau, dans un endroit tout rempli d'herbes. Nous nous arrêtâmes un peu dans cet endroit qui parut délicieux, où nous trouvâmes de si belle et de si bonne verdure. Chacun fit une petite provision d'herbes et de feuilles les moins amères qu'il pût trouver pour le souper du soir.
Nous poursuivîmes notre chemin qui commençait déjà à nous bien ennuyer, voyant que les Portugais étaient toujours devant nous, et que nous nous fatiguions depuis tant de jours sans les pouvoir rejoindre. Il n'y eut personne d'entre nous qui ne fût bien fâché d'être venu si loin avec tant d'incommodité. On regretta surtout la petite île que nous avions passée trois ou quatre jours auparavant, où nous avions trouvé de très bonne eau, et quantité de moules, qui a été le met le plus délicat que nous ayons mangé durant le temps de notre voyage.
Le murmure et le chagrin s'augmentèrent le soir. Quand nous fûmes arrivés au lieu où nous devions coucher, il n'y avait que deux chemins à tenir, lesquels étaient très difficiles, et il était impossible de connaître lequel des deux les Portugais avaient suivi. D'un côté il y avait une montagne fort rude, et de l'autre ce n'était qu'un marécage coupé de divers canaux que faisait la rivière que nous avions toujours suivie, et qui en plusieurs endroits inondaient une partie de la campagne.
Nous ne pouvions croire que les Portugais eussent traversé la montagne où il fallait beaucoup grimper. Il était encore plus difficile de savoir s'ils étaient entrés dans le marais, qui nous paraissait presque tout inondé et où nous ne pûmes jamais remarquer de leurs vestiges, ni aucune marque qui nous fît soupçonner qu'ils y eussent passé.
Dans cet embarras, nous délibérâmes une partie de la nuit sur le parti que nous avions à prendre, s'il fallait passer outre, ou s'il fallait retourner sur nos pas. Les difficultés qui se trouvèrent à choisir la route qu'il fallait tenir nous avaient tellement alarmés que tout le monde fut d'avis de ne pas aller plus avant, surtout quand on vint à considérer qu'il était impossible de traverser le marais sans se mettre en danger de périr mille fois, et que si on passait sur la montagne, on s'exposerait à mourir de faim et de soif, parce qu'il n'y avait pas d'apparence qu'il y eût de l'eau, et il fallait employer plus d'un ou deux jours à la passer.
Après qu'on eut pris cette résolution, on conclut d'un commun accord que nous retournerions à la petite île dont j'ai déjà parlé ci-devant, que nous y demeurerions trois ou quatre jours, vivant des moules qui y sont en abondance, en attendant nouvelle des Portugais, et qu'après, si on n'en recevait aucune, nous irions trouver les Hottentots dans les bois, nous offrir à eux pour garder leurs troupeaux et les servir comme leurs esclaves. Cette condition nous paraissait infiniment plus douce que le malheureux état où nous étions réduits depuis si longtemps.
Nous espérions que ces peuples, tout barbares qu'ils fussent, seraient touchés de nos malheurs, et que le service que nous leur rendrions les obligerait à nous donner quelque nourriture pour ne nous pas voir mourir de faim devant eux. Ce dernier parti que notre misère nous fit prendre fait assez voir le déplorable état où nous étions réduits. En effet, il faut bien se sentir misérable pour s'estimer heureux de servir en qualité de valet un peuple le plus abject, le plus sale et le plus abominable qui soit sous le ciel, et qu'on ne voudrait pas même recevoir chez soi pour esclave.
Ayant pris cette résolution, il nous tardait qu'il ne fît jour pour partir. Dès que l'aube parut, nous nous mîmes en chemin, et nous marchâmes avec tant de courage dans le désir de revoir cette île si désirée et d'y soulager la faim qui nous devenait chaque jour plus insupportable, que nous y arrivâmes en trois jours. Dès que nous aperçûmes ce lieu si agréable et si salutaire pour nous, nous sentîmes une joie extraordinaire. Chacun s'efforça d'y entrer le premier, mais la diligence des plus pressés fut inutile, car la marée en avait fermé le passage. Cette île, à proprement parler, n'était qu'un rocher assez élevé, de figure ronde, qui pouvait bien avoir cent pas de circuit de haute mer, et quand la mer baissait, on voyait tout à l'entour diverses petites roches qui se découvraient sur le gravier. Il y avait un sentier de sable qui joignait le rocher avec le continent, et on ne pouvait y aller que quand la mer se retirait, parce que les marées pendant que nous y fûmes furent si hautes qu'elles couvraient de plus de cinq pieds d'eau le chemin qui conduisait au rocher. Nous y passâmes cinq jours entiers, et nous allions quand la marée nous le permettait chercher les moules qui restaient sur le sable entre les rochers. Après en avoir amassé suffisamment pour toute la journée, nous en mangions une partie, et nous exposions l'autre au soleil, ou nous la mettions dans le feu pour le soir. Toutes les côtes voisines étaient extrêmement désertes et si arides qu'on n'y trouvait que quelques petits arbres secs pour allumer du feu dont nous ne pouvions nous passer, car à peine nous étions-nous endormis quelques moments durant la nuit que nous nous éveillions tout le corps engourdi et glacé.
Voyant que le bois nous manquait sur le rivage, quelques-uns allèrent en chercher plus avant dans les terres, mais il n'y avait aux environs que des déserts pleins de sable et de rochers escarpés, sans arbres et sans aucune verdure. On trouva beaucoup de fiente d'éléphants qui nous servit deux ou trois jours à entretenir notre petit feu. Enfin tout ce dernier secours nous ayant manqué, la rigueur du froid nous fit abandonner cette île qui nous avait fourni des rafraîchissements si à propos dans notre extrême besoin, et on prit le parti de chercher les Hottentots. Ce chagrin était augmenté par la triste pensée d'aller nous mettre au service et à la discrétion de la plus horrible et de la plus barbare de toutes les nations de l'univers. Mais à quoi ne nous fussions-nous pas exposés pour sauver cette vie qui nous avait coûté si cher, dans l'espérance de la rendre meilleure.
Ainsi, après y avoir demeuré six jours, nous en partîmes avec un fort grand regret des moules et de l'eau douce que nous y laissions. Ce qui acheva de nous déterminer de quitter ce poste fut que les Portugais ne nous faisant point savoir de leurs nouvelles, nous crûmes, ou qu'ils étaient tous morts en chemin, ou qu'ils croyaient eux-mêmes que nous avions péri dans le voyage, ou enfin que les gens qu'ils nous avaient envoyés ne viendraient pas nous déterrer dans cette île écartée.
Avant que de nous mettre en chemin, nous fîmes provision d'eau douce et de moules. Chacun en prit autant qu'il en pouvait porter. Nous fûmes coucher la première journée au bord d'un étang d'eau salé, tout auprès d'une montagne où nous avions déjà campé. Bien nous en prit d'avoir fait provision d'eau douce et de moules pour toute la journée, car nous ne trouvâmes quoi que ce soit qui fût bon à manger. Dès qu'il fut jour, chacun se mit en campagne pour chercher de quoi vivre. On chercha de tous côtés aux environs un peu d'herbes, ou quelques feuilles d'arbre. On avait bien des moules, mais nous voulions les garder pour une plus pressante nécessité. Quelques-uns descendirent dans le lac pour y trouver quelques poissons, mais inutilement, ce n'était qu'un amas d'eau salée et pleine de bourbe.
Tandis que tout le monde était ainsi dispersé, ceux qui étaient près du lac aperçurent trois Hottentots qui venaient droit à eux. Aussitôt, à un signal que nos gens nous firent, nous nous assemblâmes tous, comme nous en étions convenus, et nous attendîmes ces trois Cafres qui marchaient à grand pas pour nous joindre. Dès qu'ils nous eurent approchés, nous reconnûmes qu'ils avaient commerce avec les Européens aux pipes dont ils se servaient. Au commencement, nous fûmes fort embarrassés aussi bien qu'eux pour nous entendre, car quand ils furent auprès de nous, ils nous firent signe de leurs mains, nous en montrant six doigts élevés, et criant de toutes leurs forces : Hollanda, Hollanda !, nous montrant de leurs doigts ainsi ajustés le chemin qu'il fallait tenir, et nous faisant signe de les suivre. Nous fûmes en peine d'abord sur ce que nous avions à faire. Quelques-uns crurent que ces trois Hottentots étaient des espions et des émissaires de ceux que nous avions déjà rencontrés, qui nous voulaient massacrer. Les autres croyaient entendre par le signal qu'ils nous faisaient que le cap de Bonne-Espérance n'était éloigné que de six journées. On délibéra quelque temps, et on se détermina enfin à suivre ces guides quelque part qu'ils nous menassent, parce qu'aussi bien il ne nous pouvait rien arriver de pire que ce que nous avions déjà souffert, et que la mort même ne pouvait que finir tant de malheurs qui nous rendaient la vie si ennuyeuse et si cruelle. Nous ne fûmes pas longtemps dans notre dernier soupçon que ces Hottentots étaient des espions, et nous reconnûmes aisément qu'ils n'étaient pas si simples que les premiers que nous avions rencontrés, et qu'ils avaient même commerce avec les Européens. Ils avaient apporté avec eux un quartier de mouton. La faim nous obligea à leur en demander, mais ils nous firent connaître qu'ils nous le laisseraient si nous leur donnions de l'argent. Leur ayant témoigné que nous n'en avions pas, ils nous firent signe que nous leur donnassions nos boutons qui étaient d'or et d'argent. Je leur en donnai six d'or, et ils m'abandonnèrent le quartier de mouton que je fis aussitôt griller et que je partageai ensuite à ceux de notre groupe.
Ces Cafres, dès qu'ils nous eurent rencontrés, nous pressaient fort de les suivre, et ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour nous faire prendre les devants et avancer le pas. Ils se mettaient devant nous, et ayant marché quelque temps, ils nous venaient rejoindre pour nous presser d'aller. Il était environ midi quand nous quittâmes l'étang d'eau salé, et ces Hottentots nous menèrent camper auprès d'une hauteur. Nous couchâmes au pied, quoique les Hottentots, qui n'étaient pas à beaucoup près si fiables ni si fatigués que nous, nous appelassent pour les aller rejoindre au sommet et y passer la nuit. Le chemin avait été fort rude et nous avions beaucoup marché. Des quinze que nous étions, il y en eut sept qui se trouvèrent si incommodés qu'il leur était impossible de mettre un pied devant l'autre quand il fallut marcher le lendemain.
Nous tînmes conseil sur ce qu'il y avait à faire dans cette triste conjoncture, et on résolut de laisser-là les plus faibles avec une partie des moules sèches que nous avions encore, les assurant que dès que nous aurions trouvé une habitation hollandaise, nous leur enverrions des voitures commodes. Il fallut bien qu'ils y consentissent, quelque dure que leur fût cette séparation, puisqu'ils ne pouvaient absolument passer outre. À la vérité, nous étions tous fort maltraités. Il n'y en avait pas un de nous qui n'eût le corps et surtout les cuisses et les pieds extraordinairement enflés, mais les pauvres Siamois que nous laissâmes faisaient peur, tant ils étaient hideux et défigurés. Ceux qui partaient furent bien affligés de laisser ainsi leurs camarades, dans l'incertitude de ne les revoir jamais, mais ils n'eussent reçu nul soulagement de nous si nous eussions resté pour mourir avec eux. Après nous être dit un triste adieu, nous qui étions moins faibles nous mîmes en chemin pour suivre nos guides qui nous avaient éveillés de fort grand matin. Comme je fus un des premiers qui fût prêt à partir, je fus témoins d'une chose assez désagréable à voir et à dire, mais qu'on sera pourtant bien aise de savoir pour connaître la saleté et l'infection de cette puante et infâme nation. Après que nos trois Hottentots eurent fait du feu le matin pour se réchauffer, la nuit ayant été fort froide, et voyant que nous étions prêts à partir, ils prirent les charbons éteints, et les ayant mis dans un trou qu'ils creusèrent exprès, ils urinèrent dessus, et broyèrent tout ensemble durant quelque temps. Voyant ensuite qu'il était assez liquide, ils s'en frottèrent tout le corps, les bras et les jambes, et tout le visage fort longtemps. Après cette belle cérémonie, ils se vinrent présenter devant nous. Ils s'impatientaient beaucoup de nous voir aller si lentement, mais le mal était sans remède. Enfin, ils perdirent patience, et après avoir parlé quelque temps ensemble, deux se détachèrent et prirent le devant en grande diligence. Pour le troisième, il resta toujours avec nous sans nous abandonner jamais, s'arrêtant quand nous voulions, et autant de temps que nous en avions besoin.
Nous fûmes six jours entiers à suivre notre guide avec des peines et des fatigues qui nous parurent beaucoup plus insupportables que les précédentes. Il fallait incessamment monter et descendre par des lieux qui nous faisaient peur seulement à voir.
Cet Hottentot, accoutumé toute sa vie à grimper sur les hauteurs les plus escarpées, avait assez de peine à se tirer de ce mauvais pas. Quelques-uns prirent une fois résolution de l'assommer, voyant qu'il commençait à monter sur une montagne si rude qu'ils la croyaient inaccessible, se persuadant qu'il nous y menait à dessein de nous faire tous périr.
Le second ambassadeur les blâma fort sévèrement, leur disant que le pauvre homme faisait tout ce qu'il pouvait et qu'il ne fallait pas payer par un crime si horrible les grands services qu'il nous rendait avec tant de peine sans y être obligé. Comme les difficultés qui étonnent à la première vue les personnes naturellement timides s'aplanissent dans la suite quand on les envisage de près, ainsi ces lieux que nous croyions de loin si dangereux ne nous paraissaient par tels quand nous avions avancé, et à mesure que nous montions, ils nous semblait que la pente en devenait plus facile. Quoi qu'il en soit, avec tous nos maux, la lassitude, la faim et la soif, nous en venions à bout.
Pendant ce temps-là, nous ne vivions que de quelques moules séchées au soleil, que nous épargnions le mieux qu'il nous était possible, et nous étions heureux quand nous rencontrions certains petits arbres verts dont les feuilles avaient une petite aigreur qui nous semblait fort appétissante. Elles nous servaient d'un grand ragoût, mêlées avec nos moules sèches. Une espèce de grenouille verte qu'on appelle des raines nous paraissaient aussi très délicates et d'un fort bon goût. Nous en avions déjà mangé quelquefois en passant par un chemin plein de verdure où elles se nourrissent, et nous en trouvions assez souvent, dont nous ne manquions pas de profiter, aussi bien que des sauterelles qui ne sont pas à beaucoup près si savoureuses. Je ne ferai pas difficulté de dire que l'insecte qui ne parut le plus agréable au goût était une espèce de grosse mouche ou de hanneton fort noir, qui se trouve et qui ne vit que dans l'ordure. Nous en trouvâmes beaucoup sur la fiente des éléphants dans le chemin où nous conduisait le Hottentot, au travers des vallées et des montagnes. Toute la préparation que nous y apportions avant que de les manger, c'était de les faire griller au feu, et nous les trouvions merveilleux. Ces connaissances pourront être utiles à ceux qui tomberont dans l'extrémité où nous avons demeuré si longtemps.
Enfin, le trente et unième jour de notre marche après notre malheureux naufrage, et le sixième après que nous eûmes heureusement trouvé les Hottentots dont nous avons parlé, sur les dix heures du matin, en descendant une colline, nous aperçûmes quatre personnes sur le sommet d'une très haute montagne qui était devant nous et qu'il fallait traverser. La première fois que nous les vîmes, nous les prîmes pour des Hottentots, parce que l'éloignement où nous étions ne nous permettait pas de les distinguer, et il ne nous pouvait pas venir dans l'esprit que ce fussent d'autres gens. Comme ils venaient à nous, et que nous allions à eux, nous fûmes bientôt agréablement détrompés, et nous reconnûmes aisément qu'il y avait deux Hollandais, et que les deux autres étaient les Hottentots qui nous avaient laissés il y avait quatre jours pour prendre le devant et venir donner de nos nouvelles aux Hollandais. À cette vue, nous ressentîmes tout à coup une joie extraordinaire. Il nous semblait que nous avions trouvé nos libérateurs, et nous étions persuadés qu'après avoir essuyé tant de maux, notre vie était en sûreté.
Ce sentiment de joie s'augmenta quand ils nous abordèrent. La première chose qu'ils nous demandèrent fut si nous étions Siamois, et où étaient les ambassadeurs du roi notre maître et la lettre qu'ils portaient. Quand on les leur eut marqués, les deux Hollandais leur firent beaucoup de civilités, après quoi, nous faisant signe de nous asseoir, ils firent approcher les deux Cafres qui les accompagnaient chargés de quelques rafraîchissements qu'ils nous apportaient. Quand nous vîmes qu'ils nous portaient du pain frais et de la viande cuite et du vin, nous ne fûmes pas maîtres de notre reconnaissance : les uns se jetaient à leurs pieds et leur embrassaient les genoux, les autres les appelaient leurs pères et leurs libérateurs, enfin il n'y en eut pas un qui ne leur fît voir des marques d'une amitié extraordinaire.
En mon particulier, j'en fus si pénétré que je voulus sur-le-champ leur faire voir combien j'étais sensible au bien qu'ils me faisaient. Le premier ambassadeur, lorsqu'il nous ordonna de le laisser sur le chemin et d'aller lui chercher quelque voiture pour le mener au Cap, se défit de plusieurs pierreries que le roi notre maître lui avait données pour en faire divers présents. Il me donna cinq gros diamants, enchâssés dans autant de bagues d'or. Quand je vis ces Hollandais nous faire part si honnêtement de leurs rafraîchissements, je fis présent à chacun d'eux d'une de ces bagues pour les remercier de la vie qu'ils me redonnaient.
Je ne sais si on pourra croire ce que je vais dire, et j'ai eu de la peine à le raconter, quoique j'en ai été non seulement témoin, mais encore que je l'ai éprouvé moi-même. Néanmoins, cette vérité est de la nature de celles qui n'ont guère de vraisemblance, et qu'on ne peut croire qu'avec beaucoup de répugnance et de soupçon. Cependant, puisqu'on m'a ordonné de dire tous les accidents qui nous sont survenus pendant notre triste voyage, je ne ferai pas difficulté d'ajouter celui-ci, n'imposant à personne la nécessité, ni de l'entendre, ni de le croire sur ma parole. Quand les Hollandais nous eurent donné à manger et que nous eûmes bu le peu de vin qu'ils nous avaient apporté, nous nous sentîmes tous faibles et dans une si grand impossibilité de passer outre, que nul ne nous ne put se lever qu'avec des peines et des douleurs incroyables. En un mot, quoique les deux Hollandais nous pussent dire qu'il ne nous restait qu'une heure de chemin à faire pour nous rendre à une de leurs habitations où nous nous reposerions à loisir, nul de toute notre troupe ne se sentit ni assez de force, ni assez de courage pour entreprendre d'y aller. Faisant quelquefois ensuite réflexion à cette disposition si surprenante, et à un effet si contraire à celui qu'on devait attendre naturellement de nous dans cette rencontre, je ne puis en trouver d'autre raison que celle-ci que je vais dire, comme elle m'est venue naturellement dans l'esprit, en laissant la décision à ceux qui ont de l'étude, ou plus de lumière que moi.
Tant que nous nous crûmes en danger de périr, si nous ne nous sauvions pas en nous efforçant de marcher, cette crainte si terrible faisait tant d'impression sur notre imagination qu'elle nous faisait trouver des forces dans notre extrême faiblesse par des efforts extraordinaires. Que ne fait-on pas pour se tirer d'un péril présent, où l'on voit qu'il faut mourir d'une mort infâme ou cruelle ? Pendant le chemin, nous ne songions qu'à nous délivrer de l'extrême misère qui nous accablait tous les jours de plus en plus. Le déplorable état de nos compagnons que nous avions été obligés de laisser dans les bois, ou que nous avions perdus, l'affreuse mort de ceux que nous avions trouvés étendus sur le chemin, nous épouvantaient à chaque pas, et nous donnaient de nouvelles forces. D'ailleurs, l'espérance que nous avions, surtout après avoir rencontré ces trois Hottentots, que nous serions bientôt délivrés de tous nos maux, nous faisait croire chaque jour que le jour suivant serait le commencement de notre salut, et nous nous persuadions le matin en partant que le soir nous serions rendus au cap de Bonne-Espérance. Ces diverses pensées nous occupaient incessamment l'esprit, et amusaient notre imagination de ces idées tantôt effrayantes, et tantôt agréables. Nous faisions des efforts continuels, et nous surmontions toutes sortes de difficultés, sans être arrêtés ni par les péril et les obstacles qui se présentaient, ni par les cuisantes douleurs qui nous accablaient. Au contraire, dès que nous ne fûmes plus soutenus par ces grandes pensées, que nous fûmes délivrés de la crainte de la mort et que notre espérance fut remplie, il ne faut pas s'étonner si notre cœur se laissant aller à la joie et à la douceur d'une vie molle et tranquille, dont il jouissait déjà, il ne faut pas, dis-je, s'étonner si notre cœur ramolli par ces agréables sentiments n'eût plus de vigueur pour se soutenir et surmonter les mêmes obstacles qu'il avait surmontés un peu auparavant, seulement par les puissants motifs que nous venons de dire.
Quoi qu'il en soit, les deux Hollandais, voyant qu'ils ne pouvaient nous faire avancer un pas, quelque chose qu'ils nous pussent dire, ils envoyèrent les Hottentots nous chercher des voitures pour nous porter. En moins de deux heures, ils furent de retour et nous vîmes venir deux charrettes et quelques chevaux. Ces derniers furent inutiles cette journée, personne ne put s'en servir et tout le monde se mit sur les charrettes qui nous portèrent à une habitation hollandaise, qui était à près d'une lieue du pied de la montagne. Ce fut là véritablement un port salutaire pour nous, et une maison de vie. Nous y passâmes la nuit, couchés sur la paille, avec une douceur et un plaisir indicibles. Quelle fut notre joie à notre réveil de nous voir à couvert, et hors des dangers effroyables que nous avions essuyés pendant trente et un jours.
Notre premier soin en arrivant le soir dans cette maison, fut de prier le Hollandais qui en était le maître d'envoyer une charrette avec les rafraîchissements nécessaires pour aller quérir les sept Siamois que nous avions laissés comme nous avons déjà dit. Après avoir vu partir cette charrette, nous montâmes sur deux autres qui nous portèrent à une habitation hollandaise à quatre ou cinq lieues de la première. La Compagnie fait nourrir dans cet endroit-là une infinité de bœufs et de moutons, et même quantité de chevaux.
Quelque temps après que nous y fûmes arrivés, on nous vint dire que le gouverneur envoyait plusieurs soldats pour nous servir d'escorte, et deux chevaux pour les deux ambassadeurs. Mais ils étaient si malades aussi bien que tous les autres qu'ils n'osèrent y monter. Ainsi, nous nous servîmes encore de nos premières charrettes, et en cet équipage nous arrivâmes à la forteresse que les Hollandais ont à la rade du cap de Bonne-Espérance. Le commandeur, ayant été averti de notre arrivée, envoya son secrétaire recevoir les ambassadeurs hors de la place et leur faire compliment de sa part. Ce secrétaire nous fit entrer dans le fort, au travers d'une vingtaine de soldats rangés en haie auprès du corps de garde, et il nous mena à la maison du commandeur. Celui-ci se trouva au bas de l'escalier qui est en dehors du logis, et y reçut avec de grandes marques de respect et d'affection les ambassadeurs et les mandarins de la suite. Il nous fit entrer dans une salle où nous ayant priés de nous asseoir, il fit apporter du thé et du vin, tandis qu'il faisait tirer onze coups de canon pour honorer le roi notre maître en la personne de ses ambassadeurs. Nous le conjurâmes d'envoyer en diligence des gens avec quelques rafraîchissements au premier ambassadeur que nous avions laissé assez près du rivage où nous avions fait naufrage, parce que nous espérions qu'il serait encore en vie. Il nous dit que dans la saison des pluies où l'on était, il était impossible d'y envoyer personne, mais que quand le temps se serait remis au beau, il ne manquerait pas de prendre tous les soins imaginables pour faire chercher cet ambassadeur et de lui procurer toutes les commodités nécessaires pour son retour. Il ajouta que nous étions heureux d'avoir suivi les côtes, car si nous fussions entrés un peu avant dans les bois, nous eussions infailliblement tombés entre les mains de certains Cafres qui ne pardonnent à personne, et qui nous eussent massacrés impitoyablement pour nous manger, étant très friands de la chair humaine. Dans la suite de l'entretien, il nous témoigna qu'il était bien fâché du malheur qui nous était arrivé et de tous les maux que nous avions soufferts, mais qu'il nous pouvait assurer que nous avions trouvé en lui une personne qui se ferait un vrai plaisir de nous faire oublier nos misères passées par le bon traitement que nous en recevrions ; qu'il s'estimait heureux de trouver une occasion dans laquelle il pût faire sentir le respect et la reconnaissance que la Compagnie de Hollande avait toujours eu pour les grand bienfaits qu'elle avait reçus du roi notre maître.
Dès qu'en approchant du Cap nous eûmes aperçu les navires à la rade, nous sentîmes une espérance bien consolante pour nous, que nous reverrions encore une fois nos parents, nos amis, et notre chère patrie, mais ces paroles du commandeur nous confirmèrent bien agréablement dans cette douce pensée. Cette assurance effaça de notre esprit presque tout le souvenir de nos peines passées, aussi nous l'en remerciâmes avec toute la reconnaissance et l'honnêteté possible. Il nous tint fort bien sa parole, il ordonna à son secrétaire de nous mener au logis qu'il nous avait fait préparer dans le bourg, où il nous fit fournir très libéralement dans la suite tous les rafraîchissements dont nous eûmes besoin. Il est vrai qu'il fit tenir un compte fort exact de notre dépense et du louage de notre maison, qu'il envoya aux ministres du roi notre maître qui lui payèrent à son mot, comme il était bien juste, tous ces frais, et qui lui remboursèrent la paie de l'officier et des soldats qui étaient venu au-devant de nous, et qui ensuite firent la garde à la porte de notre maison pendant tout le temps que nous y fûmes.
Les Portugais étaient arrivés au Cap huit jours avant nous après avoir encore souffert plus d'incommodités que nous. Un père portugais de l'ordre de saint Augustin qui accompagnait par ordre du roi les ambassadeurs de Portugal nous en fit un récit qui nous tirait les larmes des yeux (1). Il nous disait qu'il fallait être aussi impitoyable que les tigres pour n'avoir pas le cœur fendu par les cris et les gémissements des pauvres gens qui tombaient en marchant, accablés des douleurs horribles que leur causait l'enflure de leur corps et de leurs jambes, tourmentés d'une faim et d'une soif qui les faisaient désespérer. Ils réclamaient l'assistance de leurs amis et de leurs proches. Ils les conjuraient de leur donner un peu d'eau. Tout le monde était alors insensible à leurs gémissements, et tout ce qu'on faisait pour ne pas paraître cruel et barbare, c'est que quand on voyait tomber quelqu'un, on l'exhortait à recommander son âme à Dieu, et sans lui rien dire autre chose, on détournait sa vue de dessus lui et on se bouchait les oreilles de peur d'être effrayé par les cris lamentables qui retentissaient de toutes parts à cause du grand nombre des mourants qui tombaient presque à chaque heure du jour, car dans ce voyage, dès qu'ils nous eurent quittés pour faire plus de diligence, ils perdirent cinquante ou soixante personnages de toute sorte d'âge et de condition, sans compter ceux qui étaient morts auparavant, parmi lesquels était un père jésuite qui était déjà fort vieux et fort cassé. Mais le plus triste accident qu'on puisse jamais s'imaginer, et dont on n'aura peut-être jamais vu d'exemple, fut celui qui arriva au capitaine du vaisseau. C'était une personne de qualité, fort riche et fort honnête homme. Il y avait longtemps qu'il était capitaine de vaisseau, et il avait même rendu beaucoup de services au roi son maître en diverses occasions où il avait donné des marques de sa valeur et de sa fidélité. Je ne me souviens pas bien du nom de sa maison, mais j'ai souvent ouï dire qu'il n'y avait guère de famille plus illustre dans tout le royaume de Portugal. Ce gentilhomme avait amené dans les Indes son fils unique âgé d'environ dix ou douze ans, soit qu'il voulût lui apprendre son métier de bonne heure et l'accoutumer dès sa plus tendre jeunesse aux fatigues de la mer, ou qu'il ne voulût confier à personne l'éducation de son fils qu'il chérissait plus que lui-même ; et certes ce jeune enfant avait toutes les qualités qu'il fallait pour se faire aimer, car il était bien fait de sa personne, bien élevé et savant pour son âge, d'un respect, d'une docilité et d'une tendresse pour son père qu'on ne saurait assez louer.
Son père, en allant à terre du vaisseau, avait pris lui-même le soin de l'y conduire en sûreté. Pendant le chemin, il le faisait porter par des esclaves, mais enfin tous ces nègres étant ou morts dans le chemin, ou si languissants qu'ils ne pouvaient se traîner eux-mêmes, trois jours après que les Portugais nous eurent quittés, ce pauvre enfant étant devenu si faible et si enflé qu'un jour après midi, s'étant reposé sur un rocher, bien fatigué aussi bien que tous les autres, il ne put plus se relever. Il était couché tout de son long, les jambes si raides qu'il ne les pouvait pas lever ni même plier. Cette vue fut un coup de poignard pour son père. Il essaya plusieurs fois de le relever, on l'aida à marcher quelque temps pour tâcher de le désengourdir, mais ses jambes ne lui pouvaient plus servir. On ne faisait que le traîner, et ceux que le père avait priés de rendre avec lui ce bon office à son fils, voyant qu'ils n'en pouvaient plus eux-mêmes, dirent franchement au capitaine qu'ils ne sauraient plus le porter sans périr avec lui. Ce pauvre homme, réduit au désespoir, voulut porter seul son fils et le mettre sur ses épaules, mais il n'eut pas seulement la force d'avancer un pas, il tomba avec son fils qui paraissait plus affligé de la douleur de son père que de son mal. Il le conjura souvent de le laisser mourir, qu'aussi bien, quand on le porterait plus loin, il ne pouvait pas passer la nuit, et que l'affliction de son père et les larmes qu'il versait lui étaient infiniment plus sensibles que toutes les douleurs qu'il endurait. Ces paroles, bien loin de persuader au capitaine de se retirer, l'attendrissaient encore davantage, jusqu'à prendre la résolution de mourir avec son fils. Cet enfant, étonné de la résolution de son père, et voyant qu'il ne pouvait rien obtenir auprès de lui, s'adressa aux autres Portugais, les conjurant instamment avec des expressions qui leur fendaient le cœur, d'éloigner son père que sa présence augmentait cruellement les peines et les douleurs qui le tourmentaient, et que sa vue allait avancer sa mort.
Un père de saint Augustin et un père de saint François allèrent représenter au capitaine qu'il ne pouvait pas en conscience exécuter sa résolution, qu'il était obligé de sauver sa vie, et que s'il mourait en cet état, il se perdait pour jamais. Ensuite, tous les Portugais l'enlevèrent de force et le portèrent quelque pas hors de la vue de son fils qu'on avait mis un peu à l'écart. Cette séparation fut si rude, et si affligeante pour le capitaine du vaisseau, qu'il n'en put jamais revenir, sa douleur fut si continuelle et si violence qu'il mourut de déplaisir un ou deux jours après être arrivé au Cap.
Nous demeurâmes près de quatre mois au cap de Bonne-Espérance, en attendant quelque vaisseau hollandais pour nous porter à Batavia. Les misères que nous avions souffertes nous avaient tellement abattus que nous fûmes plus de deux mois à reprendre nos forces ; je crois même que sans le secours du chirurgien, qui prenait grand soin de nous, il n'en fût pas réchappé un seul. Il fallut jeûner dans les commencements, quelque peine qui nous y eussions, pour ne pas charger notre estomac de viandes qui l'eussent suffoqué. Je dis qu'il fallait jeûner malgré nous, car je puis dire que nous trouvions plus de peine à ne pas contenter notre appétit, nous voyant en pouvoir de le faire, que nous n'en trouvions à endurer l'extrême faim quand nous n'avions rien à manger. Avant que de partir du Cap, nous apprîmes que le second pilote du vaisseau portugais s'était sauvé dans un navire anglais. Le premier pilote voulut bien en faire autant, mais le maître du navire avec l'équipage qui restait le gardèrent si étroitement pour le mener en Portugal et le faire punir de sa négligence, qu'il ne put leur échapper. La plupart des Portugais s'embarquèrent sur des vaisseaux hollandais qui les devaient porter à Amsterdam, d'où ils devaient passer en Portugal. Les autres, avec nous, s'embarquèrent dans un navire de la Compagnie hollandaise qui était venu dans l'arrière-saison au Cap, et qui nous porta tous à Batavia, où chacun prit son parti. Pour nous, après avoir demeuré six mois à Batavia, car nous y arrivâmes au mois de novembre après être parti du Cap au commencement de septembre, nous fîmes voile pour Siam au mois de juin, où nous arrivâmes le mois de septembre suivant. Le roi notre maître nous y reçut avec les marques d'une bonté et d'une tendresse extraordinaire. Il nous fit donner des habits et de l'argent, en nous faisant espérer qu'il ne nous oublierait pas dans les occasions favorables à notre fortune.
Il n'y avait pas encore six mois que j'étais arrivé à Siam, lorsque MM. les envoyés extraordinaires du roi de France arrivèrent à la barre. Oya Vichaigen (c'est M. Constance), premier ministre du roi mon maître, m'ordonna de les aller voir de sa part, et les remercier de l'honneur qu'ils lui avaient fait par leur lettre et par le gentilhomme qu'ils lui avaient député. Ce qui me procura cet avantage fut que pendant mon voyage, j'avais appris assez de portugais pour le parler et pour me faire entendre ; et c'est aussi ce qui obligea le père Tachard de me demander à Sa Majesté. Quoique je ne fusse pas bien remis des maux que j'avais soufferts, néanmoins les belles choses que les mandarins qui venaient de France en publiaient partout, me firent naître une passion extrême d'en savoir par moi-même la vérité. Mais ce qui m'engagea le plus à faire un aussi long voyage, fut le désir de voir le plus grand et le plus puissant monarque du monde, dont les vertus extraordinaires et la haute réputation sont connues et admirées jusque dans les pays les plus éloignés.
Fin du septième livre.

NOTES
1 - Il s'agissait du père Estêvão de Sousa. Voir notamment Rita Bernardes de Carvalho : La présence portugaise à Ayutthaya (Siam) aux XVIe et XVIIe siècles, École pratique des Hautes études, 2006. ⇑

5 avril 2019
