


Livre VIII - Début.
Voyage du Cap en France, et de France en Italie.

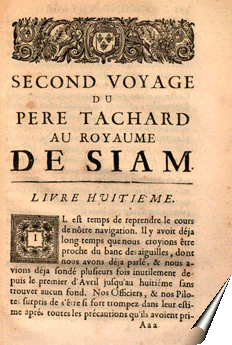
l est temps de reprendre le cours de notre navigation. Il y avait déjà longtemps que nous croyions être proche du banc des Aiguilles, dont nous avons déjà parlé, et nous avions déjà sondé plusieurs fois inutilement depuis le 1er avril jusqu'au 8 sans trouver aucun fond. Nos officiers et nos pilotes, surpris de s'être si fort trompés dans leur estime après toutes les précautions qu'ils avaient prises durant le cours de la navigation, s'attendaient chaque jour à trouver la sonde et à revoir la terre, pour reformer leur estime. Ce ne fut pourtant que le 9 du même mois que nous eûmes cette consolation en trouvant la sonde environ minuit : elle était de 125 brasses. Le sable était noirâtre mêlé de coquillages. Ceux qui n'ont pas été sur mer seront bien aises d'apprendre que ce qu'on appelle la sonde n'est qu'un cylindre de plomb auquel on attache une ligne, c'est-à-dire une ficelle assez grosse, par le plus petit bout, et dont on enduit la base de suif, afin qu'on connaisse par le sable ou par la vase qui s'attache au suif la nature du fond qu'on a trouvé et l'endroit où l'on est.
Ce même jour à huit heures du matin, nous eûmes pour la seconde fois connaissance de la terre, que nous vîmes à neuf ou dix lieues de nous. Mais comme on n'était pas bien sûr quel était le cap que nous découvrions, et que le vent n'était pas favorable pour le doubler, nous fîmes route au large, aussi bien qu'un vaisseau hollandais, lequel, selon la coutume de cette nation au retour des Indes, rangeait la terre de fort près. Enfin, après avoir essuyé quelque bourrasque sur ces bans fameux qui nous firent craindre durant assez longtemps que nous serions obligés de relâcher et de revenir sur nous pas, nous reconnûmes le 20 de ce mois d'avril le cap de Bonne-Espérance. À la vérité, le vent était favorable, mais le temps obscur et la nuit qui s'approchait nous empêchèrent d'en profiter, de sorte qu'on ne put entrer que le lendemain dans la baie. Ce ne fut pas sans difficulté et sans péril, car de quart d'heure en quart d'heure, lors même que nous étions dans la passe, entre nous et la terre il se levait des brouillards si épais que nous ne pouvions ni voir la terre à la demi-portée du mousquet, ni nos vaisseaux qui nous suivaient de fort près, d'où vient que dans l'appréhension qu'ils ne nous vinssent aborder, on tirait de temps en temps quelques coups de mousquet, ou l'on battait la caisse, afin qu'avertis par ces signaux auxquels ils répondaient de la même manière, ils gardassent entre eux et nous une juste distance pour n'en être pas incommodés. Mais comme nous avions un capitaine habile et expérimenté, et des pilotes qui connaissaient parfaitement les côtes et la rade, nous ne laissâmes pas d'aller au mouillage et de jeter l'ancre le 21 avril sur les cinq heures du soir.
Le jour suivant, M. de Vaudricourt envoya un de ses officiers à la forteresse pour complimenter de sa part le commandant du Cap, dont il reçut les mêmes honnêtetés que les voyages précédents. Après le retour de l'officier, on salua de sept coups de canon la forteresse, qui rendit coup pour coup. M. d'Andennes, capitaine du Dromadaire, qui était arrivé trois jours devant nous, vint à bord, et nous apprîmes que l'Oiseau commandé par M. Duquesne n'était sorti de la rade que depuis deux jours pour s'en retourner en France. Nous trouvâmes environ quinze gros vaisseaux hollandais mouillés au Cap, outre le Dromadaire dont nous avons parlé, et le navire Les Jeux, qui était à la Compagnie française des Indes orientales, et qui retournait de Surate en France richement chargé. Comme ce dernier vaisseau avait fait son eau et pris tous les rafraîchissements nécessaires, il partit pour ne point perdre de temps, deux jours après que nous eûmes mouillé. La flotte hollandaise composée de onze vaisseaux, qui revenait en Europe, suivit ce navire de la Compagnie quelques jours après et fit la même route. Les autres quatre navires hollandais furent joints quelque temps après par six autres qui venaient d'Europe. Dans la plupart de ces derniers vaisseaux, il y avait beaucoup de Français de la religion prétendue réformée, lesquels étant passés en Hollande, étaient envoyés avec leurs familles par les États Généraux dans les Indes pour y cultiver les terres qu'y occupe la Compagnie hollandaise. Parmi tous ces nouveaux débarqués, il n'y en avait pas un seul qui ne s'ennuyât beaucoup dans le peu de séjour qu'ils y avaient fait, ne trouvant pas dans ces pays éloignés ce qu'on lui avait fait espérer. Plusieurs même d'entre ceux que j'ai vu au Cap et à Batavia, fâchés de la faute qu'ils ont commise en abandonnant leur patrie par une malheureuse prévention, voudraient la réparer, si on ne leur fermait pas dans les pays où ils sont éloignés, toutes sortes de voies pour le retour.
Le 1er mai, sur les dix heures du matin, toutes nos provisions étant faites, nous fîmes voile du Cap, après y avoir séjourné dix jours. Nous y laissâmes dix navires hollandais qui devaient encore s'y rafraîchir longtemps pour continuer ensuite leur voyage à Batavia. Le vent changea plusieurs fois, sans pourtant nous devenir contraire. Il est vrai que le 3 du mois, à 32° de latitude méridionale, et 36° de longitude, nous eûmes une fort grosse mer et fort incommode jusqu'au lendemain. Le 12, nous commençâmes à sentir les vents alizés dont nous avons parlé ailleurs, lesquels dans la partie méridionale, soufflent régulièrement du côté de l'est et du sud. Avec ces mêmes vents, nous passâmes la ligne le 29 de ce mois d'avril sans ressentir aucune incommodité de la chaleur ordinaire de ce climat, quoique nous fussions presque sous le soleil. Pendant ce temps-là, nos pilotes remarquèrent par les hauteurs qu'ils prenaient à midi que nous faisions beaucoup de chemin. À notre retour, nous fîmes la même remarque sur les courants que nous avions faite le voyage précédent. Nos pilotes, par leur hauteur, se trouvaient toujours avoir fait plus de chemin vers le nord qu'ils n'avaient cru, de sorte qu'après plusieurs réflexions, les plus habiles sont tombés d'accord que depuis le cinq ou sixième degré de latitude sud jusqu'au cinquième et sixième de latitude nord et au-delà, les marées, ou comme parlent les gens de mer, les courants, portent avec beaucoup de violence vers le nord-ouest. C'est pour cela que quelque précaution qu'on ait pu prendre jusqu'ici pour régler la route en revenant des Indes en Europe, on se trouve toujours beaucoup plus du côté de l'ouest que l'on ne se l'était imaginé. Nous l'avons éprouvé nous-mêmes dans les deux voyages que nous y avons faits, car la première fois, nos pilotes, croyant avoir passé de cent lieues les Açores, aperçurent au coucher du soleil Corvo, la plus occidentale de ces îles, contre laquelle nous aurions infailliblement échoué la nuit suivante, si l'on ne l'eût pas découverte si à propos. En ce dernier voyage, quoique nous n'ayons pas couru un si grand péril, l'erreur n'a pas laissé d'être presque aussi considérable, ce qu'on ne peut attribuer qu'à l'impétuosité de la mer, qui se jette vers le nord-ouest, comme nous l'avons déjà remarqué. Il n'est pas aisé de donner une raison physique de ce phénomène, dont on a parlé jusqu'ici si diversement, et toujours si obscurément. Les fréquents voyages qu'on fera dans la suite nous donneront de nouvelles expériences, lesquelles jointes à celles qu'on a déjà eues, nous feront trouver un système pour expliquer nettement une matière si difficile.
Le 5 du mois de juin, un matelot qui était en sentinelle au haut du mât nous avertit à la pointe du jour qu'il voyait un navire devant nous. Nous ne fûmes pas longtemps sans l'apercevoir, mais aussitôt qu'il nous eut reconnu, bien loin de venir à nous pour suivre sa route, il tint le vent le plus près qu'il put. Comme il nous était impossible de savoir des nouvelles d'Europe, nous fîmes tout ce que nous pûmes pour le joindre. On arbora le pavillon blanc. M. de Vaudricourt même fit tirer un coup de canon pour le faire arriver. Ce vaisseau, soit qu'il nous prît pour des corsaires, ou qu'il ne voulût pas se détourner un moment, ne fit nulle attention à nos signaux et continua son voyage. À peine avions-nous perdu ce navire de vue, que le même matelot nous cria qu'il voyait la terre vers le nord-ouest à quinze lieues de nous. Le temps était serein et le vent favorable, de sorte que sur les dix heures du matin, nous distinguâmes nettement les îles de Corvo et de Flore, qui sont les plus occidentales des Açores. Cette découverte nous fit reconnaître l'erreur où nous étions, n'ayant pas un de nos pilotes qui ne crût être à trente lieues au-delà de ces îles. Quelques jours après, on vit paraître un autre vaisseau qui faisait une route contraire à la nôtre. Comme il était près de minuit, que le temps était assez obscur et le vent frais, nous pensâmes l'aborder, ne l'ayant reconnu qu'à trente ou quarante pas de notre vaisseau. Quelque soin qu'on prît de l'éviter, il passa si près de notre bord qu'on l'eût entendu aisément à la voix. On donna promptement l'alarme à tout notre équipage qui fut d'abord sur le pont, mais voyant que c'était un petit navire, et qui avait eu peut-être plus de peur que nous, chacun se retira. Le lendemain, 14 du mois, nous aperçûmes divers oiseaux, et sur le soir, on vit un navire fort éloigné sous le vent, et qui paraissait faire la même route que nous.
Nous avons eu un vent assez favorable depuis la ligne jusqu'à près de 40 degrés nord, qu'il nous devint un peu contraire. Il fraîchit le 20, et devint même si violent que nous en serrâmes nos voiles. Bien nous prit d'avoir usé de cette précaution, car le Dromadaire, dont l'équipage n'était pas si fort que le nôtre, et ne pouvant par conséquent travailler aussi vite à ses manœuvres, eut la voile de son petit hunier enfoncée par un tourbillon de vent.
Le grand nombre d'oiseaux, les différents vaisseaux que nous voyions chaque jour et le changement de couleur des eaux de la mer, qui sont les plus sûres marques qu'on est près des terres, nous persuadèrent que nous n'étions pas éloignés des côtes de France, ainsi le 23 juillet, nous croyant proches de l'ouverture de la Manche, nous jetâmes la sonde sans trouver le fond. Ceux qui viennent d'un voyage de long cours en France s'élèvent toujours à la hauteur de cette pointe de Bretagne qui s'avance le plus en mer, qu'on appelle Ouessant, parce que les côtes maritimes de France étant presque partout fort basses, et d'ailleurs fort dangereuses par le nombre des brisants qui les environnent presque de toute part et qui s'étendent bien avant dans la mer, on ne pourrait se garantir du naufrage si la providence n'y avait pourvu d'une manière assez particulière. Car à la hauteur du cap d'Ouessant, dont nous venons de parler, à plus de cent lieues de la terre ferme, on trouve fond avec la sonde, et les habiles pilotes par la nature et la couleur du sable, des coquilles ou de la vase qu'ils retirent avec la sonde, et particulièrement par le nombre des brasses d'eau qu'ils trouvent, jugent à coup sûr du lieu où ils sont et de l'éloignement de la Bretagne. Cette sonde ne se trouve nulle part ailleurs sur nos côtes, au contraire étant pleines d'écueils, on n'y pourrait jamais aborder sans courir un extrême danger de se perdre. Ainsi, tous les vaisseaux qui viennent d'un pays éloigné vont chercher la sonde, comme nous fîmes par le travers d'Ouessant, qui est au 48° de latitude.
Nous fûmes plus heureux le 24 du même mois à la hauteur de quarante-huit degrés et demi, et de neuf degrés de longitude, car sur les dix heures du matin pendant le calme, nous jetâmes l'ancre, et après avoir laissé filer cent brasses de ligne, nous trouvâmes le fond si désiré. Dès qu'on eut retiré le plomb de l'eau, chacun s'empressa de savoir de quelle nature était le fond que nous avions trouvé. Il était de sable blanc, mêlé de cailloux et de petites coquilles, ce qui nous fit juger que nous n'étions pas à quarante ou cinquante lieues d'Ouessant. Le lendemain, le vent fraîchit et devint favorable. On ne manqua pas de s'en servir, jusqu'à dix heures du soir, que M. de Vaudricourt fit serrer la plupart de ses voiles pour ne donner pas contre la terre dont il se croyait assez proche. Cette sage précaution nous fut utile, parce que le lendemain sur les huit heures du matin, nous reconnûmes l'île et le cap d'Ouessant, éloigné d'environ dix lieues, ce qui causa à tout notre équipage une joie qu'on ne saurait exprimer. Vers les sept heures du soir, nous allâmes mouiller entre les terres, assez près de la fameuse abbaye de saint Matthieu, qui est sur une pointe de terre qui porte le même nom. Le jour suivant, nous fûmes à la voile de grand matin pour aller mouiller le lendemain à la rade devant midi.
M. Desclouzeaux (1), intendant de la marine à Brest, vint au-devant de nous dans une chaloupe avec quelques officiers des vaisseaux du roi. Comme ceux de l'Oiseau qui étaient arrivés huit jours avant nous et qui nous avaient reconnu en passant du cap de Bonne-Espérance lui avaient assuré que nous ne pouvions pas être loin, aussitôt qu'on lui eut dit qu'on voyait trois vaisseaux qui venaient à toutes voiles dans la rade, il jugea aisément que ce ne pouvait être que les nôtres. Après les premiers compliments, il me dit qu'on avait ordre de la Cour de me traiter en envoyé du roi de Siam, et il me demanda en même temps de quelle manière je voulais être reçu à Brest. Cette honnêteté à laquelle je ne m'attendais pas me surprit beaucoup. Je l'en remerciai comme je devais, et lui ayant répondu que je n'avais nul caractère, j'ajoutai que pour recevoir un jésuite missionnaire, il n'y avait point de mesure à prendre.
M. Duquesne, capitaine de l'Oiseau, était venu avec lui. Cette entrevue nous causa un extrême plaisir. Il nous demanda si nous avions reconnu l'île de Sainte-Hélène qui appartient aux Anglais, où il avait été prendre quelques rafraîchissements, et si nous avions eu de ses nouvelles en passant l'île de l'Ascension. Cette île est déserte, mais fort abondante en tortues, où il n'avait pas manqué de laisser une lettre renfermée dans une bouteille. Ceux qui mettent pied à terre dans cette île quand ils vont aux Indes ou qu'ils en reviennent, gardent inviolablement cette coutume pour faire part à ceux qui y abordent après eux de tout ce qui se passe de plus considérable dans l'endroit d'où ils viennent, afin que les autres qui y vont prennent leurs mesures, et il y a un lieu aisé à reconnaître dont tout le monde est convenu, où ils exposent cette bouteille. Mais le vent favorable et dont nous voulûmes nous servir nous empêcha, comme nous avons déjà dit, d'y aller pêcher de la tortue, dont notre équipage qui était en parfaite santé n'avait pas grand besoin.
Le lendemain de mon débarquement à Brest, je partis pour Paris, ayant laissé les mandarins et les catéchistes tonkinois entre les mains de M. l'intendant qui leur fit tout le bon accueil possible.
Quelque temps après y être arrivé, le roi me fit l'honneur de me donner un audience particulière, où je lui rendis compte du sujet de mon retour en France. Sur ces entrefaites, les mandarins siamois qui s'étaient rembarqués à Brest sur une petite frégate de Sa Majesté avec les présents du roi leur maître et de son ministre pour le roi et toute la Cour arrivèrent à Rouen, et on leur donna des carrosses pour venir à Paris (2). Ils attendirent qu'on leur apportât tous les ballots de Rouen avant que de demander audience de Sa Majesté. Le roi se trouvait à Fontainebleau, où il donna ordre d'avertir les mandarins de se rendre à Versailles le 15 décembre qu'il assigna pour nous donner audience et pour recevoir la lettre et les présents du roi de Siam. Mais Sa Majesté changea de sentiment, ayant reçu le lendemain une lettre de M. le cardinal d'Estrée, à qui j'avais pris la liberté d'écrire sur le voyage que je devais faire à Rome, et m'ordonna d'y aller, puisqu'on lui mandait que Sa Sainteté en recevrait du plaisir, et que nous aurions seulement audience après notre retour.
Il n'y avait pas un moment à perdre, parce que nous étions au mois de novembre, et il fallait être de retour en France pour s'embarquer à Brest au mois de mars. Ayant reçu ces ordres, je partis de Paris le 5 novembre avec les trois mandarins et deux de leurs valets pour nous rendre par la diligence à Lyon. Le sieur Moriset (3), interprète des Siamois, avait pris le devant avec les trois catéchistes tonkinois qui allaient à Rome députés des chrétiens, deux valets siamois et les ballots de présents. Nous descendîmes de Lyon tous ensemble sur le Rhône jusqu'à Avignon, où nous prîmes des litières jusqu'à Cannes. Nous y arrivâmes le 26 et nous en partîmes le même jour avec des marques d'honneur de la part de la ville auxquelles je ne m'attendais pas. Nous les devons aux ordres obligeants de M. l'évêque de Grasse dont cette ville dépend. On m'assura même que ce prélat avait commandé qu'on l'avertît quand je serais arrivé, et que pour lui obéir on m'avait envoyé une litière. Mais la nécessité où j'étais de profiter du beau temps ne me permit que d'écrire au prélat pour le remercier de toutes ses bontés, et lui demander pardon si je n'allais pas moi-même à Grasse l'assurer de mes respects. Incontinent après dîné, nous allâmes nous embarquer sur deux felouques (4) qui nous attendaient au port depuis six jours par l'ordre de M. le marquis de Seignelay qui devaient nous porter jusqu'à Gênes.
J'eusse fort souhaité pouvoir aller à Nice pour être en état d'aller le lendemain à Savone, mais il nous fut impossible de passer Villefranche, éloignée de Cannes de 29 milles qui font 8 lieues de France. Villefranche est une petite ville de Piémont dans les États du duc de Savoie. Nous nous y rendîmes si tard que nous eûmes toutes les peines du monde à obtenir l'entrée, l'intendant de la santé faisant une grande difficulté de nous laisser mettre pied à terre.
Nous partîmes le lendemain de Villefranche avec un fort beau temps, qui ne fut pas de longue durée. Car étant obligés de toucher à Monaco pour faire voir nos lettres de santé (5), il se leva un vent d'est contraire à notre route et assez violent qui dura tout le reste du jour. La mer en fut si agitée que le lendemain, quoique le vent fût favorable et le temps fort serein, il nous fut impossible de sortir du port qu'après midi. Nous fîmes cette manœuvre contre le sentiment du capitaine du port de Monaco, et surtout contre les protestations d'un patron génois qui nous jura plus de vingt fois que nous allions nous perdre ou que nous serions obligés de rentrer. Mais nos patrons nous assurant que la mer était praticable, nous fîmes voile avant le soleil couché à San Remo, distance de Monaco de vingt milles qui font plus de sept lieues françaises.
Monaco est une petite ville très forte par sa situation escarpée de tous côtés, où l'on n'y peut entrer que du côté du port où il y a un chemin fort difficile qu'on a pratiqué dans la montagne. Il y a seulement du côté du nord une montagne qui la commande, mais elle est inaccessible. Dès que j'y fus arrivé, j'y allai dire la messe dans l'église paroissiale, après en avoir demandé permission au grand vicaire. Je visitai ensuite la place, où il n'y a rien de remarquable que le palazzo du prince, et qui n'est encore considérable que par sa situation agréable. Le long de la côte, nous vîmes deux places assez petites qui appartiennent au prince de Monaco, dont le territoire s'étend jusqu'à Vintimille qui est la première ville de la dépendance de Gênes.
Nous prîmes heureusement notre temps pour sortir de Monaco et arriver à San Remo, parce qu'en abandonnant cette ville, il se leva subitement un vent de Lebesche (6) fort violent, c'est-à-dire du sud-ouest, qui nous eût mis en danger si nous ne nous fussions pas trouvé aussi près du port que nous étions.
Le lendemain avant la pointe du jour, nous nous embarquâmes et nous vîmes Oneille, petite ville de la dépendance du duc de Savoie, mais fort agréable et assez bien bâtie, où nous prîmes quelques rafraîchissements, car nous ne nous arrêtions nulle part que pendant la nuit pour ne perdre aucun moment. Nous fûmes coucher à Arais, qui est un bourg des Génois à dix lieues de San Remo, d'où nous partîmes le lendemain à la point du jour ; c'était le jour de saint André. Je fus dire la messe à Noli en passant. C'est une ville fort peu peuplée, où il y a pourtant un évêque. Il était déjà deux heures après midi, et il fallut demander au grand vicaire la permission pour dire la messe, qui me l'accorda fort obligeamment.
Avant que d'arriver à Noli, nous doublâmes le cap de Finale, ainsi appelé à cause de la ville du même nom qui est de l'autre côté avec deux forteresses dans les terres du roi d'Espagne. À cinq pas de ce cap, nous entendîmes un bruit sourd fort semblable à celui que font deux vaisseaux qui se battent quand on les entend de loin. Le bruit nous eût sans doute alarmés et nous aurait fait conjecturer quelque chose de semblable si le patron de la barque ne nous eût détrompés en nous disant que c'était le bruit des flots qui se rompaient de l'autre côté du cap. Nous en fûmes nous-mêmes témoins en y passant à la demi-portée du pistolet, et nous aperçûmes ce rocher creusé fort avant en divers endroits, le pied qui retentissait de tous côtés lorsque les ondes se brisaient contre les différentes bouches de ses cavernes souterraines, ce qui faisait retentir de ce bruit sourd tous les environs.
Après avoir dit la messe à Noli et pris quelques rafraîchissements, nous nous remîmes dans notre felouque. Il était déjà si tard que nous ne pûmes passer au-delà de Savone qui n'en est éloignée que de trois lieues et de dix d'Arais dont nous étions partis le matin. Savonne était autrefois une des plus belles villes de la rivière de Gênes, et des plus peuplées, mais depuis qu'on a bombardé Gênes (7), elle a été presque toute démantelée par ordre de la République. Après avoir montré nos lettres de santé, nous fûmes introduits par le fils du consul français dans la ville, qui nous mena à une auberge. Dès que les mandarins furent logés, je m'en allai au collège avec le consul. Cette maison est à présent fort mal bâtie, il n'y a qu'un corps de logis neuf qui soit passable, ses revenus ont tellement diminué que de quinze personnes qui y demeuraient autrefois, il n'y a plus que quatre pères et deux frères.
Le mauvais temps nous obligea de séjourner le lendemain, la tempête fut si violente qu'elle fit périr six barques ce jour-là, avec une partie des équipages. Enfin, le 2 décembre, la mer étant un peu calme et le vent devenu bon, après avoir dit la sainte messe, je pris congé de nos pères, et le père recteur avec deux autres jésuites voulurent m'accompagner jusqu'aux felouques.
J'étais dans une extrême impatience d'arriver à Gênes, parce que j'espérais y recevoir des nouvelles de Rome et de Paris. Je m'adressai d'abord à M. Aubert, consul français, et ensuite à M. Dupré, envoyé extraordinaire du roi, croyant qu'ils eussent reçu quelques lettres pour moi, comme on me l'avait fait espérer. M. le marquis de Croissy m'avait donné une lettre de la part du roi pour M. Dupré, envoyé extraordinaire, et M. le marquis de Seignelay m'en avait donné une autre du roi pour M. Aubert, consul de la nation française.
J'étais arrivé à Gênes à une heure après midi, et j'étais résolu d'en partir le même jour, mais il était si tard quand je sortis de chez M. l'envoyé que c'eût été une témérité de passer outre. J'allais loger au collège de notre Compagnie qui était fort près de l'auberge où j'avais laissé les mandarins. Le révérend père Palavicini, frère du cardinal du même nom (8) était recteur de ce collège. C'est une personne d'un mérite singulier, et qui me fit des honnêtetés si extraordinaires, dans la conjoncture où je me trouvai, que je dois m'en ressentir toute ma vie. La pluie et le vent contraire m'obligèrent à y rester encore le lendemain, jour de la fête de saint François Xavier. Mais le 4, voyant quelque espérance de beau temps et la mer moins agitée, je partis de Gênes sans l'avoir vue, ainsi je n'en parlerai point. Le révérend père Moneilha, qui avait été le premier jésuite qui m'eût reconnu, vint me conduire jusqu'au port.
À peine eûmes-nous fait quatre lieues que nous fûmes surpris d'une grosse pluie et d'un vent contraire assez violent qui nous obligea de relâcher à Camoglio que nous eûmes même assez de peine à attraper, et où nous fûmes forcés de demeurer jusqu'au dixième du mois par la continuation du mauvais temps. Camoglio est un petit bourg à quatre lieues de Gênes, sur le rivage de la mer. L'église en est fort jolie et bien entretenue.
Après nous y être bien ennuyés, voyant que le temps ne se mettait point au beau, j'écrivis à Gênes à M. Aubert dont j'ai déjà parlé pour le prier de nous envoyer des chevaux. Il fit tant de diligence que le lendemain, il nous en envoya douze avec trois mulets. La pluie ne cessait point, mais l'extrême désir que j'avais de sortir de Camoglio m'obligea de monter à cheval une heure après que notre équipage fut arrivé de Gênes. Mon impatience me pensa coûter bien cher, car les chemins étaient si impraticables à cause des torrents qui avaient inondé la campagne et rompu toutes les routes, qu'il nous fallut passer par des endroits si escarpés que les gens même du pays avaient de la peine à y grimper. Nous rencontrâmes entre autres sur notre chemin une montagne qu'il fallut traverser, dont le sentier, pratiqué sur le penchant du roc, était si rapide et si étroit qu'un des chevaux qui portaient le bagage, s'étant abattu, ne put se retenir et fit plusieurs tours en bas avec sa charge. Par bonheur, les sangles se rompirent, et le bât se détacha, sans cela le cheval se fût mis en pièces et eût suivi les ballots qui roulèrent jusqu'au torrent qui passait au pied de la montagne. Mais le bât étant détaché, le cheval fut arrêté par une petite esplanade qu'on avait ménagée pour semer du riz sur le penchant de la montagne. Nos voituriers accoururent en faisant de grands cris, croyant que le cheval était mort, et ils n'eurent pas peu de joie de le voir relever sans aucun mal. Le reste du chemin était si rompu qu'il fallait louer des hommes pour porter nos hardes jusqu'à Rapallo, de sorte qu'en six heures, nous ne fîmes que deux lieues, et encore avec beaucoup de peine. Nous y arrivâmes le soir à deux heures de nuit, tout trempés d'eau, après avoir couru mille fois risque de nos vies. Celui qui nous conduisait, désespérant de passer outre avec ses chevaux, nous conseilla de reprendre la mer, quelque grosse somme que nous lui eussions promis, pour nous mener à Lerici. La nécessité où nous étions de passer outre nous obligea de nous remettre dans une felouque, et dans un petit canot de pêcheur que nous louâmes à un prix excessif. Car les patrons, voyant l'extrémité où nous étions réduits, nous demandèrent pour aller seulement à Lerici ce qu'ils ne nous eussent pas osé demander dans une autre occasion pour nous porter jusqu'à Rome, et il fallut passer par ce qu'ils souhaitaient.
Ainsi, nous partîmes le 2 de Rapallo, petit bourg de la république de Gênes, dont le port est assez commode pour les petites barques. Nos patrons nous menèrent à la ville de Sestri, dépendante aussi des Génois, pour y prendre une deuxième felouque. J'espérais aller à Lerici où on nous avait dit que nous trouverions des chevaux et un chemin fort uni jusqu'à Rome. Nous en repartîmes sans perdre un moment, et quoique la nuit nous eût surpris à sept lieues de notre terme, j'obligeai les matelots à passer outre pour y arriver. Nous fîmes encore trois lieues pendant les ténèbres, mais quand nous fûmes prêts à doubler le cap de Montenegro, la pluie survint et le vent contraire souleva les flots de la mer de telle sorte que les matelots me dirent qu'ils ne pouvaient passer outre sans faire naufrage. Il fallut retourner sur nos pas à Vernassale. C'est un bourg fort peuplé appartenant à la république de Gênes, à trois lieues de Porto-Venere. La mer était extrêmement grosse et la nuit si obscure qu'à peine nos patrons purent-ils trouver l'entrée du port. En approchant, ils crièrent aux habitants de toutes leurs forces pour les appeler à leur secours, car nul de ceux de notre felouque ne savait où ils devaient mener leur felouque. D'abord on nous répondit de terre qu'il n'y avait pas moyen de mettre pied à terre, à cause de la violence des flots, et qu'il fallait aller ailleurs pour nous mettre à l'abri de l'orage, mais comme les matelots leur eurent représenté qu'ils couraient encore plus de risque s'il fallait s'en retourner, ces bonnes gens ayant compassion de nous se levèrent promptement, car la plupart étaient déjà couchés, accoururent à notre secours. Tous ceux du bourg parurent en un instant sur le rivage et firent des grands feux partout et nous crièrent de venir. Peu s'en fallut que nous n'allassions périr sur deux rochers qu'on trouve aux deux côtés du port, qui d'ailleurs est fort petit et où nul de nos matelots n'était jamais entré. Nos gens mêmes étaient si troublés dans le péril où ils se trouvaient que chacun faisait sa manœuvre à son caprice, avec tant de bruit et de confusion qu'à peine pûmes-nous entendre la voix de tous les habitants qui criaient de toutes leurs forces que nous allions nous perdre et qu'il fallait nécessairement venir aborder à un certain lieu qu'ils nous montraient. Enfin nous y allâmes, mais avec bien de la peine.
La pluie et le vent contraire ne cessèrent point jusqu'au 15. Les patrons, voyant que le temps se changeait, qu'il se ferait beau, vinrent m'avertir à une heure après minuit que nous pouvions nous embarquer. Nous ne perdîmes pas un moment, je pressai si fort nos rameurs que nous arrivâmes ce jour-là même à Livorne, ayant fait cinq lieues à la rame. Il est vrai q'uil était déjà minuit quand nous fûmes rendus à Livorne, et nous fûmes obligés de passer le reste de la nuit dans notre felouque.

NOTES
1 - Hubert de Champy, seigneur Desclouzeaux (1629-1701) fut nommé intendant de Brest en décembre 1683. La ville lui doit de nombreuses réalisations, dont un hôpital, le refuge de la Magdeleine, le bassin Tourville, des manufactures, etc. Depuis 1966, une rue de Brest porte son nom. ⇑
2 - Cette nouvelle ambassade fut bien loin de susciter le même enthousiasme que celle arrivée deux ans plus tôt. Si le Mercure Galant consacra quelques pages de son numéro de juillet 1688 au retour en France de Céberet, il n'y eut pas une ligne, en revanche, pour l'arrivée du père Tachard et des envoyés siamois. Quant aux présents du roi de Siam, il semble que la qualité avait baissé, comme le note Dangeau dans son journal du mercredi 17 novembre 1688 : Le roi et madame la Dauphine ont fait ouvrir tous les ballots des présents du roi de Siam ; il n'y a rien de bien magnifique. Ces présents y sont en plus grand nombre, mais moins beaux que ceux qui vinrent par les ambassadeurs. (Journal du marquis de Dangeau, 1864, II, p. 212). ⇑
3 - Sous la plume de Tachard, on trouve parfois Morisot, Morisset, ou Moricet. ⇑
4 - Quelques-uns disent falouque, l'usage est pour felouque. C'est un petit vaisseau à six rames, et qui est sans couverture, dont on se sert sur la mer méditerranée. Ce bâtiment a cela de particulier qu'il peut porter son gouvernail de deux côtés, parce que son étrave et on étambot sont également garnis de pentures pour le soutenir, et on le porte de l'arrière à l'avant selon le besoin. C'est le moindre de tous les vaisseaux à rames. Il est de la grandeur d'une chaloupe. Il va à la voile et à la nage. (Furetière).
 Felouque de Gênes. Estampe de Pierre-Jacob Gueroult du Pas, 1710. ⇑
Felouque de Gênes. Estampe de Pierre-Jacob Gueroult du Pas, 1710. ⇑
5 - Ce sont des certificats de santé dont se pourvoient les navigateurs qui viennent de quelque pays suspect de la peste : ils contiennent le nom du capitaine, celui du vaisseau et sa destination, et en quoi sa charge consiste. (A. Savérien, Dictionnaire historique théorique et pratique de Marine, 1758, II, p. 90) Toutefois, comme l'explique Guillaume Calafat, les préoccupations sanitaires n'étaient pas les seules motivations qui avaient présidé à la création de ces documents : Dans son célèbre ouvrage sur les épidémies et les structures sanitaires de l’Italie moderne, l’historien Carlo Maria Cipolla rappelait que les étrangers qui voyageaient dans la Péninsule se plaignaient fréquemment du contrôle scrupuleux et tatillon des « bulletins de santé » (bollette ou bullette di sanità). Exigées pour se rendre et séjourner dans la plupart des États Italiens du Centre-Nord depuis au moins la seconde moitié du XVe siècle, ces patentes demeuraient peu usitées dans le reste de l’Europe et notamment en Europe du Nord. Dans les années 1640, le mémorialiste anglais John Evelyn (1620-1706) considérait ainsi que ces bulletins de santé étaient surtout l'expression de la « jalousie » réciproque des cités italiennes. Fynes Moryson (1566-1629), un autre Anglais qui voyagea à la fin du XVIe siècle, expliquait quant à lui que les villes italiennes usaient de lazarets et de quarantaines non seulement à des fins de prophylaxie, mais aussi – et surtout – pour contrôler minutieusement les gens de passage et leurs marchandises par l’examen de certificats qui détaillaient l’état et la qualité des biens transportés. (La contagion des rumeurs. Information consulaire, santé et rivalité commerciale des ports francs (Livourne, Marseille et Gênes, 1670-1690), in : Les consuls en Méditerranée, agents d’information (XVI-XXe siècles). Classiques Garnier, 2015, p. 99-119). ⇑
6 - Lebesche, ou Sud-Ouest : c’est le nom qu’on donne sur la Méditerranée au vent qui souffle entre le couchant et le midi, nommé sur l’Océan Sud-Ouest. (Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, 1751, IX, p. 331). ⇑
7 - En 1684, le doge de Gênes (Francesco Maria Imperiale Lercari) commet l'erreur de défier Louis XIV en fournissant des galères à l'Espagne, ennemie de la France. Au même moment, il traite avec désinvolture l'ambassadeur français François Pidou, chevalier de Saint-Olon. Sur ordre du roi, le marquis de Seignelay, intendant de la marine, accompagné du lieutenant-général des armées navales Abraham Duquesne, organise en mai 1684 une expédition punitive. La ville subit un violent bombardement naval. Le doge dut venir s'humilier à Versailles en mai 1685. Le doge se rendit à la présence du roi, en août plein, avec un vêtement de velours, une action publicitaire adroite qui détermina le début d'une période de grande exportation de velours de Gênes à la France. Pendant la visite, le roi, montrant au doge le nouveau palais royal de Versailles, lui demanda quelle était la chose qui l'avait le plus étonné pendant sa visite. Le doge répondit d'une formule lapidaire caractéristique du sarcasme génois : « Mi chi » c'est-à-dire « Moi ici ». (Wikipédia). ⇑
8 - Lazzaro Pallavicino (1602/1603-1680) fut nommé cardinal le 29 novembre 1669. ⇑

5 avril 2019
