

Fin du livre premier.
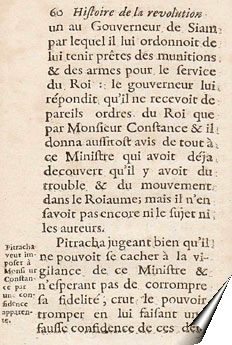
| Phetracha veut imposer à M. Constance par une confidence apparente. |
Phetracha, jugeant bien qu'il ne pouvait se cacher à la vigilance de ce ministre et n'espérant pas de corrompre sa fidélité, crut le pouvoir tromper en lui faisant une fausse confidence de ces desseins. Un jour qu'ils étaient seuls dans la salle des médecins du palais, après avoir donné mille louanges affectées à M. Constance, il lui ajouta en souriant : C'est bien dommage, Monsieur, que vous ne soyez pas siamois, vous règneriez sur nous après la mort du roi comme vous nous gouvernez à présent ; mais les Siamois voudront un homme de la nation. M. Constance lui répliqua d'un air sérieux que quand on viendrait à perdre Sa Majesté, il ne fallait pas aller chercher un successeur ailleurs que dans la famille royale. N'avons-nous pas des princes, dit-il, à qui la couronne appartient ? — Comment les princes, reprit Phetracha, sont-ils en état de régner ? Et le roi voudrait-il nous donner après lui de tels maîtres ? Vous ne savez donc pas leur mauvaise volonté, poursuivit-il. Le roi n'aura pas les yeux fermés qu'ils feront maltraiter son corps comme ils l'ont été par ses ordres, et parce qu'ils croient que nous avons contribué à leur disgrâce, il n'y a point de salut à espérer ni pour vous ni pour moi. Mais si vous me voulez croire, nous les préviendrons. Nous nous emparerons du palais à la mort du roi, nous lui ferons rendre les derniers honneurs ; après cela je vous conduirai sûrement avec mes amis à Bangkok et je me sauverai dans les bois pour passer le peu qui me reste de vie dans la solitude, après laquelle vous savez qu'il y a si longtemps que je soupire. Mon Pi entrera dans notre parti, et vous y ferez encore entrer ceux que vous jugerez à propos.
M. Constance interrompit ce discours et dit en peu de mots qu'il ne se liguait avec personne, et qu'on le trouverait toujours dans le parti du roi quand on voudrait l'y chercher avec de sincères intentions.
Cette réponse ne surprit point Phetracha, il s'y était attendu et il sortit de cet entretien assez satisfait de l'opinion qu'il eut qu'ayant fait cette fausse confidence d'une partie de ses desseins au ministre, il ne croirait pas qu'il en eût d'autres plus criminels. Mais M. Constance était trop éclairé pour ne pas pénétrer jusqu'au fond de ses pensées par ce qu'il lui en avait fait connaître.
La première chose qui se présenta à son esprit fut d'aller tout découvrir au roi, mais faisant réflexion que ce prince malade n'était pas en état d'entendre parler d'affaires de cette conséquence, qu'il était obsédé nuit et jour par Mon Pi, que d'ailleurs lui-même n'avait pas encore de quoi convaincre juridiquement les séditieux ; que s'il ne les convainquait, il était perdu, parce qu'ils étaient puissants, mais que quand il aurait de quoi les convaincre, le roi ne croirait pas aisément une telle perfidie de ses deux favoris, ou s'il la croyait, il ne pourrait dissimuler, il s'emporterait et ferait un éclat qui obligerait Phetracha à faire lui-même un coup de désespoir et à se porter aux dernières extrémités, comme la suite ne le fit que trop voir ; et qu'enfin, quand tout cela ne serait pas, le roi n'était pas état d'agir pour réprimer ces mouvements. Ainsi il trouva plus de sûreté à tenir la chose secrète et à faire de lui-même ce que le roi lui eût ordonné de faire en cette occasion s'il se fût bien porté.
| Les mesures que le ministre prit pour dissiper la conjuration. |
Les mesures qu'il prit pour cela furent premièrement de chercher des convictions évidentes de la conjuration ; en second lieu d'appeler main-forte de Bangkok, pour s'assurer du chef des séditieux et le livrer au roi avec son procès tout instruit. Pour les preuves, il n'eut pas de peine d'en trouver, les sceaux et les faux ordres de ce mandarin lui en fournirent de convaincantes. Pour le reste, il envoya un exprès au général des Français avec une lettre pour le prier de se rendre à Louvo où le service des deux rois demandait sa présence pour des affaires importantes.
| Le général des Français à Louvo. |
Le général vint et le roi, ayant su son arrivée, en témoigna beaucoup de joie et voulut le voir à la fenêtre de sa chambre ; et parce qu'on lui dit que ce commandant ne pouvait se tenir assis à la siamoise, il voulut bien qu'il s'assît à la française, et lui témoigna beaucoup d'amitié.
Après l'audience, M. Constance crut qu'il était nécessaire de communiquer à M. Desfarges l'affaire dont il s'agissait, mais pour lui laisser tout le loisir de faire réflexion sur ce qu'il avait à lui proposer et une liberté entière de prendre son parti, il ne voulut pas lui en faire l'ouverture lui-même ; il lui envoya deux jésuites, dont j'étais l'un, parce qu'il savait que le général avait quelque confiance en nous (1). Nous ne pûmes nous dispenser de cette commission, parce que l'affaire regardait les intérêts de la religion, le service du roi et le salut de toute la nation française dans ce royaume. Nous allâmes trouver M. Desfarges en son logis, et nous nous enfermâmes dans sa chambre avec lui et le sieur de Beauchamp, major de Bangkok.
Nous exposâmes ce que M. Constance avait découvert des mouvements séditieux de Phetracha ; que M. le général voyait mieux que personne les suites de cette affaire, pour la famille royale de Siam, pour la gloire des armes de la France et pour la sûreté des troupes ; que le rebelle n'avait point encore de parti fait ni de gens assemblés ; que si le général voulait prêter main forte au ministre, il le ferait arrêter, et le livrerait au roi avec des preuves convaincantes de sa trahison ; que pour faire un coup sûr, et donner de la terreur à tous les séditieux, il serait à propos qu'il amenât soixante ou quatre-vingts hommes à Louvo ; que le chef de la conjuration étant puni, le reste des conjurés songerait plutôt à se cacher eux-mêmes qu'à venger sa mort, et qu'ainsi tous les mouvements du royaume seraient assoupis dans une seule journée. On ajouta que M. Constance n'avait pas voulu parler de cette affaire au général, ne sachant pas les ordres contraires qu'il pourrait avoir là-dessus.
Le général, sans balancer, répondit que bien loin d'avoir des ordres contraires, il croyait qu'il ferait plaisir au roi son maître de rendre ce service à un roi son allié, que pour lui il n'aurait de sa vie une occasion d'agir plus glorieuse que celle de conserver à la famille royale le palais, les trésors et la couronne ; que l'amitié de M. Constance l'engageait encore plus particulièrement à sa défense ; que pour les troupes, elles n'étaient à Siam que pour le service des deux rois, et qu'il était sûr qu'il serait bien avoué à la cour de France de cette démarche.
Au sortir de cette conférence, le général alla s'aboucher avec le ministre et prit avec lui des mesures plus précises. Il promit d'amener quatre-vingts hommes à Louvo et d'y venir en personne, sur quoi le ministre lui recommanda trois choses : la première était de faire toute la diligence possible ; la seconde de tenir l'affaire extrêmement secrète, et la troisième de ne point s'amuser en passant par Siam à écouter les bruits qui ne manqueraient pas de courir de la mort du roi quand on le verrait monter avec des troupes à Louvo. Qu'il ne pouvait douter que le roi ne fût vivant, puisqu'il lui avait donné audience ce jour-là, et qu'ainsi on le priait de ne croire pas alors facilement qu'il fût mort.
L'on convint de tout et il fut résolu que le général partirait la nuit de ce même jour, pour éviter les chaleurs et pour ne point perdre de temps. Avant que de partir, M. Desfarges, pour faire les choses dans la régularité, fut bien aise d'avoir un ordre du roi de venir à Louvo avec des troupes. Il vint au palais où M. Constance qui venait de parler au roi, lui dit en présence de plusieurs mandarins et de quelques officiers français : Monsieur, le roi vous mande de venir à Louvo pour son service avec un nombre de soldats tel que vous le jugerez convenable. Le général partit fort satisfait de cet ordre et bien résolu de tenir sa parole. Il rentra dans Bangkok et fit un détachement de quatre-vingts hommes. M. Constance avait envoyé des mirous (2) et des balons pour faire une partie du chemin par eau, et des éléphants, des chevaux, des palanquinsSortes de chaises, ou de litières, portées par des hommes ou par des animaux et dont les personnes importantes se servent, dans une grande partie de l'Asie, pour se faire transporter d'un lieu à un autre. pour achever le reste par terre.
pour achever le reste par terre.
Les officiers et les soldats du détachement s'embarquèrent avec joie, jugeant bien qu'ils allaient à quelque expédition d'importance. Le lieutenant du roi se jeta dans le balon du général et le pria de permettre qu'il fût de la partie, mais le général lui dit que le service demandait qu'ils ne quittassent pas la forteresse tous deux en même temps et qu'il lui en laissait le commandement en son absence, qui ne serait pas de longue durée (3).
On arriva le Jeudi saint 15 avril à Siam, dont le gouverneur qui avait donné à M. Constance les premiers avis des menées de Phetracha vint complimenter M. Desfarges de la part du ministre et lui offrit ses services. Le général fit descendre au quartier des Français établis dans cette ville, où diverses personnes d'un rang distingué (4) s'efforcèrent de le détourner de son entreprise en lui faisant faire réflexion qu'un général ne doit point quitter sa place ; qu'il s'exposait beaucoup, par une marche aussi extraordinaire, dans un pays étranger, où l'on ne pouvait se fier à personne ; qu'infailliblement le roi de Siam était mort, qu'il trouverait la guerre à Louvo, et peut-être des embuscades sur le chemin.
| Le général des Français est détourné d'aller à Louvo avec ses troupes. |
Le général, qui avait été prévenu par le ministre contre ces bruits populaires, ne s'en émut pas beaucoup. Il dit qu'il allait au secours du roi et de M. Constance contre des séditieux et qu'il allait là comme à la source du mal qui viendrait jusqu'à lui s'il laissait succomber le ministre, son unique appui. Ha ! Monsieur, où allez-vous ? lui répliqua-t-on. Vous allez vous faire égorger. M. Constance est un ambitieux, il veut vous sacrifier à ses intérêts, il va vous engager et vous entraîner avec lui, il faut l'abandonner à sa mauvaise conduite et nous aller tous renfermer dans Bangkok.
Ce que vous dites là, reprenait le général, n'est point évident, mais il est évident que si M. Constance périt, sa perte entraîne la mienne. Bangkok n'est pas en état de soutenir un siège, nous y manquons de vivres et d'argent. On répondit qu'on avait cinquante mille livres à son service (5) et qu'on chercherait des vivres, en lui répétant cent fois qu'il s'allait faire égorger à Louvo, que le roi était mort et que la ville de Siam s'était émue à l'arrivée des troupes françaises.
Pour reconnaître ce qui en était, M. Desfarges envoya un lieutenant nommé d'Anglas par les rues pour acheter des vivres et pour observer les mouvements du peuple. Il n'est pas difficile de reconnaître dans les yeux et le discours d'une populace qui ne sait pas se contraindre, si elle est animée contre des étrangers. D'Anglas fut regardé de même œil qu'à l'ordinaire et rapporta qu'il avait trouvé toute la ville dans une profonde tranquillité. Cela rassura le général, à qui il fâchait de manquer de parole au ministre. Il voulut donc se rembarquer et continuer sa marche, mais à force d'entendre crier qu'il ne savait où il allait, que le roi était mort, que M. Constance était un homme perdu, que Phetracha était le maître, il ne crut pas devoir négliger ces avis, comme il ne voulait pas aussi y déférer entièrement.
Pour assurer sa marche, il envoya à la découverte un officier qu'il dépêchait à M. Constance (6) avec ordre d'observer l'état des choses à Louvo et sur la route, et de lui venir faire le rapport de ce qu'il aurait vu. L'officier alla par eau de Siam jusqu'à Bancon, petite bourgade où l'on quitte la rivière pour aller par terre à Louvo. Il trouva là les gens de M. Constance avec les éléphants, les chevaux, les palanquins et les charrettes que ce ministre envoyait pour le transport des troupes. Il prit un de ces chevaux et marcha par des lieux écartés pour ne point être rencontré par les gens de guerre dont on croyait que les campagnes étaient remplies. Il arriva sur la minuit près de Louvo ; il mit pied à terre, laissa son cheval à l'écart pour être moins remarqué, il s'avança vers les portes, pour essayer s'il pourrait se glisser dans la ville, mais il fut fort surpris de trouver les portes ouvertes à l'ordinaire, sans soldats ni gardes. Il m'a dit depuis que la première pensée qui lui vint alors était que l'on avait tout égorgé dans la ville et qu'on tenait la campagne. Il ne trouvait personne dans les rues, mais partout un profond silence dans la solitude et les ténèbres.
Il alla jusqu'à la maison des pères jésuites où il fut encore plus effrayé qu'il n'avait été lorsqu'il en trouva la première porte ouverte. Il ne douta plus que tout ne fût perdu, mais il fut rassuré en même temps, en entendant parler et rire des ouvriers français qui demeuraient dans une cour de la maison. Il y avait eu cette nuit-là une éclipse de lune. les pères l'avaient observée, M. et Mme Constance avec deux portugais de leurs parents y avaient assisté par curiosité. Le roi faisait aussi observer l'éclipse dans son palais par son astrologue bramine, et envoya même chez les pères un mandarin pour leur faire de sa part diverses questions ; tant il est vrai que l'on était à la cour dans une tranquillité profonde, puisqu'on y passait la nuit dans une si paisible occupation.
Les pères n'étaient donc pas encore retirés quand l'officier arriva. Il était encore si occupé de ses préventions, qu'il ne leur dit autre chose, sinon : Ha ! Mes pères, comment laissez-vous les portes ouvertes dans un temps comme celui-ci ? Et sans vouloir rien entendre il demanda avec empressement d'être conduit chez M. Constance qui ne faisait que de rentrer dans sa chambre.
M. Constance fut fort surpris à son tour d'entendre qu'on demandât à lui parler de la part de M. le général, à une heure indue. L'officier lui présenta une fausse lettre qu'il portait dans sa main pour la donner en cas qu'il fût arrêté, et en tira une autre qu'il avait cachée dans un nœud de sa perruque. Le général lui écrivait qu'il était à Siam avec quatre-vingts hommes, des armes, de la poudre, des grenades pour le service du roi, mais que les bruits qui couraient de la mort de ce prince l'avaient empêché de pousser plus loin, avant que d'avoir de ses nouvelles. Le ministre eut une extrême douleur de voir que ce général eût donné dans le piège contre lequel il avait pris tant de soin de le prévenir. Il lui récrivit sur le champ, et l'officier en attendant ses dépêches alla voir le major de Beauchamp, le chevalier Desfarges (7) et trois autres officiers français qui dormaient tranquillement dans leur maison.
L'envoyé, se chagrinant de voir la sécurité dans laquelle on était à Louvo, tandis qu'on disait à Siam que tout y était rempli d'armes et de troubles pour la mort du roi, il demanda à ces officiers à quoi ils pensaient de dormir, comme il avait dit aux jésuites à quoi ils pensaient de veiller, et les pressa de se sauver avec lui du danger où ils étaient. Les officiers le raillèrent de sa peur et le conduisirent aux écuries du roi pour prendre un cheval à la place de celui qu'il avait laissé hors la ville. Il eut tout le loisir de voir la paix profonde dans laquelle était le palais. Tout le monde y était si bien endormi qu'on eut peine à trouver celui qui avait la clé des écuries. Il fit plus de bruit lui seul en battant un valet de M. Constance qui ne le servait pas assez promptement qu'on en fit dans toute la ville de Louvo cette nuit-là. Il remonta à cheval et partit à l'heure même avec la lettre du ministre à M. Desfarges, et chacun retourna dormir en riant de la terreur panique de l'officier.
Le séjour que le général fit avec ses troupes sur la rivière, à la vue de la ville de Siam, en attendant le retour de son officier, ne manqua pas de donner lieu à divers bruits qui se répandirent parmi le peuple que le roi de Siam était mort, que les Français allaient avec des armes à Louvo pour piller le palais et pour mettre sur le trône un prince qui fût dans leurs intérêts. Le général, pour faire cesser ces murmures désagréables, jugea à propos d'ôter de devant les yeux des Siamois ce qui leur donnait occasion de parler. Il fit retirer les troupes à deux lieues au-dessous de Siam sur le chemin de Bangkok, et ce fut là où son envoyé le vint joindre et lui remit la lettre du ministre par laquelle il lui mandait que tout était à la cour dans la même situation qu'il avait vu lui-même quand il y avait été ; et que le roi était vivant, le peuple tranquille, les ennemis sans défiance, et toutes choses sans péril pour l'exécution de l'entreprise, et qu'il vînt hardiment.
Le général, à qui on avait fait envisager ce voyage dans des vues bien différentes de celle que lui donnait le ministre, prit de sa défiance sa dernière résolution et se détermina à rentrer dans sa place. Il dépêcha en même temps à la cour le sieur Dacieu, capitaine, qui était chargé de faire à M. Constance les excuses de la retraite, que les mouvements du peuple et quelque indisposition l'avaient obligé de faire contre le désir sincère qu'il aurait eu de lui tenir parole s'il lui eût été possible. C'était le jour même de Pâques que Dacieu vint faire ce compliment au ministre, dans le temps qu'il se disposait à aller à l'église pour y faire ses dévotions. Il en fut vivement touché : Pourquoi donc, dit-il, M. le général me donnait-il sa parole, s'il ne voulait pas la garder ? Il m'a engagé à faire des démarches de mon côté, et il m'abandonne. Ne l'avais-je pas prévenu contre ces faux bruits de la mort du roi ? Il me perd, mais Dieu veuille qu'il ne se perde pas aussi lui-même, et les affaires du roi son maître. En disant ces paroles, il se tourna vers l'église et dit à ceux qui l'accompagnaient : Allons, Messieurs, puisque le secours humain nous manque, n'en attendons plus que de Dieu. Voilà sa maison, j'espère qu'il la défendra lui seul, et qu'il n'abandonnera pas cette chrétienté naissante.
Il entra dans l'église où il entendit la messe et la prédication, communia avec toute sa famille et suivit la procession du Saint-Sacrement qui se fit après la messe. Dacieu fut témoin de la sûreté parfaite dans laquelle on était à Louvo, et indigné de l'ardeur qu'il avait vue en certaines personnes à Siam pour persuader au général que le roi était mort et qu'il serait égorgé lui-même s'il montait à Louvo où tout était rempli de troubles et de séditions, il alla trouver M. Constance et lui dit qu'il avait eu bien du déplaisir qu'on eût fait entendre à M. Desfarges des choses si éloignées de la vérité, mais que s'il jugeait qu'il fût encore temps d'exécuter le projet, il espérait de persuader à ce général de renouer la partie.
Le major de Beauchamp voulut être du voyage et se faisait fort d'avoir assez de crédit sur l'esprit du général pour l'amener quand il l'aurait informé avec Dacieu de l'état des choses. Ils se rendirent ensemble à Bangkok et trouvèrent le général indisposé, et gardant la chambre. Ils lui exposèrent ce qu'ils avaient vu de la tranquillité publique, mais tout ce qu'ils purent dire pour le rengager fut inutile et sans effet. Il demeura persuadé que, se renfermant dans sa place, il avait pris le parti le moins hasardeux, et il ne pensait plus qu'à s'y bien établir. Ce point dont il s'agissait entre le ministre et le général était le nœud délicat des affaires et la source de tous les événements bons ou mauvais qui devaient suivre de la résolution qu'on prendrait d'aller au secours de M. Constance ou de s'enfermer dans Bangkok.
Il n'est pas toujours du devoir d'un historien de décider du droit des différents partis de ses acteurs. Mais il serait digne de blâme s'il n'exposait pas avec sincérité les faits dont il a été le témoin, laissant au public la liberté d'en porter son jugement. C'est la loi que je me suis prescrite en prenant la résolution d'écrire cette histoire. M. Constance et M. Desfarges, qui étaient à la tête des affaires, avaient les mêmes intentions, également droites et pures, et ne différaient qu'en sentiment. Chacun de son côté envisageait le salut et la sûreté de la cause commune, mais par malheur ils avaient sur cela des vues contraires. M. Desfarges croyait tout perdre s'il montait à Louvo, et M. Constance jugeait que tout était sauvé. Suivant les maximes ordinaires de la discipline militaire, le général français était persuadé que son premier devoir était de garder sa place, et suivant la pratique des cours indiennes, le ministre siamois était convaincu que la source du bien et du mal était au palais parce que qui est maître là est maître partout et que les efforts des conjurés étant arrêtés, la conjuration était dissipée.
Le général retint Dacieu à Bangkok et renvoya le major à Louvo avec une lettre pour M. Constance remplie d'excuses et d'honnêtetés à peu près en ces termes, l'assurant qu'il avait un véritable déplaisir de ce qu'une incommodité qui lui était survenue dans son voyage, joint au bruit qui courait de la mort du roi et aux réflexions qu'on lui avait fait faire qu'un général ne devait jamais sortir de sa place, l'avait obligé de rentrer dans la sienne, que tout ce qu'il pourrait alors pour son service était de lui offrir un asile dans Bangkok, ou s'il n'y pouvait pas venir, il le priait d'y envoyer Mme Constance et son fils.
Il y a des personnes qui ont cru que le ministre devait accepter ce parti tandis qu'il était encore temps, mais quatre raisons l'en empêchèrent. La première était son attachement pour le roi son maître, qu'il ne pouvait se résoudre d'abandonner dans un temps où ses services lui étaient plus nécessaires. La seconde était l'engagement qu'il avait auprès de Sa Majesté très chrétienne dont les troupes ne pouvaient subsister dans le royaume s'il quittait le ministère qui lui donnait moyen de les entretenir. La troisième, la propre considération de sa réputation qui serait flétrie auprès de toutes les nations des Indes et de l'Europe si après avoir introduit des étrangers dans les places fortes du royaume, il se jetait parmi eux en abandonnant le service de son maître et son bienfaiteur. La quatrième était l'appréhension d'être livré aux Siamois s'ils le venaient repérer à main armée devant Bangkok.
Le roi de Siam apprit avec chagrin que le général français ne viendrait pas, parce que encore qu'il ne sût pas le secret de l'affaire, il n'avait point plus grand plaisir que de voir grand nombre de Français à la cour, et parce qu'il n'avait aucune confiance en ses sujets. M. Constance donna le meilleur tour qu'il put à la contremarche du général et dit au roi que M. Desfarges lui avait écrit qu'une subite indisposition l'avait empêché de donner à Sa Majesté la satisfaction qu'elle souhaitait. Le roi reçut d'abord cette excuse dans l'espérance de le revoir quand il serait guéri, mais le bruit qu'on avait répandu de la mort du roi dans Siam et dans Bangkok ne fut pas longtemps à venir à la cour et fut porté jusqu'aux oreilles du roi même. Il fit appeler M. Constance et lui demanda avec inquiétude ce qui avait pu donner occasion à ces fausses nouvelles.
Le ministre ravi d'avoir trouvé cette ouverture de lui parler des troubles du royaume, lui fit entendre que la maladie de Sa Majesté avait donné lieu à quelques gens mal intentionnés de divulguer de fausses prédictions ; qu'il était important que Sa Majesté ne les autorisât point par la créance qu'elle y donnait, parce qu'il était dangereux que les grands du royaume, voyant les princes dans sa disgrâce, ne fissent des partis pour porter quelqu'un sur le trône au préjudice des droits naturels de sa famille royale, et qu'en attendant que Sa Majesté eût rétabli sa santé et pût mettre un plus grand ordre aux affaires, il lui conseillait de se montrer au peuple sur son éléphant à la porte du palais.
Le roi fit un effort pour cela. Il envoya avertir les officiers français de se rendre auprès de lui et fit le tour de son palais. Il n'y eut que le major de Beauchamp qui le suivit, les autres ne vinrent pas à temps. La vue du roi répandit la joie et remit une espèce de tranquillité dans le royaume. On avait voulu jusque-là soutenir à Bangkok qu'il était mort, mais l'assurance que l'on eut du contraire ferma la bouche aux plus obstinés et changea le plan des affaires. On fit dans la place des réjouissances publiques avec une décharge de toute l'artillerie pour le retour de la santé du roi, mais on fut après cela un peu embarrassé à changer de système et à imaginer d'autres raisons que la mort de ce prince pour colorer le retour de nos troupes dans Bangkok.
| Phetracha prend ses mesures pour éclater. |
Phetracha, plus rusé, sut profiter de nos divisions. Comme tout homme criminel est soupçonneux, il jugea bien que les troupes que M. Constance appelait à Louvo étaient pour l'arrêter et pour le perdre, si sa bonne fortune n'eût détourné le coup. Et pour ne plus donner de loisir au ministre, son ennemi particulier, de tenter à l'avenir de pareilles entreprises, il se hâta de prendre des mesures pour exécuter ce qu'il n'aurait peut-être fait qu'à la mort du roi.
Il engageait tous les jours de nouveaux mandarins dans son parti par l'espérance des charges du royaume qu'il leur promettait et du pillage qu'il leur faisait espérer de la maison de M. Constance que l'on imaginait toute remplie de trésors. Il n'en fallait pas davantage pour animer ces gens avides du bien, qui d'ailleurs étaient jaloux de la puissance du ministre. Les mandarins donnaient à Phetracha leurs esclaves, les gouverneurs de place lui envoyaient des gens du roi et lui-même débauchait plusieurs ouvriers occupés à des travaux publics et particulièrement ceux qui étaient employés à l'église des jésuites et aux fortifications de Bangkok.
| Ce que fit M. Constance pour rompre les mesures du traître Phetracha. |
M. Constance, attentif à toutes ses démarches, le traversait autant qu'il pouvait en toutes ses entreprises. Il envoya des ordres plus pressants aux gouverneurs et officiers du royaume de maintenir sûrement le peuple dans le devoir, d'étouffer les bruits, d'en punir les auteurs et de ne permettre ni assemblées ni cabales contre le service du roi. Parmi ces soins généraux, il avait une attention particulière sur Bangkok par l'intérêt particulier qui l'engageait à veiller à la sûreté de cette place ; car quoiqu'il parût aux yeux du commun que les Français l'avaient abandonné, il jugea autrement des bonnes intentions de leur général, il ne l'abandonna aussi jamais, jugeant plus sainement que personne que le salut de la cause commune dépendait de leur union, et que comme il ne pouvait se soutenir contre la rébellion sans le secours des Français, sa perte serait aussi bientôt suivie de la leur s'ils le laissaient succomber.
Il fit un dernier effort pour réunir les esprits par des lettres remplies d'honnêteté et d'offres obligeantes, quelques-unes mêmes étaient accompagnées de présents fort précieux. Il envoya à Bangkok de nouveaux travailleurs pour mettre au plus tôt la place hors d'insulte. Le général se plaignait qu'on les lui débauchait, le ministre porta ses plaintes au roi et le roi envoya sur le champ des exécuteurs de justice sur les lieux avec un commissaire pour découper la peau de la tête aux mandarins qui, étant commandés pour conduire les travailleurs, les avaient laissé déserter (8). M. Desfarges crut que l'honnêteté l'obligeait de demander leur grâce à la cour. Les choses n'en allèrent pas mieux.
M. Constance avait aussi envoyé dans la place peu de temps auparavant un troupeau de deux cents vaches qu'il avait ordonné qu'on gardât pour la dernière nécessité. Il pressa longtemps de prendre des poudres dans les magasins du roi de Siam et des vivres autant qu'il en faudrait pour un an de siège si on avait à le soutenir jusqu'à l'arrivée des vaisseaux de France. Mais on lui fit réponse qu'on avait déjà des poudres et qu'il n'y avait point encore de magasins pour en prendre davantage. Il envoya aussi des ordres pour abattre le fort qui était de l'autre côté de la rivière opposé au nôtre, parce que la garde des deux places était trop pénible au petit nombre qu'on était de Français, et qu'il prévoyait la nécessité où l'on serait en cas de guerre d'abandonner ce poste aux ennemis qui pourraient s'en servir comme ils firent avec avantage contre nous. Il donna divers autres avis à M. le général de se tenir inséparablement attaché à la maison royale quoi qu'il pût arriver, de ne point écouter les conseils violents que leur suggéraient des gens peu instruits ou mal intentionnés et de se ménager avec les Siamois, lui ajoutant que ce serait peut-être les derniers avis qu'il aurait occasion de lui donner, et qu'il le priait de les recevoir comme d'un ami particulier et d'un fidèle serviteur du roi.
| Les conseils que M. Constance donna au roi. |
Il ne soutenait pas avec moins de fermeté le poids des affaires du palais pendant l'inaction du roi son maître. Il était seul dans cette cour d'infidèles et de traîtres à s'opposer au torrent de la conjuration, néanmoins comme elle n'était pas encore en état d'éclater, on gardait des mesures de part et d'autres. M. Constance cherchait à temporiser en attendant le retour de la santé du roi, Phetracha cherchait à le tromper par les ménagements qu'il avait pour lui. Ainsi ils vivaient encore ensemble assez bien en apparence pour des gens qui cherchaient à se perdre l'un l'autre.
Mais enfin, le ministre voyant que la santé du roi s'affaiblissait tous les jours et que Phetracha fortifiait davantage son parti, il eut recours aux derniers remèdes qu'il s'était proposé. Il fut trouver le roi et lui dit qu'il souhaitait que Dieu, maître souverain de nos vies, conserva celle de Sa Majesté une longue suite d'années pour le bien de ses peuples, mais qu'en faisant ces souhaits, il était obligé de lui dire qu'il y avait des troubles dans le royaume causés par les différents intérêts que l'on prenait à l'élection future du successeur de la couronne, si la mauvaise fortune des Siamois leur enlevait leur bon maître ; que Sa Majesté pouvait remédier à ces désordres en déclarant le prince de sa famille à qui elle voudrait laisser l'empire, parce que ce peuple qui adorait ses volontés se soumettrait avec joie au maître qu'il aurait reçu de sa main, et qu'ainsi les esprits irrésolus et partagés en diverses factions se réuniraient pour suivre le parti auquel le choix du roi les aurait déterminés.
Ces sortes de propositions sont toujours difficiles et délicates à faire à un souverain, mais la manière insinuante avec laquelle M. Constance fit celle-ci à son maître, et la déférence que le roi avait aux conseils de son ministre la firent bien recevoir. Le roi dit qu'il y penserait. La vue qu'avait en cela le ministre était de mettre le prince qui serait nommé successeur en action pour faire un parti capable de s'opposer aux séditieux, mais il ne jugea pas à propos d'en dire davantage au roi pour ne point avancer les malheurs qui prévoyait devoir arriver s'il déclarait plus ouvertement la conspiration, lesquels arrivèrent en effet quand elle fut découverte.
Mon Pi ne manqua pas d'avertir Phetracha que M. Constance avait eu une audience particulière et ils ne furent pas longtemps sans en savoir le sujet du roi même, qui n'avait rien de secret pour le jeune favori. Phetracha rencontra le lendemain M. Constance vers l'appartement du roi, il le prit par le bras et lui dit de son air libre : Nous sommes bons amis, il est à propos que nous nous avertissions l'un l'autre des fautes que nous faisons. Pour un homme éclairé comme vous, êtes-vous oublié jusqu'à parler au roi de mort et de successeur, et surtout jusqu'à lui donner le chagrin de voir qu'on lui demande sa couronne pour ses plus grands ennemis ? Comme il parlait avec beaucoup de chaleur, M. Constance lui dit qu'il ne faisait pas réflexion lui-même où il était en parlant de ces choses si hautement sous les fenêtres du roi. Phetracha répondit qu'il voudrait que le roi l'entendît et qu'il lui dirait à lui-même que Sa Majesté était trop équitable pour leur donner pour maître après elle un de ces princes si peu dignes de lui succéder ; qu'au reste si quelqu'un était encore si hardi pour faire de semblables propositions au roi, il le ferait repentir de sa témérité. Leur entretien qui s'échauffait fut interrompu par quelqu'un qui survint.
Un mandarin nommé Simounkiaj, capitaine des pages du roi (9) avertissait M. Constance de toutes les démarches de Phetracha, et il le sollicitait tous les jours de s'enfuir tandis qu'il était encore en liberté de le faire, lui disant que l'on mettait la nuit des gardes aux avenues de sa maison, qu'on cherchait à le tuer et que tous les officiers du palais étaient gagnés par Phetracha. Mais quoi, lui répliquait M. Constance, le roi n'a-t-il plus de serviteurs fidèles ? Ne trouverons-nous personne à la cour dans le devoir et l'obéissance ? — Ne vous flattez point, lui répliquait le mandarin. La crainte que l'on a de Phetracha arrête tout le monde, et je vous avouerai moi-même que s'il faut en venir aux mains, quoique je ne sois pas homme de guerre, je serai contraint de suivre le torrent.
Quoique M. Constance vît beaucoup de franchise dans cet homme, il crut néanmoins avoir sujet de se défier qu'il ne vînt de la part de son ennemi, qui voulait l'intimider et lui faire abandonner le terrain. Il se contenta d'envoyer Mme Constance avec son fils au camp des Japonais, et résolut de s'opposer jusqu'à la fin aux desseins des séditieux, dans la créance où il était qu'ils n'entreprendraient rien pendant la vie du roi. Peu de temps après, un autre mandarin le vint avertir de ne point aller le lendemain au palais parce qu'on y avait aposté des gens pour le tuer. Il se moqua de l'avis et il alla au palais avec moins de suite qu'à l'ordinaire. C'était une ruse de son ennemi pour l'empêcher de voir le roi et de prendre de là occasion de le rendre suspect.
| La déclaration du roi touchant sa succession. |
Le roi lui dit ce jour-là même qu'il avait pensé à ce qu'il lui avait proposé pour apaiser les mouvements du royaume, et peu de temps après, ayant assemblé son Conseil où Phetracha et Mon Pi furent appelés avec plusieurs grands mandarins, le roi leur déclara que dans l'incertitude où il était du temps qu'il lui restait à vivre, il avait pris la résolution de nommer la personne à qui il voulait laisser sa couronne pour prévenir les troubles d'une élection après sa mort ; qu'il savait que les lois du royaume lui imposaient l'obligation de prendre un successeur dans la famille royale, mais qu'on n'ignorait pas aussi que les mêmes lois lui laissaient la liberté de choisir de sa famille la personne qu'il voudrait quand il avait de justes sujets d'éloigner de la succession celui à qui elle devait naturellement venir ; qu'on savait assez les sujets de mécontentements qu'il avait contre ses frères et que c'était cette raison qui l'avait obligé de jeter les yeux sur la princesse sa fille pour la laisser régente du royaume pendant un an, jusqu'à ce qu'elle lui aurait fait faire ses obsèques, après quoi il lui laisserait la liberté d'épouser celui des princes ses oncles qu'elle jugerait plus digne de partager l'empire avec elle. Le roi prit ce tempérament parce qu'il ne haïssait pas assez les princes pour leur enlever la couronne et qu'il ne les aimait pas aussi assez pour la leur mettre lui-même sur la tête.
Quoique tout le Conseil applaudît ouvertement au choix du roi, il fut reçu d'un chacun avec des sentiments divers. Mon Pi, à qui Phetracha avait promis de proposer au roi de le faire son successeur, comme il avait le nom de son fils adoptif, eut les yeux attachés sur lui pendant tout le Conseil, et ce qui l'outra jusqu'au vif, c'est que Phetracha évita toujours la rencontre de ses regards et ne dit pas un seul mot en la faveur de ce jeune homme. Le ministre, par un motif tout différent, ne s'accommodait point de l'élection d'une princesse, parce qu'elle ne pouvait pas remédier aux désordres et parce qu'elle occupait la place d'un prince qui l'aurait fait en se mettant à la tête des affaires. Phetracha, au contraire, s'applaudissait en secret de son bonheur qui allait toujours au-delà de ses espérances, et comme son esprit féroce le portait aux résolutions les plus violentes, il prit celle d'envelopper tous ses ennemis et tous ses concurrents sous une même ruine sans leur donner le loisir de former d'autres desseins sur le nouveau plan du gouvernement.
| Phetracha fait venir à Louvo les troupes des conjurés. |
Il donna ses ordres pour faire venir en diligence de tous les endroits du royaume les troupes des conjurés à Louvo. On vit dans peu tous les chemins couverts de ses soldats indiens, la plupart sans armes, chargés de leur provision de riz et d'eau. À mesure qu'ils approchaient de la ville, il les faisait cacher dans les forêts voisines et souvent il les introduisait la nuit dans la ville jusqu'aux environs du palais pour les apprivoiser à passer par-dessus la crainte respectueuses que tous les Orientaux, et particulièrement les Siamois, ont d'approcher du palais royal. Je puis rendre compte de ces assemblées nocturnes parce que j'ai été souvent exposé à leurs insultes pendant la nuit, dans la cabane où j'étais seul parmi les prêtres des idoles de la pagode du palais par ordre du roi de Siam.
Outre ces troupes de dehors, Phetracha était sûr des compagnies des gardes mores à cheval dont il était capitaine et qui lui étaient tous dévoués, quoiqu'ils fissent assez bien leur cour à M. Constance qui comptait à faux sur eux. Il avait aussi à lui la meilleure partie des mandarins de Louvo, et ce n'était pas une affaire pour lui que de faire main basse sur les autres qui ne voudraient pas plier.
Phetracha, à la tête de ce puissant parti, voyait à sa discrétion le roi malade dans son lit. Il tenait Mon Pi engagé dans sa conspiration d'une manière à ne pouvoir plus renoncer à son engagement. Il observait le ministre et le tenait, pour ainsi dire, assiégé dans sa maison d'où il ne pouvait lui échapper. Il envoya tous les jours de ses talapoins à la princesse nommée régente, qui est grande pagodiste, pour lui faire offre de ses services et de ceux de ses amis, tout prêts, disait-il, à la proclamer régente aussitôt que le roi aurait les yeux fermés ; et enfin pour attirer encore à Louvo les princes prisonniers dans le palais de Siam, il persuada la jeune princesse de demander au roi pour eux la grâce de venir visiter Sa Majesté pendant sa maladie.
La princesse, pour obliger Phetracha en suivant sa propre inclination, parla au roi ; mais elle ne lui parla que pour le plus jeune des princes qu'elle aimait depuis longtemps et à qui elle destinait sa couronne et sa foi, abandonnant l'autre à sa disgrâce. Phetracha, qui ne voulait rien laisser à faire au second jour de sa révolte, fit de nouvelles instances pour obtenir la même faveur pour celui-ci, par l'appréhension que s'il échappait à sa fureur quelqu'un de la maison royale, il pourrait lui susciter des affaires dans le commencement d'un règne mal affermi. Mais tous ses soins trop empressés pour la liberté du prince furent rendus inutiles par ceux que M. Constance prit de le retenir dans sa prison, moins dangereuse pour lui que le séjour de la cour.
Phetracha, pour se venger du ministre, répandit le bruit qu'il voulait s'enfuir avec tous ses biens dans Bangkok et qu'il avait déjà envoyé devant lui Mme Constance et son fils. M. Constance qui ne voulait pas donner aucune prise à ses ennemis, voulut bien sacrifier sa femme au service du roi, espérant toujours que Sa Majesté recouvrerait la santé, ou qu'il pourrait toujours opposer aux rebelles le parti de la princesse régente et de la famille royale qui avait ordre de continuer à se servir de lui dans le ministère et écrivit à Mme Constance de retourner. Cette pauvre dame revint la veille même du jour que le roi et son mari furent arrêtés, comme pour être spectatrice de la sanglante tragédie que l'on préparait à sa famille.
Le jeune Mon Pi avait commencé à ouvrir les yeux dans le Conseil et à s'apercevoir qu'il avait été jusque là la dupe de Phetracha. Cet homme rusé avait donné au jeune mandarin la commission de demeurer auprès de la personne du roi pour observer ceux qui lui parleraient, et il avait pris pour soi celle de ménager les affaires du dehors et d'assembler les troupes, ce qui lui donna occasion de gagner les chefs et de les attacher à ses intérêts particuliers.
Mon Pi s'aperçut de cet artifice le 17 mai, lorsque ayant voulu à l'entrée de la nuit poster de ses gens dans un lieu avantageux près du palais, il trouva le poste occupé par ceux de Phetracha. Il lui en fit des plaintes, et voyant qu'on se mettait peu en peine de le satisfaire, il voulut se faire justice à lui-même et commanda à ses gens de charger les autres ; mais personne ne se mit en devoir ni d'attaquer, ni de céder. Cela lui fit sentir qu'on le jouait. Il s'emporta contre Phetracha et lui reprocha sa perfidie. Ce vieux mandarin le traita comme un jeune homme étourdi, le railla de ses hautes prétentions et lui remit devant les yeux la bassesse de sa naissance, ajoutant que pour lui, s'il n'était pas du sang qui faisait les rois, il avait sucé le même lait que le roi. Mon Pi le quitta brusquement sans lui répliquer et s'en alla marchant à grands pas comme un homme transporté. Phetracha le fit suivre dans la juste appréhension qu'il eut que le dépit ne lui fît prendre quelque résolution violente contre les intérêts de la conjuration que nous allons voir éclater par cette mésintelligence.

NOTES :
1 - L'autre était le père Claude de Bèze. ⇑
2 - Les mirous, ou dans certaines relations mirons, étaient de petits bateaux à rames réservés aux trajets côtiers. Robert Lingat (Une note de Véret sur la révolution siamoise, T'oung Pao vol. XXXI, 1934, p. 360), qui note que les Anglais écrivaient meruah ou merua, suggère que ce mot pourrait avoir une étymologie siamoise, de mi rua (มีเรือ) : Il y a un bateau (ou des bateaux). ⇑
3 - Ce lieutenant était M. de Vertesalle. ⇑
4 - Le terme Faux-cul avait-il au XVIIe siècle le sens que nous lui donnons aujourd'hui ? Ces diverses personnes d'un rang distingué étaient, pour ne pas les nommer, Véret, le directeur du comptoir de Siam, et l'abbé de Lionne, qui écrira plus tard pour se justifier un long Mémoire sur une affaire sur laquelle on m'a demandé quelques éclaircissements. Quoi qu'il en soit, la décision prise par Desfarges de ne pas se rendre à Louvo pour étouffer dans l'œuf ce début de coup d'État était lourde de conséquences et fut peut-être cause de la débâcle des Français. ⇑
5 - On peut penser que ce on se rapporte aux missionnaires des Missions Étrangères et particulièrement à l'abbé de Lionne. Selon le père de Bèze, il y avait au séminaire 24 000 livres en lingots d'argent et 6 000 livres en or et en argent monnayé, qui furent pris par les Siamois lors du pillage de la maison. Il y avait également deux beaux calices de vermeil et quelque argent confiés par les jésuites. (Drans et Bernard, Mémoire du père de Bèze, p. 149). On ignore quelle somme possédait le comptoir de la Compagnie. Il semblerait qu'on était tout de même loin des 50 000 livres annoncées. ⇑
6 - Selon Beauchamp, il s'agissait de l'officier Le Roy. ⇑
7 - Fils cadet du général. ⇑
8 - Ce ne sont peut-être pas seulement la paresse ou l'esprit de sédition qui incitaient les travailleurs siamois à déserter. Beauchamp, major de Bangkok, révèle que Vollant des Verquains ne faisait rien pour stimuler leur ardeur. Pis encore, s'il faut en croire ces fielleuses et savoureuses confidences, il utilisait cette main-d'oeuvre à des fins strictement personnelles : M. Desfarges fut fort surpris d'apprendre à son retour que Vollant, ingénieur, s'amusait à faire des maisons de plaisance ; qu'il débauchait sous main des ouvriers de la place ; qu'il en avait tiré jusqu'à trente en un seul jour ; qu'il avait fait démolir en partie une très belle maison que les missionnaires lui avaient prêtée, pour la rendre plus spacieuse, comme aussi il en avait fait bâtir une entière à un quart de lieue de celle-là sur le bord de la rivière, à quatre pavillons, avec une grande ménagerie, ce qui fut cause que les Siamois qui travaillaient à Bangkok se plaignirent de lui à M. Desfarges sur ce qu'il leur enlevait leurs travailleurs. Ce fut sur ces plaintes et sur ce que M. Desfarges s'aperçut qu'ils n'étaient plus si assidus aux travaux, qu'il lui dit qu'il ne prétendait pas qu'il quittât les travaux du roi pour bâtir des palais ; qu'il devait se ressouvenir que, manque d'application, les fortifications qu'il conduisait de la place ne valaient rien : que le bâtardeau qu'il avait fait construire pour retenir l'eau dans les fossés s'était éboulé, en un mot qu'il voulait qu'il fît ce qu'il était obligé de faire ; que ce n'était pas ainsi qu'on gagnait l'argent du roi, et que s'il continuait il en écrirait à la cour. Vollant lui répondit brusquement qu'il s'en souciait fort peu et qu'il en écrirait aussi. M. Desfarges, indigné d'une telle réponse, le mit lui-même en prison, où il ne demeura que deux heures, parce qu'il pria le sieur de la Salle, commissaire, de dire à M. Desfarges qu'il lui demandait pardon et qu'il tâcherait de le mieux contenter à l'avenir. (La relation de Beauchamp, Bibliothèque Nationale, Fr 8210, f°. 515r°-515v°). ⇑
9 - Le père de Bèze évoque également ce dignitaire, qu'il nomme Omun Si Munchay (...) capitaine des pages et premier officier de la chambre du roi. (Op. cit., p. 100). ⇑

21 février 2019
