


Début du livre IV.

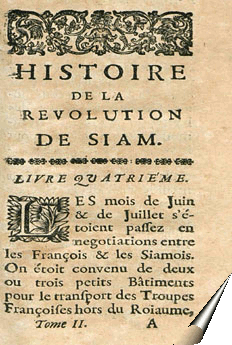
ES mois de juin et de juillet s'étaient passés en négociations entre les Français et les Siamois. On était convenu de deux ou trois petits bâtiments pour le transport des troupes françaises hors du royaume. L'un se trouva en si mauvais état en arrivant à Bangkok qu'on le laissa aller au courant de la rivière, et l'autre qui était chargé de vivres servit à ravitailler la place et demeura à l'ancre sous notre canon. M. Desfarges, ne pouvant s'accommoder de ces barques pour le voyage qu'il méditait, demandait qu'on lui vendît un vaisseau anglais qui était mouillé près de la ville de Siam et avait appartenu en partie à M. Constance, en partie à un marchand de Madras. Mais le barcalon le mit à un prix si déraisonnable qu'il fut aisé de voir qu'il ne voulait pas le mettre entre les mains des Français de crainte qu'ils ne s'en servent pour renouveler la guerre.
| Arrivée de deux vaisseaux. |
Pendant qu'on était embarrassé à trouver des vaisseaux au-dedans du royaume, il en vint deux du dehors, dont nos Français auraient apparemment mieux profité qu'ils ne firent s'ils n'avaient pas été alors en traité avec les Siamois. C'était les deux frégates que M. Constance avait envoyées en course, et dont les capitaines français avaient ordre de venir au premier bruit de guerre qu'ils entendraient se mettre sous le canon de Bangkok, comme nous avons dit. Mais par malheur, le sieur de Saint-Cry qui les allait avertir avait péri dans la barque d'envoi et ces bâtiments n'avaient rien appris en mer de tous les troubles de Siam. Ainsi, après avoir fait leurs courses sans avoir trouvé le corsaire qu'ils cherchaient, ils venaient désarmer. Le premier arriva le 29 juillet à l'entrée de la rivière. Il fut fort surpris de la trouver fermée avec des pieux et toute couverte d'hommes et de bateaux. Mais pour lui ôter tous les soupçons que la nouveauté de ce qu'il voyait aurait dû lui donner, des mandarins siamois furent à son bord avec toutes sortes de rafraîchissements. Ce sont les gens du monde les plus habitués à tromper, par l'étude continuelle qu'ils en font. Ils dirent au capitaine français que M. Constance l'avait attendu longtemps vers l'embouchure de la rivière, et qu'il n'y avait que peu de jours qu'il était retourné à la cour ; qu'au reste il était venu avec son vaisseau bien à propos pour servir le roi contre les Cambodgiens ses voisins, avec lesquels il avait la guerre par terre et par mer ; que c'était pour cela qu'il voyait la rivière fermée et couverte de monde.
Le capitaine ne se défia de rien. Il entra, désarma son vaisseau, le laissa entre les mains des Siamois, fit embarquer son équipage dans un mirou qu'on lui offrit et se rendit à Bangkok, où il apprit la révolution qui était arrivée depuis son départ. Le 2 août, Sainte-Marie arriva (1). Il s'avança une lieue dans la rivière et envoya un capitaine d'infanterie qu'il avait sur son bord à M. le général, qui étant sur le point de conclure la paix, ne voulut pas risquer le certain pour l'incertain en renouvelant la guerre. Il fit écrire ce billet à Sainte-Marie : Monsieur, j'ai appris votre arrivée avec beaucoup de joie et je vous attends ici avec impatience. Faites que toutes choses aillent bien et prenez garde que rien ne se passe entre vous et les Siamois.
Le capitaine fut renvoyé porter le billet. On dit que cet officier était chargé d'un autre ordre secret pour Sainte-Marie, qui protesta de son côté qu'il ne reçut aucun ordre. Je ne sais pas ce qui en est, mais aussitôt que l'officier eut rendu le billet, Sainte-Marie fit débarquer les soldats qu'il avait commandés et les conduisit à Bangkok. Si l'on eût eu ces deux frégates, on eût été maître de la rivière, comme M. Constance l'avait prétendu, en cas qu'il arrivât du trouble dans le royaume. Pour réparer en quelque manière la perte qu'on venait de faire, on demanda au nouveau roi d'acheter les vaisseaux qu'on lui avait rendus avec tant de bonne foi. Les Siamois ne voulaient rien conclure et paraissaient n'avoir d'autre dessein que de tirer en longueur pour obliger les Français, par la disette des vivres, à accepter de méchantes barques sur lesquelles ils périraient, ou du moins avec lesquelles ils ne seraient pas en état de rien entreprendre contre le royaume.
| Arrivée de M. de l'Estrille avec un vaisseau de France. |
Mais l'heureuse arrivée du vaisseau du roi nommé l'Oriflamme, qui vint sur ces entrefaites environ le 15 août mouiller à la barre de Siam rassura nos Français et rendit les Siamois plus traitables (2). Ce vaisseau avait touché à Batavia où les Hollandais savaient très bien tout ce qui se passait à Siam, mais l'intérêt qu'ils y prenaient leur fit cacher le danger de nos Français à ceux qui allaient à leur secours. On dit seulement à ceux-ci, quand ils partirent de Batavia, qu'on espérait bientôt de les y revoir, et le général hollandais fit suivre le vaisseau du roi par deux vaisseaux qui vinrent jeter l'ancre près de lui à la rade de Siam.
Les Siamois virent venir le vaisseau avec pavillon blanc, et quoiqu'il vînt mal à propos traverser leur dessein, ils ne se troublèrent point, espérant de traiter ce nouvel hôte comme ils avaient fait les deux précédents. Ils eurent recours à leurs artifices ordinaires, furent faire les compliments de M. Constance au capitaine de l'Oriflamme, et les accompagnèrent de présents et de démonstrations d'une joie la mieux contrefaite pour son heureuse arrivée, afin de l'engager à descendre à terre. Les Siamois s'adressaient mal. C'était M. de l'Estrille qui commandait ce vaisseau du roi, qui connaissait trop bien le génie de ces Indiens pour leur confier sa personne. Néanmoins comme il avait perdu dans le voyage près de cent hommes de deux cents qu'il avait embarqués pour les Indes, et que ceux qui restaient en vie avaient le besoin le plus pressant d'être tirés de l'infection qui était à bord, le capitaine en envoya une partie à terre, avec une escorte de quarante hommes bien armés.
Quand on fut arrivé à l'embouchure du fleuve, les Siamois eurent peur des mousquets, et ne croyant pas pouvoir arrêter tant de gens, ils renvoyèrent les soldats à leur vaisseau sous prétexte que M. Constance n'avait pas encore donné les ordres pour les loger, et retinrent seulement le sieur Cornuel, capitaine en second sur le vaisseau du roi, et quelques officiers d'infanterie. Ces messieurs demandaient d'être conduits à Bangkok. On les fit entrer en un petit balon où ils passèrent une nuit sombre et orageuse avec beaucoup d'inquiétude, et le lendemain avec beaucoup de surprise, ils se trouvèrent rendus à Siam, ne comprenant pas comme ils y étaient venus sans avoir passé par Bangkok qui est sur la route. On leur avait fait prendre de grands détours pour éviter notre forteresse. Pour empêcher encore à Siam qu'ils ne rencontrassent quelques Français qui les instruisissent de l'état des affaires, on les mena par des chemins écartés à la maison du barcalon. Par une providence de Dieu particulière, un capitaine de la garnison de Bangkok nommé Des Rivières était alors chez ce ministre pour solliciter de la part de son général l'armement des vaisseaux. On fit tenir les officiers de l'Oriflamme à l'écart, afin que Des Rivières ne pût porter à Bangkok la nouvelle de l'arrivée de ce vaisseau et qu'on pût aussi renvoyer les officiers à l'Oriflamme sans qu'ils sussent rien de la guerre ni de l'état de Bangkok.
Aussitôt que le barcalon eut congédié Des Rivières, il fit entrer d'un autre côté Cornuel et ses compagnons ; mais Des Rivières ayant appris d'un Portugais qu'il y avait un vaisseau français à la barre et que des officiers qui en étaient venus étaient à l'heure même chez le barcalon, il y rentra brusquement, malgré les gardes qui voulurent l'arrêter à la porte. Le barcalon ne parut point embarrassé de ce contretemps : Ah ! Monsieur Des Rivières, s'écria-t-il, vous rentrez fort à propos, je voulais envoyer après vous. Venez, voici des messieurs qui vous diront des nouvelles de France, et vous leur en apprendrez des vôtres.
Après un entretien assez court où tout le monde fut fort distrait, les officiers sortirent tous ensemble, et furent à la faiturieFaiturie, ou factorie : bureau où les facteurs, les commissionnaires, faisaient commerce pour le compte d'une Compagnie. L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert précise également : On appelle ainsi dans les Indes orientales et autres pays de l'Asie où trafiquent les Européens, les endroits où ils entretiennent des facteurs ou commis, soit pour l'achat des marchandises d'Asie, soit pour la vente ou l'échange de celles qu'on y porte d'Europe. La factorie tient le milieu entre la loge et le comptoir ; elle est moins importante que celui-ci et plus considérable que l'autre. française où ils passèrent le reste du jour. Ils en partirent le lendemain, et les nouvelles qu'ils apprirent et rapportèrent de part et d'autre causèrent autant de joie dans Bangkok que de surprise dans l'Oriflamme. Ce vaisseau était trop gros pour entrer dans la rivière de Ménam. Il demeura au-delà de la barre à deux lieues en mer, où il ne laissait pas d'effrayer les sauvages qui disaient n'avoir jamais vu de si grand bâtiment. Le barcalon alla lui-même le voir de près et il en retourna plus docile à écouter les propositions de Bangkok.
| On fait un traité avec les Siamois. |
On reprit les négociations qui avaient été interrompues, et elles se terminèrent enfin à un traité par lequel il était porté que les Français sortiraient des forteresses de Bangkok et de Mergui et laisseraient les ouvrages qu'ils y avaient faits en leurs entiers, avec le canon et les armes appartenant au roi de Siam. Le roi de Siam, de son côté, promettait de laisser sortir en paix les Français, avec armes et bagages, sur trois frégates qui leur seraient fournies pour les porter jusqu'à la côte de Coromandel, à condition que M. l'évêque de Métellopolis et le sieur Véret, chef de la faiturie française, demeureraient en otages dans le royaume pour assurer le retour de ces frégates qui seraient ramenées en bon état dans la rivière de Siam et remises entre les mains des gens du roi (3). Et pour ce qui regardait les troupes de Mergui, les Siamois, suivant le rare talent qu'ils ont de fourber en toute rencontre, obligèrent M. le général d'envoyer un officier dans cette place, avec un ordre à la garnison de ne commettre aucun acte d'hostilité en sortant, quoiqu'ils sussent fort bien que depuis plusieurs mois cette garnison avait été obligée d'abandonner la forteresse.
Les pères jésuites voyant les troupes du roi se préparer à sortir du royaume de Siam délibérèrent entre eux sur ce qu'ils pourraient faire de plus expédient pour la gloire de Dieu et l'avantage des missions. Ils commencèrent par proposer au barcalon qu'y ayant été appelés par le feu roi et envoyés par Sa Majesté très chrétienne pour le service du royaume, ils souhaitaient de savoir la disposition que le nouveau roi voulait faire d'eux dans les conjonctures présentes. Le barcalon leur dit assez obligeamment : Mes pères, cette affaire me regarde en particulier, c'est moi qui suis allé vous chercher et qui vous ai amenés ici, c'est à moi aussi à vous procurer auprès du roi une entière satisfaction.
Il parla au roi son maître, qui lui répondit qu'il laissait aux pères la liberté de sortir du royaume ou d'y demeurer. Les pères, après avoir consulté Dieu sur cette affaire, jugèrent qu'ils ne devaient pas demeurer tous, ni sortir aussi tous. Les raisons qu'ils avaient de ne pas demeurer tous étaient, premièrement parce qu'ils ne savaient pas comment la cour de France prendrait cette affaire et que si l'on voulait en tirer vengeance, on les blâmerait d'être demeurés comme en otages parmi les ennemis. La seconde, parce que sous le nouveau règne, n'y ayant plus d'espérance de prêcher l'Évangile pour faire de nouveaux chrétiens, et les anciens ayant déjà leurs pasteurs parmi les religieux portugais qui y sont établis, il n'y aurait pas dans le royaume de quoi occuper tant d'ouvriers. La troisième, qu'une troupe de missionnaires, qui étaient dans la fleur de leur âge, étant l'espérance de toutes les Indes, il ne fallait pas l'enfermer inutilement parmi cette nation rebelle à la lumière depuis tant d'années, pendant que la Chine, le Tonkin, la Cochinchine ouvraient une plus heureuse carrière à leur zèle et à leurs travaux apostoliques. De l'autre côté ils eurent aussi quelque raison de ne pas abandonner entièrement cette mission à laquelle ils avaient été attachés par la providence de Dieu, qui a suscité en divers temps des hommes apostoliques pour maintenir et étendre partout sa sainte loi. On jugea donc qu'il fallait laisser quelques jésuites à Siam, et l'on crut qu'il suffisait d'y en laisser deux qui se sacrifièrent volontiers à cette disposition de l'obéissance, avec la liberté néanmoins de passer à la Chine s'ils voyaient dans la suite qu'il n'y eût pas de quoi les occuper à Siam. Le sort ou plutôt le choix de la providence tomba sur les pères de la Breuille et Bouchet, parce qu'ils avaient de plus grandes avancées dans la langue du pays. Mais le dernier en est encore sorti par une autre disposition de Dieu, dont j'aurai ailleurs l'occasion de parler. M. l'évêque de Métellopolis jugea aussi à propos de partager son séminaire. Il en laissa une partie à Siam et envoya l'autre à Bangkok pour se retirer avec les Français.
Cependant la conclusion de la paix avait ramené l'abondance et la joie dans Bangkok. Les officiers et les soldats, également fatigués de cette guerre lente et ennuyeuse, reprenaient l'espérance qu'ils avaient perdue de revoir les doux climats de la France. Les Anglais qui avaient été maltraités se préparaient à être du voyage, et toute la chrétienté commençait à respirer.
Il n'y avait que Mme Constance qui se voyait plongée dans un abîme de malheurs sans espérance d'en sortir, et le départ des Français qui la laissaient en proie à ses ennemis augmentait son désespoir. Les aventures de cette dame m'ont paru si singulières que je n'ai pas voulu les confondre dans le récit de la persécution générale. Elle mérite bien de trouver ici une place distinguée, dans laquelle, reprenant d'un peu plus haut la suite de son histoire tragique, nous la représentions toute entière sans interruption.
| Suite des aventures de Mme Constance. |
Dans le partage qu'on fit de la maison de Mme Constance, elle fut faite esclave avec son fils d'un mandarin nommé Simounkiai. Sa mère et ses frères échurent en partage au capitaine des Japonais, une partie de ses filles suivantes au fils de Phetracha, et ses autres parents et domestiques à divers officiers. Le mandarin dont elle était esclave avait été ami de M. Constance. La considération de cette amitié l'empêcha de faire venir Mme Constance dans sa maison du vivant de son mari. Il la laissait à l'écart dans l'écurie où elle avait été d'abord transportée, et la négligeait même à dessein de la laisser tomber dans l'oubli du monde pour lui rendre peu à peu sa liberté comme il le lui avait fait espérer. Quand cette dame fut un peu revenue de sa première frayeur et se fut remise des douleurs de la torture qu'on lui fit endurer à la porte de son cabinet, ce fut une chose surprenante pour tous ceux qui l'approchaient de voir une personne à son âge tombée de la plus haute fortune dans le dernier abaissement, plus tranquille et plus contente, disait-elle, qu'elle n'avait été de sa vie, pourvu que ses persécuteurs se voulussent contenter eux-mêmes de l'avoir réduite en cet état, où en lui enlevant ses biens, on l'avait déchargée d'un fardeau.
Mais cette tranquillité fut bientôt troublée par de nouvelles afflictions qui lui arrivèrent coup sur coup, et qui enchérissant les unes sur les autres, la conduisaient comme par degrés au comble de ses maux. Le tyran ne pouvait s'ôter de l'esprit qu'elle avait des trésors cachés. Il avait fait renverser sa maison jusqu'à détruire une pyramide qui était devant la chapelle, pour fouiller dans les fondements, et de la rage qu'il eut de voir son avidité frustrée, il fit enlever la dame du lieu où elle était dans une salle de justice où elle fut encore gênée depuis sept heures du soir jusqu'à minuit, avec tant d'excès qu'elle demeura quinze jours sans pouvoir se soutenir ni se servir de ses mains.
Elle était dans cet état de langueur lorsqu'elle eut les premiers indices de la mort de son époux. Elle lui envoyait, comme j'ai dit, tous les jours à manger dans sa prison de ce qu'on lui envoyait à elle-même par aumône. Le 6 ou 7 juin, on refusa de laisser entrer au palais celui qui portait le dîner. Mme Constance le vit rentrer, et selon la coutume des personnes affligées qui tirent de toutes choses de tristes augures, elle jugea de ce refus ce qu'elle pouvait juger de plus fâcheux. Elle devina que M. Constance était mort, et sur ces premières alarmes, elle s'abandonna à sa douleur avec le même transport que si elle eût vu le corps ensanglanté de son époux. Ah Dieu, s'écria-t-elle ! Il est mort. M. Constance est mort, je ne me flatterai plus de l'espérance de le revoir. Les traîtres ! Que leur avait-il fait ? Et comment l'auront-ils fait mourir ? Sa bonne aïeule, appréhendant que ce que la douleur lui faisait dire ne fût entendu de ses gardes et rapporté ailleurs, lui dit plusieurs fois qu'elle n'avait pas encore sujet de s'alarmer, qu'on n'avait point encore fait mourir M. Constance, mais qu'elle disait des choses capables d'avancer sa mort. Non, non, reprit-elle avec une aigreur d'esprit qu'on ne lui avait point vu dans les autres rencontres, ne nous flattons plus, il est mort. Qu'ai-je à ménager davantage avec nos ennemis ? Qu'ils viennent nous égorger encore, aussi bien n'ai-je pas longtemps à vivre dans l'état où ils me réduisent. On ne put lui rien dire qui la rassurât contre ses vives appréhensions. Accablée de douleurs de son corps et des agitations violentes de son esprit, elle n'avait plus de repos et ne prenait de la nourriture qu'avec répugnance, ce qui la jeta dans un abattement qui faisait craindre pour sa vie.
Cependant la mort de M. Constance n'ayant pu être longtemps cachée, le bruit s'en répandit et fut porté jusqu'à Mme Constance. Elle le reçut avec une modération que nous n'avions pas sujet d'espérer après ce que nous avions vu de ses premiers transports, mais l'accablement épuise à la longue la sensibilité ; le secours du ciel fortifie dans ces rudes épreuves. Elle dit au père de Saint-Martin son confesseur (4) qui venait la consoler, que c'était elle qui par ses péchés avait attiré ces malheurs sur son époux et sa maison, à quoi le père ayant répliqué qu'il ne fallait pas regarder la mort de M. Constance ni la désolation de sa famille comme un mal, mais comme un honneur que Dieu leur faisait de les juger dignes de souffrir persécution pour la religion et pour la justice, elle leva les mains au ciel et ne put répondre que par un torrent de larmes où la tendresse et la joie avaient autant de part que la douleur. Elle pria ensuite le père d'offrir le saint sacrifice pour le repos de l'âme de son époux, et de recommander la même chose de sa part aux autres jésuites qui ne manquèrent pas de s'acquitter de ce devoir envers leur ami et leur bienfaiteur.
Le lendemain Simounkiai vint voir sa captive et lui fit ses compliments de condoléance. Elle lui demanda de quoi on avait pu accuser M. Constance pour le traiter en criminel, et le mandarin lui dit en secret que le crime de son mari avait été sa faveur et son esprit. Elle reçut encore un plus illustre témoignage de l'innocence de M. Constance de la part du roi prisonnier dans son palais. Le bon prince, ayant appris la désolation où était cette dame, lui fit l'honneur de lui envoyer dire qu'il prenait beaucoup de part à sa douleur ; que c'était injustement qu'on avait fait mourir son époux, mais qu'il fallait qu'elle prît patience, en considérant que lui qui était roi n'avait pas à souffrir de moindres disgrâces que les siennes.
| Le fils du tyran veut faire entrer Mme Constance dans son sérail. |
Mme Constance, après la perte de ses biens, de sa liberté et de son cher époux, croyait avoir éprouvé toutes les rigueurs de sa mauvaise fortune et s'endurcissait contre ses maux par la pensée qu'elle n'avait rien à souffrir de plus fâcheux, lorsque Dieu mit son courage à une nouvelle épreuve, en comparaison de laquelle toutes les précédentes devinrent légères. Après la mort de son mari, elle eut le malheur de plaire à celui qui venait d'en être le meurtrier, et par sa généreuse résistance elle devint dans la suite l'objet de sa haine et de sa cruauté. Voici comment la chose arriva. Nous avons remarqué que M. Constance, sur le point de perdre la vie, avait recommandé Mme Constance à Sorasak, fils de Phetracha, qui présidait à son supplice. Le jeune homme n'avait jamais vu la dame, parce qu'elle ne paraissait en public que dans son église, où les infidèles n'entraient point. Il eut la curiosité de connaître une personne qu'on lui avait recommandée. Il s'informa d'elle et de ses qualités, et sur le portrait qu'on lui en fit comme d'une jeune personne âgée de vingt-deux ans, ayant la couleur, l'air et les manières d'une Européenne, bien faite, d'un esprit doux et d'une humeur enjouée avant ses disgrâces, il prit pour elle la fatale passion qui a tant coûté de larmes à cette chaste dame.
Il la demanda d'abord au mandarin dont elle était esclave. Celui-ci était le plus honnête homme qui eût paru parmi les Siamois. Il avait de la bonne volonté pour Mme Constance, et pour la défendre des poursuites de Sorasak, il fit réponse à ce jeune homme que Phetracha son père lui avait donné la dame et son fils moins pour être en esclavage que pour être sous sa garde, et qu'il en était chargé, et qu'il ne pouvait pas s'en défaire sans ordre. Et si j'obtiens, reprit Sorasak, l'agrément de mon père, puis-je être sûr du vôtre ? Le mandarin ne put s'en défendre et lui répondit que oui. Sorasak le quitta fort content d'avoir sa parole, mais un peu embarrassé à faire agréer la chose à son père. Il savait que le vieillard était homme austère, n'approuvant point ses débauches. Il rêva, il consulta, et ne trouva point de meilleur expédient que de gagner Mme Constance et de l'engager à demander elle-même ce qu'il voulait d'elle.
Il lui envoya dire que M. Constance la lui avait recommandée avec son fils, et que par la considération qu'il avait pour la mémoire du mort et l'estime particulière qu'il se sentait pour elle, il lui offrait sa protection avec tous les avantages qu'elle pouvait souhaiter, si elle voulait demander d'être de sa maison. La dame connaissait le jeune mandarin pour le plus brutal et le plus emporté de la cour. Elle pénétra son dessein, elle en vit toutes les suites et en eut horreur. Elle crut qu'il fallait répondre d'une manière à rebuter d'abord sa passion et à lui ôter toute espérance. Elle lui fit dire qu'elle n'était point d'humeur à demander la chose du monde qu'elle appréhendait le plus, puisqu'elle était la plus contraire à son devoir. Sorasak s'était attendu à une pareille fierté d'une femme dont il venait de faire égorger le mari et n'en fut point rebuté. Il lui fit dire une autre fois que ce n'était point pour la traiter en esclave qu'il la demandait chez lui, mais pour la mettre au rang de ses autres femmes, et qu'étant libre comme elle était par la mort de M. Constance, de passer à un second mariage, le rang qu'il lui offrait n'étant point indigne d'elle. J'ai entendu dire à Mme Constance qu'elle ressentit en cette occasion, plus qu'elle n'avait encore fait, la dureté de sa mauvaise fortune qui l'exposait aux insultes de tout le monde, et qu'elle avait été pénétrée du plus cruel dépit de voir que son propre tyran, qui avait encore les mains ensanglantées du meurtre de son mari, sans respecter ni sa personne ni son affliction, lui fît parler de mariage. Il lui vint une fois une pensée, pour se venger de la manière outrageante dont elle se voyait traitée, d'aller prendre le rang qu'on lui offrait pour poignarder le meurtrier de son époux.
| Résistance de Mme Constance aux poursuites de Sorasak. |
Sorasak, persuadé que l'esprit le plus aigri s'adoucit avec le temps, espéra que la dame affligée ne tiendrait pas toujours contre sa persévérance. Il redoubla ses sollicitations auprès d'elle, il lui envoya toute sorte de personnes et fit lui-même toutes sortes de personnages, d'amant, de persécuteur, de maître, d'esclave, de tyran. Il la pria, lui promit, la menaça, tantôt lui faisant donner plus de liberté et tantôt la faisant tenir plus à l'étroit, pour essayer à quoi elle serait plus sensible. Tout cela fut également inutile à ses desseins. Il ne gagna rien sur l'esprit de cette femme, il la trouva partout la même, répondant partout avec la même fermeté qu'elle n'était ni touchée de ses soumissions, ni effrayée de ses menaces, et qu'elle redoutait plus son amour que sa haine, quoiqu'elle méprisât également l'un et l'autre.
Elle avait en vue par cette conduite d'éteindre la passion du prince, mais elle le porta sans y penser à de plus grands emportements. Il ne cessa point de l'aimer et cessa de la respecter, résolu de profiter de l'abandon où elle était et du pouvoir qu'il avait sur elle. Il l'avait souvent menacée de la faire enlever, mais elle ne croyait pas qu'il osât l'entreprendre, en quoi elle le connaissait mal. Un jour, quatre Mores la vinrent prendre dans sa cabane, la firent monter sur un éléphant, et sans lui dire ce qu'on voulait d'elle, la conduisirent au logis du prince. Dans l'affreux état où se vit cette dame, sans secours, à la discrétion de ses ennemis, elle ne se troubla point, mais elle se recommanda à son ange tutélaire et le pria d'être le défenseur de sa pudicité. En même temps elle se sentit inspirée, nous dit-elle, d'employer l'unique défense qui lui restait contre les ministres impitoyables de la violence d'un furieux ; elle se mit à pousser des cris si perçants que le prince, appréhendant les reproches de son père s'ils allaient jusqu'à ses oreilles, la fit reconduire dans le lieu d'où on l'avait enlevée. Mais il envoya aussitôt après un médecin du roi à cette dame pour lui dire qu'il la ferait tuer, elle et son fils, si elle lui résistait davantage, et que les jésuites se repentiraient des mauvais conseils qu'ils lui donnaient pour l'obstiner contre lui.
Il ne se trompait pas dans la créance qu'il avait que les pères confirmaient Mme Constance dans ses bonnes dispositions, mais il ne savait pas qu'elle avait encore auprès d'elle son aïeule âgée de quatre-vingts ans qui lui inspirait par son exemple et par ses discours un courage héroïque. Cette bonne dame était descendue des illustres martyrs du Japon. Son aïeul, nommé François Martinz, baptisé par saint François Xavier, avait été exilé de sa patrie pour sa religion avec toute sa famille et plusieurs autres chrétiens qui furent transportés jusqu'à Nagasaki dans des sacs, parce que l'empereur du Japon ayant vu que le fer et le feu faisaient plus de nouveaux chrétiens qu'ils ne faisaient de martyrs, avait ordonné qu'on fît sortir secrètement tous les chrétiens du royaume.
Celle dont je parle n'avait alors que cinq ans. Elle passa avec ses parents à la Cochinchine, et de là elle vint s'établir à Siam, heureuse d'avoir commencé sa vie dans la persécution du Japon pour la finir dans celle des Indes. Or cette bonne dame, qui dans une vieillesse extrême conservait encore le courage de sa jeunesse, inspirait encore les mêmes sentiments à sa fille. Elle ne l'entretenait que de la vertu de ses ancêtres et de la gloire du martyre qu'elles avaient à espérer comme eux. La jeune dame avait besoin d'avoir auprès d'elle un si grand secours pour ne point se laisser accabler sous le poids de la guerre cruelle qu'elle avait à soutenir.
Vers la fin de juillet, son tyran crut avoir trouvé un moyen de la réduire ou de se venger de ses mépris par sa mort, à l'occasion d'un livre de comptes de M. Constance. Dans la recherche qu'on avait faite des biens de ce ministre, on avait trouvé sur ce livre cent catis, c'est-à-dire cinq mille écus, donnés sans qu'on vît ni l'emploi qu'on en avait fait, ni le nom de celui qui les avait reçus. C'était un parent de Mme Constance qui tenait le livre de comptes. Il y eut ordre de le transporter de la prison où il était dans une autre près du palais. Il demanda par grâce à ses gardes de le faire passer devant la maison des jésuites. Les pères furent touchés de voir ce vénérable vieillard, un des plus fervents chrétiens des Indes, en chemise, la corde au col, la tête et les pieds nus. Il leur dit qu'il ne savait où on le conduisait, qu'il se recommandait à leurs prières et les conjurait de s'informer de ce qu'on aurait fait de lui afin de lui apporter un peu de riz, s'il était encore en vie.
Mme Constance apprit aussitôt par les pères ce nouvel incident et se douta bien qu'elle y aurait quelque part. Dès le lendemain, on la fit comparaître devant un juge qui lui demanda ce qu'elle savait de l'emploi de cet argent. Elle répondit simplement qu'elle n'en savait rien, parce qu'elle n'avait jamais eu d'autre soin que celui de donner l'argent que son mari lui envoyait demander, sans entrer en connaissance de l'emploi qu'il en faisait. Le juge fit écrire sa réponse, la renvoya ; mais le prince, voulant profiter de l'occasion, lui envoya ce même juge pour lui dire en secret que si dans trois jours elle ne consentait à ce qu'il voulait d'elle, il la ferait condamner à recevoir cent coups de rotins sous prétexte des cent catis perdus. Mais voudriez-vous faire cette injustice, dit la dame au juge, connaissant comme vous faites mon innocence ? — Je ne pourrais pas m'en défendre, répondit le juge, autrement je serais perdu moi-même. Soyez sûre, Madame, que vous serez condamnée, et profitez de la confidence que je vous fais.
Mme Constance répondit en pleurant que son parti était pris. Elle donna aussitôt avis de cette conférence à son confesseur, employa ces trois jours à prier et à pleurer devant Dieu comme pour mourir, et voulut se munir de la sainte eucharistie pour une si rude occasion. Le terme des trois jours expiré, on ne manqua pas de la faire venir dans la salle de justice avec toute sa famille. On l'interrogea sur l'argent dont il était question, et ayant fait la même réponse que la première fois, elle entendit prononcer l'injuste sentence dont on l'avait menacée, et pour ne lui laisser aucun doute que ce ne fût son barbare amant qui se vengeait d'elle, les gens même de ce jeune prince se présentèrent pour la faire battre. Elle reçut cinquante coups, et davantage, l'évanouissement où elle tomba lui épargna le reste. On ne voulut pas la faire mourir, parce qu'on la réservait à de plus grandes douleurs.
On fit battre après elle l'aîné de ses frères, trois de ses oncles et deux de ses tantes. Sa bonne aïeule était aussi condamnée aux mêmes supplices, mais son âge et sa faiblesse extrême donnèrent de la compassion. Pour la jeune dame, quand elle fut revenue de son évanouissement, elle se trouva en ouvrant les yeux dans une cabane inconnue et plus incommode que celle d'où elle avait été transportée. Ce ne fut qu'à regret qu'elle revit la lumière. Elle y avait renoncé sans peine par l'espérance qu'elle avait eue de voir finir ses persécutions en mourant sous les coups, pour la défense de sa pudicité. Mais elle apprit qu'elle avait encore à la défendre d'une autre manière, et qu'elle était exposée à de nouveaux combats. Sorasak, toujours passionné, et toujours barbare, ne pouvait ni assouvir sa haine, ni éteindre son amour, et paraissait résolu de pousser à bout son entreprise. C'était dans ce dessein qu'il avait fait transporter la dame dans cette nouvelle prison, pour la cacher aux missionnaires, se persuadant qu'elle aurait moins de fermeté quand elle serait plus éloignée de ceux qui lui en inspiraient.
Dieu voulait que la vertu de cette généreuse chrétienne fût mise à toute sorte d'épreuves. Dans le temps qu'elle était privée de la consolation de voir ses amis et ses défenseurs, elle reçut une visite la plus humiliante que l'on pût imaginer. Le bourreau qui l'avait battue si cruellement la vint voir le lendemain, s'assit auprès d'elle, l'appelant sa sœur et se disant son ami, et lui demanda quelque récompense pour l'avoir épargnée. Mme Constance ne dédaigna point de lui parler. Elle le fit même avec une douceur admirable et lui donna ce qu'il demandait. Il semblait qu'elle fût devenue insensible aux affronts, à voir l'indifférence avec laquelle elle les recevait. Son confesseur lui en témoignant un jour quelque surprise : Mon père, lui dit-elle, il faut se consoler de tout ce qui n'est pas de durée. Je touche à ma fin, je ne vivrai pas longtemps dans l'état où l'on me réduit, j'irai rejoindre mon époux. Elle lui ajouta ensuite que l'unique regret qu'elle aurait en mourant serait de laisser son fils dans un âge si tendre, et parmi les barbares. Ce petit innocent, accoutumé aux délicatesses des enfants de sa condition n'avait pour tout habit qu'une chemise de toile rayée et couchait comme les autres prisonniers sur la terre parmi les vers et les insectes dont leur prison était pleine. Son âge de quatre ans ne lui avait pas encore donné assez d'ouverture d'esprit pour ressentir le désastre de sa maison, mais il en avait assez pour faire à sa mère mille questions affligeantes, qui perçaient le cœur de cette bonne dame. Elle en était réduite là, que tout ce qui avait dû faire sa consolation, faisait la plus sensible partie de ses douleurs ; et plus affligée des malheurs de son époux et de son fils que des siens propres, elle souffrait également, et du côté de ceux qu'elle aimait, et du côté de ceux qu'elle avait sujet de haïr.

NOTES :
1 - Les dates d'arrivée du Siam et du Louvo sont sujettes à caution et il s'agit sans doute d'une erreur d'un mois. L'Abrégé de ce qui s'est passé à Bangkok pendant le siège de 1688 conservé aux Archives Nationales sous la cote Col. C1/24 140r°-171v° indique que Le 12 [septembre], le sieur des Rivières arriva à Bangkok, lequel nous rapporta qu'on nous donnerait d'autres vaisseaux qui étaient le Siam et le Louvo de retour de la mer le 5 du mois. (f° 160v°). Quant à l'Oriflamme, toujours selon l'Abrégé, il arriva le 7 septembre à la barre de Siam. ⇑
2 - Ce navire de 750 tonneaux était parti de Lorient au mois de janvier 1688 sous le commandement de M. de l'Estrille. Outre la cargaison que le navire portait pour le compte du roi, la Compagnie avait joint pour son compte une cargaison de 100 000 livres. ⇑
3 - Outre Louis Laneau et Véret, il devait également y avoir comme otage le chevalier Desfarges, fils cadet du général. On pourra consulter ici le traité de capitulation : Papier de répondance ⇑
4 - Pierre de Saint-Martin était l'un des quatorze jésuites mathématiciens et astronomes envoyés par Louis XIV au roi Naraï. ⇑

21 février 2019
