

Fin du livre IV.
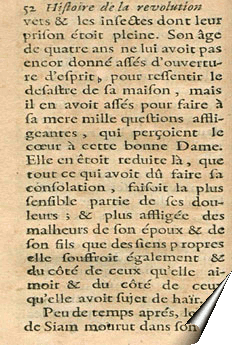
| Mme Constance. |
Peu de temps après, le roi de Siam mourut dans son palais de Louvo, les princes furent massacrés comme nous avons dit, et l'usurpateur alla se faire couronner dans la ville capitale. Mme Constance, avec les autres chrétiens, suivit en captive le triomphe de ses ennemis et se trouva dans les mêmes embarras à Siam qu'elle était à Louvo. Le mandarin à qui elle avait été donnée en esclavage, ne pouvant plus résister aux poursuites de Sorasak et ne voulant point se brouiller avec le jeune homme dont il connaissait l'esprit violent, lui céda enfin la captive. Celui-ci, triomphant de sa conquête, la fit aussitôt transporter dans une petite cabane près du palais, d'où elle voyait avec horreur l'appartement que ce barbare lui faisait élever comme on regarde un affreux tombeau. C'était là qu'elle devait être renfermée pour le reste de ses jours avec une troupe de femmes païennes, sans exercice de la religion, et pour comble de maux elle se voyait à la veille de perdre dans le départ des Français ce qui lui pouvait rester de ressource à Siam, lorsque la providence lui ouvrit une voie de salut en la manière que je vais dire.
Madame sa mère, qui avait été chassée de sa maison et dépouillée de tous ses biens, s'était réfugiée avec ses enfants chez une de ses amies dans le camp des Japonais. L'accablement où elle était la fit tomber malade vers le milieu du mois de septembre. Mme Constance, qui était gardée dans un autre quartier près du palais, demanda la permission d'aller soulager sa mère. Elle l'obtint pour huit jours, et après ces huit jours pour huit autres. Pendant qu'elle rendait les devoirs de piété à sa famille désolée, le sieur de Sainte-Marie arriva à Siam envoyé pour demander de la part de M. le général diverses choses nécessaires à l'armement des vaisseaux. Cet officier, qui avait obligation à feu M. Constance, en fut plus reconnaissant que plusieurs autres qui lui en avaient davantage. Il vint offrir son argent et ses services à Mme Constance. Elle avait entendu parler de lui comme d'un homme brave et entreprenant, ce qui lui fit naître la pensée d'accepter les offres qu'il lui faisait de ses services et de se faire conduire à Bangkok, mais elle ne voulait pas lui en parler avant que d'avoir pris le conseil des jésuites.
Les pères lui représentèrent que l'entreprise était bien hardie pour une femme et que l'exécution en était périlleuse, mais comme elle leur eut répondu qu'elle exposerait mille fois sa vie pour sauver son honneur et assurer le salut de son fils qui courait risque d'être élevé dans une pagode, comme les autres enfants du pays, ils ne crurent pas devoir s'opposer à sa résolution. Ils lui dirent seulement que pour l'exécuter, il fallait attendre que l'armement des vaisseaux fût fait et que les Français fussent sur le point de partir pour ne rien troubler. Ainsi elle laissa retourner Sainte-Marie à Bangkok et lui dit seulement qu'il la vînt encore voir quand il reviendrait à Siam. Mais peu de jours après, le prince impatient de voir Mme Constance enfermée dans le palais, fit hâter le petit appartement qu'on lui préparait pour lui ôter la tentation de s'enfuir avec les Français ou de se faire demander quand ils sortiraient. Il lui envoya une vieille mandarine, cousine de Phetracha son père et amie de Mme Constance, pour la disposer à venir le lendemain au palais.
Cette méchante femme commença par des conjouissances de ce qu'elles auraient à l'avenir le plaisir de vivre ensemble. Elle l'entretint ensuite de la passion que le prince avait de la voir, et lui dit que le lendemain elle la viendrait prendre pour aller ensemble au palais. Mme Constance la conjura, par l'amitié qui était entre elles, de vouloir bien lui faire donner encore deux ou trois jours de délai, parce que sa mère était encore fort mal et qu'elle-même était indisposée. Elle écrivit aussitôt à M. le général une lettre en portugais fort touchante pour lui demander sa protection. Je fus chargé de cette lettre et envoyé à Bangkok auprès de M. Desfarges qui m'avait toujours honoré d'une assez grande confiance. Je trouvai sur le chemin Sainte-Marie qui remontait la rivière avec l'interprète français que l'on a vu à Paris (1). Je n'osai pas parler à l'officier en présence du Siamois, ni encore moins en secret, pour ne lui point donner de soupçon. En arrivant à Bangkok, je rendis la lettre de Mme Constance à M. le général, et sur ce qu'il me dit qu'il n'entendait pas le portugais, je la lui traduisis en français fidèlement. Il fut touché des choses qu'il y vit. Il me dit qu'il voudrait que Mme Constance fût dans sa place, mais qu'il ne pourrait la demander que quand il serait à la barre.
J'écrivis sur le champ à Siam la disposition où j'avais trouvé les esprits à Bangkok, et je conseillais qu'on ne se préparât point encore à écrire sans avoir reçu de nouveaux avis. Mais l'affaire était sans remède. Sainte-Marie n'ayant pu rien obtenir de ce qu'il demandait pour achever d'armer les vaisseaux, il fut obligé de retourner à Bangkok. En passant par le camp des Japonais, qui était sur son chemin, il entra dans la maison où était Mme Constance. Elle crut que Dieu le lui envoyait dans la dernière extrémité, et ne fit plus de difficulté de s'ouvrir à lui de son dessein. Elle le conjura les larmes aux yeux, par la mémoire de M. Constance, de sauver l'honneur à sa femme et la religion à son fils ; que puisqu'il s'était offert si généreusement à la servir, le service qu'elle demandait de lui était de la mener à Bangkok ; que connaissant son courage, elle ne se faisait pas une peine de lui proposer une action aussi hardie ; qu'elle n'aurait pas voulu néanmoins abuser de sa générosité, si elle n'y avait été absolument obligée par la nécessité ou de se sauver dans vingt-quatre heures, ou de se voir pour toujours enfermée dans un infâme sérail.
Sainte-Marie remercia Mme Constance de l'honneur qu'elle lui faisait de lui donner cette occasion de la servir (2), et sans perdre de temps, il rentra dans le balon où d'Anglas, lieutenant d'infanterie, l'attendait avec quelques Anglais qui se réfugiaient à Bangkok. Il descendit la rivière avec eux environ une demi-lieue, puis feignant d'avoir oublié quelque chose, il se fit mettre à terre pour retourner à Siam, en disant aux autres qu'ils poursuivissent leur chemin et qu'il prendrait un autre balon pour les rejoindre. D'Anglas se douta bien du sujet de son retour et lui cria : Sainte-Marie, tu n'auras pas seul la gloire de l'action que tu vas faire, j'en veux être, ne me refuse pas cette amitié ! Sainte-Marie lui nia qu'il eût aucun dessein, et lui fit comprendre qu'il était à propos qu'il ne quittât point les Anglais. Ainsi d'Anglas passa et Sainte-Marie rentra dans la ville où il employa le reste du jour, qui était le troisième d'octobre, à prendre les mesures nécessaires pour le succès de l'entreprise.
| Mme Constance se réfugie à Bangkok. |
Mme Constance fit tenir prêt un petit balon avec deux rameurs affidés. À l'entrée de la nuit, Sainte-Marie se vint présenter bien armée à sa porte et la fit embarquer avec son fils et une femme de chambre. Il y a vingt-cinq lieues de Siam à Bangkok : l'on avait posé plusieurs corps de garde sur le bord de la rivière pour empêcher que personne ne passât sans passeport du barcalon. La bonne dame, parmi les alarmes continuelles et les fatigues de cette pénible fuite, disait que toutes ses peines ne lui étaient pas sensibles quand elle faisait réflexion que ce jour devait être la fin de ses malheurs, et elle pria plusieurs fois Sainte-Marie que s'ils étaient arrêtés, il les jetât elle et son fils dans l'eau plutôt que de les laisser retomber entre les mains des Siamois.
Le petit balon fit si grande diligence qu'il arriva le lendemain à Bangkok sur les cinq heures du soir. Sainte-Marie fit entrer Mme Constance dans un des vaisseaux qu'il armait sous le canon du fort et fut donner avis de son arrivée dans la place. Il y fut reçu avec de grands applaudissements de toute la garnison. On ne savait lequel des deux on devait féliciter davantage, ou la dame de son bonheur, ou le cavalier de son action, de laquelle il n'y avait aucun officier qui ne lui enviât la gloire. Mais M. le général, qui portait ses vues plus loin, en jugea d'une autre manière et crut que cet incident rompait les mesures qu'il avait prises pour tirer les troupes du roi de ce dangereux poste. Cependant M. de Vertesalle, lieutenant de roi, fit les honneurs de la place. Avec la permission de M. le général, il fut prendre Mme Constance dans le vaisseau où elle était et la mena dans sa maison qu'il lui céda pour elle et ses gens d'une manière fort obligeante, allant coucher avec les siens au bivouac.
Le lendemain dès la pointe du jour, l'interprète passa de notre fort dans celui des Siamois pour donner avis au barcalon de la fuite de Mme Constance, et il rapporta que le barcalon prenait cette affaire assez froidement, et qu'il avait dit seulement qu'il en fallait faire une honnêteté au roi de Siam, en lui demandant la liberté de la dame et de son fils. Le même jour, le sieur Véret fut aussi parler au barcalon et s'en alla aussitôt à Siam. Il y fut arrêté prisonnier avec quelques messieurs du séminaire et le père la Breuille, jésuite. Peu de temps après, le lieutenant du barcalon fit venir la mère de Mme Constance dans la salle où étaient les prisonniers et l'obligea d'écrire à Bangkok pour demander sa fille, parce que sa famille et toute la chrétienté allaient être persécutées si l'on s'obstinait à la garder.
| On délibère à Bangkok si on renverra Mme Constance. |
Sur cet avis, M. le général convoqua le neuvième d'octobre son conseil de guerre et parla aux officiers en ces termes : Messieurs, je vous ai assemblés à l'occasion de Mme Constance qui s'est réfugiée parmi nous. Je voudrais bien la sauver, mais je suis obligé de vous représenter ce que l'on me fait craindre, qui si l'on ne rend cette dame, sa famille va être mise aux fers, que la faiturieFaiturie, ou factorie : bureau où les facteurs, les commissionnaires, faisaient commerce pour le compte d'une Compagnie. L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert précise également : On appelle ainsi dans les Indes orientales et autres pays de l'Asie où trafiquent les Européens, les endroits où ils entretiennent des facteurs ou commis, soit pour l'achat des marchandises d'Asie, soit pour la vente ou l'échange de celles qu'on y porte d'Europe. La factorie tient le milieu entre la loge et le comptoir ; elle est moins importante que celui-ci et plus considérable que l'autre. française sera pillée, le séminaire ruiné, toute la chrétienté persécutée, et que pour nous-mêmes, il faut nous résoudre à voir renouveler la guerre. Qu'il jugeait qu'il était plus convenable qu'une personne fût sacrifiée à toute la chrétienté que si toute la chrétienté était sacrifiée à une seule personne. Il parut au conseil que ce raisonnement était appuyé sur un principe incertain, à savoir que les Siamois dussent, pour une femme et un enfant dépouillé, rompre le traité d'accommodement, après avoir mis trois vaisseaux entre les mains des Français, outre l'Oriflamme qui était à la barre. C'est pourquoi tous les officiers, à la réserve de deux, opinèrent par écrit qu'on ne pourrait rendre aux infidèles Mme Constance et son fils qui étaient sous le pavillon de France et qui avaient imploré le nom et la protection du roi (3).
Ces délibérations jetaient la dame réfugiée dans des frayeurs mortelles. Elle pleurait inconsolablement, et toutes les assurances que lui donnaient les officiers qu'elle était dans un asile inviolable ne pouvaient lui ôter les pressentiments secrets qu'elle avait de ses malheurs. Ses alarmes redoublèrent encore quand elle vit Sainte-Marie son libérateur transporté de son vaisseau dans le fort, où il fut gardé à vue par un soldat l'épée à la main, avec défense de le laisser parler à personne excepté au lieutenant de roi et au major de la place.
Le 14 du même mois, on rassembla le conseil de guerre sur le même sujet. On y proposa les mêmes raisons, et les sentiments des capitaines furent aussi les mêmes. La fermeté des officiers français n'ayant pu être ébranlée par la crainte, on crut qu'il serait plus facile de surprendre la jeune dame par des propositions qui l'engageraient du côté de la conscience à consentir à son retour. Monsieur N. fut chargé de cette commission et s'en acquitta de la manière que j'ai entendu raconter à Mme Constance et que je vais rapporter fidèlement (4) : Il alla chez elle, et après lui avoir fait valoir les droites intentions de M. le général pour la cause commune du christianisme, il lui dit qu'elle devait entrer dans les mêmes sentiments et sacrifier la satisfaction d'aller en France au repos de toute la chrétienté.
— Ce n'est pas le désir d'aller en France, répondit Mme Constance, qui m'a fait chercher cet asile. Qu'on me mette à Macao ou à Goa, tout m'est indifférent. Je n'ai fui que par la nécessité où j'étais de sauver à moi-même l'honneur et la religion à mon fils au péril de nos vies. — Cette résolution, Madame, reprit l'envoyé, a été un effet de votre grand courage. Mais si à présent les affaires s'accommodaient de telle sorte que vous puissiez demeurer dans ce royaume en toute sûreté pour votre honneur et en toute liberté pour les exercices de votre religion, ne vous croiriez-vous pas obligée de ne pas exposer la chrétienté, la Compagnie française, le séminaire, les pères jésuites, votre famille et les troupes de cette place à une perte inévitable ? La dame l'interrompit et lui dit avec beaucoup de fermeté : Ne prétendez pas, Monsieur, m'éblouir par ces grands noms. Le roi de Siam ne veut persécuter personne à mon occasion, car premièrement, de quelle chrétienté, Monsieur voulez-vous parler ? Est-ce des Siamois ? Il n'y en a pas un seul de chrétien dans tout le royaume. Est-ce des Portugais ? ou des Pégouans ? ne sait-on pas que ces peuples sont nos ennemis et se sont offerts pour venir prendre Bangkok ? Pourquoi les persécuterait-on à mon occasion ? Pour ce qui regarde ma famille, elle a consenti à ma retraite et n'espère de secours que de moi et de mon fils, si nous pouvons sortir du royaume ; d'ailleurs, je suis maîtresse de mes actions, et ne je suis pas obligée de sacrifier mon honneur et mon salut à la satisfaction de personne, comme je suis sûre aussi que mes parents mourraient volontiers pour une si bonne cause. De plus, les affaires du roi très chrétien ni de tous les Français n'en souffriront rien. Le roi de Siam redoute trop la puissance du roi pour renouveler la guerre à l'occasion d'une femme qu'il a rendue malheureuse, et enfin, Monsieur, poursuivit-elle, quelle assurance pourriez-vous me donner qu'après le départ des troupes du roi, je serais à couvert des insultes du jeune barbare ? — Madame, reprit-il froidement, il y a plusieurs expédients pour cela : celui qui me paraît le meilleur serait de vous remarier, avant le départ des Français, avec un Portugais que Madame votre mère vous a choisi à Siam. Les Siamois ont du respect pour le mariage, et l'on insèrerait dans le traité, pour un article particulier, que vous demeureriez sous la protection de l'évêque et du séminaire.
La pauvre dame fut si frappée de ce discours, qu'elle baissa les yeux de confusion et n'y pu répondre sur le champ. Mais un moment après, regardant d'un œil larmoyant celui qui lui parlait : Est-ce Monsieur N. qui me tient ce discours ? Et ne pouvez-vous me le tenir sans en être touché comme moi ? Quoi, Monsieur, je ne sais pas encore bien si M. Constance est mort ; mes autres afflictions ne m'ont pas encore laissé la liberté de pleurer sa perte, et vous voulez que j'aille mendier moi-même un autre mari ? Vous dites que les Siamois respectent les liens du mariage. Le jeune prince les a-t-il respectés dans la personne de tant de femmes chrétiennes qu'il a fait enlever à leurs maris ? Vous avouez que M. l'évêque me prendra sous sa protection, et M. l'évêque a-t-il eu le crédit de sauver son séminaire du pillage, et sa propre personne des insultes de ces barbares ? Si quelque protection pouvait mettre fin à mes malheurs, ce devrait être celle du grand roi dont j'ai les assurances dans deux lettres signées de sa main royale ; et puisque celle-là m'est inutile, je n'en attends plus que de Dieu. Au reste, Monsieur, vous pouvez dire à M. le général que je ne consentirai jamais à ce qu'on me propose. Je le supplie d'avoir compassion de nous. Si les Siamois craignent encore une femme et un enfant, qu'on les laisse entrer, qu'ils nous viennent égorger. La vie ne doit pas être si chère dans l'état où l'on m'a réduite, que je la doive regretter. Mais rien ne m'obligera d'exposer mon honneur à un danger que personne ne connaît mieux de moi.
L'envoyé fut attendri du courage et de la misère de cette femme. Il prit congé d'elle en l'exhortant à avoir confiance en Dieu, et le même soir m'ayant rencontré sur le rempart, il me dit qu'il avait un extrême regret d'avoir affligé cette pauvre dame, et qu'il ne prendrait plus de ces sortes de commissions. Il fit rapport du succès qu'il avait eu dans celle-ci à celui qui la lui avait donnée. On fut surpris de la fermeté que témoignait Mme Constance ; on jugea qu'elle lui était inspirée par quelqu'un de ceux qui la voyaient, et sur le champ on posa une sentinelle à sa porte pour n'y laisser entrer que des gens qui n'étaient pas suspects. Le premier qui fut mis en cette faction fut un officier. Il entrouvrit la porte pour faire son compliment à la dame, mais l'ayant vue à genoux fondant en larmes devant son crucifix, il n'osa pas la détourner et attendit qu'elle eût achevé sa prière pour lui déclarer l'ordre qu'il avait de demeurer à sa porte pour la garder contre les entreprises des Siamois. Elle comprit bien ce que l'honnêteté de l'officier lui voulait dissimuler, et s'y soumit avec beaucoup de douceur. Deux jours après elle reçut avec la même égalité d'esprit un autre ordre de passer de la maison où elle était dans le petit fort qui est à l'entrée de la place, et peu à peu elle se disposait à en recevoir un dernier de sortir entièrement, car elle ne voyait que trop que tout allait là, pour terminer sa tragique histoire.
Avant que d'en venir à cette extrémité, M. le général voulut faire une dernière tentative pour sauver cette vertueuse dame. Il fit offrir, comme je lui ai entendu dire à lui-même, un présent fort considérable au barcalon, s'il voulait trouver une voie d'accommodement. Le barcalon s'offensa de l'offre et répondit que tout ce qu'il pouvait faire pour le service du général et de la dame réfugiée chez lui, était d'écrire au roi des lettres auxquelles M. Desfarges pourrait joindre les siennes, pour lui demander sa dernière volonté sur cet article qui arrêtait l'exécution du traité. Ils écrivirent. Les lettres furent portées à la cour. Je n'ai point su ce qu'elles contenaient ni quelle réponse on y fit, et pour ne dire que ce que j'ai vu, trois jours après (le 19 octobre), le vieux mandarin que l'on a vu en France se présenta à la porte du fort avec un balon, il fit dire qu'il était là.
| On remet Mme Constance entre les mains des Siamois. |
On envoya un officier avec quatre sergents à Mme Constance pour lui dire le plus doucement qu'il se pourrait qu'on était au désespoir d'être obligé de la remettre entre les mains des Siamois, et qu'il y avait un mandarin qui la demandait à l'heure même pour la reconduire à Siam. Quoique Mme Constance eût donné à manger durant six mois chez elle à cet officier (5), et qu'elle ne dût pas attendre de lui un semblable compliment, elle le reçut avec une tranquillité qu'on ne devait pas espérer d'une femme en une pareille rencontre. Elle lui dit seulement : Monsieur, il n'était pas nécessaire d'amener des soldats pour m'enlever. — Madame, ce ne sont point des soldats, répondit l'officier, ce sont quatre sergents. Mme Constance ne répliqua rien à cela et ne demanda plus autre chose que de voir son confesseur. Tandis qu'on le cherchait, elle fit aussi avertir l'intendant qu'elle souhaitait de lui parler. Quand ce dernier fut venu, elle protesta devant lui de la violence qu'on lui faisait en la privant de la protection des armes du roi. Elle dit qu'elle s'était vue obligée avant que de sortir de la place de déclarer juridiquement qu'elle était venue de son propre mouvement sur l'invitation que lui en avait fait M. le général quelques mois auparavant, et par l'estime qu'on lui avait donnée des Français, sous le pavillon desquels elle avait entendu dire que tous les chrétiens persécutés trouvaient un asile contre les infidèles ; qu'elle avait cru que la veuve et le fils d'un homme qui venait d'être sacrifié pour les intérêts de la religion et pour ceux de la France seraient reçus comme les autres sous ce pavillon si fameux dans tout l'univers ; que Dieu lui était témoin qu'elle ne faisait point cette déclaration pour demander vengeance contre personne de la violence qu'on lui faisait ; qu'elle abandonnait tout au soin de la providence. Elle s'adressa ensuite à quelques officiers qui étaient présents et les remercia des bonnes volontés qu'on avait eues pour elle dans la place. Puis se tournant vers le supérieur des jésuites et quelques autres pères qui étaient là, elle leur dit : Adieu, mes père, tout le monde a abandonné M. Constance dans sa disgrâce, vous avez seuls été sensibles aux afflictions de sa famille désolée. Dieu sera votre récompense. Je vous prie de ne me pas refuser le secours de vos prières dans les malheurs où vous me voyez rangée. Le mandarin en même temps se présenta à la porte du donjon pour la prendre, et la conduisit dans le balon avec un prêtre du séminaire qui eut la charité de l'accompagner jusqu'à Siam.
Je laisse à penser combien de tristes réflexions elle fit sur sa destinée pendant cet affreux voyage, et combien de fois elle se demanda à elle-même s'il y avait jamais eu dans quelque contrée du monde femme dont les malheurs fussent comparables aux siens. Épouse d'un premier ministre d'État, élevée à la plus haute fortune, dans l'éclat, l'abondance et le joie, et tout à coup dépouillée de ses biens, chassée de sa maison, enfermée dans une écurie, réduite à l'aumône, ayant vu massacrer son mari, aimée de son propre tyran, fugitive parmi mille dangers pour mettre son honneur et sa religion à couvert, et enfin livrée entre les mains de ses persécuteurs et à l'âge de vingt-deux ans, c'est-à-dire encore exposée à une longue suite de maux plus fâcheux que la mort même. Toute la garnison plaignait comme elle son malheur. Elle fut quelque temps le sujet des entretiens après quoi, comme il arrive dans le monde de toutes les choses qui ne frappent plus les yeux, on n'en parla plus et l'on ne pensa qu'à travailler à l'armement des vaisseaux sur lesquels on devait sortir du royaume.
| Les Français se préparent à sortir du royaume de Siam. |
Les Siamois avaient publié que quand on rendrait Mme Constance, ils nous fourniraient des câbles, des ancres et des vivres en abondance pour le voyage, mais ils ne furent pas de si bonne foi que nous. On ne put tirer d'eux qu'un équipage de matelots mores, et le sieur Le Brun, trésorier, étant allé à Siam pour sommer les officiers du roi de leur parole, il trouva que bien loin de rien donner aux Français, il y avait même une défense de leur rien vendre. On lui fit mille insultes et il fut obligé de retourner à Bangkok les mains vides, ne rapportant que la confusion des railleries que les infidèles faisaient de nos Français. On ne laissait pas cependant d'armer les vaisseaux, et cet armement se faisait en bon ordre. On équipait tellement les vaisseaux qu'on ne dégarnissait point la place. Tout se faisait peu à peu avec beaucoup de précaution. On partageait également les vivres et les munitions de guerre dans la place et dans les vaisseaux, de sorte que de quel côté qu'on eût été obligé de se retirer, on eût de quoi subsister et de quoi se défendre.
Pendant le jour, les Siamois en grand nombre venaient aider les nôtres à embarquer leurs gros canons, et les nôtres pendant la nuit remplaçaient ces postes vides avec les canons du roi de Siam qu'on leur devait laisser dans la place, de sorte que tous les matins les Siamois trouvaient avec étonnement les batteries presque également fournies, quoiqu'ils en enlevassent continuellement du canon. Il n'y eut que la grosse batterie de six pièces de trente-six livres que l'on laissa, pour tenir les ennemis en respect jusqu'au dernier jour de l'embarquement, qui fut le second de novembre, précisément après un an révolu depuis notre réception dans le royaume. On donna et on reçut des otages de part et d'autre pour la sûreté du départ.
Sur les cinq heures du soir, on sortit de la forteresse en bon ordre, tambour battant, mèche allumée, enseignes déployées, et l'on s'embarqua sur une frégate de trente-six pièces de canon et sur deux autres plus petites qui devaient être suivies de cinq ou six bateaux chargés de la grosse artillerie et des munitions de bouche, pour laisser les vaisseaux plus dégagés pour le combat si l'on était attaqué. L'ordre était donné pour faire marcher ces bateaux jusqu'à la mer entre les frégates qui devaient les soutenir. On leva l'ancre à l'entrée de la nuit, au retour de la marée, et l'on fut une grosse heure à se tirer hors de la portée du canon des ennemis, qui de leur fort nous auraient pu couler bas s'ils avaient eu de meilleurs canonniers, ou plus mauvaise volonté.
L'ordre qu'on avait établi pour la descente de la rivière fut troublé pendant la nuit, par je ne sais quelle défiance que l'on prit les uns des autres. Nos otages s'échappèrent des mains des Siamois, disant qu'on avait voulu les arrêter contre la foi donnée, et les Siamois disaient au contraire que c'étaient nos otages qui avaient fait les premiers mouvements pour s'enfuir (6). Mais puisque la chose s'est passée dans les ténèbres, ne cherchons point à l'éclaircir. Quoi qu'il en soit nos otages s'enfuirent et montèrent sur le vaisseau de M. Desfarges vers la minuit.
Le vieux mandarin qui était chargé de faire sortir les Français en paix vint faire des plaintes de ce que nos gens s'étaient échappés, et que les leurs étaient encore entre nos mains. On l'amusa et on le retint encore lui-même sur la frégate. On ne rencontra ni troupes ni bâtiments sur la rivière et l'on passa fort tranquillement entre deux ou trois fortins de terre que les ennemis avaient construits pendant la guerre, et qui paraissaient alors abandonnés. Le lendemain à sept heures du matin les frégates rejoignirent les bateaux de munitions, mais par malheur, dans l'embarras où l'on était, on poussa toujours et l'on se contenta de leur ordonner de suivre. On ne les eut pas plutôt abandonnés que le barcalon, qui avait eu avis de la fuite de nos otages, fit arrêter six ou sept de ces bateaux chargés de trente-neuf pièces de gros canon de fer et de six mille livres de viande fraîchement salée, et des habits pour les troupes, avec deux officiers et neufs soldats et un autre mirou rempli de malades que le père de Thionville n'abandonna point.
En arrivant à la barre, un des vaisseaux nommé le Siam toucha et demeura dans la vase. M. de vertesalle eut ordre de venir mouiller auprès de lui jusqu'au retour de la marée pour le défendre en cas qu'il fût attaqué des galères que l'on appréhendait. Le barcalon envoya faire des plaintes au général de ce qu'on emmenait les otages des deux côtés contre la parole donnée, et M. le général se plaignit de son côté de ce qu'on avait arrêté M. l'évêque, le canon du roi, les bagages et les malades. Le barcalon demanda qu'on lui envoyât les otages et qu'il enverrait tout ce qu'on désirerait. Le général voulait que la barcalon fît les premières avances. Enfin l'on convint que le plus considérables des otages siamois serait renvoyé le premier au barcalon, et que le même balon qui l'aurait porté rapporterait M. l'évêque à l'Oriflamme d'où l'on renverrait ensuite les deux mandarins, après quoi l'on rendrait les bateaux.
Le général renvoya donc l'Okya à la sollicitation de M. l'évêque de Métellopolis, qui souhaitait de se tirer des mains des infidèles. Mais au lieu de ce prélat qu'on avait promis, le barcalon ne renvoya que le père Thionville avec ses malades, disant que M. l'évêque devait demeurer dans le royaume avec Véret, étant l'un et l'autre garants du traité, et que quand le dernier serait venu, il rendrait ce qui appartenait aux Français. Les frégates s'étaient cependant mises à flot et furent mouiller auprès de l'Oriflamme, regardant pendant deux jours si les Siamois ne prendraient pas de meilleurs conseils.
Il nous venait de temps en temps de bons mouvements de rentrer dans la rivière et d'aller mettre le royaume en cendres, mais cela ne durait pas. Enfin, après avoir bien juré, bien menacé, on leva l'ancre et l'on alla faire de l'eau aux îles du cap de Siam, qui est à quatre ou cinq lieues de la barre de Siam. On demeura là jusqu'au dixième du mois, qui était le terme qu'on avait donné au barcalon pour prendre sa dernière résolution. Le onzième, jour de saint Martin, le père de Saint Martin mourut de maladie et fut enterré dans une île à laquelle on donna le nom de saint Martin (7). C'était un fervent missionnaire, et ce n'est pas sans une providence particulière qu'étant destiné pour aller faire la mission dans le royaume de Cambodge, et étant déjà prêt à partir, quand les troubles de Siam arrivèrent, Dieu l'arrêta six mois après la vue des côtes de ce royaume comme saint François Xavier dans l'île de Sancian à la vue de la Chine.
Le 3 (8), comme l'on vit que le barcalon se mettait peu en peine des deux mandarins que nous tenions, qu'il n'envoyait faire aucune proposition et que cependant on consumait inutilement le peu de vivres qui restait, on leva l'ancre. Mais comme la mousson n'était pas encore venue pour gagner la côte de Coromandel, nous fûmes longtemps errants sur les mers des Indes, ce qui nous donna lieu de reconnaître ces pays et de nous détromper par nous-mêmes des idées fausses que nous en avions prises dans diverses relations peu exactes qui ont paru dans le monde. Si nous n'avons pas été plus heureux dans nos découvertes, essayons d'être plus fidèles et plus sincères dans le rapport que nous en allons faire.

NOTES :
1 - Cet interprète se nommait François Pinheiro. Dans le premier article du Voyage des ambassadeurs de Siam en France publié par le Mercure Galant en 1686, Donneau de Visée mentionne l’interprète des ambassadeurs qui est né à Siam, et fils d’un portugais qui s’y est habitué. ⇑
2 - S'il faut en croire Beauchamp, l'esprit chevaleresque ne fut pas la seule motivation de l'action de Sainte-Marie. En effet, il s'était rendu coupable de désobéissance, ce qui avait entraîné la perte de son bateau, et il avait tout à redouter des foudres du général à son retour en France. Les jésuites lui firent miroiter qu'un acte héroïque en faveur de Mme Constance pourrait lui faire obtenir sa grâce. Et Beauchamp conclut : M. Desfarges m'ordonna de faire prendre sur le champ Sainte-Marie par quatre mousquetaires et de le faire mettre en prison, de l'interroger et de lui demander pourquoi il n'avait pas exécuté les ordres qu'il lui avait donnés pour le service du roi, et qui lui avait fait emmener Mme Constance sans l'en avertir ? Il me répondit que les pères jésuites étaient la cause de tout ; qu'ils lui avaient tant promis de choses, et l'avaient si fort pressé qu'il n'avait pu s'empêcher de leur obéir. (Manuscrit B.N. Fr 8210, f° 552r°). ⇑
3 - Les témoignages divergent quant à la date exacte de cette consultation et quant à ses résultats. Comme le père Le Blanc, Saint-Vandrille indique le chiffre de 2 voix en faveur du renvoi de Mme Constance, sans donner de nom. Une relation anonyme conservée aux Archives Nationales de Paris, intitulée Relation de ce qui s'est passé à Louvo [...], indique la date du 7 octobre et donne un résultat de 2 voix, celle de Desfarges et celle de la Roche du Vigeay. Le père d'Orléans, s'appuyant sur des témoignages de jésuites, indique également 2 voix et nomme les deux fils Desfarges. Beauchamp qui, comme le père Le Blanc, place la réunion du Conseil le 9 octobre et qui affirme vertueusement qu'il aurait préféré périr que de rendre Mme Constance, indique 5 votes en faveur du renvoi, et cite les noms des deux fils Desfarges, de M. de la Roche Vigeay et de Vollant des Verquains. Ce nouveau petit coup bas n'est pas forcément crédible, l'inimitié étant grande entre l'ingénieur et le major de Bangkok. Quant à François Martin, qui n'était pas présent et s'appuyait sur on ne sait quels témoignages, il parle comme Beauchamp de quatre avis contraires, et cite les deux fils Desfarges, un officier qui touchait le général d'une alliance de loin, (sans doute la Roche du Vigeay) et un autre qu'il avait attaché à son parti (et qui pourrait bien être Beauchamp). ⇑
4 - Ce mystérieux M. N., jamais nommément cité, apparaît dans l'Histoire de M. Constance du père d'Orléans sous la périphrase : une personne d'un caractère à donner beaucoup de force à l'éloquence. (p.179). Beauchamp, moins diplomate, donne des noms : MM. de Métellopolis et de Lionne, à l'occasion de cette lettre, allèrent voir Mme Constance pour lui dire qu'elle devait se résoudre à s'en retourner pour le salut des chrétiens et de sa propre mère, que Phetracha, qui était sur le trône, avait promis à M. le général qu'elle aurait toute liberté, qu'elle pourrait se remarier à qui elle jugerait à propos, en cas qu'elle en eût le désir, et qu'on ne lui ferait jamais aucun mauvais traitement ; (Manuscrit B.N. Fr 8210, f° 555v°). La suite du texte du père Le Blanc laisse entendre que le messager était l'abbé de Lionne seul, délégué par le très courageux Louis Laneau, et qui se promit, mais un peu tard, qu'il ne prendrait plus de ces sortes de commissions, d'autant que ce n'était pas la première fois qu'il était mis dans une situation difficile. (On se rappelle que lorsque Phetracha convoqua Louis Laneau à Louvo, M. de Métellopolis qui jugeait autrement de ces nouveautés, prétexta une indisposition pour ne point aller à Louvo. On y appela M. l'abbé de Lionne, nommé évêque de Rosalie. L'affaire de Mme Constance ayant suscité beaucoup d'indignation en France, l'abbé de Lionne rédigea en 1692 un texte de justification qu'on pourra lire ici : Mémoire sur l'affaire de Mme Constance Phaulkon. ⇑
5 - Il s'agissait de Beauchamp, accompagné du missionnaire Pierre Ferreux. ⇑
6 - Le traité de capitulation prévoyait que trois otages resteraient au Siam en garantie des deux frégates prêtées aux Français pour embarquer les troupes. Étaient désignés l'évêque de Métellopolis, Louis Laneau, Véret, le chef du comptoir de la Compagnie, et le chevalier Desfarges, fils cadet du général. Dans la confusion du départ, Véret et le fils Desfarges s'embarquèrent subrepticement à bord de l'Oriflamme, ce qui provoqua la fureur des Siamois, qui passèrent leur colère sur le malheureux Louis Laneau. ⇑
7 - Dans sa relation rédigée à Middelbourg, Saint-Vandrille écrit : En partant de la rade se Siam, nous fûmes à l’île Saint Martin pour faire de l’eau ; n’en trouvant point, nous fûmes à une autre île, où tous les vaisseaux en firent, et de là nous passâmes par Pulo Pollaou (A.N. C1/25 f° 177r°). Il pouvait s'agir de Ko Sichang (เกาะสีชัง), au large de Si Racha, sur laquelle l’eau est effectivement très rare. ⇑
8 - Plus probablement le 13. ⇑

21 février 2019
