

Fin du livre VII.
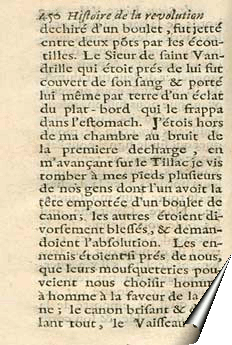
Le canon brisant et désolant tout, le vaisseau était une image affreuse d'une maison qu'on démolit. On tirait sur nous de cinq vaisseaux, dont l'un nous prenait de biais par la poupe et le reste par les flancs. Les boulets faisaient voler les éclats de toute part, et les éclats n'étaient pas moins dangereux que les boulets. Le grand mât et celui d'artimon furent à moitié brisés. Il est difficile de voir un plus grand feu contre un seul vaisseau, mais il ne dura pas. L'équipage perdit cœur à la mort du capitaine. Les canonniers se troublèrent et la plus grande partie des matelots s'enfuirent à fond de cale. Nous nous trouvâmes seuls sur le tillac, le lieutenant et moi : lui pour nous donner ses ordres, qu'on écoutait mal, moi pour assister les blessés. Je me souvins alors du père Colusson, mon compagnon, qui était encore malade, et je crus qu'il pourrait avoir besoin de mon secours. Je traversai presque tout le vaisseau à découvert et essuyai dans ce passage une bordée avec une décharge de mousqueterie, dont Dieu me préserva encore par sa bonté. J'entrai dans la chambre que je trouvai toute désolée. Le canon l'avait percée de part en part. Je crus le père tué, mais m'étant approché de son lit, je ne le trouvai point : il s'était retiré. Il y avait sur la table brisée deux paquets de diamants que notre capitaine, avant que de mourir, avait fait attacher à des boulets pour les jeter en mer, quand tout serait sans ressource, mais personne n'y pensait plus. Ils étaient abandonnés au pillage des ennemis. Je ne fus nullement tenté de les ouvrir, ne pensant alors qu'à la mort que je pouvais trouver à chaque pas que je faisais.
Pour me fortifier contre la crainte, je tâchais de faire mon devoir de missionnaire, et cette pensée que je serais tué en exposant ma vie pour le salut des âmes me soutenait et me donnait de la joie parmi les dangers, tant la bonté de Dieu est admirable de changer notre faiblesse en force et nos craintes en consolations, dans le peu qu'on fait pour son service. En sortant de la grande chambre, je trouvai l'aumônier du vaisseau. Je me mis à genoux pour recevoir l'absolution de mes péchés et la lui donnai pareillement des siens. Je remontai ensuite sur le pont, où le désordre était encore plus grand que quand j'en étais descendu. Je représentai alors à notre lieutenant qu'il ne fallait pas se laisser massacrer à plaisir, et que puisqu'il ne se défendait plus, il fallait se rendre. Nous demandâmes quartier, mais quoique les ennemis nous entendissent fort bien, ils ne laissèrent pas de faire encore sur nous quelques décharges, ce qui nous faisait croire qu'on ne voulait pas nous faire de quartier, pour nous punir de la témérité que nous avions eue de nous défendre sans espérance. Mais en même temps nous vîmes les chaloupes des vaisseaux hollandais se remplir de gens armés pour nous venir aborder.
J'entrai dans ma chambre pour jeter quelques papiers en mer. Je pris mon crucifix, mon chapelet et le livre du Nouveau Testament, et sans avoir envie de sauver autre chose, je sortis et me présentai sur le pont, en attendant les ennemis et me recommandant à Dieu. Ils montèrent, le sabre d'une main et le pistolet de l'autre, en criant Tuë tuë : plusieurs ne savaient que ce mot de français. Ils furent surpris de ne trouver qu'un homme à robe noire sur le pont. J'allai à eux les bras ouverts, et leur dis en portugais : Messieurs, nous avons mis bas les armes. Prenez tout et ne faites mal à personne. Le soldat, dans la première ardeur du pillage, brisait, frappait, menaçait tout le monde pour avoir de l'argent. Personne ne mit la main sur moi ni ne me demanda rien. Un officier matelot qui parlait français me dit fort honnêtement de m'embarquer dans une chaloupe qu'il me montra ; parce que quand leurs gens auraient bu, ajouta-t-il, je ne serai pas en sûreté. Je ne crus pas néanmoins devoir abandonner les autres pour me sauver le premier. Je fis embarquer avant moi tous les blessés et me mis avec eux pour les conduire, craignant que quelques-uns ne perdissent les forces et la vie en chemin. Les autres furent embarqués dans diverses chaloupes et nous fûmes tous transportés à terre, où l'on nous dit que les Cafres de la côte, qui s'étaient éveillés au bruit du combat, avaient demandé la permission de nous massacrer.
La chaloupe qui nous portait nous rendit au bout du pont qui s'avance dans la mer près de la forteresse. Nous le traversâmes en passant un à un devant tout le monde qui était accouru pour nous voir. Ce fut pour eux un spectacle fort agréable qu'un jésuite prisonnier de guerre. Ils m'honorèrent de plusieurs injures, et dirent qu'il fallait me jeter en mer. Il s'en fallut peu qu'il ne le fissent comme ils le disaient, car le passage qu'ils me firent le long du pont était si étroit que je me suis souvent étonné comment je passai sans tomber. Nous fûmes tous conduits en prison dans l'hôpital du bourg, à la réserve de mon compagnon qui suivit un officier hollandais et fut mis dans la forteresse auprès des autres prisonniers français. Il leur dit qu'il croyait que j'avais été tué de la dernière décharge. Plusieurs de ces messieurs eurent la bonté de se mettre à genoux, et de prier Dieu qu'il me fît miséricorde.
Je faisais cependant panser nos blessés dans la prison. Le lieu était si étroit pour le grand nombre que nous étions qu'il fallut nous tenir debout le reste de la nuit, tout fatigués, afin de laisser un espace libre aux blessés pour prendre un peu de repos à terre. À peine pouvait-on respirer l'air étouffé où nous fûmes jusqu'au jour, la porte et les fenêtres fermées. À la pointe du jour, il entra dans la prison un jeune homme, qui perçant la foule, vint à moi et me mit un pain entre les mains, sans me rien dire ni me donner le loisir de lui demander à qui j'étais obligé de cette charité. Il se retira sans que j'aie pu le revoir pendant deux mois de séjour que nous fîmes au cap. C'était apparemment quelque catholique qui n'osait pas paraître ce qu'il était. Je partageai ce pain avec ceux qui en avaient le plus grand besoin, et peu de temps après, une bonne dame hollandaise vint aussi nous voir par charité ou par curiosité. Elle fut si touchée de la vue de tant de malheureux qu'elle leva les mains et les yeux au ciel, et se retira sans nous rien dire ; mais étant retournée chez elle, elle m'envoya une assiette chargée de viande par le sergent de garde, qui me dit en me la donnant, que cette viande était pour moi seul, et qu'il en apporterait encore pour les autres. Je le remerciai et lui dis que je ne pouvais pas en manger ce jour-là, c'était un vendredi fête de Jean Porte latine (1). En sa présence, je la distribuai aux blessés en louant en moi-même la providence paternelle de Dieu qui me faisait trouver des secours plus particuliers que les autres dans un lieu où j'avais moins sujet d'en attendre que personne.
| Traitements aux prisonniers français. |
Le commandant hollandais fut dès le matin dans la chambre des officiers de la Normande et leur apprit les tristes circonstances de notre prise. Et comme ces messieurs lui demandèrent s'il était vrai que j'eusse été tué, il leur dit qu'il n'en savait encore rien, mais qu'il allait à bord du Coche, et qu'il s'informerait de ce que j'étais devenu. Il prit la peine en retournant d'y passer, et m'envoya prendre par l'officier avec le lieutenant et l'aumônier de notre vaisseau. C'était le même commandant qui l'était il y a trois ans, quand nous passâmes au cap en allant aux Indes. Il s'appelle M. Simon Vanderstel (2). J'avais eu l'honneur de le saluer chez lui, et je lui avais fait présent d'un microscope. Il me reconnut et me fit fort bon accueil. Je lui fis mon compliment en portugais, et lui dis que dans l'accident dont Dieu nous avait affligés, c'était une grande consolation pour nous d'être entre les mains de sa seigneurie ; à quoi il me répondit qu'il était fâché que le malheur fût tombé sur nous, mais que nous pouvions être sûrs qu'il n'oublierait rien pour nous le rendre supportable, et nous marquer par-là son affection et l'estime qu'il avait pour le révérend père de La Chaize (3). Il nous dit ensuite qu'il avait beaucoup regretté le sieur d'Armagnan, notre capitaine, mais il a été lui-même, ajouta-t-il, la cause de sa mort. Car à quoi pensait-il de se vouloir défendre seul contre tant de vaisseaux ? Je lui répondis qu'on ne pouvait blâmer un capitaine de se mettre en défense dans une pareille occasion, ne sachant pas encore de quoi il s'agissait ; mais que nous attendions qu'on viendrait nous sommer avant que de nous attaquer. Je l'avais aussi ordonné de la sorte, répliqua-t-il. On y devait aller à la pointe du jour, mais quand on vous a vu ouvrir vos batteries, on a été obligé de vous prévenir pour vous empêcher d'incommoder nos vaisseaux.
Ces premiers entretiens nous conduisirent jusqu'à la forteresse, où étant entrés, le gouverneur nous mena dans la chambre des officiers de la Normande, et leur dit en me présentant : Voilà le père pour lequel vous craigniez ; mais ce que Dieu garde, ajouta-t-il, est bien gardé. Nous demeurâmes près de deux mois prisonniers dans l'appartement du gouverneur avec un corps de garde à notre porte. Il nous faisait servir à manger comme on servait à sa table, ou si on ne le faisait pas, ce n'était pas faute qu'on ne donnât de bons ordres. Il nous laissait aller chaque jour quatre ensemble à la promenade avec six mousquetaires et un sergent qui nous suivaient partout où nous voulions aller.
Le jardin de la Compagnie hollandaise est d'une beauté et d'une étendue extraordinaire, rempli de toutes sortes de plantes, de fleurs et de fruits choisis des quatre parties du monde. Mais nous n'étions pas d'humeur à goûter ces plaisirs. Nous ne respirions que pour le départ de la flotte des Indes qui était arrivée après nous, et qui devait nous passer en Europe. Notre plus agréable promenade était sur le bord de la mer, pour aller voir si l'on appareillait ces vaisseaux qui devaient nous servir de prison durant quatre mois. Nous nous consolions encore plus solidement par nos exercices de piété, que nous continuâmes autant que nous le pouvions. On faisait les prières ordinaires, et on récitait tous les jours le chapelet, et les jours de fêtes, on faisait le matin à haute voix la méditation. Le reste du jour se passait assez agréablement à lire, à prier, à étudier selon les inclinations différentes de chacun. C'était une chose assez plaisante de voir nos Français jouer pendant une partie du jour sur une table, avec les clés qui leur étaient restées seules de tous leurs biens, sans que le souvenir des coffres qu'ils avaient perdus vînt troubler leur divertissement.
En attendant le temps favorable de remettre à la voile, le commandant nous vint dire un jour qu'il nous disperserait avec nos matelots sur quatre vaisseaux pour retourner en Europe, et nous laissa la liberté de choisir entre la compagnie de ceux avec lesquels il nous serait plus agréable de faire le voyage. Comme nous étions quatre prêtres, je crus que cette disposition venait d'une providence particulière de Dieu qui voulait par-là que chacune des quatre troupes eût un de nous pour assister les malades. Je proposai la chose au père Colusson et aux deux aumôniers, en leur représentant que nous ne pouvions rien faire de plus agréable à Dieu que de lui sacrifier la satisfaction que nous avions d'être ensemble et de nous priver nous-mêmes des secours spirituels, pour en donner à nos frères ; que par-là, nous exécuterions à la lettre le devoir d'un bon pasteur, qui expose son âme pour son troupeau, mais que nous ne devions pas appréhender qu'en exposant à quelque danger notre propre salut par charité, il nous arrivât du mal ; que Dieu, par sa miséricorde, tiendrait ce danger fort éloigné, et que cela nous obligerait seulement à nous tenir davantage sur nos gardes. Le sieur de Courcelles, qui avait apporté de Bengale une maladie dont il ne pouvait revenir, demanda au gouverneur que je fusse avec lui sur le même vaisseau, disant qu'il voulait mourir entre mes mains. Nous fûmes destinés l'un et l'autre pour être sur l'amiral. Les autres firent leur partie, et choisirent le vaisseau qu'ils voulurent.
Quand ces partages furent arrêtés, le 20 juin au matin, le commandant nous fit appeler les uns après les autres, selon l'ordre des vaisseaux pour lesquels nous étions destinés ; mais avant que de passer dans sa chambre, on trouvait dans son antichambre trois officiers, savoir son lieutenant, le fiscal et un commissaire, qui fouillaient tout le monde, les uns à l'insu des autres, d'une manière indigne du lieu où cela s'exécutait. Quand mon tour vint, j'entrai sans savoir de quoi il s'agissait, et demandai à ces messieurs de me faire parler à M. le gouverneur qui m'avait fait appeler. Ils me dirent que dans un moment je le verrais, et cependant ils burent à ma santé et m'invitèrent de boire à la leur. Je ne sais s'ils avaient quelque considération pour mon caractère et pour la robe que je portais, mais ils disputaient entre eux à qui me ferait la proposition de me laisser visiter, et personne ne voulant le faire, ils entrèrent dans la chambre du gouverneur et prièrent le sieur de Courcelles de me venir dire que je ne trouvasse pas mauvais que l'on me visitât, comme on avait visité les autres.
Ils me demandèrent si j'avais des diamants. Je leur dis que non. Ils voulurent savoir si j'avais de l'argent. Je n'étais pas plus obligé à le leur déclarer qu'un passant à des voleurs de grands chemins, néanmoins, pour ne point donner à ces messieurs de la religion prétendue réformée sujet de dire que les religieux ne craignent point de mentir pour de vils intérêts, je leur donnai moi-même le peu que j'avais. Comme ils voulaient ensuite fouiller dans mes habits, j'aperçus l'habit séculier que j'étais convenu avec le commandant que je prendrais pour passer en Hollande. Je leur dis que j'allais prendre cet habit, et que je leur abandonnerais plus facilement qu'ils ne pensaient tout l'or et toutes les pierreries qu'ils croyaient être dans ma robe. Ils furent surpris de n'y rien trouver, et ne pouvaient s'imaginer que venant des Indes, et ayant été dans un vaisseau où il y avait tant de diamants, je fusse si pauvre. J'avais un petit crucifix de cuivre sur une croix de bois attaché à mon col. Ils jetèrent la main dessus, croyant qu'il fût d'or ; mais le regardant de plus près, ils virent qu'il n'était que de cuivre et le laissèrent. Peu de temps après pour ne point se tromper, ils demandèrent encore à le voir, et s'étant bien assuré qu'il était de peu de valeur, ils me dirent que je le gardasse en me témoignant qu'ils étaient bien édifiés que j'eusse plutôt sauvé cela que des diamants. Ils me rendirent aussi mon chapelet et un livre du Nouveau Testament. Ce fut tout ce que Dieu permit qu'il me restât, afin de me faire voir le dépouillement où doit être un missionnaire pour n'avoir de confiance qu'en Dieu et d'attachement que pour lui seul.
Quand ces officiers eurent satisfait à loisir leur curiosité plus que leur avarice auprès de moi, ils me firent passer dans la chambre du commandant, qui me tendit la main et me reçut en riant de mon nouvel habillement. O senhor Padre ja cavalhero de boa esperança, dit-il en portugais : Voici le père devenu cavalier du Cap de Bonne-Espérance. Je lui répondis en la même langue : Cavalhero nao, mas de boa esperança si : Cavalier, non, je ne le suis pas, mais de bonne espérance, j'en suis. Vous m'avez tout ôté, Monsieur, il ne me reste que la bonne espérance que j'ai en Dieu. Il nous fit servir ensuite une collation de fruits et de confiture. Je riais en moi-même de la vanité du monde et des comédies qui s'y jouent. On nous régalait derrière la scène, et sur le théâtre, on venait de nous dépouiller sous les yeux même d'un gouverneur dont nous étions prisonniers de guerre et qui nous avait nourris deux mois chez lui, conversant tous les jours familièrement avec nous. Je crois que depuis que l'on fait la guerre, on avait vu peu d'exemples semblables.
| Embarquement des prisonniers et départ du Cap. |
On nous fit embarquer chacun dans le vaisseau qu'on nous avait marqué, mais on envoya à Batavia environ cent de nos matelots, parce que les capitaines dirent qu'ils ne pouvaient pas porter tant de Français sans danger. Nous demeurâmes encore dix jours dans la rade, où nous eûmes grand froid. Toutes les montagnes d'alentour étaient couvertes de neige au mois de juin, qui est le fort de l'hiver pour ces contrées. Le commandant vint à notre bord nous souhaiter un heureux voyage, et le 31 juin l'on mit à la voile pour sortir seulement de la baie et se mettre au large. Le lendemain 1er juillet, on se mit en route par un vent de sud-est qui continua tout ce mois-là et le suivant entre le sud et l'est, et nous porta depuis le 35° 36' de latitude sud jusqu'à 30° de latitude nord. Comme je n'avais pas la liberté de prendre connaissance des observations ni de la route, je ne rendrai pas compte de cette navigation, de laquelle les pilotes hollandais seraient peut-être bien en peine eux-mêmes de le rendre.
Je ne sais sur quoi peut être fondée la réputation que cette nation s'est acquise dans le monde de bien naviguer. Ils étaient autrefois estimés bons hommes de mer, parce qu'il n'y en avait pas de meilleurs qu'eux, mais au fond, ils ne sont ni pilotes ni manœuvriers, ni soldats. Ils devaient toucher à trois endroits dans cette traverse, savoir à l'île de Sainte-Hélène, ils la manquèrent ; aux îles Açores, ils louvoyèrent trois semaines à leur hauteur et n'en purent prendre aucune connaissance ; et enfin, se croyant à la vue des côtes d'Angleterre, ils étaient tombés à plus de 200 lieues à l'ouest. Il règne un esprit de lenteur et d'irrésolution dans tout ce qu'ils font. Ils ont tenu trente fois le conseil où il ne s'agissait que de bagatelles, et au lieu de profiter du beau temps, ils demeurèrent en panne et le côté en travers tous ces jours-là, qu'ils passaient à boire et à fumer en cherchant sur leurs cartes marines où ils étaient ; sur quoi un de leurs capitaines dit un jour plaisamment : Messieurs, nous sommes bien car nous sommes à table.
Dans l'appréhension où ils étaient de rencontrer des vaisseaux du roi, ils prenaient quelquefois la résolution d'aller passer au nord de l'Irlande par les îles Orcades, mais comme la saison était trop avancée pour tenir cette longue et périlleuse route, ils jugeaient d'autres fois qu'il serait plus sûr de toucher aux côtes d'Espagne (4) pour y prendre langue avant que d'entrer dans le canal. Ils craignaient les Français et ne se fiaient point aux Anglais. Il n'y a sur chacun de leurs vaisseaux qu'un capitaine et trois pilotes pour officiers, tous gens qui viennent d'être matelots, ce qui fait qu'ils ne sont point maîtres de leur équipage qui s'estime autant qu'eux, selon l'esprit de république. Chacun fait ce qu'il veut jusqu'à tenir toute la nuit des lampes et des chandelles allumées de toute part, et s'endorment ainsi la pipe brûlant à la bouche avec un danger extrême de mettre le feu au vaisseau. Ils font leurs manœuvres avec beaucoup de lenteur et de désordre : tout le monde crie et personne n'écoute. On dirait tout le jour, à les entendre, qu'on va périr où il n'y a aucun danger. Les matelots se renvoient les uns aux autres les commandements des officiers. J'ai vu ceux-ci cent fois obligés à manœuvrer eux-mêmes, parce qu'ils ne pouvaient pas faire monter l'équipage assez promptement sur les ponts. Ils ne leur font presque rien faire qu'en les flattant, ou en les frappant, ce qui leur attire le mépris d'un côté et la haine de l'autre. Aussi avons-vous vu qu'à la fin du voyage, quand ils arrivaient à la vue de leurs terres, les matelots révoltés ne voulaient plus mettre la main aux manœuvres. Dans un vaisseau, ils défièrent une fois le capitaine de descendre de dessus le pont pour se battre à coups de poings. Dans un autre ils allèrent frapper à la porte de la chambre du capitaine comme pour l'enfoncer, lui demandant de l'eau-de-vie, et il fut obligé de leur donner du vin d'Espagne pour les apaiser. Un autre n'en fut pas quitte à si bonne composition, car ils le maltraitèrent à terre avec tant d'excès qu'il en a gardé le lit fort longtemps.
Mais en blâmant les désordres par l'amour de la vérité, il faut rendre honneur au mérite par justice et par reconnaissance.
| Honnêteté de l'amiral hollandais. |
M. l'amiral de la flotte, sur le vaisseau duquel nous étions embarqués, pouvait être mis au rang des plus sages et des plus honnêtes officiers. C'était un homme de fortune qui après s'être enrichi dans les Indes, venait jouir dans sa patrie du fruit de ses travaux. Il nous dit en entrant dans son vaisseau qu'il voulait nous donner un exemple de la manière dont il fallait traiter les honnêtes gens prisonniers de guerre. Il nous fit manger pendant tout le voyage à sa table, ordonna à ses domestiques de nous obéir comme à lui-même, et fit par son exemple que l'on eut pour nous tous les égards que nous pouvions souhaiter. Avec son honnêteté et sa douceur, il avait un grand génie, parlait de tout et en parlait bien. Nous eûmes souvent de grandes conversations en particulier. Il gardait des mesures devant les siens ; il me donna beaucoup de lumières sur les affaires des Indes pour le bien de nos missions. Mme l'amirale, que son mari ramenait en Hollande, ne lui cédait point en honnêteté. Il semblait que l'un et l'autre prissent peine à faire oublier à nos Français, par leurs bons traitements, qu'ils fussent prisonniers, et parmi leurs ennemis. Nous ne nous en apercevions en effet que par la diversité des religions. Ils exerçaient la leur publiquement et nous laissaient toute la liberté d'exercer la notre en particulier. Il y avait un jeune prédicant hollandais dans le bord, homme d'esprit, mais libertin dans ses mœurs et dissolu dans ses paroles. M. l'amiral et Mme l'amirale le reprenaient quelquefois devant moi, et lui disaient qu'il regardât si le père tenait de semblables discours. Il répondait que c'était par politique que j'affectais cette modestie.
On ne manqua pas de nous engager l'un contre l'autre dans la dispute sur la religion. La première fois que cela arriva, je dis en souriant que puisqu'on me faisait l'honneur de vouloir m'entendre parler de ma religion, je demandais qu'on ne trouvât pas mauvais que j'en parlasse en toute liberté, parce que, quoique je fusse leur prisonnier, la parole de Dieu, selon saint Paul, n'était jamais captive. Nous disputâmes plusieurs fois sur la nécessité et le mérite des bonnes œuvres, sur l'institution et la vertu des sacrements et sur la justification du pécheur, mais nous le faisions sans clameurs, en manière de conversation. M. l'amiral après nous avoir entendu deux ou trois fois, avertit le jeune ministre de ne plus disputer.
Nos autres prisonniers n'avaient pas la même liberté et les mêmes avantages sur les autres vaisseaux, mais ils avaient plus d'occasion de mériter auprès de Dieu par leurs souffrances. Nous vîmes là un effet bien sensible de la providence adorable. Il n'y avait eu personne de nous qui, en s'embarquant, ne fût résolu et disposé à mourir dans ces vaisseaux ennemis, où nous manquerions de tous les secours avec lesquels on a encore bien de la peine d'échapper de ces longues traverses. Les Hollandais, nos vainqueurs, mouraient en grand nombre, et mouraient misérablement, sans secours, ni pour le corps, ni pour l'âme, aussi mal assistés de leurs ministres que de leurs médecins ; et nous, de tous nos prisonniers, nous n'en perdîmes que deux, dont l'un fut le sieur de Courcelles qui mourut avec toutes les marques d'un prédestiné, après s'être préparé plusieurs mois avec beaucoup de piété à ce dernier passage.
Dès le commencement de sa maladie, M. l'amiral eut la bonté de me dire qu'il me le recommandait et qu'il me laissait le soin de demander ce qui serait nécessaire pour sa santé, et la liberté de faire ce qu'ordonnait notre religion pour son salut. Quand le malade fut mort, je fus dire à l'amiral que ce capitaine m'avait chargé en mourant de le remercier de sa part de la bonté qu'il avait eue pour lui, et de l'assurer qu'il mourait son serviteur, et en même temps je lui présentai son testament que je le priai de garder, parce que nous n'avions pas où le mettre en sûreté. Ce bon homme fut attendri de la franchise avec laquelle ses prisonniers agissaient avec lui, et ne put retenir ses larmes. Il m'ordonna de faire faire au mort les obsèques que je jugerais à propos, et m'offrit de ses gens pour l'ensevelir. Je le fis faire par les nôtres, et lui, pour les consoler de la perte qu'ils venaient de faire de leur capitaine, leur fit faire un régal.
La providence semble prendre plaisir à exercer la confiance que nous devons avoir en elle par une vicissitude d'événements agréables et fâcheux. Après nous avoir fait trouver deux protecteurs dans l'amiral et sa femme, Dieu nous les enleva l'un et l'autre en peu de temps, par une maladie qui les surprit en approchant d'Europe. Nous les regrettâmes beaucoup, et je puis dire que ce fut moins par la considération de nos propres intérêts que par l'estime de leur mérite et la reconnaissance que nous avions de leurs bontés. Mais je fus indigné de la manière dont ils furent assistés à la mort. Je n'avais plus la liberté d'entrer dans leur chambre dès qu'ils furent en danger de mort, mais j'entendais d'en haut le prédicant qui se fatiguait à lire à pleine tête un discours de consolation à ses gens quand ils agonisaient et qu'ils avaient perdu tout usage de leurs sens, ne leur ayant jamais porté auparavant aucune parole salutaire. J'aurais souhaité passionnément de leur procurer la liberté des enfants de Dieu, pour la charité qu'ils avaient eue d'adoucir notre prison, et il semblait que des personnes si bienfaisantes ne devaient pas être éloignées du royaume de Dieu. Ses jugements sont impénétrables. On embauma leurs corps qui furent gardés dans des cercueils de plomb et portés en Hollande pour y être enterrés avec leurs ancêtres.
Nous étions près des côtes d'Angleterre quand l'amiral mourut. Les pilotes se mettaient même par leur estime dans la Manche, mais c'était la fausse Manche qu'on nomme de Bristol, tout près d'aller donner contre les rochers. Nous n'appréhendions pas ce danger, qui était véritable, et nous eûmes peur d'un autre qui ne fut qu'imaginaire. À la petite pointe du jour, on avait aperçu du haut des hunes deux vaisseaux qui nous semblaient ranger les côtes de France pour tenir le vent qu'ils avaient sur nous. Ils nous suivaient à toute voile, et paraissaient à la mâture être de gros vaisseaux de guerre. La flotte marchande était composée de sept vaisseaux ayant tous plus peur les uns que les autres, parce qu'ils se jugeaient perdus si les vaisseaux qui paraissaient étaient français. Leur appréhension faisait notre espérance, et quoique nous eussions expérimenté ce qu'il coûte d'être canonné dans des vaisseaux, l'ennui de six mois passés dans la captivité et l'incertitude de ce qui nous en restait encore nous faisait souhaiter de voir notre vie exposée pour recouvrer notre liberté. Cependant nos Hollandais tâchaient de tenir bonne contenance. Le contre-amiral se détacha pour aller reconnaître les vaisseaux : c'étaient deux Anglais, l'un de soixante, l'autre de quarante pièces de canon. Ils redressèrent la mauvaise route que nous faisions et nous escortèrent jusqu'à Douvres. Nous ne saluâmes que de loin les côtes de France, et les ennemis furent assez heureux pour passer avec dix ou douze millions à la vue de nos ports, sans faire rencontre de nos vaisseaux.
| Arrivée des vaisseaux en Zélande. |
Nous arrivâmes à la vue des îles de Zélande le 28 octobre 1689, et le vaisseau amiral où j'étais alla échouer à l'entrée de la nuit sur un banc de sable devant la ville de Trevers (5). Nous y demeurâmes attachés jusqu'au lendemain, et si la mer n'eût été aussi calme qu'elle fut, nous y aurions péri pour terminer le cours de nos aventures par un naufrage dans le port. J'avais pris des mesures les derniers jours du voyage avec un pilote français prisonnier, que je connaissais adroit et entreprenant, pour le faire sauver et donner par son moyen de mes nouvelles à Paris. J'écrivis en latin pour lui ôter la tentation de lire ma lettre que je lui donnai sans date et sans inscription. Il se mêla hardiment avec l'équipage hollandais à la faveur de quelques-uns de ses amis, passant sans peine partout où il voulut, parce qu'il savait l'anglais et le flamand, et arriva heureusement à la cour. Pour nous autres, nous fûmes tous mis dans une barque où il y avait deux corbeilles de fers pour nous mettre aux mains et aux pieds. Je ne sais à quoi il tint qu'on ne le fît. Nous nous vîmes là tous rassemblés avec une joie extrême, après avoir couru mille dangers. En descendant à terre, nous fûmes d'abord renfermés dans un corps de garde de la ville de Trevers, d'où nous fûmes conduits à Middelbourg, marchant deux à deux entre deux files de soldats, parmi la foule du peuple qui nous suivait avec des cris jusqu'à la prison où nous sommes à présent et d'où j'écris cette histoire.
Huit jours après notre arrivée, le président de l'amirauté avec un conseiller me fit appeler en particulier dans une chambre de la prison, pour s'informer du détail de notre prise et de la manière dont on nous avait traités au cap et sur les vaisseaux. Après m'avoir écouté, ils me déclarèrent que l'amirauté avait pris la pensée de m'envoyer avec une lettre de sa part au roi, pour lui demander l'échange général de tous les prisonniers de France et des États-généraux, afin d'arrêter les larmes de tant de pauvres familles qui gémissaient de part et d'autre. J'acceptai volontiers cette commission pour le soulagement des malheureux, mais comme je n'ai pu trouver assez tôt la caution qu'on me demandait pour la sûreté de mon retour, en cas que sa Majesté ne voulût rien accorder, l'affaire traîna en longueur et fut rompue par l'intrigue de nos ennemis particuliers.
Je ne vous marquerai rien de la manière dont on nous a traités depuis que nous sommes ici. Les prisonniers font d'ordinaire leur prison trop noire, l'image n'en peut être agréable. Je rendrai seulement avant que de finir le témoignage que je dois à la piété et au zèle de tous nos bons Français, qui font retentir les prisons de ces villes des louanges de Dieu et des cris de Vive le roi. Nous faisions cela de si bon courage et si haut, ne rougissant point de l'Évangile, que les magistrats de la ville nous envoyèrent deux officiers de leur corps pour nous défendre ces exercices de piété. Nous leur dîmes que dans tous les pays, même les plus infidèles, on ne nous avait jamais empêché de professer notre religion, ni de témoigner le zèle que devaient avoir de bons sujets pour leur roi, comme Dieu l'ordonnait, et qu'il jugeassent eux-mêmes lequel était le plus juste, d'obéir aux ordres de Dieu ou aux défenses qu'ils nous faisaient. Ils nous répliquèrent qu'ils ne prétendaient pas nous empêcher l'exercice de notre religion, mais que toute la ville était scandalisée de nos chants publics et de nos cris de Vive le roi, et que si nous continuions de la même manière, il y avait ordre de séparer les prêtres des autres et de leur ôter la liberté qu'on leur donnait d'assister les malades. Cette considération fit sur nous ce que les mauvais traitements n'auraient peut-être pu faire. Nous crûmes que le salut d'un seul matelot par l'assistance qu'on pouvait lui donner à la mort était plus chère à Dieu et au roi que la fermeté que nous pouvions témoigner dans cette occasion ne leur serait agréable. On convint de part et d'autre que nous ferions toujours les mêmes prières, mais avec moins d'éclat, néanmoins en commun et à haute voix.
Par ce petit traité, nous nous conservons la liberté de visiter les prisonniers qui sont dans d'autres chambres que nous et de les assister dans leurs besoins qui sont extrêmes. Les rigueurs du froid pendant l'hiver, et les chaleurs excessives de l'été avaient causé parmi eux des maladies contagieuses qui les auraient tous enlevés si l'on n'avait été ici pour soulager leur misère, en faisant revêtir ceux qui manquaient d'habits, donnant de la nourriture et des remèdes aux malades. Les secours qu'on leur a donnés n'ont pu empêcher que plusieurs ne soient morts, mais nous avons cette consolation qu'il n'en est mort aucun dans cette prison sans avoir reçu le sacrement de pénitence. Quoiqu'ils fussent la plupart surpris de transport au cerveau, Dieu leur donnait à tous quelques intervalles favorables avant que de les appeler. Je ne rapporterai de toutes ces miséricordes de Dieu qu'un seul exemple : un matelot malade avant que d'avoir pu se confesser, tomba dans une espèce de léthargie où il semblait agoniser et mourir à tout moment. Ses camarades prièrent le geôlier de me permettre de l'aller voir. Cet homme n'était pas ce jour-là de bonne humeur ; il les rebuta, et le malade passa ainsi le reste de la journée, la nuit et le jour suivant jusqu'à neuf heures du matin. Alors ayant obtenu permission de l'aller voir, je m'approchai de lui, je lui parlai, et comme ma voix ne lui était pas inconnue, elle l'éveilla. Il me dit qu'il m'attendait depuis longtemps. Il se confessa avec une entière liberté d'esprit, et incontinent après avoir reçu l'absolution, il mourut entre mes mains, comme s'il n'avait attendu que ce dernier secours pour sortir de sa prison et aller jouir de la douce liberté des enfants de Dieu. N'y a-t-il pas dans ce seul trait de la bonté divine de quoi nous consoler de notre captivité, quoiqu'il y ait environ vingt mois que sa providence paternelle nous conduit de prison en prison dans trois parties du monde, sur terre et sur mer, parmi les infidèles et les hérétiques ? On est bien partout avec Dieu qui nous donne partout des marques sensibles de sa providence, et partout l'on peut vivre également content, quand on ne veut être que là où il veut que nous soyons. Je finis l'histoire de tant d'événements extraordinaires en priant Dieu de rendre à tous nos ennemis ce qu'ils nous ont fait de biens, et s'il nous ont fait du mal, notre sainte foi en ayant été la principale cause, ils nous ont fait en cela trop d'honneur pour nous donner lieu de nous en plaindre.
Fin de l'Histoire de la révolution du royaume de Siam.

NOTES :
1 - Saint Jean Porte latine est une fête de l'Église de Rome en l'honneur de l’apôtre et évangéliste Jean. Elle est célébrée le 6 mai. ⇑
2 - Simon van der Stel, (1639-1712), fils d'Adriaen van der Stel, gouverneur de l’île Maurice entre 1639 et 1645. À cette époque, Simon van der Stel n’était encore que commandant du Cap. Il en obtiendra le titre de gouverneur à partir de 1691 et jusqu’en 1699. son fils Wilhelm Adriaan van der Stel (1664-1723) lui succèdera jusqu'en 1707.
 Simon van der Stel. ⇑
Simon van der Stel. ⇑
3 - François d'Aix de La Chaize (1624-1709) fut le confesseur jésuite de Louis XIV à partir 1675 et jusqu'à sa mort. ⇑
4 - Aux côtes du Pays-Bas espagnol, qui comprenait les actuels Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, ainsi que des territoires situés en France et en Allemagne. ⇑
5 - Veere ? ⇑

21 février 2019
