

Fin du livre III.
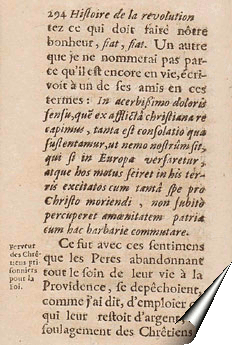
| Ferveur des chrétiens prisonniers pour la foi. |
Ce fut avec ces sentiments que les pères, abandonnant tout le soin de leur vie à la providence, se dépêchaient, comme j'ai dit, d'employer ce qui leur restait d'argent au soulagement des chrétiens avant qu'ils fussent eux-mêmes arrêtés. Mais en pourvoyant aux besoins du corps, ils avaient une autre obligation plus étroite d'avoir soin du salut des âmes de ces prisonniers et de leur procurer des secours spirituels. Quand on leur portait à manger, on leur faisait faire secrètement la prière, qui était suivie d'un petit entretien en portugais vulgaire pour les consoler, les instruire et les encourager à tout souffrir pour Jésus-Christ, en haine duquel ils étaient maltraités. Il n'y en eut presque aucun qui n'eût recours au sacrement de pénitence pour se disposer à tout ce qu'il plairait à Dieu d'ordonner d'eux, et plusieurs reçurent la sainte Eucharistie, que les pères leurs portaient en cachette, suivant la coutume de l'Église qui animait dans les premiers temps les confesseurs de Jésus-Christ par la réception de son sacré corps.
Entre les innocentes industries dont ces pères se servaient pour tromper la vigilance des gardes dans l'administration des sacrements, celle qui leur réussit davantage fut de porter partout avec eux des remèdes. Ils allaient par la ville avec des boîtes remplies d'onguents et d'eaux médicinales, pour les ulcères et les maux d'yeux qui sont fort communs à Siam, et particulièrement pour panser les plaies des chrétiens prisonniers. Les Siamois, qui sont gueux et avides de tout, les appelaient de toutes parts en leur criant Baloüan Koïa !Batluang, kho ya ! : บาทหลวง ขอ ยา, c'est-à-dire : Père, je veux de tes remèdes. Les pères qui ne prétendaient autre chose que de se faire appeler, avaient la patience de s'arrêter partout où l'on les demandait, et tandis que l'un donnait des remèdes, l'autre faisait la recherche des prisonniers chrétiens qui pouvaient être aux environs, car on les tenait dans les chaînes en toutes sortes d'endroits. Par le même stratagème les pères amusaient les gardes à la porte de la prison pour donner la liberté à celui qui portait la sainte Eucharistie de la distribuer aux fidèles.
| Constance des chrétiens. |
Ces secours spirituels étaient aussi nécessaires à ces pauvres chrétiens qu'ils furent efficaces dans les rudes épreuves qu'ils eurent à soutenir. L'on n'avait pas sujet d'attendre que plusieurs d'entre eux, accoutumés à mener une vie molle et languissante selon le génie des Indes, dussent témoigner tant de courage dans les souffrances, mais il faut avouer que quand il s'agit de la foi, les maux changent bien de nature. Dieu jette les yeux sur qui il lui plaît pour en faire des confesseurs de son nom, et change par sa grâce leur faiblesse en force. Le 14 juin, les mandarins furent envoyés par les prisons pour proposer aux chrétiens que ceux qui voudraient adorer les pagodes pouvaient sortir des fers et rentrer dans leurs biens. On leur réitéra plusieurs fois les mêmes offres. Par la grâce de Dieu, personne n'en fut touché. Tous choisirent plutôt de mourir dans les fers pour Jésus-Christ que d'en être délivrés pour les faux dieux, et ces sollicitations ne produisirent d'autres effets que la consolation qu'eurent les prisonniers de savoir que leur religion était la cause de leurs souffrances, dont j'ai cru qu'on serait bien édifié de voir le détail que j'en vais faire.
| Détail de la persécution faite aux chrétiens. |
Après qu'on eut pillé les maisons des chrétiens, qu'on les eut dépouillés, mis aux fers, et sollicités par toutes sortes de promesses et de menaces de quitter leur religion, on passa à de plus grandes rigueurs.
Le fils du tyran fit rechercher les filles et les jeunes femmes des chrétiens les mieux faites pour s'en composer un sérail, après qu'il les aurait obligées à prendre la religion du pays ; et n'ayant point de récompense à donner aux exécuteurs de ses ordres détestables, il leur donnait toute sorte de licence contre les chrétiens, avec l'impunité de toutes les cruautés qu'ils exerçaient sur eux. Mais comme si c'eût été une chose trop commune que la passion et l'amour du plaisir eussent fait faire à un jeune prince barbare de ces sortes de violences, celui-ci, par une lâcheté et une bassesse d'âme inouïe, en faisait un commerce honteux. Il faisait enlever des enfants de l'un et de l'autre sexe et envoyait proposer à leurs parents, qui avaient déjà tout perdu, de chercher encore de l'argent pour les racheter, faisant ainsi servir les uns à son avarice et les autres à son impudicité.
On suspendit en l'air par les mains un bon vieillard pégouan avec sa femme de même âge et de même nation, et on les bastonna rudement pour les obliger à déclarer où était cachée une fille unique qu'ils avaient. Ils aimèrent mieux exposer leur corps à la cruauté des bourreaux que la pudicité et la religion de leur fille, et gardèrent un généreux silence.
Un jeune Français qui se sauva, comme j'ai dit, de la barque de Saint-Cry quand il y mit le feu, ayant été pris des Siamois, souffrit les derniers excès de leur cruauté en haine de la religion. Ils faisaient des croix de bambou, et lui mettant une moitié de coco sur la tête, ils la lui enfonçaient avec des coups qu'ils lui donnaient de ces croix, en dérision de notre sauveur ; et comme ce jeune homme avait le bras cassé d'une balle de mousquet, ils prenaient plaisir à sonder la profondeur de la plaie avec des morceaux de bois et à la remplir de terre. Ils l'amenèrent ainsi dans les prisons de Louvo, où les pères jésuites le guérirent plus par l'assistance de Dieu que par leur habileté en ces sortes de cures (1).
Un autre Français, officier à Mergui, fut suspendu par les mains et rotiné pour lui faire dire ce que les Français étaient venus faire dans le royaume. On en attacha deux autres venus de Bangkok pour les frapper sur la poitrine avec des briques et leur arracher la barbe, jusqu'à ce que les pères viennent les délivrer en donnant de l'argent à un mandarin.
Une chrétienne pégouane fut envoyée de Siam à Louvo en prison. Sept gardes qu'on lui avait donnés pour être les défenseurs de sa faiblesse et de son honneur, furent ses bourreaux. Sur le chemin, ils lui arrachèrent un crucifix qu'elle portait sur elle, la battirent et la violèrent au milieu de la campagne, lui faisant souffrir un double martyre pour sa foi et sa pudicité.
Il y avait à Siam une religieuse qui élevait des jeunes filles dans le camp des Portugais. Des gens envoyés par le tyran voulurent l'obliger à fouler aux pieds un crucifix, et au refus qu'elle en fit, ils le lui attachèrent sous la plante des pieds, la traînèrent avec violence, publiant qu'elle avait mis son dieu sous ses pieds, comme disent les Siamois des choses qu'ils méprisent. Une de ses disciples, pour avoir témoigné la même fermeté, mérita l'honneur d'être souffletée pour son divin époux, de la main des bourreaux avec le crucifix même. Elles furent ensuite amenées l'une et l'autre à Louvo et mises en prison. Il y eut en cela une providence particulière, car il se trouva dans cette prison un grand nombre de filles et de femmes chrétiennes auxquelles les pères n'avaient pas liberté de parler. Ces bonne religieuses y suppléèrent et firent dans cette prison ce qu'elle purent de l'emploi des missionnaires, par leurs fervents discours et leurs exemples édifiants.
Un père jésuite allant un jour visiter les prisons avec M. Paumard, curé de Louvo, qui a témoigné beaucoup de zèle et de courage pour la défense de son troupeau, il s'entendirent appeler de la maison du jeune Phetracha par une troupe d'enfants. C'étaient les petites élèves de Mme Constance dont le prince s'était fait des esclaves. Ces petites innocentes racontèrent qu'on leur avait arraché leurs chapelets et leurs croix et qu'on les avait battues pour leur faire adorer les pagodes, mais qu'elles ne craignaient rien (disaient-elles) parce que Jésus-Christ était plus puissant que les idoles ; qu'elles se souvenaient bien de ce que la señhora (c'est-à-dire Mme Constance) leur avait appris à dire, quand on les solliciterait à changer de religion : Corta cabeça – Coupez-nous plutôt la tête. En effet, Mme Constance, qui à l'âge de vingt-deux ans avait renoncé à tous les agréments que son âge, sa beauté et sa haute fortune pouvaient lui faire trouver dans le monde, ne s'occupait que du soin d'orner les autels du Seigneur et d'élever dans sa crainte soixante filles qu'elle avait à sa suite. Elle prenait la peine de leur expliquer elle-même la doctrine chrétienne, et dans ces derniers temps où l'on prévoyait la persécution prochaine, elle leur faisait un article particulier de leur catéchisme, de la manière dont elles répondraient quand on leur dirait de renoncer à Jésus-Christ pour adorer les idoles.
Ces petites filles se levaient et répondaient hardiment pour s'accoutumer un jour dans l'occasion : Je n'adore qu'un seul vrai dieu qui a fait le ciel et la terre, un en trois personnes, dont la seconde s'est fait homme, et a bien voulu mourir en croix pour nous racheter de l'enfer et nous mériter un bonheur éternel dans le ciel. Mais quand on vous répliquera (poursuivait Mme Constance) que si vous n'adorez les idoles, on vous fera mourir, que direz-vous ?, ces bonnes filles se jetaient à genoux et baissant la tête et joignant les mains, elles disaient ce que leur bonne maîtresse leur avait appris à dire Corta cabeça je suis prête à perdre la tête pour la défense de ma foi. C'est ce qu'elles avaient dit dans la maison de Phetracha. Les missionnaires furent touchés de la ferveur de ces petites chrétiennes, ils leur donnèrent leur bénédiction et se retirèrent les larmes aux yeux, bénissant Dieu qui sait tirer la confession de son nom de la bouche des enfants.
On trouva le lendemain dans une petite cabane derrière le palais Dom Ignacio, oncle de Mme Constance (2). Il avait été cruellement rotiné, tout son dos depuis le col jusqu'aux reins n'était qu'une plaie profonde, sans qu'on ait pu savoir le véritable motif qu'avaient eu les Siamois de le traiter ainsi. Une fièvre continue lui survint, et il fut un mois entier couché sur une claie, disposé à mourir. Les pères qui le nourrissaient le pansèrent et le guérirent.
Un peu plus loin étaient deux jeunes garçons qui servaient autrefois à la chapelle de M. Constance, dans un état un peu différent du seigneur Ignace. Ils avaient été tourmentés la veille, et quand nous les trouvâmes, il leur restait encore des pointes de bambou fichées entre la chair et les ongles. Ils avaient de la peine à accepter ces souffrances de la main de Dieu, et ils n'enduraient pas de si bon courage qu'une jeune femme portugaise qui ayant appris que son mari, arménien de nation, venait d'être arrêté comme chrétien et enfermé dans une prison, que je pourrais appeler plutôt une cage pour le peu d'espace qu'elle avait, voulut avoir part à l'honneur de souffrir pour une si bonne cause. Elle prit sur ses bras un petit enfant de trois ans qu'elle avait et se vint rendre d'elle-même auprès de son mari. Nous les avons vus dans une pauvreté extrême, la mère et l'enfant perdant la vue par les incommodités de leur prison. Le mari n'avait qu'à parler pour se mettre en liberté, et il avait été souvent sollicité par son frère, qui professait la religion des Mores et tenait parmi eux un rang considérable. Mais rien ne fut capable de surmonter la patience de cette famille chrétienne. Ils souffrirent jusqu'à ce que la persécution se ralentît et qu'on leur permît de se racheter avec de l'argent que les pères leur donnèrent.
Une autre famille portugaise, par une aventure toute contraire, avait été dispersée, et on avait mis en prison le mari d'un côté et la femme de l'autre pour les tromper et les gagner plus facilement. On vint dire à la femme que si elle ne renonçait à sa religion et ne consentait à être renfermée avec les femmes du prince, on allait faire mourir son mari qui la priait d'avoir compassion de lui. Elle répondit que son mari mourrait volontiers pour la défense de sa religion et de l'honneur de sa femme, et que pour elle, on lui ferait plaisir de la faire aussi mourir pour le même sujet, afin qu'ils pussent s'aller joindre au ciel, puisqu'on ne leur permettait pas de vivre ensemble sur la terre.
Louvo était le théâtre de la persécution parce que c'était le séjour du tyran. On y amenait les chrétiens de toutes les parties du royaume. La mère de Mme Constance y fut transportée de Siam avec sept ou huit petits enfants qu'elle ne pouvait plus nourrir, parce qu'on lui avait enlevé tous ses biens et qu'on l'avait chassée de sa maison. La femme de Phetracha, faisant semblant d'être touchée de sa misère, lui offrit de lui faire rendre une partie de ses biens si elle voulait lui livrer dix jeunes chrétiens ou chrétiennes qui voulussent de leur plein gré embrasser la religion siamoise, mais elle était bien éloignée de faire cette lâcheté, et quand elle l'aurait entrepris, elle n'aurait pas trouvé ce qu'on lui demandait dans la ferveur générale de toute la chrétienté. Elle fut donnée en esclavage avec toute sa famille au capitaine des Japonais.
Un Portugais des Indes nommé Joan, qui avait servi d'interprète aux pères peu de temps avant la persécution, instruisit sa femme et sa belle-mère qui étaient pégouses, et les fit baptiser avec ses enfants. Cette pauvre famille voulut s'enfuir dans les bois quand on commença d'emprisonner les chrétiens, mais ils furent arrêtés et sollicités de renoncer à leur foi. Ils demeurèrent constants : le mari fut battu de rotins et condamné à servir les éléphants, la femme et les enfants furent faits esclaves.
Une autre famille d'un Castillan nommé Perez, composée de vingt-quatre personnes, fut pillée à Siam, mise aux fers et amenée à Louvo où elle eut beaucoup à souffrir à l'occasion de deux filles de la maison, qui passaient pour les plus belles du royaume, mais dont la vertu fut encore plus considérable que la beauté. Le fils de Phetracha leur a donné souvent le choix, ou d'entrer dans son sérail ou de perdre la vie sur-le-champ. Ces généreuses filles ont présenté plus d'une fois le col au bourreau qui avait le sabre nu sur leur tête, et l'on peut dire que si le martyre leur a manqué dans ces occasions, il semblait qu'elles ne manquaient pas au martyre.
La même chose était arrivée peu auparavant à cinq ou six veuves chrétiennes, qui avaient sauvé avec elles une jeune fille portugaise que sa beauté exposait à d'extrêmes dangers. Elles s'étaient cachées dans une maison de pierre hors de la ville, près du jardin du roi. Mais comme les Siamois en furent avertis, ils les y enfermèrent sans leur donner à manger, pour les réduire par la faim. Elles en firent donner avis aux pères jésuites qui vinrent aussitôt les chercher et les trouvèrent enfermées dans un grenier, dont on avait tiré l'échelle pour les empêcher d'en descendre. Il y avait trois jours qu'elles n'avaient mangé, et elles étaient déjà résolues à mourir de faim. Les pères leur furent chercher deux paniers de vivres qu'elles tirèrent par le moyen d'une corde qu'on leur jeta, après quoi elles souhaitèrent de recevoir l'absolution de leurs péchés qu'elles confessèrent en général, ne pouvant le faire autrement dans une occasion si pressante et dans l'incertitude si elles reverraient jamais de prêtres.
La nuit suivante, quatre bras-peints (3) ou soldats vinrent enlever la fille, et on la mena dans un lieu inconnu où un bourreau l'attendait le sabre à la main. Un mandarin qui était présent lui dit qu'il fallait mourir ou changer de religion, et aller avec lui chez le prince. Cette bonne fille se jeta à genoux, et Dieu lui donna assez de courage pour dire qu'elle mourrait volontiers. Le mandarin, voyant sa résolution, la renvoya, espérant de la gagner à son maître par un autre moyen. Nous la trouvâmes le lendemain auprès de sa mère. Elle nous raconta cette aventure avec des transports de joie qu'elle ne pouvait contenir. On l'envoya reprendre sur le soir, et on la conduisit non plus dans un coupe-gorge, mais dans une salle remplie de jeunes gens de l'un et de l'autre sexe qui folâtraient d'une manière fort dissolue. On l'invita à manger et à se divertir avec les autres. Dieu lui inspira de contrefaire la stupide. Elle demeura immobile sans lever les yeux et sans parler, de sorte qu'ils la traitèrent de folle et d'hébétée, et la renvoyèrent avec mépris. Depuis ces deux victoires, on n'a plus attenté à sa pudicité ni à sa foi, mais trois mois après, elle était encore dans les prisons avec ces autres femmes, réduite à de grandes extrémités.
| Générosité de plusieurs femmes chrétiennes. |
Nous avons vu des mères assez généreuses pour chercher des herbes qui défiguraient le visage de leurs filles afin de guérir la passion du fils du tyran, ne se souciant pas de les voir laides aux yeux des hommes pourvu qu'elles fussent agréables aux yeux de Dieu. Entre les autres, il se trouva une Portugaise qui fit une action dont il y a peu de semblables dans l'histoire de l'Église : elle avait une fille de quinze à seize ans aussi bien élevée qu'elle était bien faite. Le jeune Phetracha envoya pour l'enlever, et sa bonne mère, ne pouvant ni la cacher ni la défendre, promit aux gens du prince de la leur donner le lendemain. Quand elles furent seules dans la maison, la mère représenta en pleurant à cette enfant qu'elle ne devait rien avoir de plus précieux que son salut et son honneur, et qu'il n'y avait point de parti si rigoureux qu'on ne dût prendre pour conserver son innocence. Sur cela, lui ayant déclaré ce que Dieu lui inspirait, elle fit rougir un fer dans le feu et en brûla le corps de cette petite innocente comme on brûle dans ce pays-là celles qui sont atteinte de la plus honteuse maladie. Le lendemain, les satellites étant revenus, elle leur déclara que sa fille était dans un état à donner de l'horreur au prince, qu'elle se croyait obligée en la leur livrant, de les avertir qu'il y avait peu de temps qu'elle lui avait appliqué le feu, de sorte que ces gens, prenant cette fille pour une perdue, n'osèrent la mener au prince. Ainsi, par la douleur et par l'infamie, elle racheta sa virginité et ne feignit point de perdre son honneur devant les hommes pour le conserver devant Dieu.
Dans les épreuves et les peines que chacun souffrait en particulier, la charité leur faisait encore prendre part à l'affliction de leurs frères. Leurs plus grands empressements étaient de savoir si c'était toujours pour la foi de Jésus-Christ qu'on les persécutait, et si personne dans les autres prisons ne faisait déshonneur à sa religion. Les esclaves mêmes et les Cafres, qui sont la nation de toute la terre la plus servile, prenaient ces sentiments généreux. Ils portaient sans rougir dans les prisons leur chapelet au col, et disaient qu'il n'auraient pas voulu changer leur cangue avec des colliers d'or. Dieu ne dédaigne personne ; nous avons vu de ces pauvres gens qui ont mieux aimé mourir de misère que de sortir de prison aux conditions qu'on leur offrait. Mais aussi les Siamois, par vengeance et par mépris, les traitaient sans pitié. Un d'entre eux nommé Joseph mourut la cangue au col et les menottes aux mains, qu'on ne voulut jamais lui ôter dans l'ardeur de sa fièvre qui le consommait. J'ai eu l'honneur de lui rendre les derniers devoirs avec le père de la Breuille, et nous le regardions comme un glorieux confesseur de Jésus-Christ.
De tous les chrétiens persécutés, l'on n'a vu qu'une petite fille âgée de quatorze ans qui ait chancelé dans la foi. Elle était anglaise de nation et avait été du nombre des filles que Mme Constance élevait auprès d'elle. Dans le désastre de sa maison, elle fut donnée avec plusieurs autres à un mandarin qui, n'ayant point d'enfant, l'adopta pour sa fille parce qu'elle était spirituelle et agréable. Il gagna sur l'esprit de cette enfant qu'elle n'irait plus à l'église. On dit même qu'elle s'oublia jusqu'à dire qu'elle mettait les pagodes sur sa tête et Jésus-Christ sous ses pieds : c'est une manière de parler dans l'Orient pour marquer l'estime et le mépris que l'on fait des choses. Ses compagnes, élevées dans la même maison, eurent tant d'horreur de son infidélité qu'elles la fuyaient et ne voulaient plus lui parler. La confusion qu'elle en eut la fit rentrer en elle-même. Elle connut sa faute et en fit une satisfaction publique dans l'église pour réparer le scandale qu'elle avait donné, et déclara hardiment au mandarin qu'il avait surpris sa faiblesse et son enfance, mais que rien ne serait capable d'ébranler dans la suite la fidélité qu'elle avait promise à Jésus-Christ.
L'inquiétude que les pères eurent du danger continuel où était la petite anglaise fut bien récompensée par la consolation que Dieu leur donna en convertissant par leur ministère cinq ou six soldats anglais, qui quoique hérétiques étaient arrêtés comme chrétiens. Ils abjurèrent leurs erreurs dans les fers, confessèrent leurs péchés et furent admis à la sainte communion. Une dame aussi anglaise et hérétique, qui avait son mari prisonnier, fut laissée dans sa maison parce qu'elle était prête d'accoucher, mais dans un abandon pitoyable. Quand elle fut accouchée, elle envoya prier les pères de venir baptiser son enfant, disant qu'elle se tenait plus sûre qu'il irait au ciel quand il aurait été baptisé de leurs mains. Il le fut et il mourut heureusement le lendemain. Ses parents disaient hautement qu'ils n'avaient point vu dans leur religion d'exemples de charité semblables à ceux qu'ils voyaient dans la nôtre. Ils n'étaient pas éloignés du royaume de Dieu, si l'on eût eu la liberté de leur parler. Un Arménien qui professait le christianisme, mais en cachette, se déclara plus ouvertement dans la persécution. Il pria les pères de baptiser son fils âgé de trois ans, qu'il avait différé de faire chrétien jusque-là par une fausse honte. Pendant la cérémonie qui se faisait chez lui, une troupe de ses amis mores étant entrés, les pères pour ne lui point attirer d'affaires, s'offrirent de rester dans la chambre ; mais peu de temps après, il vint les prendre et les conduisit jusqu'à sa porte en présence des Mores, disant qu'il ne rougissait point pour l'Évangile et qu'il voulait bien que l'on sût qu'il était chrétien.
Je ne puis omettre ici ce que nous avons vu faire et souffrir à un autre Arménien nommé Jean-Baptiste, qui ne passait pas avant la persécution pour un chrétien bien fervent. Un jour, cet homme voyant passer deux pères qui portaient des claies et des vivres pour les prisonniers, dans un temps où personne n'osait approcher des prisons ni parler aux chrétiens, sa timidité fut changée tout à coup en un désir ardent de servir les prisonniers, et il voulut se charger d'une partie du fardeau des pères. Sa maison devint depuis ce temps-là le magasin des prisons, et il achetait lui-même pour cela toutes les provisions nécessaires. Sa charité ne manqua pas d'être bientôt récompensée par l'honneur qu'il eut de perdre ses biens et sa liberté pour la confession de la foi. Les pères ayant appris son emprisonnement accoururent au lieu où on l'avait mis. Ils le trouvèrent presque tout nu, mais si content et si consolé de souffrir pour la bonne cause, qu'il les assura en les embrassant qu'il n'avait aucun autres déplaisir que celui de ne s'être pas déclaré assez tôt, et que si Dieu lui rendait jamais la liberté, il s'en servirait mieux qu'il n'avait fait. En effet, les pères ayant trouvé le moyen de le racheter par une somme d'argent, il retourna le même jour à la prison et continua ses exercices de charité. Mais il disparut tout à coup et l'on n'a pu savoir ce que les Siamois en avaient fait. S'ils ont caché sa mort ou ses souffrances aux yeux des hommes, ils n'ont pu les cacher aux yeux de Dieu, qui voit ce qui se passe en secret et qui lui en rendra la récompense devant tout le monde.
Environ ce même temps, nous eûmes avis qu'on avait amené secrètement de PorceloukPhitsanulok (พิษณุโลก) dans le nord de la Thaïlande., qui est à cent lieues de Siam, dans les prisons de Louvo deux missionnaires dont l'un était un père cordelier et l'autre prêtre séculier (4). On les avait été prendre avec un appareil de guerre aussi ridicule que celui avec lequel on avait attaqué les sept officiers français. Ces bons missionnaires étant dans leur maison sans défense, on envoya trois cents hommes avec deux éléphants de guerre et deux pièces de canon pour les enlever, mais comme les Siamois n'attaquent presque jamais à force ouverte, il fallut encore pour arrêter ces deux prêtres se servir d'un stratagème de guerre. On fit mettre des gens en embuscade dans un bois, et des mandarins étant allé comme pour rendre visite aux missionnaires, ils les engagèrent à sortir de leur maison et les firent tomber dans l'embuscade. Mais on ne leur dit pas encore qu'on en voulût à eux. Ils étaient assis sous des arbres pour se reposer et s'entretenaient avec les mandarins, lorsque des gens vinrent par derrière et leur jetèrent des cordes au col. Les bons prêtres nous ont assuré que ceux qui les lièrent tremblaient si fort qu'ils avaient peine à nouer leurs cordes. Alors les gens de guerre avec les éléphants et le canon les environnèrent et les conduisirent en triomphe jusqu'à la rivière, où des balons les attendaient pour les amener garrottés à Louvo. M. de Métellopolis trouva le moyen de les délivrer à la conclusion de la paix (5).
Un autre prêtre du séminaire natif de Manille ne fut pas si heureux. Dès le commencement de la persécution, ce bon ecclésiastique, s'imaginant que tous ces mouvements regardaient moins les chrétiens que les Français, ne crut pas être obligé de souffrir pour eux persécution. Il sortit du séminaire, changea d'habit et se cacha dans la maison du castillan Pérez, dont j'ai parlé. Il fut mis aux fers avec toute cette famille et amené à Louvo, où nous le fûmes visiter. C'était un homme de bien, fort doux et fort humble. M. l'évêque le répéta, mais les Siamois, croyant que nos prêtres étaient comme leurs talapoins qui quittent leur caractère en quittant leur pagne, soutinrent qu'il n'était pas des siens, puisqu'il avait changé d'habit ; et ils ajoutèrent qu'étant interrogé s'il était du séminaire, il l'avait nié. Ainsi on le donna pour esclave à un mandarin qui ne l'a jamais voulu rendre. Il était occupé à piler du riz quand nous sommes sortis du royaume.
| Phetracha fait mourir les frères du roi. |
Tous ces événements particuliers furent suivis d'un autre plus considérable, auquel le public s'intéressa davantage. Phetracha voyant le roi baisser tous les jours et tendre à sa fin, jugea qu'il était temps de se défaire des deux princes frères de Sa Majesté, pour deux raisons que lui suggéra sa malheureuse politique. La première fut que si ces princes étaient encore en vie à la mort du roi, il appréhendait qu'il ne se fît un parti pour les légitimes successeurs de la couronne. La seconde, que les faisant mourir par un ordre supposé du roi, il espérait de faire tomber la haine de ce parricide sur ce malheureux prince que l'on savait être irrité contre ses frères. Pour mieux jouer son personnage, il fit semblant d'aller dans l'appartement du roi, et ayant ensuite assemblé le plus grand nombre qu'il put de mandarins de sa cabale, il leur déclara dans un discours étudié l'ordre qu'il avait reçu du roi de faire mourir les princes, pour des raisons dont Sa Majesté n'avait à rendre compte à personne ; et sur cela, regardant fixement chaque mandarin pour lire dans leurs yeux les sentiments de leurs cœurs, il voulut avoir l'avis de tout le monde sur cette affaire.
Ils reconnurent tous sa perfidie, et la détestèrent en secret. Mais quand il fallut opiner, il ne se trouva personne parmi ces esprits serviles qui n'applaudît aux prétendus ordres du roi. Le 25 juillet, sur les cinq heures du soir, nous vîmes passer les éléphants qui allaient prendre les princes au palais. Ils furent transportés près d'une pagode dans les bois de Telepousson (6) où on les étouffa dans des draps d'écarlate en leur pressant l'estomac avec des pièces d'un bois précieux qu'on nomme santal. On prit grand soin de cacher cette mort au roi prisonnier, mais le public la sut aussitôt et en parut consterné. Les deux princesses, la sœur et la fille du roi, pleurèrent la mort des princes et la ruine de la famille royale. Elles en firent de grands reproches au tyran, et l'on dit que pour les apaiser, il offrit à la jeune princesse de l'épouser. Elle lui répondit avec la fierté que sa naissance et sa douleur lui inspiraient. Phetracha en fut piqué et redoubla le déplorable esclavage où vivaient ces princesses infortunées (7). Quelques Siamois serviteurs des princes, ayant témoigné plus de douleur de leur mort que le temps ne le permettait, furent rotinés cruellement. Les prisons se remplirent de nouveau, ce qui obligea les pères jésuites d'étendre secrètement leur charité sur plusieurs de ces pauvres gens fidèles à la famille royale comme sur les chrétiens.
Ce fut une espèce de miracle comme le peu d'argent que ces pères avaient pu suffire à nourrir si longtemps un si grand nombre de prisonniers, aussi leur fond se trouvait épuisé sur la fin de juillet. Ils ne se voyaient aucune ressource dans ce pays infidèle où ils ne pouvaient trouver ni à vendre ni à engager leurs instruments de mathématique, leurs livres et les vases sacrés qui faisaient toutes leurs richesses. Ils ne voulurent néanmoins rien diminuer de leurs charités ordinaires, espérant que Dieu pourvoirait au besoin de son peuple, et qu'en tout cas, quand ils n'auraient plus rien, ils auraient la consolation de partager avec les autres chrétiens les misères communes, après avoir partagé leurs biens avec eux. Mais Dieu fit bien voir qu'il n'abandonne jamais ceux qui abandonnent tout pour lui ; et il leur procura du secours d'où ils en devaient le moins attendre, et de la manière la plus extraordinaire.
| Le roi prisonnier envoie de l'argent aux jésuites. |
Un jour que je disais la sainte messe dans une chapelle domestique, on vint m'avertir que si je n'avais pas encore consacré, j'interrompisse le sacrifice, parce que toute la maison était remplie de gens armés qui demandaient tous les pères. C'eût été une belle destinée d'être immolé au pied des autels. J'achevai le sacrifice et j'envoyai demander au père supérieur s'il était nécessaire de briser les vases sacrés pour en empêcher la profanation. Il fit réponse que non et me manda que je vinsse à la salle où l'on me demandait avec tous les autres pères. On avait aussi envoyé chercher les pères de Bèze et de la Breuille, qui étaient aux prisons. Les prisonniers voyant des hommes armés qui demandaient ces pères crurent qu'on les cherchait pour les faire mourir, et ne voulant pas être la cause de la perte de leurs bienfaiteurs, ils envoyèrent les soldats dans une autre prison bien loin de là les chercher, mais les pères, ayant su qu'on les demandait, ne voulurent pas être séparés de leurs frères ni perdre la belle occasion qu'ils croyaient avoir trouvée de souffrir.
Mais c'était pour un autre sujet qu'on les appelait. Le roi de Siam dans sa prison conservait la même affection qu'il avait eue pour les Français, et particulièrement pour les jésuites qu'il avait fait venir de France. Le père de Bèze et M. Paumard continuaient aussi avec la même affection d'aller au palais pour la santé de ce prince. Ils le voyaient quelquefois et il leur faisait de grandes plaintes selon la coutume des malheureux qui en font à tout le monde. Il s'informa particulièrement de l'état où étaient les jésuites, et fit demander au père de Bèze par son médecin chinois, s'il pourrait bien recevoir quelque argent qu'il apporterait lui-même en cachette dans ses poches pour lui et pour les autres pères, parce que sa faiblesse ne lui permettait pas d'en porter beaucoup à la fois, mais qu'il lui en donnerait à diverses reprises. Phetracha sut le dessein du roi par le médecin chinois qui était un homme entièrement à lui, et prit cette occasion d'aller voir ce prince qu'il n'avait encore, à ce qu'on a assuré, osé aborder depuis sa révolte.
Le roi lui fit de grands reproches et se plaignit, entre autres choses, de ce qu'il n'avait pas le pouvoir de faire la moindre libéralité. Voilà par exemple les père de San Paolo, lui dit-il, que j'ai fait venir de France, qui n'ont pas de quoi vivre, et je n'ai pas de quoi les assister. — Je venais en parler à Votre Majesté, lui dit Phetracha, qui était bien aise d'amuser ce pauvre prince par une ombre d'autorité qu'il lui laissait dans les choses de peu de conséquence. Et il fit venir en même temps le trésorier de l'épargne qui donna au roi la somme d'argent qu'il lui demanda.
Ce bon roi, pour faire plus d'honneur aux pères, leur envoya cet argent par le second mandarin du royaume avec une grande suite qui nous donna l'alarme dont j'ai parlé. Lorsque ce mandarin fut à leur maison et qu'il les eut tous assemblés, comme j'ai dit, il leur parla ainsi : Le roi mon maître conserve un souvenir particulier des grandes recommandations avec lesquelles le roi de France vous a envoyés en ce royaume. Sa Majesté vous a fait entretenir par M. Constance tandis qu'il a vécu. À présent que vous n'avez plus personne, elle appréhende que vous ne manquiez d'argent, et m'a chargé de vous en apporter de sa part. En même temps un esclave s'avança pour présenter sur un bandègeC’est ce qu’on appelle autrement cabaret, plateau, ou espèce de table à petits rebords, et ordinairement sans pieds, sur laquelle on met des tasses à café, des soucoupes, un sucrier et des cuillères lorsqu’on prend du thé, du café ou du chocolat. (Dictionnaire de Trévoux). de la Chine un cati (8), c'est-à-dire cinquante écus à chacun des sept pères, qui en sa présence mirent tout l'argent entre les mains du supérieur. Le mandarin reçut ensuite par écrit le remerciement des pères au roi, et n'y répondit que par une inclination de tête, disant seulement : Nous sommes dans un temps où il faut avoir la langue courte.
Les pères admirèrent la providence paternelle de Dieu, et touchés de la bonté du roi qui se souvenait d'eux dans sa misère, ils redoublèrent leurs prières pour la conversion de ce prince avant sa mort. M. Paumard et le père de Bèze lui portèrent plusieurs fois des paroles salutaires, mais comme il ne les entendait pas assez bien et que le médecin chinois, qui servait d'interprète, rendait fort mal leurs pensées, Dieu laissa leurs soins inutiles par un secret jugement qu'il ne nous appartient pas de pénétrer. Peu de jours après, ce pauvre prince mourut âgé d'environ soixante ans et accablé de maladies et de douleurs, d'avoir perdu la couronne et la liberté par la perfidie de ses favoris.
Tous ses sujets de l'un et de l'autre sexe se firent raser la tête pour se mettre en deuil selon la coutume du pays, et les principaux mandarins se vêtirent de blanc. C'est la couleur de deuil dans les Indes comme le noir est la couleur de joie. Pendant huit jours on fit dans le palais des concerts de trompettes et d'autres instruments. De trois en trois heures, les joueurs sortaient du palais montés sur des éléphants pour continuer leurs concerts par toutes les rues de la ville. Les talapoins dans leurs pagodes chantaient pendant la meilleure partie de la nuit, et des troupes de jeunes gens qui couraient les rues mêlaient à leurs chants des cris barbares, comme des gens qui se réjouissaient. Il était difficile de juger si c'était une pompe funèbre pour la mort du feu roi, ou une fête pour l'élévation du tyran (9).
On fit la cérémonie de mettre en liberté deux éléphants que le roi montait d'ordinaire. L'un s'en alla dans les bois, l'autre revint au palais. Phetracha, huit ou dix jours après la mort du roi, fut à la grande pagode de Louvo avec l'appareil et les marques de royauté, rendre grâces à ses dieux du succès de ses entreprises, et s'alla faire ensuite couronner à Siam. Toute la cour, le peuple et les chrétiens eurent ordre de le suivre. Les pères jésuites, que tout le monde avait cru devoir être pillés et massacrés, furent les seuls qui sortirent de Louvo sans rien perdre. Leur maison toute environnée qu'elle était de gardes fut pendant toute la persécution un asile inviolable pour tous les chrétiens qui purent s'y retirer. Leurs propres gardes adoucis devinrent dans la suite leurs domestiques, rendant à ces pères toutes sortes de services. On leur fournit des mirous pour transporter tout ce qu'ils voulurent à Siam où ils se retirèrent, après avoir laissé de l'argent pour vivre à cinquante ou soixante prisonniers qui ne furent tirés de Louvo que trois semaines après.

NOTES :
1 - Le père Le Blanc avait déjà évoqué ce jeune Français ayant eu le bras cassé d'un coup de mousquet et le talon emporté d'un éclat de grenade qui parvint à s'enfuir du navire de Saint-Cry avec le soldat La Pierre. L'Abrégé de ce qui s'est passé à Bangkok pendant le siège de 1688 conservé aux Archives Nationales sous la cote Col. C1/24 140r°-171v° relate : Le petit mousse se sauva à la nage. Les galères, enragées de ce qui venait d'arriver, lui tirèrent plusieurs coups de canon dans l'eau en le suivant, ce qu'ils firent longtemps, mais comme la rivière est d'ordinaire trouble, cela le favorisait, et d'ailleurs y ayant des petits îlots flottants sur lesquels il se reposait et cachait, cela le sauva. Il revint à Bangkok et est mort quatre mois après. (f° 155v°). Beauchamp confirme cette version : Saint-Cry qui, avec son soldat, La Pierre et un petit garçon, s'était retiré dans la sainte-barbe, dit au petit garçon de l'avertir quand il y aurait beaucoup de monde, et comme il lui eut dit que tout était plein, il fit sa prière, dit à La Pierre de se sauver, qui se jeta dans l'eau, son sabre à la main, puis prit par le bras le petit garçon, le jeta par un sabord dans la rivière, où l'ayant vu assez loin de la barque pour n'en être pas endommagé, il mit le feu au reste de ses poudres qui firent périr, avec lui et sa barque, tous les Siamois qui étaient dedans. Le soldat fut tué au milieu de l'eau, et le petit garçon eut un coup de mousquet dans le bras et se sauva à la forteresse où il dit ce qu'il venait de voir. (Bibliothèque Nationale, Ms. Fr. 8210 f° 537v° - 538r°). ⇑
2 - Lors de la révolte des Macassars, le chevalier de Forbin avait eu l'occasion de faire monter dans son balon l'oncle de Mme Constance. Il était métis, assez bonhomme, mais nullement guerrier. (Mémoires du comte de Forbin, 1730, p. 201-202). ⇑
3 - Ces bras-peints (ken laï : แขนลาย), ainsi appelés parce leurs bras scarifiés avaient été recouverts de poudre à canon, ce qui, en cicatrisant, leur donnait une couleur bleue mate, sont ainsi décrit par La Loubère (Du royaume de Siam, 1691, I, pp. 371-372) : Ils sont les exécuteurs de la justice du prince, comme les officiers et les soldats des cohortes prétoriennes étaient les exécuteurs de la justice des empereurs romains. Mais en même temps, ils ne laissent pas de veiller à la sûreté de la personne du prince, car il y a dans le palais de quoi les armer aux besoin. Ils rament le balon du corps, et le roi de Siam n'a point d'autre garde à pied. Leur emploi est héréditaire comme tous les autres du royaume, et l'ancienne loi porte qu'ils ne doivent être que six cents, mais cela se doit sans doute entendre qu'il n'y en doit avoir que six cents pour le palais, car il en faut bien davantage dans toute l'étendue de l'État parce que le roi en donne, comme j'ai dit ailleurs, à un fort grand nombre d'officiers. Ces bras-peints donneront toute la mesure de leur cruauté lors de la révolution de 1688. ⇑
4 - Il s'agissait des pères Monestier et Angelo. Le journal de la mission tenu par Bernard Martineau corrobore les dires du père Le Blanc : Je dirai seulement que les Siamois, pour ne pas manquer leur coup, vinrent à eux au nombre de 300 armés de mousquets, lances, sabres, avec trois éléphants portant chacun une pièce de canon ; il est vrai qu'il prirent encore 42 chrétiens qu'ils mirent aux fer avec eux. (Cité par Launay, Histoire de la mission de Siam I, p. 236). ⇑
5 - La notice biographique d'Antoine Monestier sur le site des Missions Étrangère Antoine Monestier indique que le missionnaire mourut en captivité en 1690 : Revenu à Juthia, il partagea le sort de l'évêque et des missionnaires incarcérés et maltraités lors du départ de l'expédition française commandée par Desfarges (1688-1689) ; il porta la cangue et les chaînes. Transporté dans une île du Mei-nam, il y mourut en 1690, le 30 septembre ou le 2 octobre, car les documents ne concordent pas sur la date de son décès. ⇑
6 - Thale Chubson (ทะเลชุบศร), une île au milieu d'un ancien lac à trois kilomètres de Lopburi, où le roi Naraï avait fait construire une résidence, le pavillon Kraisorn-Sriharaj (ตำหนักไกรสรสีหราช). On peut penser que la fraîcheur de l'eau rendait cette retraite agréable pendant les mois chauds. Elle était également connue sous le nom de Pratinang yen (พระตี่นั่งเย็น), la Résidence fraîche. Elle servait au roi Naraï pour les réceptions et pour séjourner lors de ses parties de chasse ou de ses promenades en forêt. ⇑
7 - Une très curieuse relation anonyme publiée à Londres en 1690 et intitulée A Full and True Relation of the Great and Wonderful Revolution that hapned lately in the Kingdom of Siam in the East-Indies affirme que la princesse Yothathep, fille unique du roi, fut également exécutée avec ses oncles et de la même manière, enfermée dans un sac de velours rouge et frappée avec de grosses bûches de bois d'aigle, afin que le corps royal ne soit pas pollué par le contact de mains vulgaires. Elle aurait ensuite été jetée dans le fleuve. D'autres sources indiquent qu'elle épousa Phetracha. Le père d'Orléans écrit : Le mariage que cet usurpateur [Phetracha] contracta, si nous en croyons quelques lettres, avec la princesse reine unique héritière du feu roi, l'affermit encore sur le trône ; et personne ne se trouvant en état de lui disputer, il en demeura possesseur paisible. (Histoire de M. Constance, p. 124). C'est la version retenue par l'histoire officielle thaïlandaise. ⇑
8 - Le cati, ou catti, mot probablement d'origine malayo-javanaise, n'était pas le nom d'une monnaie, mais le terme employé dans les relations occidentales pour désigner l'unité d'un poids d'argent, le chang (ชั่ง). Aujourd'hui, en Thaïlande, le chang est fixé officiellement à 600 g. On peut penser qu'il était légèrement supérieur au XVIIe siècle. ⇑
9 - Le roi Naraï mourut le 11 juillet, et ce décès coïncidait avec le début des cérémonies de Khao Phansa, l'entrée dans le carême bouddhiste, dont la pleine lune du 13 juillet allait marquer le début. Si la tradition de se faire raser la tête en signe de deuil est effectivement attestée par les relations de La Loubère et de Gervaise, c'est également un rite lié à Khao Phansa. Il est donc difficile de distinguer ce qui relevait spécifiquement du deuil du roi ou de la fête religieuse. Il est probable que les deux événements se mêlaient dans les cérémonies décrites par le père Le Blanc. ⇑

21 février 2019
