

Fin du livre VI.
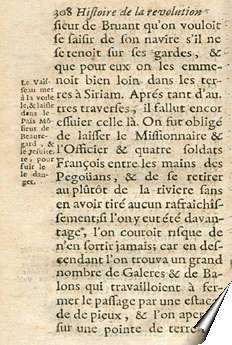
| Le vaisseau met à la voile pour fuir le danger et laisse dans le pays M. de Beauregard et le jésuite. |
On fut obligé de laisser le missionnaire et l'officier et quatre soldats français entre les mains des Pégouans et de se retirer au plus tôt de la rivière sans en avoir tiré aucun rafraîchissement. Si l'on y eût été davantage, l'on courait risque de n'en sortir jamais, car en descendant, l'on trouva un grand nombre de galères et de balons qui travaillaient à fermer le passage par une estacade de pieux, et l'on aperçut sur une pointe de terre une batterie de canon, d'où les gens du pays commencèrent à tirer sur la frégate. Pour comble de malheur, la marée vint à baisser, le vaisseau toucha et se pencha sur le côté, de sorte que notre canon ne pouvait tirer que dans l'eau d'un bord, et de l'autre en l'air. Il fallut demeurer ainsi à découvert sous le feu des ennemis qui auraient abîmé la frégate s'ils avaient eu de meilleurs canonniers.
Le retour de la marée la tira de ce danger en la mettant à flot. L'on força l'estacade et l'on sortit de la rivière, mais en se remettant en mer, on se trouva dans le même embarras où l'on était auparavant d'avoir des vivres dont la disette croissait tous les jours. Il est incroyable combien l'on a souffert dans ce vaisseau, partout chassé des terres et partout battu des vents à la mer, sans manœuvres, sans vivres, dans une saison où il était impossible de gagner aucun port ami. L'on se serait trouvé dans une espèce de désespoir si le courage des officiers et la confiance que tout le monde avait pris en la protection de la sainte Vierge ne les eût soutenus. L'on n'avait pour toute nourriture pendant un jour qu'une poignée de riz cuit à l'eau, soit qu'on fût malade ou en santé. Le commandant et les capitaines donnaient l'exemple en s'égalant au moindre des soldats, ce qui faisait que la misère étant commune et les fatigues partagées, on les souffrait sans murmure.
| Les Français vont un peu se rafraîchir dans l'île de Tavai qui est déserte. |
Cependant, la mer et les vents, de plus en plus intraitables, obligèrent M. du Bruant à chercher l'abri d'une île pour y passer la saison des ouragans. Il n'en trouva point de plus commode que celle de Tavay, où il avait déjà mouillé, toute déserte qu'elle fût. On y trouva pour tout rafraîchissement quelques tortues et une grande quantité de serpents d'une prodigieuse grosseur. La faim fut plus forte que l'horreur que l'on a de ces insectes ; le soldat affamé les faisait rôtir sur le rivage, et l'on n'eut plus d'autres vivres jusqu'à une autre aventure qui apporta quelques changements à la fortune de ces troupes errantes.
| Un vaisseau de la Compagnie française vint mouiller dans le même endroit et partagea avec eux toutes les munitions. |
Le 28 septembre, on aperçut un navire, mais sans pouvoir encore connaître quelle route il faisait, ni quel pavillon il portait. On jugea peu de temps après qu'il venait sur l'île où l'on était à l'ancre. M. du Bruant se défia de la route extraordinaire de ce vaisseau, vers une île déserte, et dans la mauvaise saison. Il crut que ce pouvait bien être encore les Siamois qui venaient pour le surprendre, et donna ses ordres pour les bien recevoir et régaler les prisonniers qu'il ferait sur eux de chair de serpent. Mais le vaisseau s'étant approché davantage, on fut agréablement surpris de voir le pavillon blanc à sa poupe. M. du Bruant fit aussitôt arborer le sien et tirer un coup d'assurance en cas que ce fût un navire français, mais il connaissait assez les Siamois pour juger qu'ils pourraient bien avoir encore employé ce dernier artifice pour le tromper. Il commanda au chevalier du Halgouët d'aller reconnaître le vaisseau dans sa chaloupe. Il y fut et trouva que c'était un Français, qui ne fut pas moins surpris de trouver en ce lieu une frégate avec pavillon blanc. Il la salua et vint jeter l'ancre près d'elle.
Le capitaine fut à bord de M. du Bruant et lui apprit que son bâtiment était à la Compagnie française, il s'appelait la Notre-Dame-de-Lorette, qu'il était parti de Pondichéry avec le navire le Coche pour Mergui, mais que le mauvais temps les avait séparés environ à la hauteur des îles d'Andaman, et qu'il croyait que le Coche aurait tenu la route et serait arrivé à Mergui. M. du Bruant témoigna à ce capitaine la joie qu'il avait de le voir venir si à propos pour secourir les troupes du roi, et lui dit qu'il fallait qu'il restât en cette île avec lui. Le capitaine lui remontra qu'il avait ordre d'accompagner le Coche à Mergui, que s'il voulait y venir avec eux, il aurait plus de secours de ce vaisseau que du sien. Plusieurs considérations empêchèrent le commandant d'accepter ce parti. Il arrêta le vaisseau pour le service du roi, et donna une décharge au capitaine en cas qu'il en fût inquiété. Ce bâtiment donna à la frégate la moitié de tout ce qu'il avait, ancres, câbles, voiles, pour le ragréer, et des vivres pour rétablir son équipage que la mauvaise nourriture et les autres misères avaient beaucoup affaibli. Ainsi la sainte Vierge sauva deux fois ces troupes, une fois du naufrage par un miracle évident, une autre fois de la famine en leur envoyant un vaisseau qui portait son nom, par une providence particulière.
| M. du Bruant fait mettre à la voile. |
M. du Bruant, se voyant en état de se mettre en mer, ne voulut pas demeurer plus longtemps à consumer les nouveaux secours qu'il venait de recevoir parmi des îles désertes. Il fit remettre à la voile au commencement d'octobre, et l'on prit la route de Bengale (1).
| La navigation est longue et fâcheuse. |
La saison n'était pas devenue plus favorable depuis trois mois. Ils trouvèrent même les mers plus rudes, et les temps plus fâcheux qu'ils n'avaient encore été. Ils furent battus de grosses tourmentes, souffrirent plusieurs coups de vents à démâter. Ils étaient obligés d'être une partie du temps à la cape, et s'ils allaient, ce n'était qu'en louvoyant, mais la force des vents et des marées leur faisait perdre à la dérive ce qu'ils pouvaient gagner en diverses bordées. En disputant ainsi contre les vents et les ondes, leurs vivres se consumèrent et ils se trouvèrent réduits à une plus grande nécessité qu'ils n'avaient encore été, ce qui les obligea à rechercher encore la terre.
| Le chevalier du Halgouët va chercher des vivres dans le royaume d'Arakan. |
Quoique toutes ces côtes infidèles leur fussent devenues également suspectes, ils relâchèrent dans la rivière d'Arakan, où le chevalier du Halgouët, oubliant l'aventure de Beauregard dans celle de Tavay, exposa généreusement sa liberté et sa vie pour le service du roi. Il fut à la ville capitale avec un missionnaire. Ils y trouvèrent un Français nommé Le Duc, qui était ministre général du royaume.
| Le premier ministre de ce royaume, Français de nation, fait toute sorte de caresses aux Français et leur fournit tout ce qu'ils demandent sans vouloir prendre leur argent. |
Ils lui firent récit de leurs longues traverses et lui demandèrent le secours dont les vaisseaux avaient besoin. Cet homme leur dit fort obligeamment que la bonne fortune qu'il avait trouvée dans ce pays ne lui avait jamais été plus agréable que ce jour-là, en lui donnant occasion de témoigner son zèle pour le service du roi leur commun maître, et de secourir des gens de sa nation. Il envoya faire ses compliments à M. du Bruant, lui fournit tout ce qu'il demanda et lui fit offre de tout ce qui était en son pouvoir. On voulut lui payer les vivres qu'on avait pris, mais il ne voulut rien recevoir, disant qu'il était assez récompensé par l'honneur qu'il avait eu de servir son roi et sa patrie. Quelques officiers, charmés de l'honnêteté qu'ils voyaient en cet homme, voulurent lui persuader de se retirer en France avec ses biens et lui dirent qu'il ne trouverait peut-être jamais une occasion de le faire aussi belle que celle qui se présentait de s'embarquer avec eux ; mais il les remercia, il avait sa famille et d'autres engagements d'honneur et de fortune qui l'arrêtèrent, quoiqu'il faille peu compter sur la fortune que l'on peut faire parmi ces infidèles qui dépouillent souvent ceux qui se sont enrichis parmi eux. Avec le secours du ministre d'Arakan, nos Français se virent en état de gagner Bengale. Il semblait que cette dernière rencontre avait fait changer pour eux la fortune. Les vents et les mers, tout leur était devenu favorable. Ils arrivèrent sans danger et sans peine dans la rivière de Bengale, mais il y a des malheurs opiniâtres qui s'attachent jusqu'à la fin à ceux qui ont une fois commencé d'être malheureux.
| Les Français se rendent dans la rivière de Bengale où les Anglais leur enlèvent les deux vaisseaux. |
Dans le port même que nos voyageurs cherchaient depuis si longtemps, une aventure plus fâcheuse que les précédentes les attendait pour terminer leur triste navigation. Les deux bâtiments entrés dans la rivière de Bengale avaient à peine mouillé l'ancre qu'ils se virent environnés d'onze vaisseaux de guerre anglais, qui firent sommer M. du Bruant de leur abandonner les deux frégates, dans la fausse pensée qu'ils avaient qu'elles appartenaient au roi de Siam avec lequel ils avaient la guerre. M. du Bruant eut beau leur représenter que bien loin d'être armés pour les Siamois, ils avaient été forcés par cette perfide nation d'abandonner Mergui après un mois de siège et de se sauver sur une frégate qui était à l'ancre dans le port, qu'ainsi ce bâtiment appartenait au roi par le droit de la guerre, et que l'autre était à la Royale Compagnie, le commandant anglais n'entra point dans ces raison et menaça M. du Bruant de l'enlever. La partie n'était pas égale, il fallut céder en protestant par un procès-verbal de la violence et de l'injustice que l'on lui faisait. Nonobstant toutes ces procédures, les Anglais retinrent les deux bâtiments et envoyèrent M. du Bruant à Madras. Il ne voulut pas prendre pour juge de ce différend le général anglais qui était dans cette ville, aimant mieux laisser au roi à s'en faire rendre en Europe la justice qu'il voudrait. Il passa de Madras à Pondichéry vers le 15 janvier 1689 avec ce qui lui restait de monde. Les Anglais offrirent quelque temps après au directeur de Pondichéry de rendre la Lorette, parce qu'elle avait été reconnue à Madras pour un bâtiment de la Compagnie, mais comme elle était en mauvais état, il ne la voulut pas recevoir, et en demanda le prix selon l'estimation que le sieur Deslandes en avait fait à Bengale.
Dans le récit que je viens de faire de la guerre de Mergui et du voyage de M. du Bruant, j'ai parlé du vaisseau le Coche, qui allait à Mergui avec la Lorette pour y passer la mauvaise saison. Comme les Français en étaient déjà sortis lorsqu'il y arriva, ceux qui liront ces mémoires auront apparemment quelque curiosité d'apprendre l'aventure de ce vaisseau dans ce port ennemi. Il faut les satisfaire, puisque cet incident n'est pas hors de mon sujet, et qu'il peut servir à donner une plus exacte connaissance de tout ce qui s'est passé dans la révolution du royaume de Siam.
Le vaisseau le Coche et l'autre bâtiment nommé la Notre-Dame-de-Lorette étaient partis de la rade de Pondichéry le 10 septembre 1688 pour aller hiverner à Mergui pendant la saison des ouragans, que les vaisseaux ne peuvent passer sans un extrême danger dans les rades forainesUne rade foraine est un lieu d'ancrage mal fermé, ouvert aux vents de la mer. de la côte de Coromandel. Les vents qui étaient contraire à M. du Bruant pour s'éloigner de Mergui, étaient favorables à ces deux bâtiments pour y arriver. Ils traversèrent le golfe de Bengale en peu de jours, mais quand ils vinrent à l'entrée des îles qui sont aux environs de celle de Mergui, dans un gros temps, la Lorette passa au nord d'une île pendant que le Coche la rangeait au sud, ce qui l'engagea à venir reconnaître le port de Tavay où elle trouva la frégate française. Le Coche fit mieux sa route, et vint mouiller à trois lieues de Mergui le 25 septembre.
| M. d'Armagnan, capitaine, prend ses mesures pour n'être point surpris en s'approchant de Mergui. |
Le sieur d'Armagnan qui commandait ce vaisseau avait eu ordre du directeur du Pondichéry, homme sage et brave, qui a une parfaite connaissance des affaires des Indes, de ne laisser descendre personne à terre avant que d'avoir des nouvelles certaines de la place et de la garnison française. Cette précaution est très nécessaire dans les Indes. Il leva l'ancre le lendemain 26 pour approcher du port, et en avançant, il tira plusieurs coups de canon de demi-heure en demi-heure en signe d'amitié, et comme pour demander à la forteresse du secours, ne doutant pas de M. du Bruant ne lui envoyât aussitôt des chaloupes pour savoir de quoi il avait besoin. Il ne vint qu'une petite nacelle (à la faveur de la nuit) d'où l'on cria en malais à qui était le vaisseau ? On répondit Français !, et la nacelle disparut aussitôt. Le capitaine jugea du silence des Français et de la retraite précipitée des Siamois qu'il y avait du changement à Mergui, et résolut de prendre langue avant que d'approcher du mouillage. Il fit armer sa chaloupe et son canot de perriersPetits canons qui armaient les embarcations et qui lançaient des balles ou de la mitraille., de grenades, de mousquets et de sabres, et le lendemain au lever du soleil, un balon siamois s'étant avancé pour reconnaître la contenance des nôtres, on détacha sur lui le canot qui lui donna la chasse quelque temps.
| Hostilité des Siamois. |
Quatre autres balons qui étaient en embuscade pour soutenir le premier s'avancèrent et arrêtèrent nos gens par le grande feu qu'ils firent de leurs perriers. Le sieur d'Armagnan envoya deux de ses officiers avec trente hommes dans sa chaloupe au secours du canot. Les Siamois prirent la fuite, mais les nôtres les joignirent à force de rames, et les obligèrent de se rendre. Ils demandèrent pourquoi ils avaient tiré sur eux, s'ils ne connaissaient pas le pavillon de France, ce qu'étaient devenu les Français, et pourquoi personne n'était venu leur parler.
| Artifice des Siamois pour exécuter leurs hostilités. |
Les Siamois leur dirent qu'ils avaient pris les armes à leur arrivée parce qu'un vaisseau portant pavillon blanc comme eux était venu peu de jours auparavant leur enlever des bâtiments jusque dans le port, et que les Français étaient allées à la ville de Siam pour garder la personne du roi, qui avait la guerre avec les Laos.
| Nouvelles hostilités. |
Pendant ce pourparler, les Français s'aperçurent qu'on s'assemblait sur le rivage auprès de deux galères. Ils résolurent entre eux d'aller attaquer ces gens-là, parce que si on leur donnait le loisir d'armer les galères, elles viendraient tomber sur eux. Ils s'en approchèrent, le boutefeuBâton muni d'une mèche servant à enflammer la charge de poudre d'une bouche à feu. (Larousse). sur les perriers, mirent tout en fuite, et trouvèrent en approchant que ce monde assemblé travaillait à fermer l'entrée du port avec des pieux.
| Nouveaux artifices pour surprendre les Français. |
Ils avaient commencé à les arracher, lorsqu'ils virent d'un autre côté venir à eux deux gros balons d'où l'on leur faisait des signes avec des chapeaux. Ces chapeaux leur firent juger que c'était des Européens, et qu'ils pourraient savoir par leur moyen des nouvelles plus certaines. C'était un Anglais et un Hollandais établis dans le pays. Ils dirent à nos Français les mêmes choses à peu près que les Siamois leur avaient dites, et avec de grandes marques d'amitié, et les invitèrent à descendre à terre pour parler au mandarin qui avait sa salle ou tribunal près du rivage. Les officiers firent avancer leurs gens le plus près qu'il purent de la salle, et furent saluer le mandarin, lui dirent qui ils étaient et le sujet qui les amenait. Le mandarin les reçut avec beaucoup d'honnêteté, leur répéta ce qu'on leur avait déjà dit, ajoutant qu'il était bien fâché de n'avoir point de rafraîchissement à envoyer ce jour-là au capitaine du vaisseau, mais que le lendemain il s'acquitterait de ce devoir et lui enverrait en même temps un pilote pour l'introduire, que cependant il le priait de se tenir au-delà de la barre, où l'on lui fournirait toutes les choses dont il aurait besoin, parce qu'il avait ordre de ne laisser entrer aucun vaisseau dans le port, par la crainte qu'on avait des Anglais. Les officiers prirent congé de lui et retournèrent faire le rapport de leur découverte au capitaine.
| Le mandarin les amuse. |
On attendit le lendemain tout le jour le pilote, mais il ne vint ni pilote, ni rafraîchissement. Les officiers retournèrent à terre. Sitôt qu'ils parurent, le mandarin fit mettre quelques fruits dans un balon, et en les saluant leur dit : Je suis au désespoir de n'avoir pu encore vous envoyer de pilote, on ne peut le trouver. Voilà un balon de rafraîchissement qui était tout prêt d'aller à votre bord, mais je n'ai pas voulu envoyer l'un sans l'autre ; à demain sans faute vous aurez tout. On retourna, on attendit, et le lendemain se passa sans qu'il parût de pilote. Le capitaine renvoya deux jours après ses officiers, mais en approchant, ils furent fort étonnés de voir tout le rivage bordé de balons remplis de gens armés. Ils ne voulurent point témoigner de défiance ni de crainte, ils allèrent à la salle, et furent encore plus surpris d'y trouver deux cents hommes sous les armes. Ils parlèrent au mandarin, lui représentèrent que le vaisseau coulait bas d'eau, qu'ils avaient besoin de mâts, et qu'après cette déclaration, le capitaine se déchargeait des accidents qui en pouvaient arriver. Le mandarin leur dit qu'il avait un fort beau mât, s'ils avaient cinq cents écus à lui donner d'avance pour y travailler ; que pour l'entrée dans le port, il n'osait encore la leur permettre sans en avoir reçu l'ordre, mais qu'il allait dépêcher un exprès à M. Constance, et que s'ils avaient des lettres pour lui ou pour les Français, il les joindrait à ses dépêches. On envoya prendre celles qui étaient dans le vaisseau, et le gouverneur les envoya à Phetracha. La nuit qui survint surprit les officiers encore à terre, et la marée qui était contraire les empêcha de retourner à bord. Ils demandèrent à manger et couchèrent dans la salle avec le mandarin. On sut depuis qu'on avait résolu de les égorger cette nuit-là, mais qu'ayant fait réflexion que cela ne servirait qu'à faire mettre davantage le capitaine sur ses gardes, on avait jugé qu'il valait mieux attendre qu'il vînt à terre pour l'arrêter lui-même et surprendre le vaisseau. En effet, ils demandaient tous les jours quand on aurait l'honneur de voir M. le capitaine.
| L'interprète portugais découvre aux Français l'artifice des Siamois. |
Il y avait quinze jours que le vaisseau mouillait parmi ces îles sans qu'on eût encore pu rien apprendre de certain, lorsqu'un jour le lieutenant étant à terre, un Portugais qui servait d'interprète lui dit en latin devant le mandarin même qui ne l'entendait pas : J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne puis vous parler en particulier, parce que ces barbares me feraient mourir. L'officier ne manqua pas de retourner le lendemain à la salle, et porta avec lui une boîte de tabac, duquel ayant présenté à tous les mandarins, il en présenta en dernier lieu à l'interprète, et lui mit la boîte dans la main en la lui serrant. Les mandarins ne se doutèrent de rien, mais l'interprète conçut bien le signal. Il sort de la salle, verse le tabac et trouve au fond de la boîte un billet par lequel on le priait de mettre par écrit les avis qu'il avait à donner. Il le fit en peu de mots, et promit d'en dire davantage si on voulait le venir prendre à terre et le sauver dans le vaisseau. Il donna un rendez-vous à dix heures du soir. La chaloupe le fut prendre au lieu assigné, où il était caché sur un arbre. Quand il se vit en sûreté dans le vaisseau, il raconta fort au long toute l'histoire de Mergui et la révolution du royaume, le gouverneur cependant le croyant à Tenasserim, où il avait demandé d'aller faire un voyage pour mieux cacher sa fuite.
| Artifice de M. d'Armagnan pour avoir un mât. |
Le capitaine avait besoin d'un mât pour retourner en France. Il lui fâchait de sortir de là sans en avoir, parce qu'il y en a des très beaux à Mergui, et qu'il ne savait où en prendre ailleurs. C'était un homme hardi qui avait été longtemps parmi les flibustiers. Il se déguisa en charpentier, prit une règle à la main, arma bien sa chaloupe, se fit commander par un de ses officier, demanda à voir le mât, et fit très bien son personnage : les mandarins firent encore mieux le leur, en l'amusant plusieurs jours, et ils avaient cependant laissé passer le vaisseau au-delà de la barre où il était déjà démâté, ce qui donnait beaucoup d'inquiétude au sieur d'Armagnan.
| Il en enlève un dans les forêts. |
Il s'impatienta et résolut d'enlever par force un mât des forêts. Il fut les reconnaître, en choisit un, le fit abattre et préparer sur les lieux. Les matelots étaient au travail jour et nuit, la hache à la main et les armes sous les pieds. Les Siamois tentèrent plusieurs fois de brûler le mât, mais ils n'osèrent attaquer les travailleurs. Avant que mât fût en état, il survint un incident qui changea la face des affaires.
| M. de la Touche apporte une lettre du général pour M. du Bruant. |
M. Desfarges, sur le point de sortir de Bangkok, renvoya l'officier de Mergui nommé la Touche avec des lettres pour M. du Bruant par lesquelles le général lui donnait avis qu'il quittait Bangkok pour se retirer à Pondichéry, et lui donnait ordre de l'y rejoindre et de sortir en paix avec eux. Mais M. du Bruant était bien loin de là, et la Touche l'alla chercher inutilement aux îles de Tavay. Nonobstant ces assurances de paix, les mandarins ne voulaient rien envoyer au vaisseau français, et les Français n'osaient aller à terre ; ceux-ci se contentèrent d'achever leur mât, ils le traînèrent jusqu'au bord d l'eau, le mirent à flot à la queue de la chaloupe, et l'arborèrent à la vue des Siamois.
Le sieur de la Touche demandait tous les jours aux mandarins d'aller au vaisseau lui signifier les ordres du général, mais on ne voulut jamais le lui permettre. Ils aimèrent mieux y envoyer des Malais pour faire savoir au capitaine qu'un officier de Bangkok demandait à lui parler à terre de la part de M. Desfarges.
| M. de la Touche obtient de parler aux Français. |
On mit les Malais aux fers dans le vaisseau comme des espions et des traîtres. Néanmoins les instances qu'ils faisaient qu'on envoyât la chaloupe pour parler de loin à l'officier français, et la résolution qu'ils témoignaient de vouloir mourir s'ils ne disaient la vérité, firent à la fin qu'on les crut. On fut à terre et l'on parla à l'officier. Le gouverneur siamois se trouva à cet entretien et témoigna aux Français le déplaisir qu'il avait d'avoir été obligé de les traiter en ennemis, que c'était des suites fâcheuses de la guerre, qu'à présent la paix était faite et qu'il fallait oublier le passé. Il commença depuis ce temps-là à leur envoyer quelques vivres.
| M. d'Armagnan vendit les marchandises et reçut toutes sortes de provisions. |
Le sieur d'Armagnan vendit les marchandises qu'il avait pour le compte de la Compagnie à un riche More établi à Mergui, et tira de lui des bœufs, de la volaille et d'autres provisions en abondance. Quand il se vit ainsi ravitaillé, et son vaisseau radoubé, il assembla ses officiers et leur dit qu'il était dans le dessein de ne point sortir de là sans avoir vengé le sang de leurs frères répandu sur le rivage, encore tout couvert de leurs ossements. Il fut résolut que le capitaine, avec vingt hommes, s'assureraient pendant la nuit de la batterie basse qui n'était défendue que d'une méchante palissade et n'était gardée que par quelques Malais ; que le lieutenant le soutiendrait avec trente hommes dans la chaloupe, et qu'un autre avec un mirou, dont on s'était saisi, irait couper les amarres et mettrait le feu à quelques frégates et galères qui étaient dans le port, mal gardées, et qu'ensuite on irait piller et désoler la bourgade. La Touche assista à ce conseil et approuva tout ce qui fut résolu. On en fit la proposition à l'équipage, tous s'écrièrent d'une voix qu'on n'avait qu'à les mener, qu'ils étaient prêts de répandre jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour la gloire de la nation. On commença cette expédition par arrêter l'Anglais et le Hollandais sur le vaisseau où on les avait attirés sous prétexte de voir de belles marchandises à bon prix. On les enchaîna et l'on leur dit qu'on allait tout brûler à Mergui. Ils se mirent à jeter de grands cris et prièrent le capitaine de considérer que cette action attirerait une persécution furieuse à tous les chrétiens du royaume. On se rendit à leur raison et à leurs larmes, le capitaine les renvoya et leva l'ancre le 20 novembre et tira le vaisseau d'un lieu si dangereux.
| Le vaisseau part et arrive à Pondichéry. |
Le 9 décembre, ce vaisseau vint heureusement mouiller à la rade de Pondichéry pour y prendre sa charge de marchandises pour la Compagnie et se préparer à son retour en France. M. le général qui arriva longtemps après, voulait rester comme j'ai dit, dans les Indes avec l'Oriflamme et les deux frégates siamoises qu'il avait emmenés de Bangkok. Il n'y eut que la flûte du roi, la Normande, qui fut destinée à faire le voyage de France avec le Coche. Pendant qu'on chargeait ces deux bâtiments, nous eûmes encore quelques jours de loisir pour nous instruire des affaires des Indes et recueillir de quoi satisfaire la curiosité de ceux qui souhaiteraient en France d'en savoir des nouvelles.
| Guerre des Anglais dans la rivière de Bengale. |
Nous trouvions que toute la côte occidentale du golfe de Bengale était depuis deux ans le théâtre de la guerre, des incendies, des inondations, de la peste et de la famine qui avait tout désolé depuis le royaume de Golconde jusqu'au cap de Comorin. Les Anglais de Madras avaient porté la guerre dans la rivière de Bengale, et pillé en 1687 les douanes des Mores, d'où ils emportèrent près de deux millions. Ils y retournèrent en 1688 avec quatorze vaisseaux de guerre, mirent à terre mille hommes qui firent le ravage à l'entour de Balassor, et furent obligés de se rembarquer sans avoir rien fait de considérable. Ce fut dans cette occasion qu'ils prirent comme j'ai dit les deux vaisseaux de M. du Bruant.
| Le Moghol avait pris Golconde. |
Le Moghol avait envahi tous les États de Golconde. Le sujet de cette guerre était le refus que le roi de Golconde, à la persuasion de son ministre, fit de payer quatre ou cinq années de tribut qu'il devait au Moghol qui envoya mettre le siège devant la capitale du royaume, la prit, la pilla, et réduisit le reste du royaume.
| Le prince Sumagie, fils du grand Silvagie, ami des Français dans ce pays-là. |
Le prince Saumagie, fils du fameux Silvagie qui avait fait longtemps la guerre au Moghol, usurpé sur lui près de quatre cents lieues de terre et pillé deux fois Surate, soutenait encore l'entreprise de son père, et il était campé à douze lieues de Pondichéry avec quinze mille hommes lorsque nous y arrivâmes. Il a des forteresses inaccessibles sur des roches au milieu des forêts, et il est bon ami des Français parce qu'ils n'y sont pas redoutables et qu'ils y font du commerce. Il ne permettra pas que dans cette guerre, leurs ennemis les viennent inquiéter sur ses terres, à moins qu'il ne se laisse gagner par argent, que les Hollandais n'épargnent point dans les Indes.
| Désolation de la ville de Masulipatan. |
La belle ville de Masulipatan, d'où l'on tirait tant de manufactures, avait été réduite en cendres par divers incendies causés trois fois par le feu du ciel, et d'autres fois par des accidents inconnus. Elle est ruinée de fond en comble, et entièrement déserte. Une partie des habitants fut enveloppée sous les ruines de leurs maisons, les autres gagnèrent la campagne. Personne ne songeait à rien emporter, mais à se sauver seulement de l'incendie. Après avoir été assiégés par feu, ils le furent encore par les eaux qui devinrent amères et se changèrent en sang. La famine et la peste qui suivirent de près ces premiers fléaux obligèrent les peuples à déserter plus de vingt lieues de pays aux environs de Masulipatan.
Tout le reste de la côté n'avait pas moins souffert, mais d'une manière différente. La désolation commença par des pluies qui inondèrent tout le plat pays. Les eaux croupissantes corrompirent l'air et causèrent la peste. Après qu'elle furent desséchées, il resta sur la terre un quantité effroyable de toutes sortes d'insectes qui firent mourir les herbes et dépouillèrent les campagnes. Les troupeaux mouraient faute de fourrage, et s'il y en avait quelque peu de réserve, les hommes également affamés l'ôtaient aux bêtes pour s'en nourrir eux-mêmes. La misère fut si grande et dura si longtemps que l'on ne voyait plus que des squelettes animés, et comme ces gens sont nus ou ne sont couverts que d'un grand linceul, on les aurait pris à les voir languissants, pâles et desséchés, pour des fantômes. Ils sortaient de leurs maisons, où ils n'avaient plus rien, et se traînaient dans les lieux publics, où ils espéraient de trouver quelques secours.
M. le directeur fit de grandes charités dans cette calamité publique. Depuis Pondichéry jusqu'à Madras, le chemin qui était de vingt lieues était tout couvert de cadavres pourris, sans sépulture, et de moribonds sans secours. Les pères et les enfants ne se connaissaient pas, et quand quelqu'un voulait secourir ou soutenir un de ses proches, ils tombaient tous deux et mouraient ensemble dans le même lieu. Des gens dignes de foi nous ont assurés qu'il était à peine resté la dixième partie des habitants de ce pays-là. Dans la ville de Madras, qui est aux Anglais, les maisons se donnaient pour rien à qui voulait les habiter ; mais quand on y entrait, on trouvait les chambres encore remplies de cadavres et de pourriture avec une puanteur insupportable. L'on commençait à respirer et à se rétablir sur la côte de Coromandel, quand nous y arrivâmes ; néanmoins les vivres y étaient encore fort chers, l'on n'en pouvait avoir pour les troupes qui venaient de Siam. On fut obligé de tuer et de saler pour elles des buffles, en attendant qu'on pût aller chercher de meilleurs vivres à Bengale. Mais le bâtiment qu'on y aura envoyé aura couru grand risque d'être pris à Balassor, quand les Anglais et les Hollandais auront su la guerre.
| M. le directeur fait bâtir un fort à Pondichéry. |
Pour se mettre à couvert de toute insulte, parmi tant de gens armés par terre et par mer dans tout ce golfe de Bengale, le directeur français faisait bâtir, avec l'agrément du prince du pays, une forteresse à Pondichéry. Il aurait bien souhaité d'y élever des bastions, mais on ne lui permit d'y faire que des tours, dont on lui prescrivit même le terrain et la figure. La saison qui était déjà bien avancée pour le voyage de France, fit presser l'embarquement dont j'ai parlé. Le R. P. le Royer, notre supérieur, m'ordonna de monter sur un des vaisseaux qui allaient mettre à la voile, pour venir rendre compte en France de l'état des missions royales de la Chine et des Indes. Je pris congé de M. le général, de M. l'évêque de Rosalie et de tous les officiers, et je quittai enfin nos père avec un sensible regret. Je puis protester que ce ne fut que l'obéissance et l'espérance de les aller rejoindre dans ces terres infortunées qui me consolèrent du voyage que j'allais faire dans des lieux auxquels j'avais renoncé avec joie pour jamais.

NOTES :
1 - Dans son Histoire de la Compagnie royale des Indes orientales (1905, p.152), Julien Sottas relate un peu différemment cet incident : Après une navigation assez mouvementée, du Bruant rencontra un navire de la Compagnie, le Notre-Dame-de-Lorette, qui lui fournit des vivres, et les deux navires gagnèrent ensemble la rade de Balassor. Une escadre anglaise de quatorze vaisseaux les y trouva, les arrêta comme appartenant au roi de Siam, à qui les Anglais faisaient la guerre, et les conduisit à Madras. – Note : [En arrivant à Madras, le Notre-Dame-de-Lorette s'échoua et se perdit, et pour couper court aux réclamations du comptoir de Pondichéry, le tribunal anglais de Madras le jugea de bonne prise ; au contraire, le Mergui fut rendu aux Français après jugement.] – De là, du Bruant et ses troupes se portèrent à Pondichéry où ils arrivèrent le 15 janvier 1689. ⇑

21 février 2019
