

Fin du livre II.
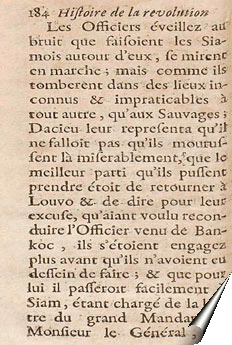
Les officiers, éveillés au bruit que faisaient les Siamois autour d'eux, se mirent en marche ; mais comme ils tombèrent dans des lieux inconnus et impraticables à tout autre qu'aux sauvages, Dacieu leur représenta qu'il ne fallait pas qu'ils mourussent là misérablement, que le meilleur parti qu'ils pussent prendre était de retourner à Louvo et de dire, pour leur excuse, qu'ayant voulu reconduire l'officier venu de Bangkok, ils s'étaient engagés plus avant qu'ils n'avaient eu dessein de faire, et que pour lui il passerait facilement à Siam, étant chargé de la lettre du grand mandarin à M. le général. Ils se séparèrent là et peu de temps après, les six officiers furent obligés de s'approcher des Siamois pour avoir des vivres. Un mandarin s'avança et leur dit que leurs armes faisaient peur à tout le peuple et qu'à moins qu'ils ne voulussent les mettre bas, personne n'oserait approcher d'eux pour leur apporter à manger ni leur servir de guide pour retourner à Louvo. Mais ils n'eurent pas sitôt quitté leurs armes que cette lâche et perfide populace, ne les craignant plus, se jeta sur eux, les dépouilla, les maltraita et les mena garrottés à Siam, d'où on les renvoya le même jour à Louvo attachés à la queue des chevaux qu'on faisait courir devant eux et qu'on les obligeait de suivre à coup de pieds et de bâtons.
Les Mores avaient cependant levé le siège de la pagode sur les avis qu'ils avaient eus que ceux qu'ils y croyaient enfermés tenaient la campagne. Ils y étaient accourus et ils trouvèrent ces officiers qui retournaient dans le triste équipage que je viens de dire. Ils se joignirent à leurs bourreaux pour décharger sur eux le dépit qu'ils avaient de leur ridicule expédition, et pour se consoler de n'avoir point eu de part à leurs dépouilles, ils voulurent en prendre aux cruautés qu'on exerçait sur eux. Bressy y succomba et mourut sur le chemin, assommé de coups, mais avec des sentiments fort chrétiens. Tous ces jeunes officiers, au milieu d'une foule innombrable de barbares qui les outrageaient, ne donnèrent aucune marque de faiblesse. Ils s'exhortaient à haute voix à tout souffrir pour Jésus-Christ, en haine duquel les Mores les frappaient au visage avec leurs sandales. Ils furent ainsi traînés à la porte du palais de Louvo, et de là envoyés en prison jusqu'à l'arrivée du général.
Le bruit qui courut qu'il était déjà parti de Bangkok augmenta l'insolence des infidèles et la consternation des chrétiens. Ce fut comme le signal qu'on attendait pour commencer, sans plus garder de mesures, la persécution générale, dont M. et Mme Constance furent les sujets les plus considérables, et par la grandeur des maux qu'on leur fit, et par le courage avec lequel ils les endurèrent.
| Les tourments indignes que l'on fit souffrir à M. Constance. |
Aussitôt que le ministre s'était vu entre les mains de son ennemi mortel, il n'avait plus douté de sa perte, et il ne pensa plus qu'à se préparer à sa fin. Il semblait que Dieu l'y disposât depuis quelques mois par les sentiments extraordinaires de piété qu'il lui avait inspirés au milieu d'une cour idolâtre et parmi l'embarras des affaires de tout un royaume dont il était chargé. Il prenait régulièrement sur ses autres occupations une heure le matin et autant le soir pour l'employer à la prière ou à une lecture dévote, et pour ne manquer aucun jour à assister à la messe, il faisait souvent une lieue sur un éléphant pendant des chaleurs excessives.
Quand il fut arrêté au palais avec le roi son maître, il abandonna tout le soin des affaires de ce monde et ne demanda aucune grâce que celle d'avoir ses livres de prières et un père jésuite auprès de lui pour ne plus penser qu'à l'éternité. On lui donna ses livres et on lui refusa le jésuite, en disant qu'on lui en enverrait un pour l'avertir quand il faudrait mourir. Le roi fit de grandes plaintes des traitements injustes qu'on faisait à ce ministre, l'unique de ses serviteurs qui lui fût demeuré fidèle, et fit dire plusieurs fois à Phetracha qu'il voulait l'avoir en sa chambre auprès de sa personne ; mais Phetracha répondit que ce criminel n'était pas dans un état assez décent pour paraître devant Sa Majesté et qu'elle pourrait être incommodée du bruit des chaînes dont il était chargé.
| Ce que fit Mme Constance pour délivrer son mari. |
Mme Constance était chez elle, abîmée pour ainsi dire dans la douleur et l'étonnement de ce qui venait de se passer et dans de mortelles frayeurs pour l'avenir. C'était un triste exemple de la vanité des choses du monde de voir cette maison, peu auparavant si florissante, tombée tout à coup dans la dernière désolation et remplie de cris et de larmes. Ceux qui venaient faire autrefois leur cour la fuyaient et personne ne voulait paraître y avoir jamais eu d'accès. Les Mores se promenaient insolemment devant sa porte, tant pour observer ceux qui voudraient y entrer que pour enlever les domestiques qui étaient obligés d'en sortir pour le service de sa maison, de sorte que la dame fut réduite en peu de jours avec tous ses parents à vivre de riz cuit à l'eau.
La nécessité lui donna de la résolution et le danger lui inspira du courage. On voyait cette jeune dame âgée de vingt-deux ans régler elle-même toutes choses au-dedans de la maison et donner les ordres qu'elle pouvait au-dehors avec une présence d'esprit peu ordinaire dans ces rudes occasions. Outre le danger où elle était de perdre son mari, elle avait une autre inquiétude pour son fils, qu'on lui avait enlevé trois jours auparavant en retournant à Louvo sans qu'elle en eût encore pu apprendre des nouvelles. Elle le fit demander au grand mandarin qui répondit assez obligeamment que ce rapt ne s'était point fait par son ordre ; qu'il ferait chercher l'enfant et le rendrait à sa mère. En effet, deux jours après, sa nourrice le rapporta. C'était des soldats qui l'avaient arrêté à la porte de la ville, lui avaient enlevé ses habits et une chaîne d'or qu'il portait au col, et pour cacher leur vol, ils avaient fait passer l'enfant de quartier en quartier. Sa nourrice, qui était une bonne siamoise, l'avait suivi partout malgré les insultes des gens de guerre, et le rapporta au logis quand Phetracha l'eut ordonné.
Cette première faveur du mandarin en fit espérer une seconde à Mme Constance pour la délivrance de son mari. Comme si elle n'eût attendu cette grâce que du ciel, elle commença à la demander par des prières extraordinaires qu'elle fit faire dans sa chapelle et par des grosses aumônes qu'elle fit distribuer aux pauvres chrétiens qui étaient dans les prisons ; et ensuite, comme si elle n'eût rien attendu que de ses propres soins, elle employa tous les moyens humains qu'elle crut pouvoir lui réussir. Elle envoya de beaux présents aux sancras ou supérieurs des talapoins qu'elle savait avoir beaucoup de crédit auprès de Phetracha, elle leur fit même offrir sous main de grosses sommes d'argent, s'ils voulaient s'employer à sauver M. Constance. Ils reçurent les présents, refusèrent les offres et répondirent que cette affaire surpassait leur crédit.
La dame ne se rebuta point. Elle avait entendu dire que la princesse fille du roi, qui était très grande pagodiste, était d'intelligence avec les talapoins et Phetracha, et pouvait beaucoup sur l'esprit de ce mandarin. Elle crut pouvoir la gagner, et comme rien ne se fait aux Indes que par intérêt, elle prit parmi ses bijoux divers ouvrages d'or et en fit faire une chaîne fort riche qu'elle envoya à cette princesse. Celui qui fut chargé de présenter la chaîne (c'était un secrétaire de la maison), ne rapporta à Mme Constance, pour répondre à ses honnêtetés, que la triste nouvelle qu'en traversant le palais, il avait vu son maître dans une enceinte de pieux, chargé de trois chaînes au col, aux mains et aux pieds, que s'étant voulu approcher pour lui parler, M. Constance s'était couvert le visage de son mouchoir. Ainsi la pauvre dame vit, avec ses présents, ses espérances perdues. La seule grâce qu'elle put obtenir fut la permission d'envoyer à son époux ce qui lui était nécessaire chaque jour pour son entretien, car elle savait que le mandarin, par une sordide avarice, le laissait manquer de toutes choses, et que par politique personne n'osait l'assister ni approcher de sa prison. Ce furent les derniers devoirs d'amitié qu'elle eut occasion de lui rendre avant sa mort. Elle lui préparait elle-même à manger et lui envoyait tous les jours du linge et des habits, et quand on lui rapportait ceux qu'il avait quittés, elle se faisait un triste plaisir d'y chercher les marques de ses chaînes et fondait en larmes en les regardant.
| Ce que le tyran fit souffrir à Mme Constance. |
Elle supporta avec plus de constance la perte de ses biens qu'on lui enleva peu à peu. Le 30 mai on vint lui demander les sceaux des chartes de son mari ; le lendemain on enleva ses armes, ses papiers, et ses habits, il en avait près de trois cents paires ; un autre jour on lui fit donner les clés de ses coffres auxquels on mit le scellé. L'on posa des corps de garde autour de sa maison et une sentinelle à la porte de sa chambre pour la garder à vue. Elle ne put s'empêcher à ce dernier coup de témoigner quelque ressentiment et de s'écrier : Qu'ai-je donc fait pour être traitée comme une criminelle ? Sur quoi deux pères jésuites lui ayant représenté que les chrétiens, qui avaient leur trésor et leur patrie dans le ciel, ne devaient point s'affliger comme les païens de la perte de leurs biens et de leurs libertés, à ce discours elle reprit sa première tranquillité et leur dit avec beaucoup de douceur : Il est vrai, mes pères, j'ai tort. Dieu nous avait tout donné, il nous ôte tout, son saint nom soit béni, je ne lui demande plus des choses d'ici-bas que la délivrance de mon époux.
Elle pria ensuite les jésuites de ne plus abandonner sa maison qu'elle jugeait devoir être en peu de jours exposée au pillage et aux violences des barbares. Les pères furent les seuls qui ne rougirent point de paraître attachés à cette famille, dans sa disgrâce comme dans sa prospérité, lui rendant tous les devoirs de charité et de reconnaissance jusqu'à la fin, malgré les insultes et les menaces des infidèles. Le scellé ne fut pas longtemps chez Mme Constance sans qu'on le vînt lever, comme elle l'avait prévu. Phetracha ne put dormir plus d'une nuit sur ces trésors cachés. Le lendemain 3 juin, à sept heures du matin, un mandarin suivi de cent hommes vint pour les enlever. La jeune dame, avec une fermeté que ces barbares admirèrent, les conduisit par les appartements de chambre en chambre, leur donna tout ce qui était à M. Constance, et sans attendre qu'on lui demandât ce qui était à elle, elle ouvrit son cabinet et l'abandonna au pillage avec ce qui y restait encore de précieux ; puis se tournant vers les pères qui l'accompagnaient : Enfin, leur dit-elle, nous n'avons plus que Dieu, mais personne ne nous l'ôtera.
C'était un spectacle touchant de voir ces barbares emporter tant de richesses avec des cris de joie et des éclats de rire, et cette dame affligée les regardait faire avec la même indifférence que si l'on eût enlevé les biens d'un étranger. Mais ce fut bien un autre spectacle plus triste, le même jour sur les six heures du soir, lorsque le même mandarin qui avait présidé au pillage, retourna avec la troupe de satellites, et dit à Mme Constance qu'il venait encore lui demander de la part du grand mandarin les trésors qu'elle avait cachés. Elle avait tout donné, mais elle n'avais pas encore assez donné pour ces gens avides qui avaient cru trouver des richesses immenses dans cette maison. Ils ne pouvaient se persuader que cette dame ne se fût rien réservé, parce que c'est la coutume parmi les Siamois d'enterrer leur argent et de souffrir toute sorte de supplices plutôt que de le déclarer.
Elle répondit froidement au mandarin qu'il ne lui restait rien et qu'il pouvait faire chercher partout. Sans sortir d'ici, reprit le barbare, je te ferai tout apporter, ou je te ferai tourmenter jusqu'à mourir, et en même temps, il fit avancer deux bras-peints, ou exécuteurs de justice, avec des cordes pour l'attacher, et des rotins ou petites cannes pour la frapper. Cette pauvre dame se jeta à ses pieds toute éperdue en lui criant en langue siamoise : En douteutEndu thoe : เอ็นดูเธอ c'est-à-dire Ayez pitié de moi, à quoi le barbare ne répondit jamais que ces mots : En dou midaüEndu mi daï : เอ็นดูมิได้, Je n'ai point de pitié.
Les parentes de Mme Constance et toutes ses filles, jusqu'aux petits enfants qu'elle élevait dans sa maison, voyant leur maîtresse en cette posture, se prosternèrent avec elle en terre autour du mandarin et il s'éleva un cri confus de cette troupe d'innocents qui demandaient miséricorde, capable d'émouvoir une bête farouche. Le Siamois n'en fut point touché. Il fit attacher la dame par les mains à la porte de sa chambre et la menaça que si elle ne déclarait ses trésors, il l'allait faire mourir sous les coups. En effet, il la fit tourmenter aux bras, aux mains et aux doigts, depuis sept heures jusqu'à neuf en présence de son aïeule, de deux de ses tantes, de son fils et de tous ses domestiques qui fondaient en pleurs. Elle fut ensuite enlevée avec ses tantes et ses filles, et l'on ne laissa dans la maison que la bonne dame son aïeule, parce qu'elle était si malade que l'on ne crut pas la pouvoir transporter sans la faire mourir.
Le même jour qu'on mît des gardes à la maison de M. Constance, on en avait mis aussi à celle des pères jésuites, mais par une conduite assez irrégulière, on leur laissait la liberté de sortir pendant le jour pour assister les chrétiens dans les prisons. Il faut bien dire que leur heure n'était pas encore venue, et peut-être que la providence ne les avait amenés dans ce royaume que pour encourager les fidèles à confesser, comme ils firent, Jésus-Christ dans la persécution. Il est vrai que quand on posa les corps de garde aux portes de la maison de ces pères, le peuple paraissait furieusement animé contre eux. On avait fait courir le bruit qu'ils étaient envoyés par le roi des chrétiens pour détruire la religion des Siamois, et qu'on en avait mis trois dans les pagodes pour observer les talapoins et les discréditer. Tout cela n'était pas éloigné de la vérité et c'est ce qui faisait espérer aux pères avec plus de certitude l'effet des menaces qu'on leur venait faire tous les jours, de les piller et de les mettre aux fers avec les autres chrétiens.
Il y eut défense de rien porter à vendre à leur maison, et leurs domestiques n'avaient pas la liberté de sortir pour aller acheter des vivres. Ces pères étaient obligés d'aller eux-mêmes chercher du riz et quelques poissons secs pour eux et pour les chrétiens qu'ils nourrissaient dans les prisons, mais en passant par les rues, les corps de gardes qu'on avait posés dans divers quartiers de la ville les arrêtaient comme des gens qui s'étaient sauvés des mains de leurs gardes. On les fouillait, on les menait devant les tribunaux, on leur jetait des pierres et en passant devant les pagodes, on les voulait obliger à faire la zombaie (1). Les petits enfants mêmes leur donnaient des marques de la haine publique en s'enfuyant devant eux et leur disant des paroles injurieuses, au lieu des caresses qu'ils leur faisaient auparavant. Les plus modérés leur portaient compassion, mais tous généralement les regardaient comme des victimes destinées à la mort.
Comme ces pères savaient ce qui s'était passé la veille chez Mme Constance, il y furent le lendemain pour donner quelque consolation à cette famille affligée, mais ils furent fort surpris de ne trouver dans la maison que la désolation et la solitude ; néanmoins, comme il leur vint en pensée de visiter les appartements, ils rencontrèrent dans une chambre la bonne aïeule de Mme Constance qu'on avait laissée malade à l'extrémité. Elle leva ses mains et ses yeux aux ciel, regardant les pères comme des anges tutélaires que Dieu lui envoyait dans cet extrême abandon. Elle était encore si étonnée et si pénétrée de douleur de ce qui était arrivé, qu'elle fut quelque temps sans pouvoir s'expliquer ; enfin étant un peu revenue à soi, elle leur dit qu'on avait tourmenté sa fille jusqu'à neuf heures et qu'ensuite on l'avait enlevée avec toutes ses filles sans qu'elle en sût davantage. Mais la providence découvrit, peu de jours après, le lieu où l'on l'avait transportée, de la manière que je vais dire.
Les pères jésuites, pour soulager plus facilement tous les chrétiens, avaient partagé entre eux les quartiers de la ville, et chacun parcourait tous les jours le sien, s'informant de l'état et des besoins des prisonniers pour y pourvoir. Un des pères, retournant à la maison après sa visite, passa par hasard près des écuries du palais et fut aperçu par une des tantes de Mme Constance. Cette femme pria ses gardes de la laisser sortir pour aller demander quelque argent au père qui passait, promettant de leur en faire part. Elle l'obtint et vint se présenter au père, mais elle n'eut pas le courage de lui demander l'aumône. Elle tendit la main et se mit à pleurer. Elle lui montra une petite écurie où était Mme Constance et son fils, et lui raconta comment, après avoir été tourmentée pendant deux heures, on l'avait portée dans cette écurie, où elle était couchée à terre sur un morceau de natte, et que ses filles avaient été emmenées par les gens du mandarin.
Le père n'avait plus que quarante sols du reste de ses aumônes. Il voulut aller à la maison pour en prendre davantage, mais la dame ne voulut pas lui en donner le loisir et le pria même de ne pas la suivre pour ne point donner de défiance à ses gardes. Peu de temps après, le père le Royer, supérieur des jésuites, alla faire offre à Mme Constance de tout ce qui était dans leur maison, et dès ce jour-là, les pères commencèrent de porter à manger à cette famille, ce qu'ils ont toujours continué du depuis. Mme Constance partageait ce qu'on lui apportait entre les siens, sans se réserver presque rien pour elle. Elle en envoyait une partie à son mari prisonnier dans le palais, une autre à sa mère qui était dans une prison séparée avec sept enfants, et le reste à ses oncles et à ses tantes, parce qu'elle avait fait vœu de s'abstenir de viande le reste de ses jours et ne vivait plus dès lors que de riz cuit à l'eau et de poisson séché au soleil.
| Arrivée du général français à Louvo. |
Les choses étaient dans cet état à Louvo quand le général des Français y arriva. On n'avait pu se dispenser de lui porter à Bangkok l'ordre que Phetracha lui envoyait de venir à la cour (2). Il délibéra longtemps sur le parti qu'il prendrait. Comme il avait jugé auparavant qu'un général ne devait point quitter sa place sur la foi même d'un ministre chrétien et ami qui l'appelait à son secours, il jugeait qu'il devait encore bien moins en sortir sur la parole d'un païen et d'un rebelle. La pluralité des voix allait à se tenir dans le fort, mais quand on vint à considérer comment on s'y pourrait défendre, on trouva que la place était encore ouverte en plusieurs endroits, qu'on y était sans munition de guerre et de bouche et que la garnison affaiblie n'était pas en état d'y soutenir un long siège. Ainsi l'on voyait avec inquiétude qu'il était très dangereux de monter à Louvo dans un temps de révolte et qu'il n'était pas plus sûr de demeurer dans Bangkok. Il fallut néanmoins se déterminer. On le fit, et l'on risqua tout pour sauver tout. M. le général prit le parti d'obéir parce qu'il y trouvait deux avantages : l'un que la confiance qu'il marquait en se mettant entre les mains des Siamois était un témoignage de ses droites intentions, qui leur ôterait peut-être les ombrages fâcheux qu'ils pourraient avoir ; l'autre que son voyage donnerait le loisir à la garnison de fermer les brèches, d'amasser des vivres, de monter les batteries.
Il partit de Bangkok le 31 mai. Avant son départ, il fit jurer M. de Vertesalle, lieutenant du roi qu'il laissait commandant dans la forteresse, que quelque ordre qu'on lui pût apporter de sa part, il ne rendrait jamais la place. Puis se tournant du côté du mandarin Monpan (3) qui devait l'accompagner, il lui dit que s'il avait quelque chose à lui demander qui concernât la forteresse ou la garnison, il la lui proposât pendant qu'ils étaient dedans, parce qu'aussitôt qu'il en serait dehors, il n'y aurait plus de commandement.
Il s'embarqua avec M. de Lionne et prit encore avec lui son fils aîné pour témoigner plus de confiance. Il ne fut pas hors de la place sans s'apercevoir que tout ce qu'on avait dit des biens et des charges de M. Constance n'était qu'un artifice et qu'il n'avait pas même sa propre liberté, car il fut en peu de temps environné d'un grand nombre de balons armés, qui sous prétexte de lui faire honneur, le menaient comme en triomphe avec des chants et des cris barbares. Il prit le sieur Véret en passant par Siam et ils arrivèrent le deuxième de juin à Louvo, où ils trouvèrent le roi prisonnier, Phra Pi égorgé, M. Constance chargé de chaînes, Mme Constance dans une écurie, réduite à l'aumône, les officiers français dans les fers, dépouillés et meurtris de coups, les jésuites gardés dans leur maison et tous les chrétiens prisonniers.
On ne donna pas à ces messieurs le loisir de s'informer de ces choses ni de se délasser de leur voyage. Ils furent conduits droit au palais, où le tyran avait pris plaisir d'assembler ce jour-là un grand nombre de mandarins. Il était assis sur des carreaux de velours, ayant quatre sabres à ses côtés. Il fit asseoir le général sur un tapis étendu à terre et fit placer derrière lui un de ses satellites avec un sabre nu pour l'intimider. Il lui dit d'un ton menaçant qu'il courait d'étranges bruits des Français, et qu'il l'avait appelé pour répondre aux plaintes qu'on avait faites d'eux à la cour. Qu'il voulait savoir premièrement ce que les Français étaient venus faire dans le royaume. Secondement pourquoi ils avaient maltraité les Siamois à Bangkok. En troisième lieu pour quel dessein il venait lui-même à Louvo avec des troupes, et ce qui l'avait obligé de changer de résolution étant à Siam. En quatrième lieu pourquoi les officiers français s'étaient voulu enfuir de la cour, et si c'était par son ordre.
Le général, un peu interdit, voulut répondre à tous ces chefs, mais le mandarin l'interrompant brusquement : Je en reçois point, lui dit-il, vos justifications aujourd'hui. Le roi veut que vous tiriez toute la garnison de Bangkok pour venir ici rendre compte de leurs actions avec vous, et alors si Sa Majesté est satisfaite de ce que vous avez à dire, elle vous fera rentrer dans la place, ou vous enverra faire la guerre aux peuple de Laos ses ennemis.
M. Desfarges lui répondit qu'étant hors de sa place, il n'y avait plus d'autorité et que tous les ordres qu'il enverrait à la garnison d'en sortir seraient inutiles. Telle était la discipline des troupes de France, qu'il fallait qu'il rentrât dans Bangkok pour donner au roi la satisfaction qu'il souhaitait, et prit Monpan à témoin du serment de M. de Vertesalle. Dieu, confondant en cette occasion la fausse prudence des infidèles, leur empêcha de voir les avantages qu'ils avaient entre les mains. Ils tenaient le général avec ses deux fils et cinq autres officiers, messieurs les évêques avec leur séminaire et les pères jésuites, le chef de la faiturie française avec tout son monde, et il ne leur aurait pas été difficile d'attirer le reste des Français ; mais la timidité que ces messieurs affectèrent à l'audience les sauva. On crut qu'ils parlaient de bonne foi et qu'ils feraient jusqu'à la fin comme ils avaient commencé.
Ainsi il fut résolu qu'on les enverrait à Bangkok. Au sortir du palais, on les conduisit dans la maison de M. Constance où l'on leur servit à manger dans l'appartement des ambassadeurs de France. Le roi prisonnier apprit l'arrivée de M. le général. Il en témoigna beaucoup d'inquiétude et fit dire par ses médecins chinois au père de Bèze, jésuite, et à M. Paumard (4), prêtre missionnaire, qui allaient tous les jours au palais pour la santé de ce prince, que ce n'était point par son ordre qu'on l'avait appelé, et qu'il avait fait une grande faute de se mettre à la discrétion de leur ennemi commun.
C'était le sentiment de ce bon prince, ce n'était pas celui de ceux qui avaient fait la démarche. Ces messieurs n'avaient rien fait sans doute que par de bonnes vues, ils croyaient mettre la forteresse à couvert en témoignant plus de complaisance pour Phetracha qu'on n'en avait eu pour M. Constance, mais par un événement assez particulier, ils perdirent en celui-ci un bienfaiteur et trouvèrent en celui-là un tyran qui commença par piller ceux qu'il avait employés pour venir à ses fins. Après le repas les mandarins qui étaient venus ambassadeurs en France proposèrent à M. le général d'écrire à M. du Bruant pour lui ordonner de sortir avec ses troupes de Mergui et de le venir joindre à un rendez-vous qu'on lui marqua, pour aller ensemble faire la guerre aux ennemis du roi de Siam. Il s'en défendit autant qu'il put et demanda plusieurs fois que si le roi n'agréait plus le service des Français, on leur permît d'acheter des vaisseaux pour se retirer du royaume.
Les Siamois éludèrent ces demandes par des compliments affectés, et il fut obligé d'écrire la lettre dans les termes qu'on lui prescrivit. Le mandarin, après cela, lui envoya deux pièces d'étoffe de la Chine, le priant de les accepter comme une marque de la satisfaction qu'il avait de sa conduite, et il pouvait encore ajouter, comme un appât pour l'engager à revenir avec plus de sécurité et lui amener ses troupes. Ce fut dans cette espérance qu'il le renvoya dès le même jour dans sa place ; mais pour la sûreté de son retour, on retint ses deux fils avec quatre autres officiers (5) qui furent mis à la chaîne deux à deux, en attendant leurs compagnons de Bangkok.
| La mort de M. Constance. |
Le lendemain, Phetracha, voyant le peu d'intérêt que les Français prenaient à la cause de M. Constance, jugea qu'il pouvait sans danger se défaire de cet ennemi pour lequel il avait jusque-là appréhendé que les Français et les autres chrétiens ne fissent un parti. Il le fit mourir le jour même. On n'a jamais bien su tous les tourments qu'on lui avait fait souffrir avant que d'en venir là, pour l'obliger à confesser les crimes qu'on lui supposait. Les uns ont dit qu'on lui avait brûlé d'abord la plante des pieds pour l'empêcher de s'enfuir (6), et que l'ayant appliqué à la question, on lui avait serré les tempes avec un instrument de fer, et déchiré tout le corps à coups de rotin. Les autres ont cru qu'on lui avait coupé les pieds et les mains et qu'on lui avait laissé longtemps au col la tête du malheureux Phra Pi, pour faire croire qu'il avait été son complice. Il ne faut pas douter que ces barbares n'aient exercé sur lui de grandes cruautés selon leur esprit vindicatif et sanguinaire. Ce ne sont pas des supplices trop rigoureux parmi eux que de brûler à petit feu, de faire frire les hommes dans des poêles d'huile bouillante et les y plongeant peu à peu, d'attacher un tigre affamé auprès d'un patient, de telle sorte qu'il ne puisse lui manger que les extrémités, de faire avaler des métaux fondus, et de nourrir longtemps des hommes de leur propre chair qu'ils leur coupent et qu'ils font griller en leur présence.
Mais si l'on n'a pas su les tourments qu'avait souffert M. Constance en sa prison, on a du moins su le genre de sa mort. Le 5 juin, veille de la Pentecôte, on lut publiquement dans la salle du palais une sentence par laquelle, sans avoir gardé aucune formalité de justice, on déclarait Constantin Phaulkon, ci-devant grand Okya et ministre d'État, criminel de lèse-majesté et convaincu de haute trahison, pour avoir introduit des étrangers dans le royaume pour de mauvais desseins et avoir conspiré avec Mon Pi contre le roi et la maison royale ; pour lesquels crimes Phetracha, par l'autorité qu'il en avait reçue du roi, le condamnait à mourir ce jour-là même.
Sur les six heures du soir on le mit sur un éléphant pour être conduit avec une bonne escorte dans les forêts de Thale Chubson. Ceux qui marchaient près de lui remarquèrent qu'il avait le visage pâle et abattu, mais le regard assuré, la voix ferme, et tout l'air de sa personne doux et tranquille, sans se plaindre ni sans donner des marques d'inquiétude ou d'appréhension de la mort. Il récitait pendant tout le chemin des prières à voix basse et prononçait de temps en temps tout haut les noms de Jésus et de Marie. Quand on fut arrivé au lieu destiné à son supplice, on lui fit mettre pied à terre. Tous les gens de l'escorte l'environnèrent. Sorasak, fils de Phetracha, présidait à cette exécution, son père n'ayant pas voulu la confier à d'autres qu'à lui.
M. Constance se tourna de son côté et lui demanda quelques moments de délai pour faire sa prière avant que de mourir. Il la fit à genoux au milieu de ces infidèles, qui tout barbares qu'ils étaient, ne pouvaient s'empêcher d'être touchés en voyant devant eux dans cet état déplorable celui qu'ils avaient vu peu auparavant sur leur tête dans la splendeur et l'éclat. Après sa prière il leva les yeux et les mains au ciel et protesta qu'il mourait innocent de tous les crimes dont on l'avait accusé, mais qu'il mourait volontiers avec le témoignage que lui rendait sa conscience de n'avoir rien fait en tout cela que pour la gloire du vrai dieu, le service du roi et le bien du royaume ; qu'il pardonnait sa mort à ses ennemis, priant notre seigneur Jésus-Christ, qui était mort pour lui, de lui faire pareillement miséricorde. Il s'adressa encore au jeune mandarin pour lui recommander Mme Constance et son fils, lui disant d'une manière fort touchante que quand il serait coupable ils étaient innocents ; qu'il ne demandait pour eux ni richesses ni grandeur, mais seulement la liberté et la vie.
Après cela ayant encore levé les yeux au ciel, il fit le signe de la croix et s'abandonna entre les mains de ses exécuteurs, sans savoir quel genre de mort on lui préparait. Un bourreau s'avança et du revers de son sabre le fendit par le milieu du corps. Il tomba mourant sur son visage et poussant un grand soupir. On acheva de lui ôter la vie en lui tranchant la tête de plusieurs coups. Ainsi mourut en la fleur de son âge Constantin Phaulkon, digne d'une meilleure destinée. Mais si sa mort paraît tragique aux yeux des hommes, elle est précieuse devant Dieu dont les jugements sont bien différents des nôtres. Ayant eu le malheur d'être élevé dans la religion anglicane, il en reconnut la fausseté et l'abjura entre les mains des jésuites portugais (7). Il a été pendant le reste de sa vie l'appui de notre sainte foi dans les Indes, et à sa mort un exemple de fidélité envers son prince prisonnier, en allant mourir à ses pieds. Heureux d'avoir été sacrifié pour de si justes causes, et plus heureux encore si avant que de mourir il avait pu seconder avec succès les desseins du plus grand roi du monde pour l'établissement du christianisme dans l'Orient, comme il le désirait si ardemment et comme il l'avait si sagement projeté.
Mais reprenons le cours de notre histoire. Il se présente ici deux choses, qui pour être arrivées en même temps incontinent après la mort de M. Constance, sembleraient devoir être décrites ensemble, savoir le siège de Bangkok et la persécution des chrétiens à Louvo ; mais parce que ces sujets sont trop différents et que les événements se sont passés dans des lieux éloignés l'un de l'autre, j'ai cru qu'il ne fallait pas les mêler confusément selon la suite des jours. On prendra plus de plaisir à voir ces deux événements sans interruption, et après avoir appris ce qui s'est passé dans quelques mois à Bangkok, on retournera sans peine sur le temps passé pour être spectateur de ce qui se faisait à Louvo et dans le reste du royaume.

NOTES :
1 - Les mots sombaye, ou zombaye, fréquemment employés dans les relations françaises, sont des transpositions du portugais sumbra çumbaya, sumbaïa sumba, etc. L'origine en reste obscure. Il pourrait s'agir d'une déformation du mot malais sěmbah, une salutation, une respectueuse adresse, l'acte de salutation ou d'hommage consistant à élever les mains au visage, (Dictionnaire anglais-malais de R. J. Wilkinson, Singapour, 1901, p. 404) ou de son dérivé sěmbah-yang (vénération de dieu, prière, rituel). Le dictionnaire Hobson-Jobson de Yule et Burnell (p. 850) cite les mots Somba, et Sombay, du malais présent, cadeau. Peut-être est-ce le même mot que le Sěmbah de Wilkinson, les cadeaux, les présents étant habituellement offerts en Asie aux personnes à qui l'on souhaite rendre hommage. ⇑
2 - Une petite pique contre l'abbé de Lionne qui, on s'en souvient, avait déchiré les lettres par lesquelles les jésuites suppliaient Desfarges de ne pas se rendre à Louvo. ⇑
3 - Kosapan. ⇑
4 - Étienne Paumard (vers 1640-1690) était un missionnaire des Missions Étrangères. Ses connaissances médicales lui permirent d'approcher le roi et les hauts dignitaires, et d'échapper à la rigueur de la persécution qui frappait les Français. On trouvera davantage de détails biographiques sur le site des Missions Étrangère à la page Étienne Paumard. ⇑
5 - Ces quatre autres officiers étaient MM. de Fretteville, de Saint-Vandrille, de Lasse et Des Targes (Relation anonyme, A.N. Col. C/1/24, f° 149r°). ⇑
6 - C'est notamment ce que prétend Beauchamp. (Manuscrit Bibliothèque Nationale Fr 8210, f° 522v°). ⇑
7 - C'est le jésuite flamand Antoine Thomas qui obtint la conversion de Phaulkon. Tachard écrit : Il abjura son hérésie entre les mains du Père Thomas (Voyage de Siam des pères jésuites, 1686, p. 193). Claude de Bèze donne d'autres précisions : Comme il n’avait jamais fait profession d’aucun dogme hérétique, on ne lui fit pas faire d’abjuration, comme quelques-uns ont dit, mais on se contenta de le réconcilier à l’Église par une profession de foi qu’on lui fit faire publiquement, lui-même le demandant ainsi, pour réparer par-là en quelque manière, le scandale qu’il avait donné auparavant par son éloignement de l’Église. (Drans et Bernard, op. cit., p. 30). ⇑

21 février 2019
