


Début du livre II.

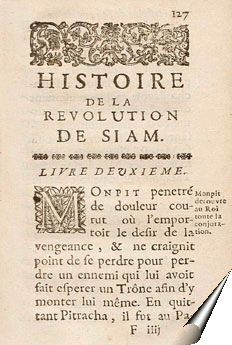
ON PI, pénétré de douleur, courut où l'emportait le désir de la vengeance et ne craignit point de se perdre pour perdre un ennemi qui lui avait fait espérer un trône afin d'y monter lui-même. En quittant Phetracha, il fut au palais, entra dans la chambre du roi, se jeta à ses pieds, et les larmes aux yeux, lui découvrit tout le secret de la conspiration dans laquelle Phetracha l'avait malheureusement engagé. Il lui raconta comme ce méchant homme, abusant de la faveur dont Sa Majesté l'honorait, avait soulevé les mandarins, les talapoins et le peuple sous le prétexte spécieux de défendre la religion et la liberté publique contre les étrangers que M. Constance avait introduits dans le royaume ; que le dessein des conjurés était de se défaire de ce ministre, de s'emparer du palais, d'arrêter Sa Majesté et de perdre la famille royale ; que Phetracha, pour l'engager dans ce parti, l'avait aveuglé de l'espérance de la couronne ; que les détestables artifices dont ils s'étaient servis ensemble pour réussir dans leur entreprise avaient été de surprendre et de contrefaire les sceaux du roi pour donner de faux ordres aux gouverneurs et aux officiers, de leur envoyer des hommes et des armes ; que les environs du palais en étaient remplis et que Sa Majesté n'y était pas en sûreté.
Le roi écouta ce discours avec un trouble qui l'empêcha quelque temps d'y répondre, également surpris de voir un homme à ses pieds s'accuser des crimes les plus atroces, et effrayé du danger où il était par la perfidie de ses deux plus grands favoris. Il ordonna à Mon Pi de demeurer au palais et il envoya quérir sur le champ M. Constance. C'était à six heures du soir le 17 mai. Aussitôt qu'il parut : Dia-vit Kiai gen, lui dit le roi – c'était le nom de Siamois de M. Constance (1), je me repose sur vous du gouvernement de l'État, et j'apprends par un autre que l'on conspire contre moi. Comment s'est-il pu faire que vous n'en ayez rien su ou pourquoi, l'ayant su, ne m'en avez-vous rien dit ?
| M. Constance justifie sa conduite auprès du roi. |
Sire, répondit M. Constance, je supplie Votre Majesté de vouloir m'écouter, et si elle n'est point satisfaite de ma conduite, voici ma tête que j'apporte à ses pieds. Il y a près de deux mois, Sire, que je me suis aperçu que Phetracha remuait dans le royaume, mais comme Votre Majesté était déjà malade en ce temps-là et hors d'état d'agir, je crus que les avis fâcheux que je pouvais lui en donner ne serviraient qu'à augmenter son mal sans remédier aux désordres du royaume. Mais, Sire, ne pouvant pas encore en parler à Votre Majesté, j'ai tâché de donner tous les ordres qu'elle m'aurait commandé elle-même de donner pour prévenir les malheurs. J'ai cherché des preuves convaincantes de la mauvaise volonté de Phetracha, j'ai voulu faire venir à Louvo avec des troupes le général des Français à qui j'avais confié le secret de la conjuration. Il monta jusqu'à Siam. Si l'on ne l'eût détourné de venir à Louvo, j'aurais fait arrêter le chef de la rébellion et l'aurais livré à coup sûr à Votre Majesté devant laquelle j'avais de quoi le convaincre. Cet expédient m'ayant mal réussi, j'ai envoyé à tous les gouverneurs des ordres très pressants de tenir les peuples dans le devoir et d'étouffer les bruits séditieux, dans l'espérance que Votre Majesté reprendrait sa santé et le gouvernement de son royaume et que la conspiration tomberait d'elle-même. Depuis ce temps-là, voyant Votre Majesté s'affaiblir davantage, je pris la liberté de l'avertir qu'il y avait quelque trouble dans le royaume causé par les bruits populaires que des gens mal intentionnés prenaient soin de répandre et par les intérêts différents que chacun prenait à l'élection d'un successeur de Votre Majesté, si Dieu disposait d'elle. Elle peut se souvenir combien de fois je l'ai pressée de déclarer le prince de la famille royale à qui il lui plairait de laisser sa couronne, afin que si la mauvaise destinée de ce royaume venait à nous enlever Votre Majesté, ce prince fût en état de se mettre à la tête de tous ses bons sujets et des troupes auxiliaires de France pour apaiser tous les troubles. Enfin toutes ces mesures m'ayant manqué, il ne me restait plus que de venir déclarer tout ce que je savais à Votre Majesté, mais la voyant toujours dans le même état et connaissant qu'elle ne voudrait pas se contenir en apprenant une si horrible trahison, j'ai appréhendé que les rebelles, se voyant découverts, ne se portassent aux dernières extrémités ; car je ne sais s'il y a ici personne sur la fidélité de qui Votre Majesté puisse compter. Phetracha n'entreprendra rien du vivant de Votre Majesté, à moins qu'on ne le pousse, et j'ai toujours appréhendé l'éclat qui vient d'arriver. Je sais bien, Sire, que je serai la première victime de la conspiration. Il y a longtemps qu'on me menace pour m'obliger à fuir, parce que je suis le seul qui soutienne leurs efforts. Mais rien n'a été capable de m'ébranler dans mon devoir. S'il faut périr, ce ne sera qu'aux pieds de Votre Majesté, avec mes amis que j'armerai pour sa défense. Mais je la conjure, par son salut et celui de royaume, de dissimuler jusqu'à ce que nous puissions prendre des mesures certaines ; car si Votre Majesté manque son coup, tout est perdu sans ressource.
Le roi avait écouté jusque-là son ministre sans l'interrompre, quoique agité de divers mouvements qu'il avait peine à réprimer : Vous m'apprenez là, lui dit-il, d'étranges choses. J'en savais déjà une partie et l'on m'avait dit que l'on devait commencer par vous tuer pour venir à nous. Je suis bien aise de vous trouver dans le devoir, vous auriez eu grand tort de m'abandonner. Mais que je dissimule, reprit-il, avec beaucoup d'emportement, contre des traîtres que j'honorais de ma confiance ? Cela n'est ni conforme à mon humeur, ni digne de ma grandeur. Je vois bien que j'ai trop vécu pour ces ingrats qui attendaient ma mort pour perdre ma famille, mais j'ai encore assez de vie et de force pour les perdre eux-mêmes par la plus éclatante vengeance. Néanmoins, M. Constance lui fit si bien comprendre qu'il n'était pas facile d'arrêter Phetracha par la force ouverte, qu'il consentit à user de stratagèmes pour le surprendre. On convint qu'on l'attirerait le lendemain dans le palais, et le roi promit cependant de se taire. Mais il n'eut pas la force de gagner si peu de temps sur ses ressentiments.
M. Constance sortit fort tard de chez le roi, et en retournant à son logis, entra dans la maison des pères jésuites. Il leur dit qu'on était à la veille d'une grande action pour le succès de laquelle il venait leur recommander d'offrir leurs prières et leurs sacrifices à Dieu. Il leur déclara que le roi voulait le lendemain faire arrêter des séditieux ; qu'il ne savait pas quelle serait l'issue de l'entreprise, mais qu'il en espérait beaucoup, parce que c'était la cause de Dieu et le bon droit du roi qu'on aurait à défendre, ; qu'il n'était en peine que pour la personne de Sa Majesté, et que pour lui il ne pouvait manquer d'avoir la consolation ou de rendre son maître victorieux de ses ennemis, ou d'être sacrifié pour le service des deux rois et les intérêts de la religion qui l'avaient engagé dans le péril. Il ne put ensuite s'empêcher de se plaindre de ce que Sa Majesté très chrétienne lui ayant fait l'honneur de prendre tant de confiance en lui, les Français en avaient eu si peu, et que ceux que leur devoir engageait davantage à maintenir l'union sans laquelle il était impossible de se maintenir dans ce royaume étranger s'étaient employés si efficacement à la rompre, mais qu'il espérait que ce grand roi rendrait plus de justice à sa fidélité et qu'il le compterait toujours parmi ceux qui avaient été de ses bons serviteurs.
Il se retira ensuite chez lui où les officier français et anglais soupèrent à l'ordinaire. Pour lui, il ne mangea point, mais il entra dans sa chapelle et y demeura deux heures à genoux. Il passa de là dans son cabinet où il employa le reste de la nuit à écrire et à donner des ordres jusqu'à deux heures après minuit qu'il se jeta sur son lit pour prendre quelque repos et s'endormit profondément jusqu'au jour.
Le roi, au contraire, avait passé la nuit dans des inquiétudes mortelles. Il fit venir dans sa chambre Mon Pi auquel il fit grâce, et quelques autres officiers du palais à qui il se fiait encore. Il se plaignit, il s'emporta et protesta mille fois qu'avant la fin du jour suivant il ferait souffrir à Phetracha la peine que méritait sa perfidie. Il donna même des ordres pour l'arrêter quand il viendrait au palais selon sa coutume, et à peine fut-il jour, qu'impatient de revoir M. Constance, il lui envoya dire de se rendre auprès de lui. Phetracha, qui avait pris de grandes défiances du dépit de Mon Pi et de sa prompte retraite au palais, ne voulut pas se hasarder d'y aller ce jour-là, et se contenta d'envoyer Sorasak son fils (2) faire sa cour et observer ce qui se passait.
Sorasak arriva en même temps que M. Constance et s'alla placer parmi les autres mandarins près de la fenêtre du roi. Le roi affecta devant lui de parler tout haut à son ministre et ne l'entretint que de sa maladie jusqu'à ce que le jeune mandarin, s'ennuyant de n'entendre parler que de médecine et croyant tout tranquille dans le palais, se retira. Alors le roi parla en secret à M. Constance et lui dit qu'il avait donné les ordres nécessaires pour s'assurer de Phetracha qui devait venir au palais à midi. Mais le pauvre prince était trahi, ceux-là mêmes auxquels il avait donné cet ordre en avaient déjà donné avis au rebelle.
| Phetracha assemble les factieux. |
Phetracha, voyant par là sa conjuration découverte, jugea bien qu'il n'avait plus rien à ménager et que dans cette journée il fallait tout gagner ou tout perdre. Il assembla ses amis, envoya ses conjurés dans les quartiers et les environs de la ville où il tenait des gens cachés, fit monter ses Mores à cheval, amassa une foule d'esclaves, de rameurs et d'autres gens de travail, qui sous leurs naïs, c'est-à-dire leurs chefs, se rendirent aux environs du palais sur le midi du 18 mai. Je me trouvai là avec un de nos pères et nous nous arrêtâmes fort longtemps au milieu de cette populace sans ordre, sans discipline et presque sans armes, moins capable de donner de la terreur que de causer de l'indignation de voir qu'il n'y eût alors personne à Louvo pour apaiser ce tumulte. Cent hommes déterminés auraient dissipé cette canaille d'esclaves et d'Indiens qui portaient les armes pour la première fois de leur vie.
À la tête des troupes était porté sur les épaules de six hommes le grand sancrasangkha rat (สังฆราช) : supérieur d'une communauté monastique. de Louvo, auprès duquel je demeurais pour apprendre la langue par ordre du roi de Siam. Ce talapoin invitait tout le monde du geste et de la voix à le suivre. Il se présenta à une petite porte du palais qui lui fut ouverte aussitôt par des gens de la faction qui s'en étaient assuré. Il entra, et après lui tous les rebelles se jetèrent confusément. On voyait accourir ces barbares de toute part, les uns avec leurs haches dont ils coupent le bois, les autres avec des bambous ferrés ou brûlés par le bout, et les mandarins avec des sabres et des boucliers. Ils s'étaient mêlés, infanterie et cavalerie, officiers et soldats, selon que le hasard les confondait, et l'unique forme de discipline qui paraissait parmi eux était le silence que les principaux leur imposaient en leur faisant entendre, pour les tromper, qu'ils étaient au secours du roi et qu'il fallait entrer sans bruit au palais pour surprendre des criminels d'État que Sa Majesté voulait faire punir.
| M. Constance se rend auprès du roi. |
M. Constance fut averti de ces mouvements sur le midi et voulut se rendre près de la personne du roi. Tous ses amis l'en dissuadèrent autant qu'ils purent, lui conseillant de s'enfermer chez lui avec ce que l'on pourrait assembler d'Européens à Louvo. Il ne put se résoudre à prendre ce parti, qui lui paraissait bien le plus sûr, mais non pas le plus conforme à son devoir.
Pour s'assurer si les gens qui s'attroupaient étaient tous à Phetracha et si ceux que le roi avait commandés ne venaient point, il envoya le secrétaire du vieux barcalon au palais avec ordre de lui rapporter lui-même ce qu'il aurait vu. En même temps, il pria le major de Beauchamp d'aller faire mettre sous les armes à la porte du palais les officiers français avec les trois compagnies siamoises qu'ils commandaient, et dit au capitaine de ses gardes anglais de se tenir prêt à recevoir ses ordres. Cependant son envoyé lui vint rapporter que tout était pour Phetracha dans le palais et que le roi allait être fait prisonnier.
À cette parole il n'écouta plus que son devoir et son amour pour son maître. Quelqu'un lui ayant voulu représenter qu'il s'allait perdre, il lui répliqua brusquement : Quoi, Monsieur, abandonnerai-je le roi pour me sauver ? Il entra dans la chambre de Mme Constance et lui tendant la main : Adieu, Madame, lui dit-il, je m'en vais au palais. Je ne sais pas ce qui peut m'y arriver, mais le roi est en danger. Il ne faut pas l'abandonner. Mme Constance jeta un grand cri et voulut l'arrêter, mais il la quitta et sortit. Il fut suivi du major, du chevalier Desfarges et du sieur de Fretteville. Son capitaine des gardes préféra à son devoir une cassette d'argent qu'il aima mieux défendre que la vie de son maître. M. Constance, soit qu'il ne s'aperçut pas qu'il fût si mal suivi, soit qu'il espérât de pénétrer encore jusqu'à l'appartement du roi et de rassembler là ce qu'il pourrait de ses fidèles serviteurs, entra dans le palais. Mais à l'entrée, il fut arrêté par Phetracha et son fils qui l'attendaient avec une troupe de mandarins siamois le sabre à la main.
| La conduite que tint Phetracha dans les commencements de la révolte. |
On désarma les trois officiers français et M. Constance fut conduit dans une cour intérieure du palais. Sur son passage, un bourreau se présenta, et ayant pris son avantage pour le frapper, il leva le cimeterre sur sa tête. M. Constance présenta son bras au cimeterre et se tourna du côté de Phetracha pour lui demander quelque délai. Le mandarin arrêta le coup du bourreau et fit même plus que M. Constance ne lui avait demandé, car il le conduisit sur les murailles du palais, où il lui parla seul à seul comme s'il eût été en liberté, ce qui donna occasion au bruit qui se répandit dans Louvo que M. Constance était maître du palais et qu'on l'avait vu sur les murs donner des ordres. Phetracha en usait ainsi pour empêcher que les Européens et les autres amis du ministre ne prissent de l'ombrage et ne fissent quelque effort pour se venger dans un temps où Phetracha lui-même avait encore tout à craindre. Il le ramena ensuite dans une salle où étaient les trois officiers français, et les laissa ensemble jusqu'au lendemain (3).
Il envoya le vieux mandarin que l'on a vu à Paris (4) aux autres officiers français qui étaient au corps de garde près de la grande porte du palais, pour leur ordonner de se retirer. Saint-Vandrille, qui commandait dans ce parti, fit réponse avec beaucoup de fermeté qu'ayant été mis là pour le service du roi par M. Constance quand il était entré au palais, ils n'en sortiraient que par l'ordre qu'il leur en donnerait lui-même quand il retournerait chez lui. Ils demeurèrent en effet tout le jour à la tête de leurs compagnies siamoises, en si bon ordre au milieu de l'armée ennemie qu'elle n'osa jamais les insulter, et quand Phetracha envoyait des détachements pour faire ses rondes autour du palais et dans les quartiers voisins, le corps de garde les arrêtait hardiment et les obligeait à prendre de grands détours.
Sur la minuit, ces officiers, pour voir la contenance de leurs soldats sur lesquels il comptaient fort peu, donnèrent une fausse alarme au corps de garde pour faire prendre les armes. Tout le corps de garde se dissipa à la faveur des ténèbres et abandonna les officiers. Ceux-ci ne quittèrent point leur poste, mais avec un petit renfort de quelques ouvriers français, ils firent bonne contenance jusqu'au jour sans que personne osât se présenter pour les enlever, et alors ils se retirèrent d'eux-mêmes pour ne point donner sujet de plainte, parce que les ouvrier n'avaient point d'ordre de tenir le corps de garde. Le lendemain on les envoya avec la garde anglaise de M. Constance à Tlee Pousson (5) qui est une maison du roi à demi-lieue de Louvo. L'on arrêta tous les Européens capables de porter les armes. On posa dans tous les quartiers de la ville des corps de garde. Le peuple effrayé se renferma dans les maisons et l'insolence du soldat rebelle commença de faire sentir aux Siamois la tyrannie de celui qu'ils avaient cru devoir être leur protecteur.
Tandis que le roi, abandonné de ses alliés et trahi par ses sujets, gémissait dans son propre palais, prisonnier d'un de ses favoris, on enleva à ce prince tous les officiers de sa maison, à la réserve de ses médecins et de deux esclaves pour le servir, et pendant plusieurs jours personne ne se présenta pour écouter les plaintes et les reproches qu'il faisait inutilement à ses perfides serviteurs. Car Phetracha éloignait tout le monde de son appartement et y allait seul avec son fils pour faire croire qu'il ne faisait rien que par les ordres qu'il recevait du roi dans ces audiences secrètes. Par cet artifice, sans encourir la haine publique, il fit arrêter dans son appartement celui des princes qu'il avait attiré à Louvo. Il ôta aux deux princesses, la sœur et la fille du roi, le crédit qu'elles avaient à la cour, et mit M. Constance dans une étroite prison sous la garde et à la discrétion d'une troupe de ses satellites.
Pour Mon Pi, il était allé chercher un asile dans la chambre du roi. Le mandarin, qui gardait encore quelque apparence de respect pour son maître et son bienfaiteur qu'il tenait prisonnier, ne voulut pas faire enlever de force ce jeune favori de sa chambre, mais il mit des gens à la porte pour l'observer de si près que ce malheureux, étant sorti le 20 mai deux heures avant le jour, il fut enlevé et massacré. Ce fut la première victime que le tyran immola à son ambition par un coup de la providence qui permit que ces deux hommes, s'étant unis pour des desseins criminels, se brouillèrent ensuite et servirent réciproquement à se détruire l'un l'autre.
Phetracha vit sa conspiration découverte par celui qu'il avait mis auprès du roi pour la tenir secrète, et Mon Pi eut la tête tranchée par ordre de celui qui lui avait promis de le faire couronner. Le tyran, s'étant ainsi assuré de la personne du roi son maître et des concurrents qu'il avait à la cour, tourna tous ses artifices contre les ennemis qu'il avait au-dehors, sans se donner le loisir de goûter la douceur de ses premiers avantages. Maître absolu dans le palais et dans Louvo, il ne lui restait, pour pousser à bout son entreprise, que de s'aller faire reconnaître à Siam et de chasser les Français du royaume.
Pour mieux réussir dans le premier de ces projets, il jugea à propos de ne prendre d'abord que la qualité de grand mandarin et de conserver la vie au roi avec une ombre d'autorité, afin de se servir de son nom dans ces lieux où la tyrannie n'était pas encore établie, et de tromper par de faux ordres les mandarins qui seraient encore dans le devoir. Le gouverneur de Siam était de ce nombre. C'était lui qui avait donné à M. Constance les premiers avis de la conjuration, et il était demeuré toujours attaché à la maison royale. Il y avait dans le palais de Siam un des princes frères du roi que le rebelle n'avait pu encore en tirer, et il était dangereux que le gouverneur ne le mît à la tête d'un parti pour la délivrance du roi et sa propre défense, ou qu'il ne se fît même reconnaître pour héritier de la couronne pendant la captivité du roi son frère. Phetracha fit plusieurs fois demander le prince de la part de Sa Majesté au gouverneur de Siam, sous différents prétextes, mais toujours inutilement, ce qui l'obligea d'avoir recours à un stratagème qui lui réussit mieux.
Il envoya secrètement des mandarins de son parti, qui feignant d'avoir horreur de sa rébellion, venaient faire au prince des offres de service qu'il ne refusait pas dans le mauvais état de ses affaires. Ces traîtres venaient souvent au palais faire leur cour, et lorsqu'ils s'en furent rendu l'accès assez libre, qu'ils eurent observé tout ce qui s'y passait et gagné quelques misérables esclaves qui en faisaient la garde, ils y vinrent un soir en plus grand nombre avec des armes. Les uns s'assurèrent des avenues et des portes, et les autres entrèrent avec violence dans la chambre du prince, d'où ils l'enlevèrent et le mirent dans un balon qu'ils tenaient prêt sur la rivière qui passe à la porte du palais. La chose s'exécuta avec tant de diligence et des justes mesures que quand le gouverneur en eut le premier avis, le prince était déjà arrivé à une petite bourgade nommée Bankou où des éléphants l'attendaient pour le transporter à Louvo. Le rebelle fit en même temps afficher dans divers quartiers de Siam des placards scellés des sceaux de l'État, par lesquels M. Constance était déclaré proscrit de par le roi, ses biens et ceux de sa famille confisqués avec ordre à tous les sujets du rois, sous peine de la vie, de déclarer ce qu'ils en savaient entre les mains des autres, et par les mêmes déclarations, le révolté était établi en sa place ministre général du royaume. Les talapoins de leur côté, appuyant ces faux ordres, ne prêchaient plus que l'amour de la liberté et l'obéissance à Phetracha.
Le peuple de Siam, grand amateur de nouveautés, reçut celle-ci avec joie. Les mandarins, trompés par les titres spécieux d'autorité royale et de sûreté publique, ou gagnés par les promesses et intimidés par les menaces des rebelles, n'osèrent s'opposer au torrent fatal qui entraînait tout le monde. Le gouverneur de la capitale fut contraint lui-même de plier et de demander sa paix pour prévenir son malheur. Ainsi, du consentement général de tous les ordres, Phetracha fut reconnu pour administrateur du royaume et bientôt après honoré du titre de libérateur de la patrie et de conservateur de la religion.
Pour remplir les obligations que ces grands noms lui semblaient imposer et ne rien laisser à souhaiter pour l'établissement de son règne, il fallait délivrer l'État des garnisons françaises et se tirer lui-même de l'inquiétude où il était que ces étrangers dévoués à la maison royale ne ramenassent par une puissante faction les esprits des Siamois mal assujettis et partagés encore entre l'amour de la nouveauté, la crainte de la tyrannie et leurs anciens devoirs. Phetracha craignait cette révolution, et pour la prévenir, il entreprit de perdre ceux qui en pourraient être les auteurs.
C'est le génie des Indiens de n'employer jamais la force ouverte contre leurs ennemis lorsqu'ils croient pouvoir en venir à bout par la fraude et la surprise. Au défaut du courage qui leur manque, ils se font un exercice d'apprendre à user de ruses, comme on s'en fait ailleurs d'apprendre à se servir d'une épée. Leur naturel timide, leur air servile et rampant, leurs paroles flatteuses, le ton de leur voix, leurs gestes, leurs manières, tout impose. Il n'y a point d'artifice si bas et si honteux dont ils rougissent, le point d'honneur et la bonne foi sont des noms inconnus parmi eux, et l'on confond en langue siamoise la fourberie, l'esprit, le savoir-faire, la trahison, la prudence sous le même mot de pania (6). Ce qui a donné lieu à un proverbe qui court à Siam qu'il faut laisser aux Hollandais le commerce, aux Chinois les beaux-arts, aux Français la guerre, et aux Siamois l'esprit.
| Phetracha met la fraude en usage pour perdre les Français. |
Phetracha, suivant cette maxime, ne crut pas devoir tenter la voie des armes contre la garnison de Bangkok, et il espéra que ses ruses auraient le même succès contre les étrangers qu'elles avaient eu contre ses concitoyens. Il s'adressa pour cela à M. l'évêque de Métellopolis, prélat que sa rare vertu et son âge vénérable devaient mettre à couvert de l'insolence qu'eut le barbare de le vouloir faire servir d'instrument à la perfidie. Il lui écrivit à peu près en ces termes :
|
Okphra Phetracha au Sancra français : Vous aurez sans doute été surpris d'entendre le changement qui est arrivé à la cour. Tout s'est fait par ordre du roi, et c'est par son même ordre que je vous écris pour vous assurer que ces mouvements ne regardent ni les chrétiens, ni les Français. Sa Majesté m'a chargé de l'administration de l'État, j'ai besoin, pour m'aider à porter un si pesant fardeau, de vos sages conseils et je vous prie pour cela de venir à Louvo, etc. |
Il donna les mêmes assurances au chef de la faiturie française qui en fit part aussitôt au chevalier Desfarges par cette lettre qui lui fut écrite de Louvo :
|
Mon cher chevalier, En attendant les ordres de M. votre père, vous voulez bien que je vous avertisse que c'est à présent Okphra Phetracha qui gouverne et que c'est à lui que vous devez obéir ; ainsi prenez garde à ne vous point laisser surprendre par les ordres qui vous pourraient venir d'une autre part, nous sommes en sûreté comme au milieu de Paris et nous aurons dorénavant quelque part aux affaires, etc. |
M. de Métellopolis qui jugeait autrement de ces nouveautés, prétexta une indisposition pour ne point aller à Louvo. On y appela M. l'abbé de Lionne, nommé évêque de Rosalie (7).
| M. de Lionne va à la cour. |
Ce prélat n'avait peut-être pas moins de répugnance que l'autre à faire le voyage, mais il n'eut point d'excuse comme lui pour s'en défendre. Il vint à Louvo où nous étions. Les Siamois, pour l'instruire de ce qui était arrivé les jours précédents dans cette ville, avaient pris plaisir selon leur coutume de lui faire un détail des circonstances qui étaient autant de contrevérités. Ils lui avaient raconté que le roi ayant fait appeler M. Constance au palais, ce ministre s'était barricadé dans sa maison et y avait été forcé ; que Mme Constance avait été enlevée de la chapelle où elle s'était réfugiée ; que le roi avait établi Phetracha ministre général du royaume ; que tout était paisible à Louvo et que les chrétiens y jouissaient, comme à l'ordinaire, d'une entière liberté. Le prélat trouvait en arrivant le contraire de toutes ces choses : le roi était prisonnier, Mme Constance était encore chez elle, et la plus grande partie des chrétiens étaient aux fers.
M. de Lionne prit part à la consternation où nous étions, mais à peine avait-il eu le temps de se défaire des fausses idées qu'on avait voulu lui donner, lorsqu'on vint le prendre à son logis avec le chevalier Desfarges pour les conduire à l'audience. Ce n'était plus le roi qui la donnait avec les marques ordinaires de sa bonté, c'était Phetracha. Il y parut avec tout l'appareil et tout l'air d'un tyran au milieu de ses mandarins, ayant quatre sabres rangés devant lui. Il fit asseoir les Français à terre sur des tapis et leur dit, d'un ton fier et hautain, qu'ayant été choisi du roi son maître pour rétablir le bon ordre dans le royaume, il les avait appelés pour les envoyer à Bangkok porter de la part de Sa Majesté un ordre à M. le général de venir incessamment à la cour pour des affaires de conséquence ; qu'il savait que le général, ayant déjà reçu de pareils ordres, s'était excusé d'y obéir sur quelques incommodités qui lui étaient survenues, mais que se portant bien alors, il ne pouvait refuser de le faire sans donner atteinte à l'alliance royale des deux nations.
Les Français sortirent de l'audience encore plus détrompés des fourberies siamoises qu'ils ne l'étaient en y entrant. M. l'abbé de Lionne assembla chez lui ce qu'il y avait d'officiers et de missionnaires à Louvo pour savoir leur sentiment sur la proposition qu'on lui venait de faire d'aller appeler M. le général, et sur le conseil qu'il serait plus à propos de lui donner. Toute l'assemblée, d'une commune voix, se récria que tout était perdu si M. Desfarges venait se mettre à la discrétion des révoltés. Le prélat avec sa douceur et sa prudence ordinaire reçut tous les avis et se disposa pour son voyage (8).
Les mandarins qui étaient venus ambassadeurs en France, pour ôter tout ombrage aux Français, furent féliciter les officiers qui étaient à Louvo de ce que tout allait être pacifié par la venue du général, et poussant la fourberie jusqu'à l'extravagance, ils ajoutaient que le roi attendait avec impatience M. Desfarges pour le faire mandarin du premier ordre, ou pour le moins barcalon, et lui donner les dépouilles de M. Constance. Ces Indiens ont si peu d'estime des Européens qu'ils nous croient assez grossiers pour donner dans tous ces pièges, et nos Français étaient obligés par politique de faire semblant d'y donner.
Il avait été résolu dans le Conseil de Phetracha d'envoyer à Bangkok le chevalier Desfarges avec M. de Lionne ; mais le major de Beauchamp ayant représenté que le général ne sortirait point de sa place, s'il n'allait lui-même l'informer de l'état des choses, on retint le chevalier et l'on envoya le major. Ils partirent, M. de Lionne et lui le 20. Tandis qu'ils descendaient la rivière pour porter à M. Desfarges les ordres de Phetracha, le capitaine d'Acieu montait avec une lettre de ce général à ce grand mandarin. Les bruits populaires avaient porté à Bangkok ce qui se passait à la cour et avaient obligé M. Desfarges à écrire à Phetracha, pour lui demander son fils et les autres officiers, afin de les punir selon la discipline militaire s'ils avaient manqué à leur devoir ; et pour ce qui regardait M. Constance, il le priait comme son ami particulier qui connaissait son innocence, qu'il ne lui fût fait aucun tort. On ne fit pas l'honneur à cet envoyé de lui donner audience, on lui remit seulement une lettre pour assurer le général que la cour n'était point mécontente des officiers français, et que pour l'affaire de M. Constance, il en serait lui-même le juge quand il serait à Louvo. Dans le peu de séjour que ce capitaine y avait fait, il avait vu la désolation générale de la chrétienté, la révolte de Phetracha et la captivité du roi, ce qui lui fit dire en partant aux jeunes officiers français que quand il aurait fait à M. le général son rapport sur l'état des affaires, il songerait moins à venir à Louvo qu'à se préparer dans Bangkok à une vigoureuse résistance.
Ce discours du capitaine joint à plusieurs avis secrets que les officiers avaient eus des mauvais desseins qu'on avait sur eux, les fit déterminer assez brusquement à s'enfuir de Louvo en passant sur le ventre de tout ce qui s'opposait à eux pour se jeter dans Bangkok avant qu'il fût bloqué. Telle fut la résolution qu'ils prirent entre eux sans en parler à personne, et voici quelle fut leur aventure.
| Aventure des Français qui se sauvèrent de Louvo. |
Il y avait quelques jours que pour ne point donner de défiance aux Français de Bangkok que l'on voulait attirer, on laissait la liberté aux officiers de Louvo d'aller par la ville, et même de monter à cheval pour se promener dans la campagne. Aussitôt que Dacieu fut parti, les officiers français furent demander des chevaux aux écuries du roi et sortirent de la ville au nombre de six, savoir le chevalier Desfarges, Saint-Vandrille, Desfarges, de la Fretteville et Bressi (9). Ils furent d'abord au jardin du roi prendre des armes chez un Français et après avoir fait quelques tours dans la plaine, voyant venir la nuit favorable à leur fuite, ils tournèrent tout à coup du côté de Siam et laissèrent dans peu de temps bien loin derrière eux la garde siamoise qu'on leur avait donné pour les suivre.
Ils rejoignirent Dacieu en chemin. Quoique le cheval de Saint-Vandrille eût crevé sous lui, il ne laissa pas de suivre ses camarades à la course. Il forcèrent divers corps de garde de plus de cent hommes, qui n'osant se présenter sur leur passage, se contentaient de donner l'alarme au corps de garde suivant qui ne faisait pas plus de résistance que le premier. Sur la minuit, ils arrivèrent à Bankou où l'on met pied à terre pour s'embarquer sur la rivière jusqu'à la ville de Siam. Il y avait sur le rivage un balon rempli de talapoins et quelques gens du pays endormis près de là. Les officiers se saisissent du balon, font sauter les talapoins dans l'eau et obligent les autres à leur servir de rameurs ; mais comme ils n'avaient pas eu la précaution de se fournir de cordes pour les attacher, les rameurs dans l'obscurité de la nuit se jetèrent à la nage et laissèrent nos aventuriers fort embarrassés de la conduite de leur nacelle. Dans ce même temps, ils virent arriver sur eux un gros balon à cinquante rames qui venait apparemment les heurter pour les couler à fond. Ils se jetèrent sur leurs armes en criant Tüe tüe, ce qui obligea les ennemis de tourner sur la droite en passant avec une vitesse incroyable, pour aller donner avis de leur fuite à Siam. On sonnait partout le tocsin sur eux, le bord du fleuve était d'un côté tout couvert de monde, de sorte qu'étant réduits à ramer eux-mêmes et à se tenir en défense, ils se fatiguaient beaucoup et avançaient peu, ce qui les obligea de descendre à terre du côté où il y avait le moins de monde pour continuer leur voyage à pied.
On n'avait pas été moins étonné de cette fuite à la cour qu'à la campagne, quand le garde en vint donner avis. Phetracha envoya après ces officiers trois cents Mores à cheval, auxquels se joignirent quatre cents Siamois des corps de garde posés sur les chemins. Ces troupes eurent avis dans leur marche que les fugitifs s'étaient retirés dans une vieille pagode abandonnée, à trois lieues de Louvo. Il fut résolu qu'on en ferait le blocus. Ils formèrent un grand cercle autour de la pagode hors de la portée des armes à feu contre lesquelles leur bravoure n'est pas à l'épreuve, et l'on détacha un More et un Siamois sans armes pour sommer les prétendus assiégés de se rendre à honnête composition. Ces deux hérauts, s'étant avancés jusqu'à cent pas de la porte du temple, faisaient de profondes inclinations avec de grands gestes pour témoigner à ceux qu'ils y croyaient retirés qu'on ne leur ferait point de mal s'ils voulaient en sortir ; mais comme personne ne paraissait, on cria à ces deux braves de ne pas s'avancer davantage, parce que les Français voulaient les attirer plus près pour les tuer plus sûrement. L'armée campa là toute la nuit et le jour suivant, résolue d'affamer la place pour n'exposer la vie de personne selon le génie du pays.
Mais ceux qu'ils croyaient tenir assiégés étaient bien loin dans les plaines de Siam, fatigués, égarés dans la nuit, sans guide et sans vivres. Ils s'assirent pour consulter ce qu'ils avaient à faire et en consultant ils s'endormirent jusque bien avant dans le jour, sans que les Siamois osassent les attaquer, croyant qu'un sommeil si tranquille était un stratagème pour les attirer à la portée de leurs armes.

NOTES :
1 - Le titre officiel siamois de Phaulkon était Chao Phraya Wichayen (เจ้าพระยาวิชเยนทร์). ⇑
2 - Le père Le Blanc écrit : Soiatan, nom également utilisé dans d'autres relations, notamment par le père d'Orléans et Vollant des Verquains qui épellent Soyatan. Il s'agit peut-être d'une déformation de Suriyenthrathibodi (สุริเยนทราธิบดี), un des titres sous lesquels régna le fils de Phetracha, dont le nom était Sorasak (สรศักดิ์). À la fin du deuxième volume de son Histoire de la révolution de Siam, Marcel Le Blanc insère un erratum invitant à remplacer Soiatan par Sorasak dans tout l'ouvrage. C'est ce que nous avons fait.
Fils de Petratcha, Sorasak ou Luang Sarasak (หลวงสรศักดิ์) devint à la mort de son père, en 1703, le 29ème roi d’Ayutthaya sous le titre de Sanphet 8 (สรรเพชญ์ที่ ๘), mais il reste surtout connu sous le surnom de Phra Chao Süa (พระเจ้าเสือ : le roi tigre). W.A.R. Wood en brosse un portrait peu flatteur : Ce fut un homme cruel, intempérant et dépravé. Turpin dit qu’il a épousé la princesse Yothathep, une des veuves de son père [par ailleurs fille de Phra Naraï]. Une des portes de son palais était connue sous le nom de Porte des Cadavres en raison du grand nombre de petits cercueils qui en sortaient, contenant des enfants assassinés victimes de sa luxure et de sa cruauté. (…) Le roi Tigre, usé par l’alcool et la débauche, mourut en 1709, terminant ainsi un règne court et peu glorieux. (A history of Siam, 1924, pp. 225 et suiv.). ⇑
3 - Beauchamp, l'un des principaux acteurs de l'arrestation de Phaulkon, donne une version un peu différente : Phetracha prit par le bras M. Constance, lui fit quitter ses souliers et son chapeau, et le promena ainsi tout autour du palais pour le montrer au peuple qui s'y était rendu en foule ; après, on l'amena dans la salle où nous étions. À peine il fut-il entré qu'il me dit en m'abordant : « Seigneur major, je suis bien fâché de vous voir ici ». Je lui répondis : « Votre Excellence l'a bien voulu, car si vous m'aviez cru, ni vous ni moi n'y serions pas. » Phetracha, voyant que nous nous parlions, le vint prendre et l'emmena. On le chargea de fers, on lui mit la cangue au col et on lui brûla la plante des pieds. Ensuite Phetracha s'en alla dans l'antichambre du roi, y fit prendre Mon Pi et là, le fit couper en trois en sa présence. La princesse reine, la fille du roi, qui était dans le palais lorsque tout cela se faisait, disait tout haut qu'il fallait exterminer tous les chrétiens qui étaient dans le royaume. (Manuscrit Bibliothèque Nationale Fr 8210, f° 522v°) ⇑
4 - Il s'agissait d'Okluang Kanlaya Ratchamaïtri (ออกหลวงกัลยาราชไมตรี), connu en France sous le nom de Uppathut (second ambassadeur).
 Ooc Louang Calayanaraa Tchaimaitrioupathoud.
Ooc Louang Calayanaraa Tchaimaitrioupathoud.
OOC LOÜANG CALAYANARAA TCHAIMAÏTRIOUPATHOUD. Premier ajoint de l'ambassadeur de Siam envoyé au Roy, homme âgé et qui a beaucoup d'Esprit. Il a été Ambassadeur du Roy de siam vers l'Empereur de la Chine, et s'acquita fort bien de cette Ambassade. Ces Ambassadeurs partirent de Siam le 22 Decembre 1685. sur les trois heures du matin dans le Vaisseau du Roy nommé l'Oiseau, commandé par Mr de Vaudricourt. Dessiné sur le naturel. A Paris chez Nolin, rue St Iacques, a l'Enseigne de la Place des Victoires. Avec P. du Roy. ⇑
5 - Thale Chubson (ทะเลชุบศร), une île au milieu d'un ancien lac à trois kilomètres de Lopburi, où le roi Naraï avait fait construire une résidence, le pavillon Kraisorn-Sriharaj (ตำหนักไกรสรสีหราช). On peut penser que la fraîcheur de l'eau rendait cette retraite agréable pendant les mois chauds. Elle était également connue sous le nom de Pratinang yen (พระตี่นั่งเย็น), la Résidence fraîche. Elle servait au roi Naraï pour les réceptions et pour séjourner lors de ses parties de chasse ou de ses promenades en forêt.
 Le pavillon Kraisorn-Sriharaj.
Le pavillon Kraisorn-Sriharaj.
 Les vestiges du système d'irrigation de Thale Chubson, peut-être dû à l'ingénieur La Mare. ⇑
Les vestiges du système d'irrigation de Thale Chubson, peut-être dû à l'ingénieur La Mare. ⇑
6 - panya (ปัญญา) : le mot signifie intelligence, sagesse, esprit, pénétration, astuce. ⇑
7 - M. de Lionne, nommé coadjuteur de Mgr Laneau le 20 mai 1686 et évêque de Rosalie le 5 février 1687, refusa cette double nomination. Il n'accepta qu'en 1696 d'être évêque. (Launay, Histoire de la mission de Siam, note 1, p. 205). ⇑
8 - Bien différente et bien plus polémique est la version donnée par le père de Bèze (Drans et Bernard, Mémoire du père de Bèze sur la vie de Constance Phaulkon, p. 122-123) : M. de Lionne ne s'attendait pas à être chargé de cette commission, cependant, comme il n'était pas encore convaincu de la trahison et de la mauvaise foi de Phetracha, il paraissait assez disposé à porter M. le général à obéir aux ordres de ce mandarin. Comme nous étions persuadés que M. Desfarges ne pouvait pas faire cette démarche sans abandonner les chrétiens à la fureur de Phetracha qui ne les épargnait à Louvo que parce que les Français étaient maîtres de Bangkok, nous crûmes devoir le représenter à M. de Lionne et le conjurer de ne point engager M. Desfarges à venir se mettre entre les mains de ce traître sans s'être bien assuré de ses intentions ; que le roi nous avait fait dire que ce mandarin n'en avait point d'autre que de faire égorger tous les Français s'il pouvait s'en rendre maître et qu'il sacrifierait ensuite tous les chrétiens à la haine des talapoins ; que ce n'était pas une affaire de si petite conséquence qu'elle ne méritât bien qu'il s'informât mieux qu'il ne l'était de l'état des choses ; que, s'il ne voulait pas nous en croire ni M. Paumard, qu'il demandât à voir le roi et à savoir de lui sa volonté.
M. de Lionne nous répondit qu'il ne voulait pas choquer le grand mandarin par une démarche semblable qui ferait voir qu'il se défiait de lui, mais que, si nous croyions qu'il ne fût pas à propos que M. Desfarges vînt à Louvo, nous lui écrivissions notre sentiment et nos raisons ; qu'il s'offrait de lui porter nos lettres. Nous écrivîmes en effet, le R.P. supérieur et moi, et j'allai lui porter nos lettres comme il était prêt de partir. Je lui dis que, s'il avait de la peine à s'en charger, je les donnerais à M. de Beauchamp qui s'en allait avec lui. Il me dit qu'il n'en avait aucune et, qu'étant envoyé de la part du grand mandarin, il ne craignait pas qu'on le fouillât. Cependant il changea bientôt après de sentiment car, sitôt qu'il fut sorti de Louvo, il déchira nos lettres, à ce qu'il nous dit depuis, craignant qu'elles ne lui fissent de la peine si elles venaient à être surprises. Il se rendit bientôt à Bangkok où Mun Pan l'accompagna avec ordre de faire toutes sortes de promesses à M. Desfarges pour l'engager à venir. ⇑
9 - Le père Le Blanc n'en mentionne que cinq, à moins que Dacieux, rejoint plus tard, ne soit compté comme le sixième. Les relations diffèrent quant au nombre de captifs français qui furent les acteurs de cet épisode. On peut citer sûrement le chevalier Desfarges, fils cadet du général, le chevalier de Fretteville, Saint-Vandrille, peut-être Delas, et un officier nommé Des Targes, dont le nom apparaît dans la relation de La Touche, et qui est peut-être ici confondu avec Des Farges, même si les deux fils de Desfarges se trouvaient alors à Louvo. L'ingénieur qui périt dans cette aventure se nommait Brécy, ou Bressy. ⇑

21 février 2019
