

Treizième chapitre.
Des richesses des Siamois et des tributs qu'ils payent au roi.
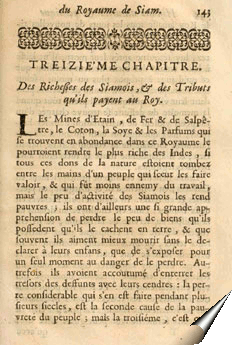
Les mines d'étain, de fer et de salpêtre, le coton, la soie et les parfums qui se trouvent en abondance dans ce royaume le pourraient rendre le plus riche des Indes si tous ces dons de la nature étaient tombés entre les mains d'un peuple qui sût les faire valoir et qui fût moins ennemi du travail, mais le peu d'activité des Siamois les rend pauvres. Ils ont d'ailleurs une si grande appréhension de perdre le peu de biens qu'ils possèdent qu'ils le cachent en terre, et que souvent ils aiment mieux mourir sans le déclarer à leurs enfants que de s'exposer pour un seul moment au danger de le perdre. Autrefois, ils avaient accoutumé d'enterrer les trésors des défunts avec leurs cendres. La perte considérable qui s'en est faite pendant plusieurs siècles est la seconde cause de la pauvreté du peuple. Mais la troisième, c'est que le roi amasse tous les jours de nouvelles richesses et que la part qu'il en fait aux mandarins, qui ne sont riches que de ses libéralités, lui retourne après leur mort, il ne laisse à leurs enfants des biens de leur succession que ce qu'il juge à propos plus ou moins selon que leurs pères lui ont rendu de services pendant leur vie. Quelquefois il prend tout, quand la mémoire du défunt se trouve chargée d'un soupçon violent de malversation dans ses emplois, mais quelquefois aussi, quand il est parfaitement satisfait de sa conduite, il ne retient rien et il abandonne toute sa succession à ses héritiers légitimes.
Leurs richesses consistent principalement en esclaves, en vaisselle d'or et d'argent, en pierreries et en terres. Ils divisent leurs esclaves en deux bandes : l'une est employée au-dedans de la maison au service de la famille, et ils envoient l'autre à la campagne pour cultiver leurs terres, ou bien ils leurs donnent la liberté de faire ce que bon leur semble, à la charge de leur rapporter tous les jours un foüang, qui est une pièce de monnaie qui vaut environ cinq sols (1). Le roi n'a point d'autres fermiers de ses terres que les mandarins qui les louent huit foüangs l'arpent pour chacun an. Cette ferme ne leur peut guère être ôtée qu'avec la vie pour punition de quelque crime qui aura mérité la confiscation de tous leurs biens. C'est presque le seul moyen qu'ils aient d'acquérir du bien, car leur dignité ne leur permet pas de trafiquer. Quand ils ont amassé quelque argent monnayé, comme les constitutions de rentes ne sont point en usage parmi eux, ils le donnent à usure et les intérêts qu'ils en tirent sont si gros qu'en trois ou quatre ans, ils excèdent et surpassent le fort principal. Il est vrai qu'ils risquent beaucoup, car les marchands à qui ils prêtent leur font souvent banqueroute ou deviennent insolvables, tantôt par le naufrage de leurs vaisseaux et tantôt par le rabais de leurs marchandises. De là vient qu'il se voit peu de mandarins qui meurent riches. Comme ils savent qu'après leurs décès leurs enfants ne seront peut-être pas leurs héritiers, ils leur donnent pour dot quantité de vases d'or et d'argent, des cabinets, des pierreries et d'autres meubles précieux qu'ils ont acquis ; car les héritages qui leur ont été donnés par le roi sont sujets au droit de réversion. La plus grande partie du peuple est dans le commerce, les uns vont en tout temps trafiquer sur la rivière avec leurs femmes et leurs enfants dans de grands bateaux appelés communément myrous (2), d'où ils ne sortent presque jamais. Les autres demeurent dans les villes, attachés à leurs boutiques pour y vendre en détail les marchandises qu'ils ont achetées en gros à l'arrivée des vaisseaux, pour y travailler chacun de son métier et pour y débiter leurs ouvrages. Ils sont bien malheureux s'ils n'y gagnent plus qu'il ne leur en faut pour vivre car là, plus aisément qu'en tout autre lieu du monde la nature se contente de peu, aussi n'y a-t-il que les infirmes et les prisonniers qui soient réduits à la mendicité.
Les tributs que l'on paye au roi sont de deux sortes : il y en a de personnels et il y en a de réels. Pour l'intelligence des premiers il faut savoir que le peuple de ce royaume est divisé en trois classes : la première est de ceux qui sont employés à la garde du roi, à la chasse des éléphants et généralement à toutes les choses qui le regardent en particulier ; la seconde est destinée aux travaux publics, comme à porter la terre, à cuire la brique, à couper le bois dans les forêts et à travailler aux mines ; et la troisième est attachée au service des mandarins, car chaque titre ou dignité a certain nombre de personnes dont le mandarin qui en est revêtu peut disposer à son gré. L'un en a trente, l'autre cinquante, chacun suivant la prééminence de sa charge ou les fonctions de son emploi. Généralement, tous les sujets du roi sont obligés de servir à leurs dépens pendant six mois de l'année (3), mais ils ne servent pas tous en même temps. Ceux qui sont attachés au service de Sa Majesté ont successivement un mois de travail et un mois de repos, mais ceux des mandarins les servent six mois de suite, quoiqu'ils ne les servent pas tous en même temps. Si un mandarin par exemple a trente baos (4), c'est le nom que l'on donne à ses serviteurs, il n'en emploie que quinze une partie de l'année et il réserve pour l'autre partie les quinze autres. Dès l'âge de seize ans on est écrit sur le registre public et distribué dans l'une de ces trois classes. Quand on ne se trouve pas au travail auquel on est destiné, il n'y va pas moins que d'être mis à la chaîne ou d'être fouetté si cruellement avec des osiers que les cicatrices en demeurent sur le corps le reste de la vie. Si l'on fuit pour n'être plus obligé de travailler, après une légère perquisition, les parents et les voisins du déserteur sont mis en prison et ils y demeurent jusqu'à ce qu'il se soit représenté. C'est pourquoi qui que ce soit ne peut jamais s'exempter du service qu'en payant quinze ticals par chacun an, ou qu'en se faisant esclave ou talapoin. Il y a dans tous les camps un mandarin inspecteur des travaux qu'ils appellent Nâi (5) : ils choisissent ordinairement pour cet emploi un homme sévère qui châtie rigoureusement les défaillants. Souvent il se laisse corrompre par les présents qu'ils lui font volontairement ou qu'il en exige, mais il ne manque pas d'être puni comme un concussionnaire si le roi en est averti.
Comme ces travaux publics deviennent quelquefois insupportables à ces pauvres gens, il y en a qui aiment mieux se faire esclaves que de la continuer ainsi toute leur vie. Et voici de quelle manière ils s'en tirent : ils empruntent de l'argent de tous ceux qui veulent bien leur en prêter, et faute de paiement, ils se font mettre en prison par leurs créanciers qui ont droit de les y retenir jusqu'à ce qu'ils aient été payés de tout ce qu'il leur est dû. Le Nâi, qui voit son homme en danger d'y demeurer toute sa vie et de n'en pouvoir plus tirer aucun service, lui permet moyennant quelque petite somme d'argent de se vendre pour avoir de quoi payer ses dettes. S'il est fort et robuste ou s'il sait quelque métier, il vaut ordinairement cinquante ou soixante francs, mais il ne se vend jamais que sous la condition de se pouvoir racheter pour le même prix qu'il s'est vendu. Les pères mêmes, qui par les lois du royaume peuvent vendre leurs enfants, ne peuvent pas engager pour toujours leur liberté. Le maître qui les achète contracte une obligation tacite, mais indispensable, de la leur rendre toute et quantefois que le prix qu'il en a donné lui sera offert.
Il n'en va pas de même des enfants qui sont nés pendant l'esclavage de leurs pères, car ils ne peuvent jamais se racheter que du consentement de leurs maîtres. Il y en a peu qui le demandent, parce que ces esclaves de naissance, quand ils sont reconnus fidèles et affectionnés à leurs maîtres, sont souvent traités dans les familles avec autant de douceur et d'amitié que les enfants mêmes de la maison.
Comme les femmes sont obligées de nourrir leurs maris pendant les six mois qu'ils travaillent, elles ne sont point comme eux sujettes au service et elles s'occupent dans la maison du soin de la famille dont elles se trouvent seules chargées pendant tout ce temps.
Les tributs réels se tirent des douanes de toutes les marchandises qui entrent dans le royaume et de toutes les denrées qui se débitent dans les marchés. Les fruits, l'arec, le bétel et les bambous ne sont point exempts d'impôts, qui tout modiques qu'ils sont, ne laissent pas de rapporter tous les ans au roi des sommes très considérables. Il n'y a que le riz qui, comme le blé en France, en soit exempt. Pour chaque arbre de durillonDurian ou durion (Durio zibethinus). (6), qu'il ait du fruit ou qu'il n'en ait point, on doit payer tous les ans deux foüangs. S'il meurt, afin que le roi n'y perde rien, on est obligé d'en planter incessamment un autre et de payer la même somme dans la même année.
(6), qu'il ait du fruit ou qu'il n'en ait point, on doit payer tous les ans deux foüangs. S'il meurt, afin que le roi n'y perde rien, on est obligé d'en planter incessamment un autre et de payer la même somme dans la même année.

NOTES
1 - Au chapitre 10, Gervaise estimait le fouang à 4 sols 2 deniers. Il fallait douze deniers pour faire un sol. ⇑
2 - Les mirous, ou dans certaines relations mirons, étaient de petits bateaux à rames réservés aux trajets côtiers. Robert Lingat (Une note de Véret sur la révolution siamoise, T'oung Pao vol. XXXI, 1934, p. 360), qui note que les Anglais écrivaient meruah ou merua, suggère que ce mot pourrait avoir une étymologie siamoise, de mi rua (มีเรือ) : Il y a un bateau (ou des bateaux). ⇑
3 - Seuls les Phrai luang (ไพร่หลวง), les roturiers placés sous l'autorité du roi, étaient astreint à ces corvées. Encore pouvaient-ils s'en affranchir en acquittant une contrepartie en espèce ou en nature. Voir le chapitre 10 note 1. ⇑
4 - Bao (บ่าว), domestique, laquais. ⇑
5 - Nai (นาย) est un préfixe utilisé pour un chef, seigneur, maître, patron, etc. On peut également l'employer comme pronom dans le sens de vous lorsqu'on s'adresse à un supérieur. Le chef des ouvriers s'appelle nai ngan (นายงาน). ⇑
6 - Le fruit appelé durion, ou durian. Sur cette taxe, La Loubère avance le chiffre de 2 mayons, soit un demi-tical (baht), c'est-à-dire le double de ce qu'indique Gervaise. Par ailleurs, La Loubère déroule une liste d'impôts et de taxes qui va bien au-delà du simple durion : sur les terres labourables, sur les bateaux, en fonction de leur longueur, de leur largeur et de leur capacité, sur l'eau-de-vie, sur le bétel et l'arec, sur le jeu, sur les cocotiers, les orangers, les manguiers, les mangoustaniers, les pimentiers, etc. (Du Royaume de Siam, I, 1691, p.357 et suiv.) ⇑

5 mars 2019
