

Troisième chapitre.
De la guerre de Cambodge et de l'intérêt qu'y prend aujourd'hui le roi de Siam (1).
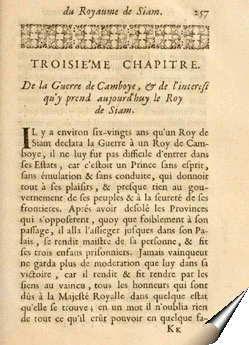
Il y a environ six-vingts ans qu'un roi de Siam déclara la guerre à un roi de Cambodge (2). Il ne lui fut pas difficile d'entrer dans ses États, car c'était un prince sans esprit, sans émulation et sans conduite, qui donnait tout à ses plaisirs et presque rien au gouvernement de ses peuples et à la sûreté de ses frontières. Après avoir désolé les provinces qui s'opposèrent, quoique faiblement, à son passage, il alla l'assiéger jusque dans son palais, se rendit maître de sa personne et fit ses trois enfants prisonniers. Jamais vainqueur ne garda plus de modération que lui dans sa victoire, car il rendit et fit rendre par les siens au vaincu tous les honneurs qui sont dus à la majesté royale dans quelque état qu'elle se trouve ; en un mot il n'oublia rien de tout ce qu'il crut pouvoir en quelque façon le consoler de sa mauvaise fortune, mais il n'eut pas la consolation de le mener jusqu'à Siam car ce prince, plus touché de la privation de ses plaisirs que de la perte de sa couronne, quoiqu'il fût déjà dans un âge fort avancé, s'affligea tellement qu'il en mourut en chemin. Nac-Cesta, Nac-Barachia et Nac-Protien, ses trois fils, suivirent le vainqueur à Siam, qui les y traita toujours fort honnêtement. Il leur donna même de quoi subsister à sa cour, d'une manière proportionnée à la grandeur de leur naissance, jusqu'à ce que trois gouvernements assez éloignés les uns des autres, ayant vaqué presque en même temps par la mort des mandarins qui en avaient été pourvus, il eut la générosité d'en gratifier ces trois princes ; il crut le pouvoir faire sans rien hasarder, car après avoir réduit sous son obéissance tout le royaume de Cambodge, il avait eu la précaution avant que d'en sortir, d'établir pour gouverneur des provinces et des villes principales des gens affidés et d'une probité reconnue ; et afin de les engager par leurs propres intérêts à lui être fidèles, il leur en avait généreusement accordé la propriété, à la charge seulement de quelques légers tributs qu'ils s'obligèrent de lui payer par chacun an ; d'ailleurs ses troupes avaient fait tant de dégâts dans tous les endroits par où elles avaient passé, et la terreur qu'elles y avaient répandue avait fait tant d'impression sur les esprits des peuples, qu'il n'y avait pas d'apparence que l'envie leur prît sitôt de se révolter ; en effet, il auraient toujours vécu en paix et parfaitement satisfaits de leurs gouverneurs qui les traitaient fort humainement, et ils n'auraient peut-être jamais pensé à faire remonter sur le trône l'ancienne famille des rois de Cambodge si la mort imprévue du roi de Siam ne leur en eut fait naître l'occasion. Nac-Cesta qui en reçut les premières nouvelles, s'en réjouit et résolut d'en profiter. Il en donna avis à ses frères qui le vinrent trouver secrètement dans son gouvernement ; là, il fut arrêté entre eux qu'ils dépêcheraient incessamment quatre de leurs plus fidèles amis à Cambodge, pour y sonder les esprits des peuples et pour tâcher de faire entrer dans leurs intérêts les gouverneurs de provinces qu'ils savaient avoir reçu depuis peu de temps quelque mécontentement du défunt roi de Siam. Leur négociation fut plus heureuse qu'ils n'avaient osé l'espérer, car en très peu de jours il tirèrent des assurances que Nac-Cestat serait très bien reçu dans Cambodge et qu'il ne tiendrait qu'à lui de s'y faire proclamer roi ; la seule difficulté qui restait à ces princes était celle de s'échapper sans qu'on s'en aperçut, car il n'y allait pas moins que de leur tête s'ils eussent été découverts. Pour rendre leur fuite plus secrète, ils partirent la nuit accompagnés de quelques-uns de leurs amis qui voulurent bien suivre leur bonne ou mauvaise fortune. Les forêts qu'ils gagnèrent le plus diligemment qu'il leur fut possible les mirent bientôt à couvert et hors d'état d'appréhender d'être poursuivis. Enfin ils arrivèrent heureusement à Cambodge et les mesures qui avaient été prises pour les y faire bien recevoir se trouvèrent si justes que Nac-Cesta, peu de jours après son arrivée, fut publiquement proclamé roi et reçut le serment de fidélité de tous les gouverneurs des provinces. Les Siamois, qui n'apprirent la fuite de ces princes que lorsqu'il n'était plus temps de l'empêcher, rentrèrent en eux-mêmes et commencèrent d'appréhender les suites qu'elle pourrait avoir s'ils ne s'accommodaient entre eux, car la mort du roi avait allumé dans le royaume une guerre civile qui l'exposait en proie à tous ses ennemis. Les États s'assemblèrent ; la paix y fut proposée et toutes les parties intéressées étant demeurées d'accord des conditions, il fut enfin résolu que l'on préviendrait le roi de Cambodge par des courses que l'on ferait incessamment sur ses terres avant qu'il eût le temps de s'affermir sur son trône. Il en fut averti et se sentant en effet trop faible encore pour pouvoir résister aux forces d'un si grand royaume prêtes à fondre sur lui, il envoya des ambassadeurs au roi de la Cochinchine pour implorer son secours et pour demander en mariage quelqu'une des princesses de son sang. Ce prince qui avait l'âme grande, et qui par les glorieuses victoires qu'il venait de remporter sur le Tonkin s'était acquis beaucoup de crédit et de réputation dans les Indes, se fit un honneur d'accorder au roi de Cambodge tout ce qu'il lui demandait. Il lui donna pour femme une de ses filles naturelles et il fit escorter les coffres pleins d'or et d'argent qu'il lui envoya pour sa dot par quatre ou cinq compagnies de ses plus braves soldats. À peine ces troupes furent-elles arrivées que Nac-Cesta se vit dans la nécessité de s'en servir sans pouvoir leur donner le temps de se reposer, car les Siamois étaient déjà venus par mer et par terre assiéger Cambodge. Il se mit donc en campagne à la tête de ses troupes cambodgiennes et il laissa à la reine sa nouvelle épouse la conduite des Cochinchinoises. Cette courageuse princesse les ayant fait monter avec elle sur ses vaisseaux, alla le sabre à la main affronter l'armée navale de Siam ; le choc fut rude et le combat dura fort longtemps, mais enfin la victoire se rangea du côté de la reine, et elle donna la chasse à la flotte siamoise pendant que le roi son époux mit sur terre l'armée ennemie en déroute, et qu'il la força de rentrer honteusement dans son pays.
Le malheur voulut qu'il n'eut point d'enfant de cette grande princesse et qu'il ne laissa en mourant après avoir régné quinze ans, que deux fils qu'il avait eu d'une de ses concubines. Comme Nac-Channe, et Nac-Ché (c'est ainsi qu'ils se nommaient) étaient encore trop jeunes pour pouvoir gouverner le royaume, la régence en fut donnée à Nac-Barachia, leur oncle. Il s'en trouva si bien, que ne pouvant plus se résoudre de rendre à l'aîné de ses neveux la couronne qu'il n'avait reçue qu'en dépot, il prit le dessein de se la conserver par sa mort ; mais il ne put pas si bien le cacher que la princesse qui était d'une pénétration d'esprit surprenante, n'en découvrît quelque chose. Elle avertit Nac-Channe de se tenir sur ses gardes. Le prince, ouvrant les yeux sur le péril qu'il courait, en fut effrayé et crut qu'il était de la prudence de prévenir le coup dont il était menacé. Il eut été dangereux de le faire à force ouverte, parce que comme le traître avait toujours beaucoup ménagé le peuple pendant les dix années de sa régence, il en était extrêmement aimé. Il fallut donc en venir aux dernières extrémités et prendre les seules voies qui lui restaient pour sauver sa vie ; l'ordre fut donné à deux pages de sa chambre d'attendre le régent au bout d'une petite galerie fort obscure, par laquelle il passait ordinairement dans son appartement quand il sortait le soir de celui de Nac-Channe, et là, de l'assassiner sitôt que le prince leur en aurait donné le signal en soufflant les flambeaux et frappant du pied contre le plancher de sa chambre. Les choses se firent comme elles avaient été concertées, mais elles ne purent pas se faire sans beaucoup de bruit. Les gardes s'éveillèrent et crièrent aux armes. Le peuple acccourut en foule au palais, et comme il ne doutait point que Nac-Channe n'eut été l'auteur de cet assassinat, il en aurait forcé les portes pour l'en tirer et le mettre en pièce si la reine, pour qui le peuple était prévenu d'un profond respect et d'une très grande confiance, n'eut paru à la fenêtre pour l'apaiser. Elle lui représenta l'intérêt sensible qu'il avait d'avoir pour roi un légitime héritier de la couronne et non point un usurpateur et un traître qui avait voulu tremper ses mains dans le sang du fils de son roi ; que Nac-Channe était un prince généreux qui ne voulait monter sur le trône que pour être plus en état de faire du bien à tous ses sujets, et qu'elle se rendait elle-même caution de cette bonne volonté. Qu'il avait déjà donné des marques assez éclatantes de sa valeur et de son courage pour leur faire croire qu'il n'avaient point d'ennemis, point de Siamois qu'ils dussent craindre pendant qu'il serait à leur tête pour les défendre, et que pour leur conserver la gloire des victoires qu'ils avaient remportées sous la conduite du roi son père. Vous devez cette justice, ajouta-t-elle, au sang et à la mémoire de cet illustre défunt qui vous a toujours tant aimé ; vous la devez au repos de l'État et vous ne pouvez pas la refuser aux prières d'une reine qui ne vous demanderait pas encore aujourd'hui pour Nac-Channe cette couronne qui lui appartient par le droit de sa naissance, si sa vertu et l'amour qu'il a pour vous ne l'avait déjà rendu digne de la porter.
À peine eut-elle achevé ce discours avec cette grâce et cette éloquence qui lui étaient naturelles que le peuple s'écria vive Nac-Channe et qu'il fut à l'heure même proclamé roi à la porte de ce même palais où on était venu le chercher pour le poignarder. Il régna vingt-cinq ans, mais son règne ne fut pas heureux, car il fut presque toujours traversé par les factions des cinq enfants que le régent avait laissé en mourant, lesquels ne cessèrent de chercher les moyens de venger la mort de leur père. L'aîné de tous qui s'appelait Nac-Prachoufa y parut moins échauffé que les autres ; comme il était déjà fort avancé dans les charges, il crut, après y avoir bien pensé, qu'il était de la prudence de sacrifier son ressentiment à sa fortune, et qu'il devait pour l'établissement de sa famille s'attacher plutôt aux intérêts de Nac-Channe que de demeurer dans le parti de ses frères, qu'il voyait bien être trop faible pour pouvoir se soutenir encore longtemps. Le roi qui n'avait point d'enfants, pour l'engager de plus en plus à lui être fidèle, lui fit l'honneur d'adopter son fils Nac-Non et de le déclarer l'héritier présomptif de sa couronne. La jalousie qu'en eurent ses frères les jeta dans le désespoir et leur fit prendre la résolution d'attaquer Nac-Channe à force ouverte. Nac-Prachoufa fit dans cette occasion si délicate tout ce que la reconnaissance de tant de bienfaits reçus de son souverain et la fidélité qu'il lui avait juré exigeaient de lui. Il prit les armes contre ses frères, et ne se sentant pas assez fort pour se défendre contre eux, sans en parler à la princesse reine avec qui le roi Nac-Channe s'était depuis quelque temps brouillé mal à propos, il écrivit en son nom au roi son père pour lui demander du secours. Deux cents hommes bien choisis et des mieux aguerris lui furent envoyés par le roi de la Cochinchine, et ils arrivèrent aussitôt pour se joindre aux troupes de Nac-Prachoufa, qui se mettant à leur tête, marcha droit contre les rebelles, lesquels se sentant trop faibles pour lui pouvoir résister en face, se contentèrent de se battre en retraite, et après quelques légères escarmouches, furent sagement se cacher dans l'épaisseur des forêts. Nac-Prachoufa eut la hardiesse de les y poursuivre, nonobstant le danger qu'il pouvait courir d'y être enveloppé et d'y périr avec toute son armée. Il fut assez heureux pour les joindre et pour les combattre dans une plaine assez étendue, qui se trouva par hasard au milieu des forêts. Mais il ne lui fut pas si aisé qu'il l'avait pu croire de les vaincre, car ils lui disputèrent fort longtemps le champ de bataille, et quand ils se virent forcés de le céder au plus grand nombre, ils se retirèrent en bon ordre dans de plus épaisses forêts où ils savaient bien que Nac-Prachoufa n'aurait jamais la témérité de les venir attaquer. Là ils tinrent conseil de guerre, et il fut résolu entre eux que les deux plus jeunes des quatre frères iraient implorer la protection du roi de la Cochinchine, car ils ne savaient pas encore qu'il était entré dans les intérêts de leur ennemi. Ils équipèrent le mieux qu'ils purent une longue barque qu'ils trouvèrent sur le rivage. Nac-Tam et Nac-Pane cinglèrent dessus en pleine mer, mais il faut bien qu'ils aient péri en chemin, car depuis leur départ de Cambodge on n'a point encore reçu de leurs nouvelles. Les deux autres frères qui étaient demeurés dans leurs retranchements, ennuyés de les y attendre, cherchèrent d'autres moyens de se défendre contre leur aîné. Ils avaient appris que la reine était mal avec le roi, qu'elle était indignée de ce que, contre sa volonté, il s'était fait mahométan, et de ce qu'il avait honteusement violé le droit des gens en faisant massacrer par le conseil de quelques Malais qui l'avaient engagé dans leur secte, l'ambassadeur du roi son père. cela leur donna sujet d'espérer que cette princesse, qui d'ailleurs était naturellement généreuse et bienfaisante, ne leur refuserait peut-être pas le secours qui leur était si nécessaire. Nac-Protien se chargea du soin de cette dangereuse négociation, il vint incognito la trouver chez elle, et s'étant jeté à ses pieds, il sut si bien la persuader de la justice de sa cause,qu'elle lui promit d'écrire en sa faveur au roi son père. Son voyage fut plus heureux qu'il ne l'avait espéré, car comme il était un des hommes des mieux faits et des plus spirituels de son temps, la reine s'en aperçut et elle eut le cœur assez tendre pour être touchée de son mérite, de sorte que ce fut plutôt par la force de l'inclination qu'elle sentit pour ce prince que par l'aversion qu'elle eut pour Nac-Channe qu'elle voulut l'adopter pour son fils, avant qu'il la quittât pour retourner à son camp. Elle eut bien souhaité le retenir plus longtemps auprès d'elle, mais elle craignit encore plus que lui qu'il ne fût découvert à la cour et que les ennemis qu'il y avait ne lui fissent acheter trop chèrement le plaisir qu'elle avait eu de le voir.
À peine fut-il retourné dans les forêts, où son frère l'attendait avec une extrême impatience, qu'il apprit que le roi de la Cochinchine avait envoyé à la reine sa fille, mille hommes des plus braves de ses troupes sous la conduite d'un vieux capitaine des plus expérimentés de son temps ; qu'à leur arrivée dans le royaume de Cambodge ils s'étaient saisis par adresse des postes les plus avantageux et par force des personnes qu'ils avaient cru les plus capables de traverser leurs desseins ; que le roi s'était enfui à la première nouvelle qu'il avait reçue de leur descente sur ses terres et qu'il était temps qu'il vînt lui-même faire valoir l'occasion que sa bonne fortune lui présentait de monter sur le trône. Il n'en fallut pas davantage pour l'obliger de quitter son méchant poste. Il s'approcha secrètement de la ville de Cambodge où il trouva ses affaires dans un meilleur état qu'il ne pensait, car ce vieux capitaine, suivant l'ordre qu'il avait reçu du roi son maître, avait toujours, en attendant ce prince, assemblé les États du royaume et les avait fait déjà consentir à trois choses : la première que Nac-Protien serait déclaré roi ; la deuxième que la reine partagerait avec lui le gouvernement du royaume ; et la troisième, que l'on irait incessamment à la quête de Nac-Channe pour le mettre en lieu de sûreté et hors d'état de pouvoir jamais troubler la paix de ses peuples. Ce qui avait été résolu en l'absence du prince fut exécuté sitôt qu'il parut, et les troupes cochinchinoises, qui avaient eu commission d'aller chercher Nac-Channe, le trouvèrent caché ans un vieux temple dont les ruines étaient encore en vénération parmi le peuple, parce qu'on tenait pour certain dans le pays qu'il avait été autrefois bâti par Alexandre le Grand. On le pria d'abord avec beaucoup de respect de venir prendre sa place dans l'assemblée des États où il était attendu pour délibérer d'une affaire qui lui était de la dernière conséquence. Mais se doutant bien de son malheur, il refusa de s'y trouver. Nac-Channe, lui dit hardiment un officier cambodgien, si vous n'y venez de bon gré, on vous y fera marcher de force. Alors ce prince se sentit si vivement touché de la réponse de ce sujet insolent qu'il eut toutes les peines du monde à retenir ses larmes. Il se mit à genoux, et levant les yeux et les mains au ciel, il lui demanda la vengeance de la perfidie de son peuple ; il le conjura entre autres choses de le rendre si misérable qu'il n'eût pas seulement de quoi couvrir sa nudité. Je ne sais point si Dieu en exauçant les prières de ce prince, tout infidèle qu'il était, a voulu marquer à tous les peuples de la terre l'obéissance qu'ils doivent à leurs souverains tels qu'ils puissent être, mais je sais bien que les Cambodgiens, qui étaient autrefois fort riches, se trouvent aujourd'hui réduits dans un état de pauvreté si déplorable qu'ils vont tout nus en tout temps, et que les plus accommodés d'entre eux ont à peine une aune de toile pour couvrir leur nudité.
Nac-Channe, qui pendant qu'on le conduisait à Cambodge avait eu le temps de se rassurer de ses craintes et de rappeler son courage, se présenta à l'assemblée des États avec une assurance qui fit trembler ses ennemis. Comme il était naturellement éloquent, il parla pour sa justification avec tant de force et d'énergie, qu'il fit rentrer dans ses intérêts la plus grande partie de ceux qui s'étaient ouvertement déclarés contre lui ; de sorte que le résultat de l'assemblée fut que Nac-Channe et Nac-Protien se rendraient incessamment auprès du roi de la Cochinchine, qui serait très humblement supplié de donner la couronne à celui des deux qu'il jugerait avoir le plus de droit d'y prétendre. Le premier s'y soumit avec joie, parce qu'il était persuadé de la justice de sa cause et de la sagesse de celui qui en devait être le juge. Mais Nac-Protien ne crut pas devoir mettre en compromis une affaire d'une si grande conséquence. Il laissa donc partir son compétiteur, qui fut très bien reçu à la cour de la Cochinchine ; ses prétentions y furent discutées avec toute l'exactitude qu'elles méritaient. Il se purgea du crime dont on l'accusait d'avoir fait assassiner l'ambassadeur du roi et enfin la couronne de Cambodge lui fut adjugée par le grand arbitre qui en devait décider. Afin de lui en assurer la possession, ce prince eut encore l'honnêteté de lui donner pour escorte quelques compagnies de ses meilleures troupes. Nac-Channe reprit dont le chemin de Cambodge, parfaitement satisfait de son voyage. Mais ayant voulu s'en réjouir en particulier avec plusieurs de ses amis qui étaient venus au-devant de lui jusqu'à Cyampa, il y but tant de raque qu'il en tomba malade et mourut deux jours après. Avant que de mourir, il déclara qu'il voulait que Nac-Cotrei son plus jeune cousin lui succédât à l'exclusion de Nac-Protien, qui par sa révolte, dit-il, avait troublé la paix du royaume et s'était rendu indigne de le gouverner par les malheurs dont il l'avait accablé. Il fit promettre au commandant des troupes cochinchinoises qu'il ferait publiquement cette déclaration sitôt qu'il serait arrivé à Cambodge. Cet officier satisfit à sa commission, mais Nac-Protien qui était en place s'en moqua, et soutint opiniâtrement en présence des États assemblés que cette disposition du défunt renversait l'ordre de la nature et donnait atteinte au droit d'aînesse qui résidait et devait être inviolable en sa personne. Les sentiments des États furent encore partagés, et il fallut avoir recours comme auparavant au roi de la Cochinchine qui les mit enfin d'accord en ordonnant que les deux frères partageraient le royaume par moitié, et que chacun d'eux posséderait en souveraineté la part et la portion qui lui serait échue par le sort. Le partage en fut fait et exécuté en très peu de temps. Tout le monde en fut satisfait et le peuple, que tous ces princes différents avaient beaucoup fait souffrir par leurs divisions, commença à respirer un air plus doux et à jouir pour un temps de cette paix qu'il avait tant désirée. Je dis pour un temps, car elle ne dura que peu de jours, et voici ce qui donna lieu à une nouvelle guerre qui ne fut pas moins cruelle que celles qui l'avaient précédée.
Nac-Protien avait deux fils, Nac-Cesta et Nac-Son, et une fille que l'on appelait Naé-Bene, qu'il maria à Nac-Sotechit son cousin germain. Le beau père et le gendre vécurent quelques mois ensemble dans une parfaite intelligence, mais ils se brouillèrent bientôt après pour un sujet qui n'en valait pas la peine. Nac-Sorechit se divertissait à nourrir chez lui des tourterelles ; il en avait une entre autres d'un plumage extraordinaire qui plut tant à Nac-Protien qu'il le pria de la lui donner. Ce prince eut la malhonnêteté de la lui refuser, et ce refus mit si fort en colère Nac-Protien contre lui que dès lors il prit dessein de s'en défaire. Nac-Bene, sa fille, fut assez heureuse pour le découvrir. Elle en avertit son mari qui prit ses précautions et se résolut de prévenir son ennemi. Il prit l'occasion d'une fête solennelle qui devait attirer ce jour-là Nac-Protien dans un temple pour y faire ses prières accoutumées. Quelques marchands chinois, à qui il avait promis et assuré une récompense de quatre mille cinq cents livres s'ils faisaient le coup, ne le manquèrent pas. Nac-Protien fut tué sur la place, au milieu de ses gardes qui n'osèrent pas seulement mettre le sabre à la main pour le défendre. Nac-Cotrei, qui en reçut les premières nouvelles, ne crut pas que sa vie fût trop en sûreté dans Cambodge après un assassinat de cette qualité. Il se déroba par la suite à l'ambition de ce prince qui sans doute ne l'aurait pas épargné, et par sa retraite il lui facilita les moyens de se rendre maître du reste du royaume. Ce tyran, pour s'en assurer la possession et donner en même temps à son usurpation quelque couleur de justice, s'imagina qu'il lui fallait épouser la femme de Nac-Cotrei qui n'avait pu suivre son époux dans la Cochinchine où il s'était réfugié. La princesse fit semblant d'agréer cette alliance, mais en effet elle ne donna la main à Nac-Sorechit qu'afin de pouvoir plus aisément venger la mort de son beau-frère, l'exil de son mari et les malheurs de sa patrie sur celui qui en était coupable. Elle le poignarda dans son lit la première nuit de ses noces, et en même temps elle dépêcha un courrier à Nac-Cotrei pour lui donner avis de ce qu'elle venait de faire en sa faveur, et un autre à Nac-Cesta fils de Nac-Protien, pour lui dire qu'il était temps qu'il vînt partager le royaume avec le prince son époux. Mais ce dernier au lieu de reconnaître le bon office qu'elle venait de lui rendre, ne vint que pour lui plonger dans le sein le même poignard dont elle venait de tuer son plus mortel ennemi.
Cependant, Nac-Cotrei revint de la Cochinchine, mais quand il apprit la mort de sa femme, il en eut tant de douleur qu'il se résolut de quitter le monde et de se faire talapoin. Il se retira donc dans une affreuse solitude éloignée du bruit des villes et du commerce de la cour, où il finit paisiblement ses jours. Quoiqu'étant dans cette solitude Nac-Cesta ne dût plus l'appréhender, il n'osa pourtant jamais paraître en public ni prendre la qualité de roi pendant qu'il le sut en vie, tant il était effrayé par l'image de son crime qui le suivait en tous lieux. Mais sitôt qu'il apprit sa mort, il assembla ses amis, et par leur crédit s'empara de tout le royaume. Il crut qu'il devait pour sa conservation demander l'agrément du roi de la Cochinchine qu'il savait bien n'avoir pas sujet d'être satisfait de lui, mais les riches présents qu'il lui envoya ne purent engager ce grand prince à rien faire contre la justice. Il adjugea à Nac-Cesta cette partie des États de Cambodge dont son père avait autrefois joui et donna l'autre moitié à Mac-Non fils de Nac-Prachoufa, dont nous avons déjà parlé dans le commencement de cette histoire.
Nac-Cesta, mal satisfait du roi de la Cochinchine, ne voulut pas s'en tenir au jugement qu'il avait rendu. Il déclara la guerre à Nac-Non qui s'en était bien douté, et qui pour pouvoir se défendre contre lui, avait déjà formé un parti très considérable dans le royaume. Ils se livrèrent plusieurs combats où il y eut même assez de sang répandu de part et d'autre. Mais l'égalité de leurs forces tint toujours la victoire en suspens, de sorte que Nac-Cesta mourut trois ans après sans qu'on pût dire qu'il ait été le vainqueur ou le vaincu. Il laissa pour son successeur Nac-Son qui était encore en bas âge. Sitôt que Nac-Non, qui était un fort bon prince, eut appris la mort de Nac-Cesta, il eut la générosité d'envoyer à son fils des présents très considérables et un grand nombre de talapoins pour faire avec plus d'honneur et de pompe les funérailles de son père. Mais ceux qui pendant la minorité de ce jeune prince gouvernaient le royaume en son nom, reçurent ces présents avec beaucoup de mépris et ils furent même assez lâches pour mettre à mort tous ces pauvres talapoins. Une action si inhumaine et si brutale alluma la guerre entre ces deux princes. Nac-Non ne se sentant pas le plus fort demanda le secours au roi de la Cochinchine, et Nac-Son se mit sous la protection du roi de Siam, qui lui envoya des troupes et lui fournit de l'argent. Les deux armées se joignirent et après un sanglant combat, le champ de bataille demeura à Nac-Son qui mit en fuite les Cochinchinois et força Nac-Non de se retirer avec eux dans la Cochinchine. Il ne jouit pas longtemps de la paix que cette grande victoire n'avait fait, pour ainsi dire, que prêter au royaume de Cambodge, car deux ou trois ans après, trois mille Chinois que le Tartare avait chassés de leur pays se vinrent joindre aux Cochinchinois et aux Cambodgiens qui avaient favorisé la retraite de leurs princes ; et Nac-Non s'étant mis à leur tête, vint fondre sur Nac-Son qu'il battit en plusieurs rencontres. Les troupes siamoises furent taillées en pièces par les siennes et le vaincu fut obligé de s'aller cacher dans l'épaisseur des forêts pour ne pas tomber entre les mains du vainqueur. Tout ce qu'il put faire dans cette extrémité fut de demander un nouveau secours au roi de Siam qui voulut bien encore hasarder cinq cents hommes de ses meilleurs troupes ; mais c'était trop peu pour pouvoir résister à un si grand nombre d'ennemis. Presque tous y perdirent la vie. Il est vrai que contre la coutume des naturels du pays, ils la vendirent plus chèrement qu'on n'avait espéré.
Ce sont-là les dernières nouvelles que l'on reçut à Siam de cette guerre de Cambodge lorsque j'y étais encore sur la fin de l'année 1685. Le roi se disposait, quand j'en partis, d'envoyer à ce prince un secours de dix-huit mille hommes par terre, et par mer une escadre de quatre ou cinq grands vaisseaux commandés par des Portugais et des Anglais, avec soixante grosses barques, à qui l'on a donné le nom de galères, sous la conduite des plus braves officiers siamois. On attend avec impatience le succès de cette grande entreprise.

NOTES
1 - La multiplication des noms, des surnoms et des titres honorifiques, souvent complètement déformés par les oreilles occidentales, les imprécisions de date et la complexité des alliances conclues, défaites et renouées, des usurpations et des trahisons dans un contexte de conflits endémiques entre les deux royaumes depuis au moins cinq siècles rendent ce chapitre particulièrement abscons. Nous nous sommes efforcés de lui donner un semblant de logique historique, mais nous restons conscients de ses failles et de ses incohérences. Nous avons trouvé de précieux renseignements dans les trois articles de Mak Phoeun et Po Dharma consacrés aux interventions militaires vietnamiennes au Cambodge publiés dans les Bulletins de l'École français d'Extrême-orient, tome 73 (1984), tome 77 (1988) et tome 92 (2005), - référencés ici Phoeun et Dharma I, II, et III - mais ne ne pouvons que souscrire à la remarque d'Henri Russier dans son Histoire sommaire du royaume de Cambodge (Saïgon, 1914, pp. 87-88) : À partir de ce moment [mort de Ponhea Chan, qui régna de 1642 à 1658 sous le titre de Ramadhipati 1er], l'histoire du Cambodge devient extrêmement confuse. La succession des rois est à peu près impossible à établir. On en compte parfois jusqu'à quatre à la fois, ayant chacun sa résidence et se partageant le pouvoir, sans parler des princes qui le leurs disputent. Un fait, du moins, apparaît très nettement dans cette histoire désormais si embrouillée, c'est que les princes cambodgiens, divisés entre eux, appellent à leur secours soit les Siamois, soit les Annamites, et que Siamois et Annamites se disputent le Cambodge comme une proie qu'ils s'arrachent l'un à l'autre, lambeau par lambeau. Et c'est pourquoi, à partir de cette date, l'histoire du Cambodge se réduit à l'histoire de son démembrement. ⇑
2 - Gervaise ayant écrit ces lignes au milieu des années 1680, les six-vingts ans nous renvoient vers les années 1560. On trouve trace dans l'histoire siamoise d'un roi captif mort sur le chemin d'Ayutthaya, ou plus tard en exil. Il s'agit de Reachea Ramathuppdey, prince Sri Raja, qui régna de 1468 à 1477. L'anecdote est relatée dans la peu rigoureuse Histoire du Cambodge depuis le 1er siècle de notre ére d'Adhémard Leclère (Paris, 1914, p.233) : Quand le roi de Siam eut passé la frontière, il ordonna une halte de trois jours. C'est au cours de cette halte que le roi Srey-Ramathipdey, qui refusait toute nourriture depuis son départ de Lovêk et qui ne voulait plus se baigner, tomba malade et mourut de tristesse et de faim. Le roi de Siam le fit mettre dans un cerceuil qu'on emporta et donna à son fils, ponhéa Ongk qu'il avait adopté, le nom de préah Sauphan-réachéa qui était le titre que portait au Siam le fils aîné du roi. Plus tard, il le nomma gouverneur de Suvannakalok (Svarga-loka ?) et lui donna sa propre fille pour première épouse. On est toutefois là près d'un siècle avant les six-vingts ans évoqués par Gervaise. La conclusion de Aymonier s'impose par son bon sens (Le Cambodge, II, 1904, p.759) : Nicolas Gervaise, qui écrivait un siècle après ces événements et qui place cette invasion siamoise vers 1560, relate que le roi du Cambodge et ses enfants furent pris avec la capitale que le roi fut bien traité par le vainqueur, mais mourut en captivité, que ses trois enfants reçurent des gouvernements de provinces au Siam, prirent plus tard la fuite et retournèrent dans leur pays. Bref, les détails que cet auteur donne par ouï-dire ne sont rien moins que certains, ils remontaient trop loin. ⇑

5 mars 2019
